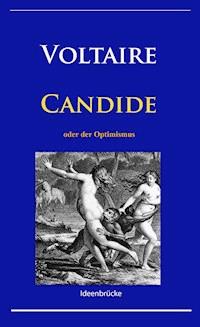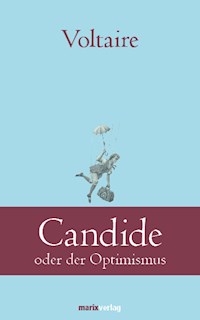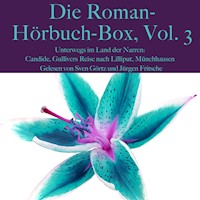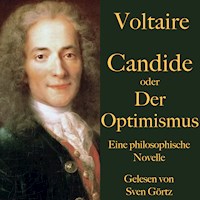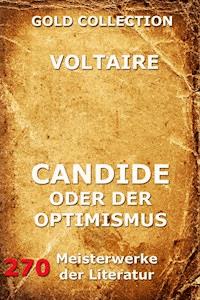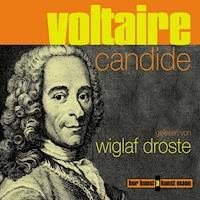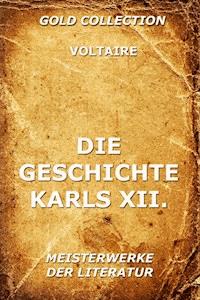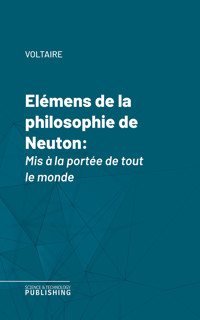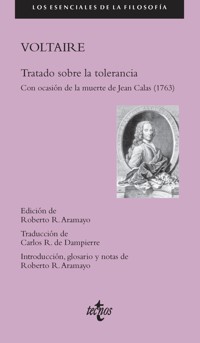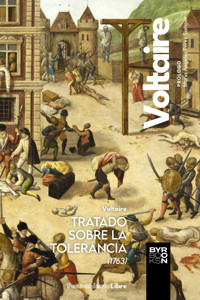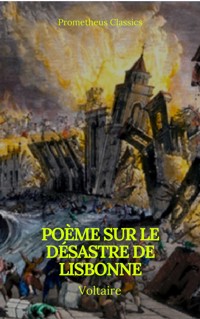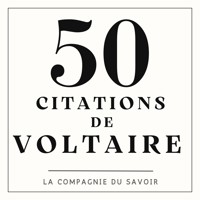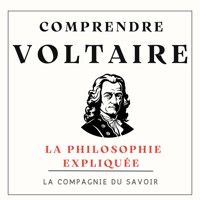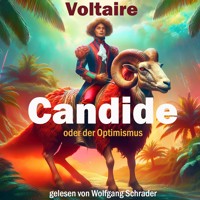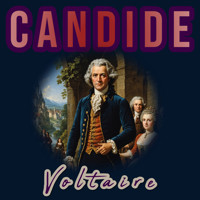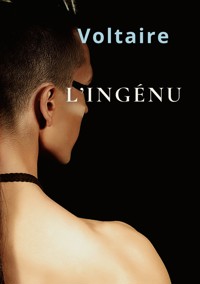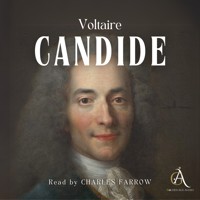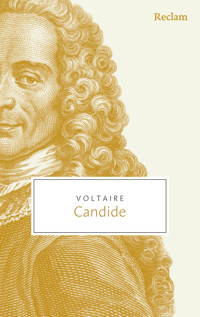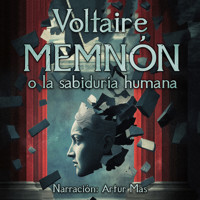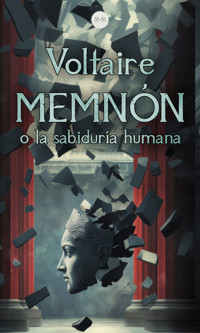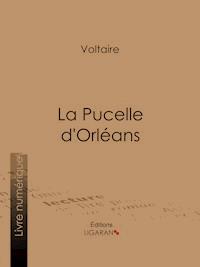
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je ne suis né pour célébrer les saints : Ma voix est faible, et même un peu profane. Il faut pourtant vous chanter cette Jeanne, Qui fit, dit-on, des prodiges divins. Elle affermit, de ses pucelles mains, Des fleurs de lis la tige gallicane, Sauva son roi de la rage anglicane, Et le fit oindre au maître-autel de Reims. Jeanne montra sous féminin visage, Sous le corset et sous le cotillon, D'un vrai Roland le vigoureux courage."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335091236
©Ligaran 2015
C’est d’après Voltaire lui-même que les éditeurs de Kehl disent que la Pucelle fut composée vers 1730. Ce n’est pas donner une époque bien précise, et l’on peut tout aussi bien dire que le poème était au moins commencé en 1726, et même en 1725. Voltaire écrivait à Tressan, le 9 décembre 1726 : « Il y a dix ans que je refuse de laisser prendre copie d’une seule page du poème de la Pucelle. » Dix-neuf ans après, il disait à d’Argental que c’était « une vieille plaisanterie de trente ans ».
Dans une lettre à Formont, que l’on croit de juin 1734, il est honteux d’avoir tant avancé un ouvrage si frivole. C’était le moment où les Lettres philosophiques venaient d’être condamnées, et il ne manifestait aucune crainte des indiscrétions qui plus tard lui causèrent tant de chagrin. Cependant il n’y avait encore que huit chants de composés au commencement de 1735 ; au milieu de la même année, le neuvième chant était fait.
Malgré ce qu’il dit dans sa lettre à Tressan, il avait communiqué très légèrement plusieurs chants à quelques amis et à de grands personnages. Lors des persécutions dont il fut l’objet en 1736, pour la satire du Mondain, Mme du Châtelet ne se borna pas à lui recommander plus de réserve et de prudence dans les communications des chants de la Pucelle, elle s’empara de tout ce que l’auteur avait en manuscrit, et ne voulut « pas s’en dessaisir ». Voltaire se trouva ainsi hors d’état de donner copie de son poème à Frédéric, alors prince royal. C’était le temps de toute la ferveur de l’amitié entre ces deux grands hommes.
Il n’y avait alors que dix chants de composés. On croit qu’un onzième le fut en 1738.
Frédéric était roi depuis trois ans lorsqu’il écrivit à Voltaire qu’il était possesseur de six chants. Trois ans après, toujours retenu par Mme du Châtelet, Voltaire s’excusait auprès du monarque de n’avoir pu lui remettre tout ce qui était composé. Dans les premiers mois de son séjour à Berlin, en 1750, il satisfit enfin les désirs de Frédéric. La copie qu’il lui offrit était de la main de Tinois, son secrétaire, qui en fit en même temps une copie furtive pour le prince Henri, et fut congédié dès que son maître eut connaissance de cette infidélité.
S’il faut en croire Colini, un quatorzième chant fut composé à Potsdam en 1752 ; et le quinzième commencé en février 1753, au milieu des dégoûts dont l’auteur était abreuvé à la cour de Prusse. Lorsqu’il fut arrêté à la porte de Francfort, il tira d’un portefeuille quelques papiers et les remit à Colini, en lui disant : « Cachez cela sur vous. » Colini les cacha dans le vêtement qu’un auteur ingénieux a nommé le vêtement nécessaire. Lorsqu’il examina le précieux dépôt, il vit que c’était tout ce que Voltaire avait fait de son poème.
En 1754, les copies étaient multipliées tellement que Voltaire regardait l’impression comme inévitable, et comme « une bombe qui devait crever tôt ou tard pour l’écraser ». Ces inquiétudes étaient prématurées. Elles redoublèrent en 1755, et il prit le parti de faire écrire par Mme Denis au lieutenant général de police à Paris, pour le prier de faire des recherches : elles n’aboutirent à rien, ainsi qu’on le voit par le rapport de d’Hémery, inspecteur de police, en date du 19 juin 1755. Mal disposé contre Voltaire, d’Hémery croit que l’impression n’aura lieu que du consentement de l’auteur. Dans un second rapport, du 24 juillet, il signale la quantité de manuscrits qui sont à Paris dans les mains d’amis ou de connaissances de Voltaire ; « entre autres M. d’Argental, Mme de Graffigny, le sieur Thieriot, Denis, Mme la comtesse de La Marck, M. le duc de La Vallière, qui n’aura sûrement pas manqué d’en donner une expédition à Mme la marquise ».
Cette marquise est Mme de Pompadour, à qui Voltaire en avait adressé une copie à la fin de juin, ou au commencement de juillet. Quant au duc de La Vallière, il lui en avait aussi adressé un manuscrit vers le même temps. Mais ce riche amateur avait très bien pu s’en procurer un auparavant ; il en avait du moins marchandé un, dont on lui demandait cinquante louis.
C’est sur un manuscrit divisé en quinze chants que Darget avait fait à Vincennes, en mai 1755, une lecture de la Pucelle à quelques personnes. Cependant la lettre à d’Argental, du 6 février 1755, parle d’un dix-neuvième chant, qui était entre les mains de Mlle du Thil, anciennement au service de Mme du Châtelet. Ce dix-neuvième chant, sur lequel je reviendrai, était donc composé avant la mort de Mme du Châtelet.
La police, continuant ses recherches, soupçonna un abbé de La Chau, ancien habitué de l’hôpital, et brouillé avec l’archevêque, d’avoir vendu des copies manuscrites. De semblables soupçons s’élevaient contre le chevalier de La Morlière.
Au milieu de tous ces ennuis, Voltaire lui-même multipliait les copies. Ce n’était pas seulement à Mme de Pompadour et au duc de La Vallière qu’il en envoyait ; il en promettait une à Formont, tout en renouvelant ses plaintes sur leur multiplication. En même temps il recommandait à Mme de Fontaine de faire copier son poème, et de se faire rembourser par son notaire Delaleu les frais de copie. Il n’était pas étonnant que les manuscrits devinssent à bon marché. On en avait offert à Ximenès pour cinq louis, et Colini dit qu’on en avait pour un louis.
Il est assez naturel de penser que les copies envoyées par Voltaire à Mme de Pompadour, au duc de La Vallière, etc., étaient toutes conformes à l’ouvrage tel qu’il voulait l’avouer.
Palissot, qui alla aux Délices en octobre 1755, et qui s’est trouvé ainsi en position de voir ou d’apprendre bien des choses, dit que Voltaire « imagina d’employer à Paris même un grand nombre de copistes occupés jour et nuit à répandre dans le public des manuscrits de la Pucelle. Tous ces manuscrits différaient les uns des autres ; tous étaient plus ou moins chargés de vers détestables, ou de turpitudes révoltantes, que lui-même y faisait insérer à dessein. L’empressement qu’on avait de jouir de ce poème, quelque défectueux qu’il pût être, faisait acheter toutes ces copies. Chacun se flattait d’avoir la meilleure… Il n’était guère de société qui n’eût son manuscrit.
Ce singulier moyen de défense, qu’on ne peut guère reprocher à un vieillard menacé d’une persécution si cruelle, lui paraissait un prétexte plausible pour désavouer hautement un ouvrage qui semblait être devenu l’objet des spéculations d’une foule de corsaires. »
Si des additions de vers grossiers, défectueux, bizarres, étaient nécessaires, il n’était pas moins important de faire des suppressions. Je possède quatre manuscrits du poème de la Pucelle : j’en ai vu beaucoup d’autres, et je n’y ai pas trouvé les vers du chant II (voyez page 46) qu’on appliquait à Mme de Pompadour :
Ces vers ne sont pas non plus dans les premières éditions, de 1755.
Il en est de même de l’hémistiche du chant quinzième sur Louis XV :
On se demande si des éditeurs qui auraient fait de tels vers ne pouvaient pas ailleurs être aussi bien inspirés. Mais s’il leur était impossible de prendre la manière de Voltaire, il lui était très facile de faire des vers ridicules ou répréhensibles sous divers rapports.
Je suis d’autant plus porté à adopter l’opinion de Palissot, que des vers cités par Voltaire, et signalés par lui comme affreux, ne se trouvent dans aucune des éditions ni dans aucun des manuscrits que j’ai vus. Voltaire, que le fanatisme voulait arracher de son asile, sans lui en laisser aucun autre, devait tout employer pour faire échouer le projet de ses ennemis. Aussi écrivait-il à d’Argental : « Il n’y a pas de parti que je ne prenne, ni de dépense que je ne fasse très volontiers, pour supprimer ce qu’on fait courir sous mon nom avec tant d’injustice. » Voltaire ne pouvait avoir l’idée d’anéantir tous les manuscrits. Il savait depuis longtemps qu’il existait « trop de copies de cette dangereuse plaisanterie ». Il voulait donc parler du singulier moyen de défense révélé par Palissot.
Il est probable toutefois que quelques vers, omis ou estropiés par les copistes, ont été rétablis ou corrigés par les premiers éditeurs. Il est possible même qu’ils aient méchamment changé ou défiguré des vers ou des passages ; mais leur part ne me paraît pas facile à faire, et ne doit pas être bien grande.
Grasset, libraire de Lausanne, était venu, le 26 juillet 1755, offrir à Voltaire de racheter cinquante louis un manuscrit dont l’impression était commencée, et dont il montra une feuille manuscrite. Mis en prison, Grasset avoua qu’il tenait cette feuille de Maubert ; ce capucin défroque, interrogé à son tour, répondit qu’il l’avait reçue de Lausanne. Les magistrats de Genève conseillèrent à Grasset « de vider la ville », et déclarèrent à Maubert qu’on s’en prendrait à lui si la Pucelle était imprimée. Maubert et Grasset, sortis de Genève, n’avaient qu’à se moquer des magistrats.
À la fin d’octobre, Voltaire apprit que la Pucelle était imprimée. L’édition que je crois la première est intitulée La Pucelle d’Orléans, poème divisé en quinze livres, par M. de V***, Louvain, 1755, in-12 de 161 pages, plus le faux titre, le titre, et une préface de deux pages. Sur le faux titre, on lit seulement : La P… d’O…, poème divisé en quinze livres. Le volume finit par trois lignes de points, et ces mots : Cætera desusnt.
Dans sa lettre à l’Académie française, de novembre 1755, Voltaire dit l’édition faite à Francfort, quoiqu’elle soit annoncée de Louvain ; il parle même de deux autres éditions exécutées, dit-il, en Hollande.
L’existence des réclames au bas de chaque page indique une impression faite hors de France. Je n’ai pas la témérité de contredire l’assertion de Voltaire sur Francfort ; mais, en quelque lieu que cette édition ait été faite, je crois qu’on la doit au capucin Maubert. C’est à lui que Voltaire a toujours persisté à en faire honneur, si honneur y a ; c’est à lui seul qu’il s’attache dans une phrase ajoutée, en 1773, à une note de la Préface de dom Apuleius Risorius, et dans une note ajoutée, la même année, au chant XXI.
Les quinze chants de l’édition de 1755 sont aujourd’hui les I, II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XX et XXI (sauf variantes considérables pour ces deux derniers).
Il serait fastidieux pour la plupart des lecteurs, et plus difficile encore, de donner une liste complète des éditions de la Pucelle. Je ne parlerai donc que de quelques-unes.
La Pucelle d’Orléans, poème divisé en quinze livres, par M. de V***, Paris, 1756, petit in-12 de IV et 198 pages. Le frontispice est orné d’un portrait de Voltaire couronné de lauriers, avec cet exergue : Père des poètes. Pour le texte, elle ne diffère pas de l’édition de 1755. Seulement le quinzième chant n’est pas terminé par des points, et se trouve ainsi donné pour complet.
La Pucelle d’Orléans, poème héroï-comique, nouvelle édition, sans faute et sans lacune, augmentée d’une épître du P. Grisbourdon à M. de Voltaire, et un jugement sur le poème de la Pucelle à M. ***, avec une épigramme sur le même poème, en dix-huit chants ; Londres, 1756, in-32 de ij et 240 pages.
Les chants VIII et XI de 1755 forment, dans l’édition de 1756, les chants VIII et IX, XII et XIII. Le chant de Corisandre y est imprimé pour la première fois, toutefois avec les dix-neuf premiers vers du chant XV de 1755, qui sont aujourd’hui en tête du chant XXI. Le chant XVIII, dont un fragment de 155 vers formait le chant XV en 1755, est en entier dans l’édition de 1756, tel qu’on le lit aujourd’hui dans les variantes du chant XXI ; et il y a 329 vers, quoique n’ayant qu’un prologue de 12 vers, au lieu des 34 premiers de l’édition de 1755. Cette édition est donc la première où le chant de l’âne soit complet. Ce chant devait être désavoué par l’auteur ; mais ce désaveu, commandé par les circonstances, ne fait pas autorité pour tout le monde, quand on se rappelle que Voltaire, dans une lettre à d’Argental, parle du chant de l’âne, et craint qu’on ne l’imprime tel que vous l’avez vu d’abord, et non tel que je l’ai corrigé depuis. D’Argental était le seul qui eût eu copie de ce malheureux chant… Le roi de Prusse n’a jamais eu ce maudit chant de l’âne de la première fournée ; mais Mlle du Thil, qui avait été femme de chambre de Mme du Châtelet, avait une copie de ce chant, que Voltaire lui-même appelle intolérable.
Il est évident que, dès 1749, et conséquemment bien longtemps avant que l’on pût supposer à des éditeurs l’intention de dénaturer la Pucelle, il existait un chant que réprouvait l’auteur après l’avoir composé. Lorsqu’il fut publié, les altérations faites par les éditeurs durent consister tout au plus en quelques interpolations et quelques inexactitudes.
Outre le chant XIV (Corisandre) et le complément du dernier chant, cette édition de 1736 contient çà et là diverses augmentations. Elle est la première qui contienne les vers sur Mme de Pompadour, et le fameux hémistiche sur Louis XV.
Cette édition mérite d’être distinguée entre toutes celles qui ont précédé celle de 1762, la première qu’ait avouée l’auteur.
Voltaire accusait d’abord La Beaumelle de l’avoir donnée. Peu de temps après, c’était sur La Beaumelle et d’Arnaud que portaient ses soupçons. Mais il ne tarda pas à reconnaître qu’on l’avait trompé, du moins quant à d’Arnaud. D’Alembert disait qu’on attribuait l’édition à Maubert ; et Voltaire, tout acharné qu’il était contre La Beaumelle, paraît s’être rendu à l’opinion de d’Alembert, si l’on en juge d’après ce qu’il écrivait dans les deux notes qu’il ajouta en 1773, et dont j’ai parlé à la page précédente.
La Pucelle d’Orléans, poème héroï-comique, par M. de Voltaire, Genève, 1757, deux volumes très petit in-8°, de 116 et 92 pages, avec titres gravés, et cette épigraphe :
HORAT.
Cette édition est divisée en vingt-quatre chants, mais n’est pas plus ample que l’édition in-32 de 1756. Les chants IV, VI, VIII, IX, X de 1755 ont été, chacun, mis en deux ; le chant XI en trois ; le chant XIX de 1757 est celui de Corisandre, qui était le XIVe dans l’édition de 1756 ; enfin le chant XII de 1755 forme, en 1757, les chants XX et XXI.
La Pucelle d’Orléans, poème héroï-comique en dix-huit chants, nouvelle édition sans faute et sans lacune, augmentée d’une épître du P. Grisbourdon à M. de Voltaire, et un jugement sur le poème de la Pucelle à M***, avec une épigramme sur le même poème. À Londres, chez les héritiers des Elzévirs, Blaew et Vascosan, 1761, petit in-12 de 180 pages.
Cette édition, qui a pour épigraphe : Non vultus, non color unus, est une réimpression de l’édition in-32 de 1756. Elle présente toutefois une variante remarquable ; le vers 43 du chant VI y est ainsi imprimé :
Les autres éditions portent :
La Pucelle d’Orléans, poème héroï-comique en vingt-quatre chants, nouvelle édition avec de belles figures. À Londres, aux dépens de la Compagnie, 1761, petit in-8° de 224 pages.
La division en vingt-quatre chants est comme dans l’édition de 1757.
La Pucelle d’Orléans, poème divisé en vingt chants, avec des notes ; nouvelle édition corrigée, augmentée, et collationnée sur le manuscrit de l’auteur ; Genève, 1762, in-8°, avec vingt figures qui ne sont pas toutes obscènes.
C’est la première édition avouée par l’auteur. Le chant de Corisandre n’en fait point partie ; mais elle est augmentée de cinq chants entiers, de la Préface de dom Apuleius Risorius, de notes mises au bas des pages. Elle contient un grand nombre d’additions et corrections dans divers chants. Ceux qui ont été ajoutés sont les VIII, IX, XVI, XVII, XVIII (aujourd’hui les VIII, IX, XVI, XVII et XIX). Le chant XX est une version presque entièrement nouvelle du chant XV de 1755, ou XVIII de 1756.
La Pucelle d’Orléans, poème divisé en vingt chants, nouvelle édition augmentée de cinq chants nouveaux et de notes, collationnée sur le manuscrit de l’auteur, enrichie de variantes, de belles figures, et de jolies vignettes. À Londres, aux dépens de la Compagnie, 1764, grand in-8°, avec figures.
C’est une réimpression de l’édition de 1762 ; mais on a ajouté des variantes. Le chant de Corisandre est en forme de note au bas du chant XVII. L’est aussi au bas du chant XX qu’est le texte du chant XVIII de 1756. Les cinq chants nouveaux promis sur le titre sont ceux qui avaient été ajoutés en 1762. Les notes sont aussi celles de 1762. En tête de la Préface de dom Apuleius Risorius est une tête de Voltaire couronnée.
La Pucelle d’Orléans, poème divisé en vingt chants, avec des notes ; nouvelle édition corrigée, augmentée, et collationnée sur le manuscrit de l’auteur. À Conculix, in-24 de 264 pages, avec vingt figures et un titre gravé. Sur ce titre gravé, qui n’a point de date, est un portrait de Voltaire, réduit d’après celui qui est en tête d’une édition du poème de la Loi naturelle. Entre les pages 138 et 139, avant le XIe chant, sont un faux titre et un titre imprimés qui portent tome second. L’adresse et la date qu’on lit sur ce titre sont : Aux Délices, 1765.
Le texte est celui de 1762, avec la préface et les notes. Il n’y a point de variantes.
Voltaire avait, en 1764, publié dans le volume intitulé Contes de Guillaume Vadé un Chant détaché d’un poème épique ; c’était ce qu’il appelait la Capilotade, et ce qui forme aujourd’hui le XVIIIe chant. Il est assez singulier que ce chant n’ait pas été compris dans l’édition de 1765.
Il existe un si grand nombre d’éditions de la Pucelle, que je serais fort embarrassé de dire quelle est la première dans laquelle a été introduite la Capilotade ; mais cela eut lieu du vivant de Voltaire. J’ai sous les yeux une édition de 1773, augmentée de quelques notes données sous le nom de M. de Morza, et qui la contient ; et c’est ainsi que le poème se trouve avoir vingt et un chants dans cette édition, et dans les éditions des Œuvres de l’auteur qui ont paru depuis. Dans l’édition in-4°, la Pucelle est au tome XX, daté de 1774 ; dans l’édition in-8°, encadrée, ou de 1775, elle est au tome XI.
Les éditions de Kehl, qui feront toujours époque dans l’histoire des éditions des Œuvres de Voltaire, furent augmentées d’un travail considérable des éditeurs, principalement sur les variantes. Ces éditions de Kehl sont, comme celle dont je viens de parler, en vingt et un chants. Voici la date de la publication de chacun d’eux. Les sept premiers ont vu le jour en 1755 ; les VIII et IX, en 1762 ; les X, XI, XII, XIII, XIV, et XV, en 1755 ; les XVI et XVII, en 1762 ; le XVIII, en 1764 ; le XIX, en 1762 ; le XX (sauf variantes), en 1755 ; le XXI, partie en 1755, partie en 1762.
Palissot ne pouvait que suivre cette division, consacrée par le temps et par l’auteur lui-même ; mais il restait quelque chose à faire au chant XV, et il l’a fait. Ayant aperçu « une omission bien étrange, à laquelle Voltaire, dans les bouleversements qu’il fut obligé de faire à son poème, n’avait pas pris garde », il l’a réparée. Dans les premières éditions, l’argument de ce chant (alors le treizième) avait trois phrases, dont voici la dernière : Ce qui arrive à la belle Agnès et à ses compagnons de voyage. Dans l’édition de 1762, Voltaire supprima les vers concernant Agnès et ses compagnons, mais ne supprima pas la phrase de l’argument. Cette lacune dans le texte coupe absolument, comme l’observe Palissot, le fil des évènements ; il était donc important de la rétablir. La restitution faite par Palissot date de 1792 ; mais Palissot ne s’en est pas tenu au texte des premières éditions.
En ne faisant pas les restitutions dans le texte, il faut du moins supprimer la phrase de l’argument. C’est ce que je fis en 1817, dans l’édition in-12 des Œuvres de Voltaire, dont j’ai publié les premiers volumes. Depuis lors on a cependant, en général, laissé subsister la phrase dans l’argument, et la lacune dans le texte.
M. L. du Bois, qui, dans l’édition de Voltaire entreprise par M. Delangle en 1825, s’était chargé de la Pucelle, qu’il a publiée en 1826, a profité de la découverte de Palissot, mais a disposé à sa guise quelques passages.
L’Épître du P. Grisbourdon à M. de Voltaire, qui, comme on l’a vu, se trouve dans diverses éditions de la Pucelle, avait été imprimée séparément (1756), in-12 de 12 pages ; l’auteur est J.-B. de Junquières.
Ce qui, dans l’édition de 1756 de la Pucelle, et dans quelques autres, est annoncé comme un Jugement sur le poème, n’est autre chose que des Vers sur le poème de la Pucelle, à M. M***, qui en avait envoyé une copie peu correcte, et déjà imprimés séparément en quatre pages in-8°. Ces vers sont au nombre de 69. Dans l’édition de 1756, ils sont donnés comme adressés à M. *** qui en a fait (de la Pucelle) deux éditions peu exactes. Dans l’édition de 1761, ils sont adressés à M. D.L.B., qui en a fait deux éditions peu exactes. Par ces initiales on a voulu désigner M. de La Beaumelle. La lettre M, qu’on lit sur l’édition originale, désignait Maubert.
Il parut en 1760 une Épître de Belzébuth à l’auteur de la Pucelle, in-8° de huit pages. Dans un Avertissement, l’auteur dit que son Épître était composée et circulait manuscrite avant que la Pucelle fût imprimée : il réclame, en termes exprès, l’antériorité sur l’Épître du P. Grisbourdon.
Les Mémoires secrets connus sous le nom de Bachaumont parlent, à la date du 15 février 1765, d’un « petit auteur nommé Nougaret, qui avait formé le projet de continuer la Pucelle », et qui avait été mis à la Bastille pour avoir composé un roman ordurier, intitulé la Capucinade. Ce Nougaret, mort en 1823, est autre que Félix Nogaret, mort en 1831.
Je ne sais si l’ouvrage dont il est question dans les Mémoires secrets est celui qui fut imprimé vingt-six ans après sous le titre de : Suite de la Pucelle d’Orléans en sept chants, poème héroï-comique par M. de Voltaire, trouvée à la Bastille le 14 juillet 1789 ; à Berlin, et se trouve à Paris chez Laurens junior, 1791, in-18 de IV et 102 pages, plus le titre.
Il n’y a rien à dire de cet ouvrage ; quelque peu d’étendue qu’il ait, je ne crois pas qu’il y ait dix personnes qui aient eu la patience de le lire en entier.
La même année parurent les Pucelles d’Orléans, poème en six chants, in-8°, de 119 pages. Il en existe des exemplaires intitulés les Victimes du despotisme épiscopal, ou les Pucelles d’Orléans, poème en six chants ; et d’autres ayant pour titre : Poème sur les vexations exercées par trois évêques successifs d’Orléans, contre les religieuses de Saint-Charles. On voit qu’il ne s’agit aucunement de Jeanne d’Arc, mais seulement de querelles ecclésiastiques. Les victimes sont des religieuses qui refusaient de signer le formulaire, et à qui les évêques refusaient pour cela les sacrements et autres accessoires. Aussi ce n’est point à Voltaire, mais à Pascal, que Robbé adresse une invocation dans le début de son poème, dont l’intitulé m’obligeait de parler.
Un des plus grands reproches faits à Voltaire, et constamment répété, est d’avoir empêché à jamais le succès de tout poème sur la Pucelle. Laharpe, à une époque où il n’était plus le champion de Voltaire, ne pensait pas que le règne de Charles VII pût fournir à l’épopée un sujet intéressant. Le reproche dirigé contre Voltaire, et l’observation de Laharpe, n’ont point effrayé plusieurs auteurs de nos jours. Vienne le génie, et un grand changement dans le goût et le caractère français, l’on n’aurait plus rien à dire.
Laharpe, converti, se montre bien sévère envers le poème sur Jeanne d’Arc. Il dit « qu’il n’y a point d’homme véritablement honnête qui ne rougisse en prononçant le nom de cet ouvrage… Sous le rapport de l’art, la Pucelle (qu’il nomme cependant lui-même) est un monstre en épopée comme en morale ». Laharpe, en parlant ainsi, voulait effacer, et rappelait au contraire, ce qu’il avait écrit en 1780. « Oublions, disait-il alors, quelques traits que lui-même a effacés ; effaçons-en même d’autres, échappés à l’intempérance excusable d’un génie ardent… Ne jugeons pas dans toute la sévérité de la raison ce qui a été composé dans des accès de verve et de gaieté. Peignons, s’il le faut, au-devant de ce poème, où le talent a mérité tant d’éloges, peignons l’Imagination à genoux, présentant le livre aux Grâces, qui le recevront en baissant les yeux, et en marquant du doigt quelques pages à déchirer ; et après avoir obtenu pardon (car les Grâces sont indulgentes), osons dire, en leur présence et de leur aveu, que nous n’avons point dans notre langue d’ouvrage semé de détails plus piquants et plus variés, où la plaisanterie satirique ait plus de sel, où les peintures de la volupté aient plus de séduction, où l’on ait mieux saisi cet esprit original qui a été celui de l’Arioste, cet esprit qui se joue si légèrement des objets qu’il trace, qui mêle un trait de plaisanterie à une image terrible, un trait de morale à une peinture grotesque, et confond ensemble le rire et les larmes, la folie et la raison. »
Parmi tous les écrits dont la Pucelle a été le sujet, on doit encore distinguer l’Essai sur la PUCELLE de Voltaire, considérée comme poème épique, par M. Eusèbe Salverte, qui a été imprimé dans les Veillées des muses.
Je tenais beaucoup à publier tous les volumes de l’édition des Œuvres de Voltaire ; mais j’ai craint de ne pouvoir donner à la Pucelle tous les soins que demandait encore ce poème.
M. Ravenel, sous-bibliothécaire de la ville de Paris, a bien voulu se charger de ce travail. Je lui ai donc remis les notes que j’avais recueillies ou reçues. La partie la plus importante et la plus considérable de ce que j’ai remis à M. Ravenel consiste en un assez gros cahier que m’avait envoyé M. Thomas, et qui contient une très grande quantité de variantes, d’après les éditions de 1756, 1762, 1775, etc., etc., et d’après un manuscrit de la Pucelle, qui a appartenu à l’avocat général Séguier. Le dépouillement avait été fait avec une telle exactitude qu’il restait très peu de chose à faire pour cet objet ; et je prie M. Thomas de recevoir mes remerciements.
En remettant à M. Ravenel toutes les notes que j’avais relativement à la Pucelle, je suis encore bien en arrière avec lui pour le grand nombre de celles qu’il m’a communiquées pour tous les autres volumes des Œuvres de Voltaire ; et, en signant de son nom les notes dont je lui ai remis les matériaux, mais dont la rédaction lui appartient, il n’a fait que suivre l’exemple que je lui ai donné, en mettant ma signature à des annotations que je tenais de lui. C’est un long échange qui a été tout à mon avantage.
La manière dont M. Ravenel s’est acquitté de sa besogne satisfera sans doute les lecteurs, mais ne m’a pas surpris. Je sais depuis longtemps quelle conscience il apporte à ses travaux ; et je ne connais personne aujourd’hui mieux préparé et plus capable que lui pour publier une bonne édition des Œuvres de J.-J. Rousseau.
Je n’ai point revu son travail sur la Pucelle ; mais je l’ai lu très attentivement sur le manuscrit, sans en passer une syllabe ; et j’avoue que je n’aurais jamais fait autrement, si ce n’est dans les endroits où je n’aurais pas fait aussi bien. Par exemple, dans le chant XVII, vers 193, M. Ravenel a fait une très heureuse correction.
Lorsque, dans ce chant, où tous les personnages sont devenus fous, Charles prend Bonneau pour Agnès, il lui adresse ces tendres paroles :
Toutes les éditions depuis et compris 1762, où ce chant parut pour la première fois, jusqu’à ce jour, portent :
Ce changement d’une seule lettre n’est-il pas indiqué par ce qui précède ? Il avait échappé aux yeux de tous les éditeurs et de tous les lecteurs. C’est, au reste, la seule fois que le nouvel éditeur s’est permis une correction sans l’autorité d’une édition ou d’un manuscrit.
Dans la collation des éditions et manuscrits, il était impossible de ne pas trouver les variantes données par les éditeurs de Kehl, et celles qui ont été ajoutées par M. Louis du Bois. Le travail de M. Thomas est de beaucoup plus complet que le leur. Cependant on a laissé aux éditeurs de Kehl et à M. Louis du Bois ce que chacun d’eux avait donné le premier.
En quelques endroits M. Ravenel a préféré telle version à telle autre ; en d’autres il n’a pas craint d’admettre dans le texte des vers reniés par l’auteur et même par ses éditeurs, mais sur l’origine desquels on ne peut pas avoir de doutes. Toutefois, ceux que Voltaire n’avait faits que pour avoir motif de désavouer tout l’ouvrage ont été laissés dans les variantes.
Les dates ajoutées à la fin de chacune des notes de Voltaire indiquent l’année de leur publication.
Les notes signées K sont des éditeurs de Kehl. Les notes de M. Ravenel sont signées d’un R. Lorsque les unes ou les autres de ces notes sont à la suite d’une note de Voltaire, elles en sont séparées par un –.
Les variantes que M. du Bois a données le premier, et qui n’avaient point échappé à M. Thomas, sont sans aucune signature. Celles que M. du Bois n’a point connues, et dont la majeure partie vient de M. Thomas, ainsi que le dit M. Ravenel, page 37, portent la signature de ce dernier.
B.
24 décembre 1832.
L’Avertissement de Beuchot appelle une seule remarque. Nous avons eu sous les yeux une édition de la Pucelle qui a échappé à l’examen de M. Ravenel ; elle a pour titre : « La Pucelle d’Orléans, poème divisé en vingt chants avec des notes, nouvelle édition revue, corrigée, augmentée, et collationnée sur le manuscrit de l’auteur. M. DCC. LXV (1765). » À la page 202 de cette édition, le mot « perle d’amour » est exactement imprimé.
L.M.
Ce poème est un des ouvrages de M. de Voltaire qui ont excité en même temps et le plus d’enthousiasme et les déclamations les plus violentes. Le jour où M. de Voltaire fut couronné au théâtre, les spectateurs qui l’accompagnèrent en foule jusqu’à sa maison criaient également autour de lui : « Vive la Henriade ! vive Mahomet ! vive la Pucelle ! » Nous croyons donc qu’il ne sera pas inutile d’entrer dans quelques détails historiques sur ce poème.
Il fut commencé vers l’an 1730 ; et, jusqu’à l’époque où M. de Voltaire vint s’établir aux environs de Genève, il ne fut connu que des amis de l’auteur, qui avaient des copies de quelques chants, et des sociétés où Thieriot en récitait des morceaux détachés.
Vers la fin de l’année 1755, il en parut une édition imprimée, que M. de Voltaire se hâta de désavouer, et il en avait le droit. Non seulement cette édition avait été faite sur un manuscrit volé à l’auteur ou à ses amis, mais elle contenait un grand nombre de vers que M. de Voltaire n’avait point faits, et quelques autres qu’il ne pouvait pas laisser subsister, parce que les circonstances auxquelles ces vers faisaient allusion étaient changées : nous en donnerons plusieurs preuves dans les notes qui sont jointes au poème. La morale permet à un auteur de désavouer les brouillons d’un ouvrage qu’on lui vole, et qu’on publie dans l’intention de le perdre.
On attribue cette édition à La Beaumelle, et au capucin Maubert, réfugié en Hollande : cette entreprise devait leur rapporter de l’argent, et compromettre M. de Voltaire. Ils y trouvaient
Un libraire, nommé Grasset, eut même l’impudence de proposer à M. de Voltaire de lui payer un de ces manuscrits volés, en le menaçant des dangers auxquels il s’exposerait s’il ne l’achetait pas ; et le célèbre anatomiste poète Haller, zélé protestant, protégea Grasset contre M. de Voltaire.
Nous voyons, par la lettre de l’auteur à l’Académie française, que nous avons jointe à la préface, que cette première édition fut faite à Francfort, sous le titre de Louvain. Il en parut, fort peu de temps après, deux éditions semblables en Hollande.
Les premiers éditeurs, irrités du désaveu de M. de Voltaire, consigné dans les papiers publics, réimprimèrent la Pucelle en 1756, y joignirent le désaveu pour s’en moquer, et plusieurs pièces satiriques contre l’auteur. En se décelant ainsi eux-mêmes, ils empêchèrent une grande partie du mal qu’ils voulaient lui faire.
En 1757, il parut à Londres une autre édition de ce poème, conforme aux premières, et ornée de gravures d’aussi bon goût que les vers des éditeurs : les réimpressions se succédèrent rapidement, et la Pucelle fut imprimée à Paris, pour la première fois, en 1759.
Ce fut en 1762 seulement que M. de Voltaire publia une édition de son ouvrage, très différente de toutes les autres. Ce poème fut réimprimé en 1774, dans l’édition in-4°, avec quelques changements et des additions assez considérables. C’est d’après cette dernière édition, revue et corrigée encore sur d’anciens manuscrits, que nous donnons ici la Pucelle.
Plusieurs entrepreneurs de librairie, en imprimant ce poème, ont eu soin de rassembler les variantes, ce qui nous a obligés de prendre le même parti dans cette édition. Cependant, comme parmi ces variantes il en est quelques-unes qu’il est impossible de regretter, qui ne peuvent appartenir à M. de Voltaire, et qui ont été ajoutées par les éditeurs pour remplir les lacunes des morceaux que l’auteur n’avait pas achevés, nous avons cru pouvoir les supprimer, du moins en partie.
L’impossibilité d’anéantir ce qui a été imprimé tant de fois, et la nécessité de prouver aux lecteurs les interpolations des premiers éditeurs, sont les seuls motifs qui nous aient engagés à conserver un certain nombre de ces variantes.
Il nous reste maintenant à défendre la Pucelle contrôles hommes graves qui pardonnent beaucoup moins à M. de Voltaire d’avoir ri aux dépens de Jeanne d’Arc, qu’à Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, de l’avoir fait brûler vive.
Il nous paraît qu’il n’y a que deux espèces d’ouvrages qui puissent nuire aux mœurs : 1° ceux où l’on établirait que les hommes peuvent se permettre sans scrupule et sans honte les crimes relatifs aux mœurs, tels que le viol, le rapt, l’adultère, la séduction, ou des actions honteuses et dégoûtantes qui, sans être des crimes, avilissent ceux qui les commettent : 2° les ouvrages où l’on détaille certains raffinements de débauche, certaines bizarreries des imaginations libertines.
Ces ouvrages peuvent être pernicieux, parce qu’il est à craindre qu’ils ne rendent les jeunes gens qui les lisent avec avidité insensibles aux plaisirs honnêtes, à la douce et pure volupté qui naît de la nature.
Or il n’y a rien dans la Pucelle qui puisse mériter aucun de ces reproches. Les peintures voluptueuses des amours d’Agnès et de Dorothée peuvent amuser l’imagination, et non la corrompre. Les plaisanteries plus libres dont l’ouvrage est semé ne sont ni l’apologie des actions qu’elles peignent, ni une peinture de ces actions propre à égarer l’imagination.
Ce poème est un ouvrage destiné à donner des leçons de raison et de sagesse, sous le voile de la volupté et de la folie. L’auteur peut y avoir blessé quelquefois le goût, et non la morale.
Nous ne prétendons pas donner ce poème pour un catéchisme ; mais il est du même genre que ces chansons épicuriennes, ces couplets de table, où l’on célèbre l’insouciance dans la conduite, les plaisirs d’une vie voluptueuse, et la douceur d’une société libre, animée par la gaieté d’un repas. A-t-on jamais accusé les auteurs de ces chansons de vouloir établir qu’il fallait négliger tous ses devoirs, passer sa vie dans les bras d’une femme ou autour d’une table ? Non, sans doute : ils ont voulu dire seulement qu’il y avait plus de raison, d’innocence et de bonheur dans une vie voluptueuse et douce, que dans une vie occupée d’intrigues, d’ambition, d’avidité, ou d’hypocrisie.
Cette espèce d’exagération, qui naît de l’enthousiasme, est nécessaire dans la poésie. Viendra-t-il un temps où l’on ne parlera que le langage exact et sévère de la raison ? Mais ce temps est bien éloigné de nous, car il faudrait que tous les hommes pussent entendre ce langage. Pourquoi ne serait-il point permis d’en emprunter un autre pour parler à ceux qui n’entendent point celui-ci ?
D’ailleurs, ce mélange de dévotion, de libertinage, et de férocité guerrière, peint dans la Pucelle, est l’image naïve des mœurs du temps.
Voilà, à ce qu’il nous semble, dans quel esprit les hommes sévères doivent lire la Pucelle, et nous espérons qu’ils seront moins prompts à la condamner.
Enfin, ce poème n’eut-il servi qu’à empêcher un seul libertin de devenir superstitieux et intolérant dans sa vieillesse, il aurait fait plus de bien que toutes les plaisanteries ne feront jamais de mal. Lorsqu’en jetant un coup d’œil attentif sur le genre humain, on voit les droits des hommes, les devoirs sacrés de l’humanité, attaqués et violés impunément, l’esprit humain abruti par l’erreur, la rage du fanatisme et celle des conquêtes ou des rapines agiter sourdement tant d’hommes puissants, les fureurs de l’ambition et de l’avarice exerçant partout leurs ravages avec impunité, et qu’on entend un prédicateur tonner contre les erreurs de la volupté, il semble voir un médecin, appelé auprès d’un pestiféré, s’occuper gravement à le guérir d’un cor au pied.
Il ne sera peut-être pas inutile d’examiner ici pourquoi l’on attache tant d’importance à l’austérité des mœurs. 1° Dans les pays où les hommes sont féroces, et où il y a de mauvaises lois, l’amour ou le goût du plaisir produisent de grands désordres ; et il a toujours été plus facile de faire des déclamations que de bonnes lois ; 2° les vieillards, qui naturellement possèdent toute l’autorité, et dirigent les opinions, ne demandent pas mieux que de crier contre des fautes qui sont celles d’un autre âge ; 3° la liberté des mœurs détruit le pouvoir des femmes, les empêche de l’étendre au-delà du terme de la beauté ; 4° la plupart des hommes ne sont ni voleurs, ni calomniateurs, ni assassins. Il est donc très naturel que partout les prêtres aient voulu exagérer les fautes des mœurs. Il y a peu d’hommes qui en soient exempts ; la plupart même mettent de l’amour-propre à en commettre, ou du moins à en avoir envie : de manière que tout homme à qui on a inspiré des scrupules sur cet objet devient l’esclave du pouvoir sacerdotal.
Les prêtres peuvent laisser en repos la conscience des grands sur leurs crimes, et, en leur inspirant des remords sur leurs plaisirs, s’emparer d’eux, les gouverner, et faire d’un voluptueux un persécuteur ardent et barbare.