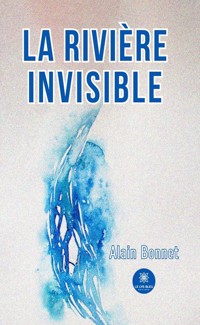
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Telle une invitation à explorer des horizons inconnus, "La rivière invisible" débute dans un quartier populaire, puis plonge dans l’Algérie des années tumultueuses précédant son indépendance. De là, il vous transporte sur les pentes chargées d’histoire de la Croix-Rousse, avant de vous entraîner à travers différents pays. Chaque destination devient la vôtre, et les destinées des personnages vous appartiennent. Ce périple se métamorphose en une odyssée intérieure, une découverte de vos propres territoires intimes, prêts à être dévoilés.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain Bonnet a traversé plusieurs vies en une seule existence, depuis ses premiers pas hésitants jusqu’aux horizons qui s’ouvrent vers l’inconnu. Grâce à ses multiples expériences, il partage dans son livre un chemin vers la découverte de soi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alain Bonnet
La rivière invisible
Roman
© Lys Bleu Éditions – Alain Bonnet
ISBN : 979-10-422-3222-1
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Préface
Et pourtant elle coule sous nos pieds… 90 % des rivières et des ressources en eau douce sont souterraines. 90 % à nouveau, d’un iceberg est invisible. L’eau jouerait-elle à se cacher ? 90 % d’un être humain serait ainsi voilé ?
Il est un fait que l’iceberg comme l’humain ne connaissent pas leur partie cachée, pourtant l’Essentiel de leur être. Maître Eckart ne disait-il pas : Il y en a qui connaissent leur Seigneur (leur Soi) par leur moi, je connais mon Seigneur par mon Seigneur. Il reconnaissait sa profondeur par sa profondeur, non par la partie émergée : le moi. L’on serait tenté d’ajouter au demeurant : et si la qualité de conscience un peu plus loin était de reconnaître le Seigneur de l’autre, par son Seigneur ? Voir la partie profonde de l’autre par sa propre infinitude ; Alain Bonnet semble faire partie de ces êtres gracieux, élus, ou éligibles, en tout cas sur le chemin.
Merveilleuse poésie que la sienne : le moi serait « le palimpseste du Soi », la peinture de surface (parfois une croûte…) recouvrant entièrement la peinture d’origine, le Soi.
Alain et moi partageons ce tropisme naturel vers l’Inde, lui en spécialiste, moi en amateur. La plus vieille civilisation (6000 ans) a tout découvert, suis-je tenté de dire à force et à coups de voyages intérieurs. (Gandhi ne disait-il pas que le vrai voyageur n’était pas celui qui avait fait dix fois le tour de la planète, mais une fois le tour complet de lui-même ?) Entre autres perles : l’inconscient, les différentes qualités de conscience (chit, chitta, dhyana, turya, turyatitta, etc., les corps subtils, les méridiens, les chakras et… le Soi : repris par Jung pour désigner le Moi Universel et divin de l’humain).
L’Occident est centrifuge, il conquiert l’extérieur, l’Orient est centripète, il conquiert l’intérieur. Le Soi, c’est son Amérique à lui, sa « terra incognita », sa terre du Ciel non colonisée, mais effleurée, les premiers colons étant bel et bien les Indiens. Ceux-ci témoignent depuis des millénaires de la Beauté du Soi, en croissance lente et tranquille en nous, car relevant du temps du cosmos, alors que d’autres prouvent par leurs chars invasifs la, parfois, laideur infinie du moi…
Alain Bonnet, philosophe, psychologue au sens large, doté d’une belle lucidité, poète aussi, sorte de Krishnamurti à la française est un voyageur infatigable (au sens où l’entendait Gandhi). Il nous offre un viatique, une voie vers l’Essentiel, une manière subtile de « décaper » la peinture de surface, le palimpseste, au white spirit, le blanc esprit de la lucidité et de l’innocence. Faire surgir sous la peinture de façade la Toile d’origine est un art de l’Attention. Le plus subtil de tous les arts.
Grand connaisseur des voies du monde, il évoque parfois la voie soufie : « l’ami spirituel ». Celui-ci vous accompagne sur le chemin et est tour à tour votre maître et votre disciple. Ne pourrait-on pas étendre la formule à « l’amant spirituel » ? Le jeu de miroir du couple renvoyant non pas seulement l’image de chaque Moi, mais aussi l’absence d’image de chaque Soi ?
Il y a une urgence à « s’éveiller » au sens que lui donne la tradition indienne. Ce n’est plus seulement de la Réalisation individuelle dont il est question. Le monde va mal. Le monde est malade de la gouvernance du moi. L’exploitation de l’homme par l’homme cisaille dans la chair de l’Humanité et celle de notre planète une plaie béante. Dans un monde où le Soi de chacun se serait révélé, épanoui, offrant à la planète en retour un champ de fleurs célestes, une humanité à la beauté inouïe, cette exploitation cesserait. L’exploitation du Soi par le Soi aurait-elle le moindre sens ? Osons même : l’exploitation de…. Dieu par Dieu ?
Pierre Vassas
J’ai rencontré Alain Bonnet en 1983. Nous entamions tous deux, à cette époque, un cycle de formation d’enseignants de Yoga à Lyon dans le cadre de l’E F Y R A. Nous fûmes donc amenés à nous rencontrer régulièrement durant quatre années lors des séminaires et également en dehors, car, dès le départ, Alain m’offrit généreusement l’hospitalité. Nous apprîmes ainsi à nous connaître et nos échanges portaient bien sûr sur les multiples aspects du Yoga. Sa singularité le rendait particulièrement sensible à l’enseignement de Krishnamurti, aux rencontres d’été que celui-ci animait à Saanen en Suisse ; la mienne s’inspirait de la vision de Sri Aurobindo, de son Yoga Intégral (Purna Yoga) et de l’expérience de la ville internationale libre, « Auroville », fondée en 1968, près de Pondichéry en Inde du Sud.
Nos différences étaient stimulantes et ce qui nous rendait proches était une même passion, un même intense élan vers la découverte de la vérité-réalité.
Déjà, à cette époque, nos aspirations respectives commençaient à trouver un bel espace où se déployer dans les approches non duelles du Tantra, même si nos connaissances et nos discours à ce sujet ne dépassaient pas beaucoup le stade du balbutiement. À la fin de cette formation, nos vies respectives et l’éloignement géographique relatif de nos résidences nous firent perdre de vue durant trente-six ans.
Alain suivit son chemin, fidèle à son orientation ; je suivis le mien, fidèle à mon orientation.
Les dynamiques invisibles qui animent le déroulement de nos vies – source de bien d’émerveillements – nous firent nous rencontrer à nouveau au printemps 2023. Je lui suis reconnaissant d’avoir initié cette rencontre, car dès le départ, nous découvrîmes que nos aspirations, travaux, rencontres, voyages et expériences intérieures respectifs nous avaient conduit tous les deux à la même découverte, émerveillée pour chacun d’entre nous, d’un des grands courants du Shivaïsme Tantrique non-duel du Cachemire : la Pratyabhijna.
Pratyabhijna : Reconnaissance ou reconnaissance spontanée de Soi.
Cette école fut fondée à la fin du IXe siècle par Somananda puis systématisée par son disciple Utpaladeva. La Pratyabhijna révèle un nouvel accès à la réalité ultime « reconnue » immédiatement par le cœur. Il ne s’agit ni d’atteindre un état élevé ni d’acquérir une dimension nouvelle, mais, plutôt, d’une prise de conscience du Soi omniscient et tout puissant en nous-mêmes, dans l’ouverture de notre propre cœur ; reconnaissance intuitive directe et immédiate du « Je ». Ce « Je », le Sujet ultime, est toujours déjà présent, toujours déjà ici, toujours déjà disponible. Mais tant que nous ne le reconnaissons pas, tant que nous n’en prenons pas conscience, c’est comme s’il était absent. La Pratyabhijna ne s’occupe pas de rituels, pratiques corporelles, respirations, etc. Elle pointe directement vers la source de l’intériorité de façon à reconnaître l’évidence de cette lumière consciente qui anime et éclaire la totalité de notre expérience humaine et du cosmos. La Pratyabhijna considère la conscience à la fois comme une lumière indéterminée, un substrat lumineux permanent qui éclaire la réalité, mais aussi comme un acte de conscience, une prise de conscience de soi et une force vive, infinie, qui engendre et anime l’univers. Les philosophes cachemiriens appellent cette lumière prakasha et cette prise de conscience (et puissance) vimarsha.
L’école de Yoga qu’Alain a fondée et animée s’appelle, naturellement, Vimarsha.
Douglas Harding, mon maître bien aimé et ami spirituel, m’introduisit à la Pratyabhijna à travers une expérience simple et puissante qu’il nomme la « Vision Sans Tête ». Elle consiste à voir vraiment ce que nous voyons et à reconnaître la source consciente de notre propre vision : Le Voyant ultime.
La Pratyabhijna est une voie qualifiée de très réduite, car elle consiste principalement à retourner notre attention à 180 degrés pour voir et reconnaître au cœur de soi-même le Voyant, le « Je » souverain.
Conformément à sa singularité, Alain nous offre à travers ce livre des indications nouvelles précieuses, des pistes salutaires, des points de vue éprouvés par des dizaines d’années de pratique, réflexions, études et expériences directes sur notre réalité humaine. Comme un arbre vigoureux aux floraisons odorantes, les fruits qu’il nous offre en partage aujourd’hui sont ceux mûris dans la lumière et la chaleur d’une longue maturité, ils sont savoureux, simples, incarnés. Ils rassasient notre besoin d’y voir plus clair et nous donnent l’élan de retrouver du sens, d’élargir notre horizon et de cheminer délibérément sur la voie ensoleillée que chacun d’entre nous ne peut que suivre vers la connaissance ou reconnaissance de soi.
Richard Boyer
Avant-propos
Il est juste que l’auteur s’efface derrière l’œuvre, quelle qu’elle soit, un livre, l’assiette façonnée par le potier, l’ossature de bois assemblée par le charpentier ou le labeur quotidien du paysan. L’œuvre est inspirée par une force que chacun nomme comme il l’entend. Ce livre est dicté par une force à laquelle je donne plusieurs noms, parmi lesquels l’Esprit, la rivière invisible ou encore l’insondable compassion.
Je ne suis que l’artisan, celui qui met en forme, qui inscrit dans des mots les mille nuances de la lumière sur les flots indomptables, celui qui tente de saisir l’insaisissable cours de la rivière, toujours le même et toujours différent ; entreprise vaine et cependant nécessaire ! Ainsi donc, toi qui lis ces lignes, toi qui t’apprêtes à pénétrer dans l’aventure intérieure qu’il décrit, ne t’attache pas aux personnages qui sont autant de faces réelles et illusoires de l’artisan, mais sache que je t’invite à reconnaître Cela qui inspire et anime chaque phrase, car Cela ne t’est pas étranger.
Prologue
Mon nom est Absalom. Le soleil brûlait la plaine livrée à la stridulation des sauterelles. Adossé à un térébinthe, je suivais du regard le vol de quelques pies-grièches lorsqu’une sittelle se posa si près de moi que ma main droite aurait pu l’effleurer. Et je me pris à penser à un autre Absalom auquel la vie offrait les plus belles promesses, mais qui connut un mort tragique, sa longue chevelure prise dans les branches entremêlées d’un grand térébinthe, d’un autre térébinthe semblable à celui qui m’offrait ombre et fraîcheur. Il avait levé une armée contre le roi David, son père, il fut défait et fuyait le champ de bataille, son cheval noir lancé à toute allure. C’est alors qu’il passa sous le grand térébinthe. Joab, le général du roi David, donna l’ordre à un soldat de tuer le fils rebelle, suspendu entre ciel et terre. Le soldat refusa d’achever l’enfant bien-aimé du roi. Alors Joab immola Absalom de trois coups d’épée.
La tête d’Absalom pencha sur le côté comme pour contempler la rivière de sang qui emportait sa vie. L’image du Nazaréen se superposa à celle d’Absalom, sa longue chevelure prise dans la couronne d’épines, il était cloué entre le ciel et la terre, un seul coup de lance transperça sa poitrine.
La tête du Nazaréen s’inclina sur le côté comme pour contempler la rivière de sang et d’eau qui donne la vie.
J’en étais à ce point de mes réflexions lorsque j’entendis une voix, grave et cependant pleine d’allant. Je n’avais pas entendu l’homme arriver.
L’homme reprit, ignorant ma question.
Il me sourit comme on sourit à un enfant frondeur et impertinent. Mais je devais faire bonne figure, je l’interrogeai vivement.
Je pressentais que l’homme, bien qu’il semblât ne pas répondre à mes questions, leur donnait un sens plus large que j’avais ignoré jusqu’alors. C’est pourquoi je me tus. Longuement. Le soleil avait depuis longtemps quitté le zénith lorsqu’enfin je rompis le silence.
Je ne refusai pas, ce long silence nous avait rapprochés et je savais en mon for intérieur qu’il était vain de chercher une explication.
Je ne sais pourquoi mes lèvres et mes yeux lui sourirent, aussitôt son visage s’illumina. Je remarquai alors les profonds sillons que le soleil, le vent et sans doute les embruns avaient imprimés sur son front, ses joues et autour de sa bouche. Il jeta sa besace sur son épaule, j’attachai mon sac autour de la taille et nous avançâmes sous un soleil implacable malgré les ombres qui s’allongeaient. Nous marchâmes sans nous arrêter, enfin le Clos de la Vierge se dessina au loin. Aucun de nous n’avait prononcé un seul mot. Nous savions que ce n’était pas encore le temps de dévoiler l’histoire d’Ilaan.
Nous posâmes nos maigres effets, sans rien dire je lui montrai sa chambre, celle du haut surplombant le vaste jardin qu’égayaient les fuchsias d’un rouge profond et singulier, les dahlias jaunes, oranges et mauves, et les alstrœmerias aux grandes fleurs blanches. Nous échangeâmes quelques phrases courtes en partageant un repas sobre et paisible.
Nous voici maintenant assis sur la terrasse, face aux hauts plateaux derrière lesquels glisse le soleil, dispensant alentour recueillement et sérénité.
Et voici, Osée respire profondément pour enfin plonger son regard clair dans mes yeux vaincus.
Nous revêtons un chandail, car la fraîcheur gagne la terrasse et la plaine, les arbres trouvent le repos, les chauves-souris dérivent dans le ciel en un vol heurté et imprévisible. La lune et bientôt les étoiles veillent sur nous, l’univers semble prendre part au récit.
Je regarde, j’écoute et quelque chose en moi me dit avec force : « je connais cet inconnu ». Mon cœur bat plus fort, ma vision a une clarté nouvelle et les sons résonnent dans mes oreilles étonnées comme des notes absolument pures. L’air vibre, l’air bruisse d’une gloire nouvelle qui semble fuser des origines de l’univers.
Osée commence son récit, et comme il parle mes oreilles entendent et mes yeux voient. Ou bien serait-ce une voix à l’intérieur de moi, une vision au-dedans de moi ?
Les annales du temps
Le soleil couchant saigne sur la terre atterrée. Tout est rouge, rouge sombre : les arbres, les genêts et les bruyères, l’herbe et les rochers, le ciel, le soleil. Rouge sang, grenat, magenta, pourpre, enfin rouge ! Rouge comme la vie qui abandonne l’astre de la Terre, rouge comme la colère, rouge comme l’envie, rouge comme le désir insatiable.
Ilaan chancelle, Ilaan se laisse tomber sur un grand rocher rouge. Le sang du soleil se répand sur la Terre ; un large filet vermillon sourd lentement, obstinément de la blessure qui déchire la poitrine d’Ilaan et s’en vient mourir dans la mer de sang du soleil.
C’est la nuit, la nuit noire, la nuit rouge d’Ilaan. Les souvenirs se frayent un chemin de clarté à travers le brouillard opaque et rouge. Des souvenirs sombres, des souvenirs lumineux comme des feux follets, des souvenirs bleus comme l’enfance. Les souvenirs sont le sang de la mémoire, la trame visible de nos existences humaines. Que nous reste-t-il quand la mort nous appelle, seulement des souvenirs, des remords et la peur insondable ? Et que sommes-nous au moment où la mort nous prend dans ses bras, des souvenirs, rien de plus que des souvenirs ? Que devenons-nous à l’instant où Elle nous emporte, un tremblement irrépressible, des convulsions, un long déchirement ? Et que disent nos lèvres gercées et nos yeux terrifiés, des paroles de malédiction… ou des promesses de paix ? Que dit notre corps de douleur quand nous savons que nous quittons sans retour la Terre, le monde, la vie, quelle plainte, quelle tristesse, quel désespoir ? Ou bien, oui ou bien quelle espérance, quelle certitude, quelle gratitude ?
Mais Ilaan n’a pas peur, son corps étrangement calme ne tremble pas, ses lèvres ne frémissent pas. Un visage lisse et familier se penche sur lui, le visage de la compagne fidèle, présente sans faillir depuis ses premiers pas dans l’existence jusqu’au dernier souffle qui semble désormais si proche. Elle est là depuis le premier cri clair et puissant jusqu’au dernier cri sourd et profond. Un cri ? Ou peut-être, ou sûrement un souffle léger, un murmure… une bénédiction ?
Nulle tristesse, aucune plainte, ni révolte, ni résignation. Une paix profonde, calme et lucide.
Et voici, le soleil sombre dans la Terre. Tout devient noir, noir comme le mystère… Noir comme ses cheveux d’ébène qui luisaient sous les rayons du soleil, te souviens-tu Ilaan ?
Et voici, le soleil tombe dans l’abîme.
Ilaan ouvre lentement ses paupières fatiguées par le poids de la peine et de la tristesse, lassées par l’opprobre et la haine tenace. Il voit l’espace rouge et noir, la danse sauvage et frénétique des immensités rouges et noires qui se combattent violemment, s’interpénètrent et se déchirent de nouveau, s’unissent et se séparent sans fin. De longs arbres dénudés et rouges penchent leurs membres décharnés au-dessus de lui, puis s’éloignent ; ils s’agitent furieusement dans un air immobile, suffocant, implacable.
Soudain ils semblent se calmer, s’apaiser, laissant entrevoir une brèche. Une brèche ? Une porte dans le temps et l’espace ! Une brise légère se lève, douce et insistante : le vent de la mémoire, des mémoires innombrables.
Et voici, une main retombe, lentement, infiniment lentement ; une main retombe sans fin.
Le vent de la mémoire, l’appel de la mémoire ! La mémoire humaine est si peu sûre, mais la Grande Mémoire qui s’invite lorsqu’approche la mort, la Grande Mémoire est infaillible, elle sait tout, elle dit tout.
Ilaan suit, déchirant la brume rouge, tel un vaisseau fantôme, la silhouette familière, presque irréelle qui s’avance d’un pas souple, léger et décidé. Elle se tient à distance maintenant, suffisamment proche pour révéler son corps légèrement vêtu à la manière des antiques statues grecques, les reflets bleutés de sa peau semblent éclairer l’obscurité incertaine et rouge. Elle s’approche encore un peu, remonte d’un geste trop sûr ses longs cheveux d’ébène sur son épaule nue, laissant apparaître un visage aux traits fins et volontaires, encore juvéniles et cependant empreints d’une gravité presque solennelle. Ses yeux ont l’éclat de la jade et la profondeur de l’océan ; ils rencontrent le bleu délavé par les ans des yeux d’Ilaan, ils ne s’y perdent pas et transpercent son âme. La douleur est vive, claire, d’une pureté absolue. Ilaan ne la repousse pas. Une force intérieure opère une transmutation, lentement, presque avec nonchalance ; alors comme par inadvertance la douleur n’est plus, laissant place à la douceur et à la lucidité. Ilaan est emporté par cette paix incommensurable, un instant, une éternité. Une voix lui parvient qui semble venir de l’autre côté du temps, mais il ne saurait dire depuis quelle rive du temps elle l’appelle, de quel côté du réel lui-même se tient.
Et voici, le vent des mémoires qui font et défont nos vies incertaines se glisse dans l’interstice du temps, dans la déchirure des apparences. Des apparences, oui, car le temps est illusion. Et la mémoire est un grand livre, un livre vivant, elle est le passé toujours présent, palpitant, brûlant parfois.
Le temps de l’innocence
Voici venu le temps de l’innocence
innocent est celui qui ne nuit pas
pureté ce qui est sans souillure
innocence et pureté sont sœurs
La mémoire est un livre vivant qui déconstruit le temps. Une page est ouverte sur l’image de la rue pavée, interminable, longée d’un côté par les murs gris des usines, et de l’autre par les devantures du laitier, de la crémière, de l’épicier et par celles des cafés porte-pot où les ouvriers dans leur bleu de travail viennent prendre leur pause de midi ; dans la rue, des vélos, quelques charrettes à bras et de rares automobiles : tractions avant, 203 ou 2 chevaux à la carrosserie en tôle ondulée.
Cette époque est un entre-deux qui forme le trait d’union entre le temps d’avant, la France rurale, rude et besogneuse, celle du paysan organiquement relié à sa terre et le temps d’après, la France urbaine, pressée, celle des autoroutes, des zones industrielles et des centres commerciaux qui étalent leur laideur là où autrefois les champs de blé ondoyaient sous la brise de juillet. La France des champs et des bocages, des vergers et des collines, du ciel bleu, et la France du béton et du bitume, de la pollution, cette France orpheline du chant des oiseaux, qui ignore qu’elle a échangé l’éclat du coquelicot et les pétales finement découpés du bleuet contre la trivialité de l’argent.
La rue pavée fait une fourche que traverse la rue Saint-Maximin ; le côté droit de la fourche constitue le début de la rue Villon, le côté gauche est la continuation de la rue Paul Sisley, plus étroite et qui longe une maison bourgeoise retirée au fond d’un parc ceint de grands murs de pisé usés par le temps, au-dessus desquels se dressent deux grands cèdres bleus.
Sur le côté gauche de la rue Paul Sisley, le croisement avec la rue Saint-Maximin est occupé par la maison du charbonnier, dont la cour surélevée où sont formés des tas de charbon comme des petites montagnes domine la cour de la modeste maison où vit la famille d’Ilaan : Abel le père, Joséphine la mère, Louis l’aîné d’un an et Ilaan. L’entrée de la maison se situe juste avant le café fréquenté par les joueurs de cartes ; la porte d’entrée s’ouvre sur un long couloir sombre et étroit qui mène à un jeu de boules, puis il faut prendre le petit chemin à droite, longer la cour des deux appartements en rez-de-jardin pour parvenir au portillon en bois qui ferme la cour de la maison où une tortue traîne sa peine. Au fond de la cour à gauche il y a les toilettes, et de l’autre côté, le poulailler. Une unique pièce occupe le bas de la maison, on y découvre un évier en faïence, un fourneau flanqué d’un seau à charbon en métal gris tacheté et légèrement cabossé, une table et quelques chaises, et trônant sur ce mobilier modeste, une chaise haute de bébé. Un escalier donne accès à la chambre des enfants qu’éclaire faiblement une petite fenêtre ; au fond de la pièce, une marche conduit à la chambre des parents que ferme une porte sombre rendue moins austère par une poignée en faïence blanche. Il n’y a pas de salon ni de salle de bain, on se lave à l’évier ; à cet effet on fait chauffer l’eau dans la bouilloire qui chante sur le fourneau une mélopée grise.
C’était le monde des premières années d’Ilaan. Le souvenir en est précis : la chaise haute repeinte en bleu clair qui forme une oasis de lumière dans la pénombre de la cuisine, les boulets de charbon luisants sous la faible lumière que laissent passer les carreaux opaques de la porte d’entrée, à l’étage, la tapisserie verte de la chambre des enfants, le lit à barreaux d’Ilaan ; à gauche de son lit, celui plus grand de son frère semble le regarder de haut ; et puis la cour, le portillon, le chemin, le jeu de boules, le couloir, la rue Paul Sisley triste et monotone et à deux cents mètres de la première intersection, l’école maternelle.
L’école, l’oppression d’un monde étrange qu’il ne comprend pas, un monde dominé par des adultes indifférents qui exigent des enfants qu’ils ne parlent ni ne bougent, jusqu’au moment où ils se retrouvent brusquement dans une cour bruyante, goudronnée et isolée de l’extérieur, fermée à la vie par une grille infranchissable. Les grands de l’école primaire bousculent les petits :
Les plus grands, ceux de la classe de fin d’études se regroupent derrière deux arbres maigrichons qui n’apprécient guère l’asphalte de la cour ; ils fument religieusement à l’abri du regard des adultes qui de toute façon ne s’intéressent pas à eux, leur propre médiocrité semblant les satisfaire. Ilaan contemple le rituel des grands et croise leur regard et leur visage transfigurés par la magie de la fumée de cigarette.
Encore une fois la classe, la maîtresse vient vers Ilaan, déroule le ruban adhésif avec lequel elle lui colle les lèvres :
Il observe ses yeux brillants de fierté, quel monde étrange ! Bientôt les parents arrivent, la maîtresse incapable de taire plus longtemps son exploit pédagogique se précipite sur la mère d’Ilaan qui ne dit rien, car elle pense que les spécialistes ont toujours raison et par-dessus tout elle se conforme à l’autorité.
Parfois le père vient à la sortie de l’école. Souvent pendant la récréation, pour combler leur ennui, les maîtresses l’appellent :
Elles insistent :
Elles rient, mais il n’est pas dupe, ce n’est pas un rire bienveillant, alors il se garde bien d’en dire plus sur son père, car il a compris que les maîtresses sont comme les Grosses Têtes.
Le père est souvent absent, il part « en déplacement » ; quand il revient, il parle de manifestations à Bordeaux, à Tignes à cause d’un barrage. Les parents parlent souvent de l’Indochine, et parfois de partir pour « avoir de l’avancement ». Il ne sait pas ce que cela signifie, mais il comprend que c’est important, il saisit l’espoir que recèlent ces trois mots.
Dans le noir de la nuit, sa mère vient à lui :
Elle retourne dans la chambre des parents. À travers la porte Ilaan entend :
Suivent quelques mots, un silence, jusqu’au moment où malgré lui des cris jaillissent de sa gorge. Une courte négociation, et la mère revient excédée :
Heureusement pour Louis, rien ne semble pouvoir troubler son sommeil. Elle s’impatiente, il n’a pas les mots pour lui expliquer les Grosses Têtes et il a dû se rendre à l’évidence, les Grandes Personnes ne peuvent pas comprendre les Grosses Têtes, elles ne peuvent pas comprendre les enfants. D’ailleurs cherchent-elles à les comprendre ou cherchent-elles seulement à se faire obéir ?
Et elle est fière, elle aussi, car elle est raisonnable ; les Grandes Personnes sont raisonnables. Mais Ilaan voit les Grosses Têtes, elles ressemblent à d’immenses ballons de baudruche flottant dans l’espace de la chambre ; elles viennent le narguer jusqu’au-dessus de son lit à barreaux. La Grosse Tête bleue est ronde, hautaine et suspicieuse elle inspire le trouble et l’inquiétude, la Grosse Tête rouge a une forme ovale, hostile et malveillante elle provoque la méfiance et la peur, quant à la Grosse Tête jaune, allongée et crasseuse, sa voix de fausset la rend déroutante et terrifiante. Et elles rient, elles se moquent de lui, puis elles parlent, elles parlent vite et fort. Que disent-elles ? Il ne connaît pas le langage des Grosses Têtes, elles sont méchantes, c’est tout ce qu’il sait.
Ilaan est résolu à ne plus perdre son temps avec les Grandes Personnes, non seulement elles ne peuvent pas comprendre, mais en plus elles sont blessantes, elles ne méritent pas l’attention des enfants.
Ilaan entrouvre les paupières sur le visage calme et grave qui se détache sur l’espace rouge, ce visage d’où filtre une lumière verte ; une lumière d’un vert de jade.
Elle sourit tristement.
Et le vent de la mémoire souffle à travers la porte du temps, un souvenir en chasse un autre.
L’enfance encore. Les souvenirs de l’enfance sont les plus obstinés. Le canard sans tête court à travers la cuisine et la cour, rien ne semble pouvoir l’arrêter ; le père a tué le canard et le voici bien démuni, son long couteau à la main alors que le canard semble devoir se jeter ainsi de-ci de-là jusqu’à la fin du monde.
C’est ce que sa mère aime à dire quand il est sur la chaise haute. Le pape, il ne sait pas ce que cela veut dire ; mais un jour il verra une image, celle du pape assis lui aussi sur une chaise haute.
Louis apprend à lire, il hésite, il reprend, venant à bout du peu de patience maternelle. Ilaan vient au secours de son frère :
Et il continue, car à force de l’entendre il connaît par cœur la lecture. La mère s’emporte.
Elle dit qu’il apprendra à lire l’année prochaine.
Ilaan en déduit qu’elle ne sait pas et les Grandes Personnes n’aiment pas dirent qu’elles ne savent pas. Elles possèdent une arme imparable : il faut, il faut pas. Par exemple il ne faut pas lécher les boulets de charbon, il ne faut pas lécher la vitre dans l’autobus, il faut être sage, il faut faire un bisou à la dame.
La porte du temps se referme, la femme aux cheveux d’ébène se tient debout aux pieds d’Ilaan, son corps se détache sur le ciel rouge, les reflets bleutés de sa peau éclairent la pénombre avec douceur. Le silence est là soudainement qui les enveloppe tous deux dans le léger manteau de soie d’un silence calme, profond, fraternel. Le silence, la paix… comme un répit. L’éternité d’un instant.
Et insensiblement le silence se fait lourd, la porte du temps s’ouvre doucement.
Et voici : une main retombe. Lentement, infiniment lentement. Une main retombe sans fin.
Le vent souffle sur les souvenirs de l’enfance, d’abord léger puis de plus en plus insistant, et c’est un souvenir inoubliable, fondateur, l’expérience du piochon.
Louis et Ilaan n’ont pas connu les grands-parents paternels, car Abel avait quatre ans à la mort de sa propre mère et douze ans quand survint la mort brutale et tragique de son père. Mais voici que les grands-parents maternels sont arrivés en ce beau dimanche de printemps, heureux de partager cette belle journée en famille. Arthur, le grand-père, porte un chapeau et le costume du dimanche, rayé et sombre ; sa silhouette mince contraste avec la silhouette imposante de la grand-mère, Marie, vêtue d’une robe noire. Le repas touche à sa fin, le grand-père impatient entraîne les deux frères dans la cour, heureux et fier de la surprise qu’il leur a préparée : une pelle et un piochon. Il montre comment les utiliser, la démonstration est pénible pour son dos, car les outils sont à la taille des enfants, puis il rejoint les adultes dans la cuisine. Ils ne se doutent pas du drame qui se joue dans la cour. En effet, Louis et Ilaan veulent la même chose, la pelle. Louis s’en est saisi le premier, déçu Ilaan se retrouve en possession du piochon, mais il n’a pas le temps de le regretter, car l’espace d’un instant une intuition s’est emparée de lui, qu’il met derechef en application : d’un geste sûr Ilaan assène un coup de piochon, très précis en plein milieu du crâne de son frère. Il ne s’agit pas d’un acte de méchanceté, encore moins de vengeance, il s’agit seulement de la beauté du geste, de la spontanéité de l’action lorsque l’impulsion et l’acte s’enchaînent parfaitement. Et quelle récompense ! La sensation jubilatoire du piochon qui rebondit sur la boîte crânienne de son frère, la sensation merveilleuse, indescriptible de l’élasticité d’une boîte crânienne juvénile ! Le point d’orgue de cette illustre expérience est le son émis par le choc et le rebond, un son étouffé et clair à la fois.
C’est le premier ravissement.
Ilaan s’apprête à renouveler l’expérience, hélas, il n’en a pas le temps, les pleurs de son frère ont attiré les adultes en émoi. Leurs cris couvrent les sanglots de Louis. Personne ne comprend la profondeur de l’expérience du piochon, inutile d’expliquer que chacun devrait faire cette expérience au moins une fois dans sa vie d’enfant.
Malheureux grand-père qui subit une salve de reproches :
Le père qui jusque-là s’est prudemment abstenu de tout commentaire déclare que la blessure est superficielle et sans conséquences. Cette belle journée s’achève tristement, les grands-parents quittent la maison plus tôt que prévu, le grand-père sommé de repartir avec pelle et piochon.
Ilaan est un enfant singulier, une forme étrange de solitude est son refuge, à la maison parce que les relations avec sa mère et son frère sont distantes, à l’école par habitude, mais aussi parce qu’il est souvent désarmé face à l’agressivité des autres enfants. Ilaan est un enfant à part surtout en raison d’une sensibilité exacerbée qui lui confère une lucidité surprenante pour son âge. Une lucidité impitoyable quand elle se porte sur le monde des adultes ; son regard d’enfant dénonce le mensonge des adultes, les obligeant à baisser les yeux. Le mensonge, il l’entend dans les silences gênés, les rires hors de propos ou trop bruyants, il le voit dans les gestes qui disent ce que cachent les paroles, dans le sourire trompeur et dans l’éclair de malice dans les yeux. Le mensonge, il le sait dans les faux-fuyants des adultes : quand soudain ils parlent trop vite et de n’importe quoi aussi stupide que ce soit, dans un toussotement qui échoue à donner une contenance, dans les dérobades dont ils sont coutumiers. En revanche il semble accorder aux autres enfants l’innocence qui est la sienne, malheureusement les enfants ne sont pas tous innocents, ils ont tôt fait d’apprendre à être retors et trompeurs, incités en cela par les adultes qui détestent l’innocence : « Il faut défendre ses intérêts, il faut être plus malin que les autres ! »
Ilaan connaît si bien les petits mensonges quotidiens de sa mère qu’il ne s’en étonne plus, et il a tôt fait de comprendre qu’il doit se méfier des Grandes Personnes et de leur monde construit sur le mensonge.
Vient un jour marquant, saillant, celui où il passe instantanément de la méfiance à la perte de confiance. En effet voici plusieurs semaines, peut-être même quelques mois, à chacune des visites chez les grands-parents, la grand-mère est seule ; Louis et Ilaan s’en étonnent et n’obtiennent pour toute réponse que des paroles gênées, des propos évasifs, et pire encore, des regards fuyants. Ce jour-là donc, Ilaan insiste :
La mère lâche en évitant le regard des enfants :
Trop tard, la confiance est brisée. La confiance n’est plus et ne sera plus, restent la peine et la douleur qui prennent en tenaille la poitrine et le ventre.
Peu de temps passe jusqu’à ce qu’un évènement ne scelle définitivement la désillusion de la perte de confiance, une autre journée marquante qui apporte à Ilaan la confirmation de ce dont il se doutait depuis quelque temps : le Père Noël est une invention des Grandes Personnes. Chaque année dès novembre, Joséphine avait l’habitude d’aiguillonner sa progéniture : « le Père Noël passe par la cheminée, le Père Noël viendra pendant le sommeil des enfants, le Père Noël dépose des cadeaux dans les chaussures des enfants… à condition qu’ils soient bien sages. » Ilaan ressent cruellement ce jour-là que la voix et les paroles de sa mère sonnent faux et pressent ce qu’elles cachent : le désir de créer une attente, une excitation. Ilaan insiste avec l’obstination et la ténacité dont seuls les enfants sont capables ; ne sachant résister sa mère n’a d’autre recours après des dénégations gênées que d’avouer que « c’est pour faire plaisir aux enfants » et que « ce sont les parents qui font les cadeaux ». Elle n’a pas compris que Louis et Ilaan ne sont pas en demande de cadeaux, qu’ils ne sont pas malléables au point de se conformer, ce que les adultes appellent « être sages », et que de toute façon ils ne font pas de « bêtises », qu’elle n’a donc à se plaindre ni de l’un ni de l’autre. Ce qui se passe ce jour-là c’est beaucoup plus que la réitération de la perte de confiance, c’est en prime le discrédit et pour Ilaan la blessure profonde d’avoir été trompé et de se savoir l’objet d’une manipulation continuelle. Les enfants lui apparaissent comme des pantins dont les Grandes Personnes tirent les fils selon leurs caprices et à la mesure de leur médiocrité et d’une imagination souvent malsaine, parfois abjecte.
Le temps du mépris
Voici venu le temps du mépris
le mépris, un refuge
le seul asile à la mesure de l’exigence de vérité
l’innocence attend sans bruit tapie quelque part dans le cœur
Ilaan a compris autant qu’on peut le comprendre à son âge, c’est-à-dire confusément, que sa mère est en manque de tendresse, cette tendresse qu’elle quémandera toute sa vie. Il entrevoit sans pouvoir l’exprimer qu’elle ne sait pas donner ; enfermée dans son malheur elle ne sait que prendre. Il ne peut porter ce pressentiment de la détresse de sa mère et ne peut se douter que dans quelques années elle s’en déchargera sur lui.
La femme aux cheveux d’ébène fixe sur Ilaan un regard tranquille et résolu.
Un silence calme et douloureux descend sur eux. Calme et douloureux, cela paraît étrange, mais c’est ainsi. Un long et pénétrant silence s’étend sur le monde jusqu’au moment où l’air se fige.
C’est alors qu’une fois encore s’ouvre la porte du temps.
Et voici, une main retombe, lentement, infiniment lentement, une pauvre main maigre, tremblante et suppliante retombe sans fin.
La brise des mémoires ensevelies se lève et souffle de plus en plus fort, c’est alors qu’apparaît La Chavassonnière.
La Chavassonnière, c’est un chemin de terre boueux sous la pluie, bordé au nord par des petites maisons ouvrières au fond d’un jardin. Elles sont aussi modestes les unes que les autres : leur unique pièce du bas abrite un poêle, une cuisinière et une table de cuisine, au fond un escalier mène à l’unique chambre. Les fenêtres sont petites, tout est petit pour les petites gens. Au sud le chemin est longé par des constructions nouvelles encore en chantier, des maisons de banlieue qui sont toutes construites selon le même plan. La famille d’Ilaan vient de s’installer dans l’une d’elles, au numéro dix. Le bas de la maison, c’est le garage, un escalier en façade mène à l’appartement. Derrière la maison s’étend un vaste jardin, devant c’est la cour qu’un muret sépare du chemin qui donne sur les champs de cardons que l’on entoure de sacs de ciment jusqu’en décembre afin de les blanchir. Enfin le chemin aboutit à la Rize, un ruisseau où survivent les dernières écrevisses, et qui longe le canal dans lequel il se perd un peu plus loin. La Rize, elle coulait dans les caves de la rue de la Buire où habitait la famille d’Ilaan lors de sa naissance et qu’elle a quittée très vite pour la maison de la rue Paul Sisley. La Rize déjà, comme un signe dès sa venue au monde.
La Chavassonnière pour Ilaan c’est le vaste jardin où les oiseaux sont nombreux dans les arbres, picorant les cerises, ce sont les nuages de hannetons les nuits d’été, les crapauds, les courtilières qui mangent les pommes de terre, quelques hérissons qui s’abritent l’hiver sous les tas de feuilles, des menthes et de la ciboulette qui poussent de-ci de-là, le plantain, le grand et vénérable abricotier. Le jardin c’est une partie de lui, aussi cet après-midi sous le soleil de mai quand il entend son oncle déclarer en regardant l’espace non cultivé, « un coup de bull et c’est un terrain à bâtir » il ressent le sacrilège, il réalise que les hommes ne tiennent pas la terre pour sacrée, ils abattent les arbres, n’ont cure des habitants des bois, des forêts, des étangs et des jardins. La terre pour eux se divise en terrain à bâtir, terrain à aménager pour une zone industrielle ou commerciale, pour une nouvelle zone pavillonnaire, ou terrain réservé pour le passage d’une autoroute.
Le père est souvent absent, « en déplacement » ; quand il est à la maison, il écoute dans un silence imposé le feuilleton radiophonique, la famille Duranton. Dans la conversation des parents, l’Algérie remplace l’Indochine, ravivant le désir « d’avoir de l’avancement » à condition de saisir la proposition d’une mutation. Le leitmotiv qui conclut leurs conversations est l’espoir du retour du Général. Ilaan imagine un cavalier sur un cheval blanc, sabre au clair à l’assaut de l’ennemi ; l’ennemi ? Peut-être les grévistes dont il entend souvent parler, ou les communistes.
La mère est au foyer, elle se plaint des tâches ménagères, elle se plaint du temps quand il pleut, quand il fait trop chaud, trop froid, elle se plaint des enfants sur lesquels elle reporte sa frustration. Pourtant Louis et Ilaan ne sont pas turbulents, ils jouent calmement, rarement ensemble, car chacun reste dans son monde, un monde à l’abri des dépressions de leur mère. Depuis peu, à la dépression de la mère sont venues s’ajouter les colères de la grand-mère qui habite désormais dans une partie du garage que le père a transformée en appartement. Un appartement sombre au plafond bas dont les petites fenêtres donnent d’un côté sur la cour, de l’autre sur le jardin auquel on accède par une porte sans vitrage, étroite et ténébreuse. L’appartement de la grand-mère c’est la morosité, c’est le temps qui s’est figé dans le lit bateau, le temps emprisonné dans les bibelots et les napperons et qui s’est perdu dans des souvenirs tristes qu’elle rumine jour après jour en tâchant de ne pas penser à la fin. La fin ? Ilaan comprend, c’est la mort, cette mort qui suscite tant de peur. Il ne sait pas trop ce que c’est la mort, car les adultes contournent toujours la question.
Il a maintenant six ans et fait son entrée à « la grande école », l’école primaire du Pont des Planches, un bâtiment à l’architecture caractéristique de l’esprit de la Troisième République, avec son grand fronton et ses fenêtres hautes aux rideaux beiges. Dans cette cité ouvrière les enfants se répartissent pour un tiers entre ceux d’origine espagnole, les parents sont des réfugiés de la Guerre d’Espagne, un tiers d’origine italienne, les parents ont fui la pauvreté, et le dernier tiers d’origine française, les parents espèrent une vie meilleure, à moins qu’ils ne soient résignés.
Sur le chemin de l’école qu’empruntent ensemble sans rien dire Louis et Ilaan, les trottoirs étroits sont émaillés de flaques d’eau gelées dès la Toussaint. La cour de l’école est balayée par la bise, les maîtres et les maîtresses, calfeutrés dans de lourds manteaux s’abritent sous un porche, les enfants courent, les enfants crient, certains essuient avec leur manche la morve jaune et vert qui s’écoule obstinément jusqu’à leurs lèvres. Puis de retour en classe c’est le réconfort que dispensent les radiateurs en fonte du chauffage central, un réconfort de courte durée, bien vite effacé par les heures ternes et interminables, la discipline et la torpeur dont la logorrhée du maître peine à faire sortir des élèves lassés par la stérile contemplation des murs d’une couleur indéfinissable en errance entre le jaune délavé et un gris vert insignifiant. Et pourtant, un matin gris et pluvieux, cet homme mortellement adapté à sa fonction, ce volcan éteint dont le regard a épousé le gris de sa blouse, stupéfie la classe qui navigue entre le sommeil et l’ennui, et cela aux dépens d’Ilaan : à la question « quel est le premier producteur de charbon en Europe », Ilaan qui surnage sur l’océan de la lassitude, lève le doigt :
Tous redoutent, ou espèrent qu’il étouffe de rage.
L’école c’est aussi l’hiver, un hiver qui n’en finit pas de se traîner de septembre à juillet. Appuyé au bastingage, sa mère à sa gauche, son frère à sa droite, Ilaan se demande si le monde nouveau que l’on devine au loin sera lui aussi la terre d’un hiver interminable. Le long paquebot noir aux deux grandes cheminées, ils l’ont pris à Marseille ; la traversée a été marquée par de très fortes houles, le bateau tanguait, roulait, craquait et maintenant la mer est calme, le soleil déjà haut. Ce monde nouveau c’est l’Algérie, dont les deux frères ignorent les convulsions. Leur père les attend sur le port ; la ville s’appelle Philippeville, en hommage au roi Louis-Philippe dont ils ne connaissent pas encore l’existence paradoxale, à la fois insignifiante et capable d’ordonner de terribles répressions. Quelques années plus tard, la ville reprendra son nom algérien, Skikda. Sur la gauche le port et la ville se dessinent de plus en plus nettement, sur la droite de la baie c’est Stora, le village où ils habiteront, avec ses maisons prises en étau entre mer et montagne. Voici une année déjà que le père est en Algérie, « pour l’avancement ». Il a trouvé un appartement à louer dans une maison en bord de mer dans ce village à trois kilomètres de Philippeville.
Philippeville ! l’Algérie ! Un autre monde qui n’étonne guère les enfants et qui inquiète un peu, parfois beaucoup les adultes engoncés dans leur certitude d’appartenir à la civilisation. Louis et Ilaan découvrent une ville blanche avec ses arcades, ses bazars, dont les articles déposés sur des tapis débordent dans la rue. Dans la rue où l’on croise beaucoup d’hommes et quelques femmes portant de larges djellabas, souvent un voile recouvre leurs cheveux teints au henné. La plupart des hommes portent un burnous, ce long manteau de laine avec une capuche, certains sont en djellaba ou portent le sarouel ; ils sont coiffés d’un turban ou de la chéchia. La dignité de la tenue tant vestimentaire que corporelle des Algériens contraste avec l’arrogance des européens, qui se répartissent entre français d’Algérie, qu’on appelle les pieds-noirs et Français de France, qu’on appelle non sans quelque mépris, les métropolitains. Ceux-ci ne s’intégreront ni à la société des pieds-noirs ni à celle des Algériens.
Ici dans l’est de l’Algérie les pieds-noirs sont les descendants depuis quelques générations de paysans ayant quitté leur village natal du sud de l’Italie en quête d’une vie meilleure, pour devenir des colons auxquels l’état français a attribué des terres ou quelque poste sans éclat de petit fonctionnaire. À Stora les pieds-noirs sont d’origine sicilienne. Les colons ont répondu à l’incitation de la France, leur nouvelle patrie, à laisser derrière eux la pauvreté et la misère pour l’espérance d’une vie prospère. Ils pensent que la terre d’Algérie leur appartient : la France ne leur a-t-elle pas distribué les terres qu’elle leur avait promises ? Autour de Philippeville ils ont planté des orangers, de la vigne et des oliviers. À Stora, ils ont construit les maisons blanches à terrasse du bord de mer, l’église et la place du marché, et fermant la baie à côté des vestiges de l’ancien port phénicien, un petit port de pêche. Et une sardinerie qui se distingue par sa laideur.
Quant aux Algériens, on les oublierait presque, ils sont refoulés à l’extérieur du village dans des gourbis. Ils n’ont pas les mêmes droits, ils sont certes citoyens français, mais de seconde zone. Il ne semble venir à l’idée de personne qu’ils sont les vrais propriétaires de ce vaste pays de mer, de plaines et de montagnes arides, d’étendues de sable sans fin avec de-ci de-là des oasis aux palmiers verts et fiers, se dressant tels des sémaphores au milieu d’un océan de dunes sans cesse mouvantes.
L’Algérie pour Ilaan ce n’est pas le miroitement du soleil sur la Méditerranée ni l’éclat des maisons blanches en plein midi ni le parfum des orangers, ce n’est pas non plus les buissons de figuiers de Barbarie qui se dressent comme un défi sur les pentes desséchées de la montagne. L’Algérie pour Ilaan c’est un océan de morne et de gris, c’est la vie en suspens. La vie en souffrance. Une souffrance silencieuse que chaque communauté feint d’ignorer, les métropolitains parce qu’ils savent qu’ils ne trouveront jamais leur place entre deux communautés que rien ne saurait réconcilier ; les Algériens parce qu’ils se sentent profondément humiliés et se réfugient dans l’attente et l’espoir de recouvrer leur dignité et la prospérité ; face à l’inéluctable, les pieds-noirs nient l’évidence qui s’imposera cruellement dans quelques années. L’Algérie pour Ilaan c’est la dépression et la solitude d’une mère qui à chaque soupir instille la lassitude, l’ennui et la déception, c’est aussi un père qui est rarement à la maison en raison des « évènements » ; ce père dont il subodore qu’il n’est pas à sa place. Il a obtenu certes de l’avancement, mais était-ce bien son désir ou celui de son épouse ? N’a-t-il pas embrassé une carrière pour laquelle il n’était pas fait ? Ce sont ses attitudes, ses gestes et les intonations de sa voix ainsi que ses silences qui le disent silencieusement et douloureusement.
Ilaan soulève les paupières, son regard usé contemple l’éclat de la jade et de l’ébène. Tout est calme, tout est paix. Elle sourit un peu puis ses yeux, ses lèvres s’illuminent, dissipant l’ombre qui s’était immiscée sur son front. Il sourit et ses yeux las se ferment sur les mémoires de la vie qui s’éloigne.
Son père ! n’a-t-il pas toujours été en porte-à-faux, depuis sa naissance jusqu’à son dernier souffle ? Même son prénom semblait le prédestiner au sacrifice, Abel. Son premier cri est un appel, une requête en légitimité, car il sait, c’est-à-dire que son corps, ses cellules savent que celui que l’on attend ce n’est pas lui. Celui que l’on attend, celui que l’on veut voir à travers son regard, au-delà de ses rires et de ses peines, c’est l’enfant qui est mort très tôt, à six mois à peine et dont on ne s’est jamais consolé, cet enfant que l’on avait appelé… Abel. Alors Abel qui est-ce ? C’est lui et ce n’est pas lui. Abel c’est un fantôme qui se cache derrière un corps, derrière une personne qui a usurpé son nom. Son frère a eu plus de chance, on l’a appelé Aimé, il est le premier de la fratrie ; après lui viendront Anna et Abel, le premier, le légitime ; à son tour paraîtra Abel l’illicite, anaphore impuissante dans laquelle survit celui que l’on attendait. Des deux, lequel est véritablement le fantôme ? Nul ne peut le dire.
Ilaan revoit les photos en noir et blanc des grands-parents qu’il n’a jamais connus : la mère de son père, qui porte le regard ténébreux, digne et austère des femmes de la dure terre des confins de l’Ardèche et de la Haute-Loire, le père de son père à l’autorité que l’on devine rigide, mais bienveillante, et qui est son grand-père. Celui-ci, après la mort prématurée de son épouse, assuma seul la responsabilité de ses enfants, dans une austérité quasiment monastique dont Ilaan est l’héritier.
À son tour, cet homme, noble dans l’infortune et dans cet entre-deux entre la misère et le nécessaire est trop tôt enlevé à la vie, soustrait à ses enfants que les dames de la paroisse prennent alors en charge, permettant à Abel d’entrer au petit séminaire pour poursuivre sa scolarité gratuitement, une chance que n’ont pas eue sa sœur et son frère. Il ne passera que la première moitié de son baccalauréat, la guerre interrompant le cours de ses études. Puis il fera la rencontre de celle qu’il épousera un beau matin de l’été 1948. Quelques photos jaunies font découvrir un couple qui semble heureux. Peut-être pas heureux, plutôt riche de l’insouciance de la jeunesse, cette jeunesse remplie d’espoir et de confiance après les années noires de la guerre et de l’occupation. Mais très vite, trop vite viennent les photos où l’on croise le regard taciturne du père et les épaules de la mère qui s’affaissent, annonçant ses compromis, ses petits mensonges et sa quérimonie.
Enfin le père restera à tout jamais dans la mémoire d’Ilaan l’appel silencieux qui résonna un soir d’automne. Ce soir d’octobre où, à la sortie du collège, il allait à vélo côte à côte avec Richard, son camarade. Sans doute parce qu’il avait perçu l’inquiétude d’Ilaan, Richard s’enquit de l’état de santé de son père qu’il savait de nouveau hospitalisé. C’est alors qu’un pressentiment envahit Ilaan. Arrivés rue Bourgchanin, comme d’habitude leurs chemins se séparèrent. Ilaan entendait l’appel de son père, là-bas sur son lit d’hôpital, il s’engagea dans la direction de la petite ville que formaient les nombreux pavillons formant l’hôpital de Grange Blanche. Il suffisait d’emprunter le chemin longeant le boulevard de ceinture, car il ne connaissait pas l’itinéraire à prendre à travers la ville. Déjà il se voyait déposant sa bicyclette au pied du pavillon H bis. Mais les infirmières le laisseront-elles entrer, lui diront-elles qu’il n’a rien à faire dans la chambre n° 12 ? Et il ne faisait aucun doute que sa mère s’inquiéterait ; chez eux on n’avait pas le téléphone, encore peu répandu. Sa mère et sa grand-mère s’angoisseront et elles ne chercheront pas à comprendre sa conduite. Alors il se compromit, fit demi-tour et prit la direction d’une maison où la vie est en sursis. Au milieu de la nuit, il entendit sonner, il entend encore le son de cette cloche et sa mère en panique s’habillant rapidement, le bref conciliabule avec la grand-mère en bas de la maison, puis la mère montant dans la voiture des gendarmes venus la conduire à l’hôpital. Ilaan avait compris et fit comme s’il n’avait rien entendu. Au matin seule la grand-mère fut capable de faire face un tant soit peu à la situation, elle ne put que dire « il est arrivé quelque chose à votre père ! » Quelque chose qu’elle n’avait pas plus que la mère le courage de nommer. Ensuite ce fut la chambre mortuaire, les collègues se relayant pour veiller le corps pendant trois jours et trois nuits, les prêtres venus bénir le corps, et lorsqu’ils invitèrent à prier, la grand-mère qui ostensiblement regagna son appartement en marmonnant que le « Bon Dieu ne devrait pas permettre ça ». Puis vint la cérémonie à l’église, les condoléances et les hochements de tête qui disaient « ces deux-là sont à peine adolescents, que deviendront-ils ? » Bien des années passeront avant qu’Ilaan soit délivré du sentiment de culpabilité qui accompagne l’évocation de l’image à jamais gravée de son renoncement à répondre à l’appel de son père, qui mourut seul, anonyme et sans bruit dans cette chambre n° 12 du pavillon H bis ; c’est un interne qui constata le décès en faisant sa surveillance de routine. Son père ne se plaignait pas, son père ne se plaignait jamais, comme Ilaan ; sa main n’aurait jamais imploré, comme Ilaan, et il était fier et taciturne, comme Ilaan. Il n’était pas une victime, il restait digne malgré la déchéance de la maladie.
L’Algérie dans la mémoire d’Ilaan c’est aussi un kaléidoscope d’images aux couleurs vives associées aux senteurs d’embruns, au son rauque de la langue arabe mêlée à l’inimitable accent pied-noir, et par-dessus tout à ces nuits étranges qui apportent le bruit sourd des tirs au loin dans la montagne ; cette montagne équivoque, qui semble veiller sur le village le jour pour se métamorphoser la nuit en une menace vague, mais certaine, un futur inconnu, imminent et sans cesse reporté. La montagne est habitée par des invisibles, ces Algériens que l’arrivée des colons a refoulés à distance des maisons blanches, ces invisibles qui sont une présence silencieuse, une vibration presque imperceptible et insistante. Ils sont si proches et pourtant des inconnus que l’on croise le jour sans jamais les rencontrer. Leur existence est un danger, mais pas pour Ilaan ; du haut de ses huit ans, de ses neuf ans, de ses dix ans et de ses onze ans, il se sent en affinité avec ce peuple banni dans son propre pays, il se sait étranger, définitivement, au monde vide et terne qui l’entoure ici en Algérie et qui n’est pas différent de celui qu’il a quitté de l’autre côté de la Méditerranée.
Le jour, les convois militaires traversent le village, remontent la rue principale qui longe la plage et parvenus à hauteur de la place du marché, ils empruntent la route étroite à gauche qui forme une boucle s’élevant au-dessus du clocher de l’église, pour s’aventurer dans la montagne jusqu’au fortin qui, à un peu moins de deux kilomètres, interdit l’accès au vaste domaine où règnent les fellaghas ; puis ils se hasardent et se perdent dans le maquis qui leur promet la mort. Le lendemain, parfois très tôt à l’aube, les camions, bâchés, retraversent le village dans un silence lourd et s’éloignent lentement, avec dans leur sillage une peine inconsolable. Et chacun chasse bien vite ces nuages noirs en retournant à ses occupations ou les noie dans un verre d’anisette. Chacun retourne à l’ennui qui s’accroche au corps comme une sangsue, l’ennui qui émousse les sens. L’ennui, ce poison de l’âme.





























