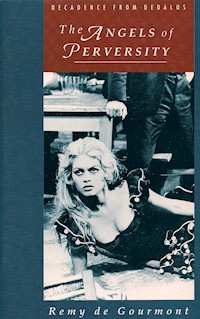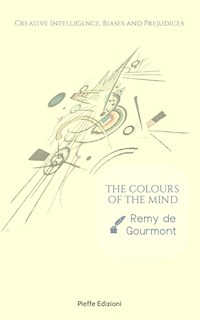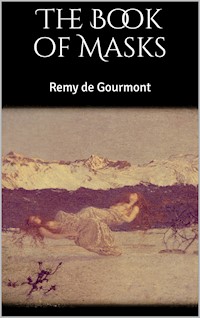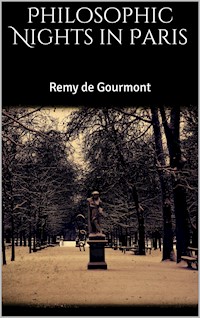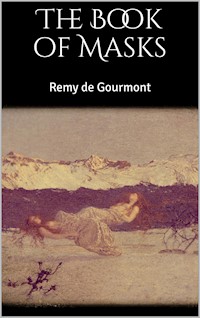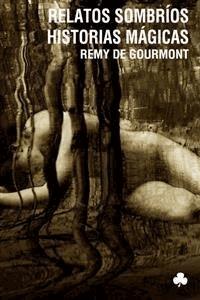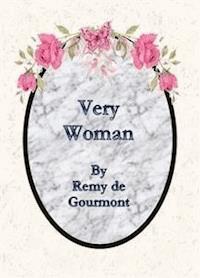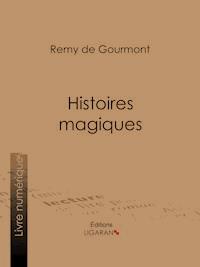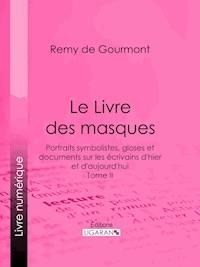Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Le Livre des Masques, publié en 1896 par Remy de Gourmont, est une oeuvre littéraire unique qui dresse des portraits critiques et littéraires de trente écrivains contemporains de l'auteur. Illustré par les dessins de Félix Vallotton, ce recueil se distingue par son approche originale et son style incisif. Gourmont, figure influente du symbolisme, utilise ces "masques" pour explorer les personnalités littéraires de son temps, offrant à la fois une analyse esthétique et psychologique de chaque auteur. Parmi les écrivains présentés, on retrouve des figures emblématiques telles que Stéphane Mallarmé, Maurice Maeterlinck, Émile Verhaeren, et Paul Verlaine. Chaque portrait est une combinaison de critique littéraire et de réflexion personnelle, où Gourmont met en lumière les qualités et les défauts des auteurs, ainsi que leur contribution à la littérature de l'époque. Il ne se contente pas de décrire leur oeuvre, mais s'intéresse également à leur influence sur le mouvement symboliste et leur place dans le panorama littéraire. L'ouvrage est structuré de manière à offrir une vision d'ensemble de la scène littéraire de la fin du XIXe siècle, tout en permettant au lecteur de découvrir les particularités de chaque écrivain. Le Livre des Masques est à la fois un hommage et une critique, révélant la complexité et la richesse de la création littéraire de l'époque. La plume de Gourmont, à la fois acérée et poétique, fait de ce recueil un incontournable pour les amateurs de littérature symboliste et de critique littéraire. Aujourd'hui, Le Livre des Masques est considéré comme une oeuvre de référence dans les catégories de Critique littéraire, Littérature symboliste, et Biographies littéraires sur Amazon. Il continue d'inspirer les lecteurs et les chercheurs par sa profondeur analytique et son style unique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
PREFACE
MAURICE MAETERLINCK
ÉMILE VERHAEREN
HENRI DE RÉGNIER
FRANCIS VIELÉ-GRIFFIN
STÉPHANE MALLARMÉ
ALBERT SAMAIN
PIERRE QUILLARD
A.-FERDINAND HEROLD
ADOLPHE RETTÉ
VILLIERS DE L’ISLE-ADAM
LAURENT TAILHADE
JULES RENARD
LOUIS DUMUR
GEORGES EEKHOUD
PAUL ADAM
LAUTRÉAMONT
TRISTAN CORBIÈRE
ARTHUR RIMBAUD
FRANCIS POICTEVIN
ANDRÉ GIDE
PIERRE LOUYS
RACHILDE
J.-K. HUYSMANS
JULES LAFORGUE
JEAN MORÉAS
STUART MERRILL
SAINT-POL-ROUX
ROBERT DE MONTESQUIOU
GUSTAVE KAHN
PAUL VERLAINE
BIBLIOGRAPHIE
PREFACE
Il est difficile de caractériser une évolution littéraire à l’heure où les fruits sont encore incertains, quand la floraison même n’est pas achevée dans tout le verger. Arbres précoces, arbres tardifs, arbres douteux et qu’on ne voudrait pas encore appeler stériles : le verger est très divers, très riche, trop riche ; — la densité des feuilles engendre de l’ombre et l’ombre décolore les fleurs et pâlit les fruits.
C’est parmi ce verger opulent et ténébreux qu’on se promènera, s’asseyant un instant au pied des arbres les plus forts, les plus beaux ou les plus agréables.
Quand elles le méritent par leur importance, leur nécessité, leur à-propos, les évolutions littéraires reçoivent un nom ; ce nom très souvent n’a pas de signification précise, mais il est utile : il sert de signe de ralliement à ceux qui le reçoivent, et de point de mire à ceux qui le donnent ; on se bat ainsi autour d’un labarum purement verbal. Que veut dire Romantisme ? Il est plus facile de le sentir que de l’expliquer. Que veut dire Symbolisme ? Si l’on s’en tient au sens étroit et étymologique, presque rien ; si l’on passe outre, cela peut vouloir dire : individualisme en littérature, liberté de l’art, abandon des formules enseignées, tendances vers ce qui est nouveau, étrange et même bizarre ; cela peut vouloir dire aussi : idéalisme, dédain de l’anecdote sociale, antinaturalisme, tendance à ne prendre dans la vie que le détail caractéristique, à ne prêter attention qu’à l’acte par lequel un homme se distingue d’un autre homme, à ne vouloir réaliser que des résultats, que l’essentiel ; enfin, pour les poètes, le symbolisme semble lié au vers libre, c’est-à-dire démailloté, et dont le jeune corps peut s’ébattre à l’aise, sorti de l’embarras des langes et des liens.
Tout cela n’a que peu de rapports avec les syllabes du mot, — car il ne faut pas laisser insinuer que le symbolisme n’est que la transformation du vieil allégorisme ou de l’art de personnifier une idée dans un être humain, dans un paysage, dans un récit. Un tel art est l’art tout entier, l’art primordial et éternel, et une littérature délivrée de ce souci serait inqualifiable ; elle serait nulle, d’une signification esthétique adéquate aux gloussements du hocco ou aux braiements de l’onagre.
La littérature n’est pas en effet autre chose que le développement artistique de l’idée, que la symbolisation de l’idée au moyen de héros imaginaires. Les héros, ou les hommes (car chaque homme est un héros, dans sa sphère) ne sont qu’ébauchés par la vie ; c’est l’art qui les complète en leur donnant, en échange de leur pauvre âme malade, le trésor d’une immortelle idée, et le plus humble peut être appelé à cette participation, s’il est élu par un grand poète. Quel humble que cet Énée que Virgile charge de tout le fardeau d’être l’idée de la force romaine, et quel humble que ce Don Quichotte à qui Cervantès impose l’épouvantable poids d’être à la fois Roland et les quatre fils Aymon, Amadis, Palmerin, Tristan et tous les chevaliers de la Table ronde ! L’histoire du symbolisme, ce serait l’histoire de l’homme même, puisque l’homme ne peut s’assimiler une idée que symbolisée. Il ne faut pas insister, car nous pourrions croire que les jeunes dévots du symbolisme ignorent jusqu’à la Vita Nuova et ce personnage de Béatrice, dont les frêles et pures épaules restent pourtant droites sous le complexe faix des symboles dont le poète l’accable.
D’où est donc venue l’illusion que la symbolisation de l’idée était une nouveauté ? Voici.
Nous eûmes, en ces dernières années, un essai très sérieux de littérature basée sur le mépris de l’idée et le dédain du symbole. On en connaît la théorie, qui semble culinaire : Prenez une tranche de vie, etc. M. Zola, ayant inventé la recette, oublia de s’en servir. Ses « tranches de vie » sont de lourds poèmes d’un lyrisme fangeux et tumultueux, romantisme populaire, symbolisme démocratique, mais toujours pleins d’une idée, toujours gros d’une signification allégorique. Germinal, la Mine, la Foule, la Grève. La révolte idéaliste ne se dressa donc pas contre les œuvres (à moins que contre les basses œuvres) du naturalisme, mais contre sa théorie ou plutôt contre sa prétention ; revenant aux nécessités antérieures, éternelles, de l’art, les révoltés crurent affirmer des vérités nouvelles, et même surprenantes, en professant leur volonté de réintégrer l’idée dans la littérature ; ils ne faisaient que rallumer le flambeau ; ils allumèrent aussi, tout autour, beaucoup de petites chandelles.
Une vérité nouvelle, il y en a une, pourtant, qui est entrée récemment dans la littérature et dans l’art, c’est une vérité toute métaphysique et toute d’a priori (en apparence), toute jeune, puisqu’elle n’a qu’un siècle et vraiment neuve, puisqu’elle n’avait pas encore servi dans l’ordre esthétique. Cette vérité, évangélique et merveilleuse, libératrice et rénovatrice, c’est le principe de l’idéalité du monde. Par rapport à l’homme, sujet pensant, le monde, tout ce qui est extérieur au moi, n’existe que selon l’idée qu’il s’en fait. Nous ne connaissons que des phénomènes, nous ne raisonnons que sur des apparences ; toute vérité en soi nous échappe ; l’essence est inattaquable. C’est ce que Schopenhauer a vulgarisé sous cette formule si simple et si claire : Le monde est ma représentation. Je ne vois pas ce qui est ; ce qui est, c’est ce que je vois. Autant d’hommes pensants, autant de mondes divers et peut-être différents. Cette doctrine, que Kant laissa en chemin pour se jeter au secours de la morale naufragée, est si belle et si souple qu’on la transpose sans en froisser la libre logique de la théorie à la pratique, même la plus exigeante, principe universel d’émancipation de tout homme capable de comprendre. Elle n’a pas révolutionné que l’esthétique, mais ici il n’est question que d’esthétique.
On donne encore dans des manuels une définition du beau ; on va plus loin : on donne les formules par quoi un artiste arrive à l’expression du beau. Il y a des instituts où l’on enseigne ces formules, qui ne sont que la moyenne et le résumé d’idées ou d’appréciations antérieures. En esthétique, les théories étant généralement obscures, on leur adjoint l’exemple, l’idéal parangon, le modèle à suivre. En ces instituts (et le monde civilisé n’est qu’un vaste Institut) toute nouveauté est tenue pour blasphématoire, et toute affirmation personnelle devient un acte de démence. M. Nordau, qui a lu, avec une patience bizarre, toute la littérature contemporaine, propagea cette idée vilainement destructrice de tout individualisme intellectuel que le « non conformisme » est le crime capital pour un écrivain. Nous différons violemment d’avis. Le crime capital pour un écrivain c’est le conformisme, l’imitativité, la soumission aux règles et aux enseignements. L’œuvre d’un écrivain doit être non seulement le reflet, mais le reflet grossi de sa personnalité. La seule excuse qu’un homme ait d’écrire, c’est de s’écrire lui-même, de dévoiler aux autres la sorte de monde qui se mire en son miroir individuel ; sa seule excuse est d’être original ; il doit dire des choses non encore dites et les dire en une forme non encore formulée. Il doit se créer sa propre esthétique, — et nous devrons admettre autant d’esthétiques qu’il y a d’esprits originaux et les juger d’après ce qu’elles sont et non d’après ce qu’elles ne sont pas.
Admettons donc que le symbolisme, c’est, même excessive, même intempestive, même prétentieuse, l’expression de l’individualisme dans l’art.
Cette définition, trop simple, mais claire, nous suffira provisoirement. Au cours des suivants portraits, ou plus tard, nous aurons sans doute l’occasion de la compléter ; son principe servira encore à nous guider, en nous incitant à rechercher, non pas ce que devraient faire, selon de terribles règles, selon de tyranniques traditions, les écrivains nouveaux, mais ce qu’ils ont voulu faire. L’esthétique est devenue, elle aussi, un talent personnel ; nul n’a le droit d’en imposer aux autres une toute faite. On ne peut comparer un artiste qu’à lui-même, mais il y a profit et justice à noter des dissemblances : nous tâcherons de marquer, non en quoi les « nouveaux venus » se ressemblent, mais en quoi ils diffèrent, c’est-à-dire en quoi ils existent, car être existant, c’est être différent.
Ceci n’est pas écrit pour prétendre qu’il n’y a pas entre la plupart d’entre eux d’évidentes similitudes de pensée et de technique, fait inévitable, mais tellement inévitable qu’il est sans intérêt. On n’insinue pas davantage que cette floraison est spontanée ; avant la fleur, il y a la graine, elle-même tombée d’une fleur ; ces jeunes gens ont des pères et des maîtres : Baudelaire, Villiers de l’Isle-Adam, Verlaine, Mallarmé, et d’autres. Ils les aiment morts ou vivants, ils les lisent, ils les écoutent. Quelle sottise de croire que nous dédaignons ceux d’hier ! Qui donc a une cour plus admirative et plus affectueuse que Stéphane Mallarmé ? Et Villiers est-il oublié ? Et Verlaine délaissé ?
Maintenant, il faut prévenir que l'ordre de ces portraits, sans être tout à fait arbitraire, n’implique aucune classification de palmarès, il y a même, hors de la galerie, des absents notoires, qu’une occasion nous ramènera ; il y a des cadres vides et aussi des places nues ; quant aux portraits mêmes, si quelques-uns les jugent incomplets et trop brefs, nous répondrons les avoir voulus ainsi, n’ayant la prétention que de donner des indications, que de montrer, d’un geste du bras, la route.
Enfin, pour rejoindre aujourd’hui à hier, nous avons intercalé, parmi les figures nouvelles, des faces connues : et alors, au lieu de récrire une physionomie familière à beaucoup, on a cherché à mettre en lumière, plutôt que l’ensemble, tel point obscur.
Les renseignements bibliographiques de l’Appendice, aussi précis que possible, sont là pour ajouter à ce tome de littérature, qui se glorifie d’abord des insignes masques de M. F. Vallotton, un petit intérêt documentaire.
R. G.
MAURICE MAETERLINCK
De la vie vécue par des êtres douloureux qui se meuvent dans le mystère d’une nuit. Ils ne savent rien que souffrir, sourire, aimer ; quand ils veulent comprendre, l’effort de leur inquiétude devient de l’angoisse et leur révolte s’évanouit en sanglots. Monter, monter toujours les dolentes marches du calvaire et se heurter le front à une porte de fer : ainsi monte sœur Ygraine, ainsi monte et se heurte à la cruauté de la porte de fer chacune des pauvres créatures dont M. Maeterlinck nous dévoile les simples et pures tragédies.
En d’autres temps le sens de la vie fut connu ; alors les hommes n’ignoraient rien d’essentiel, puisqu’ils savaient le but de leur voyage et en quelle dernière auberge se trouvait le lit du repos. Quand, par la Science même, cette science élémentaire leur eut été enlevée, les uns se réjouirent, se croyant allégés d’un fardeau ; les autres se lamentèrent, sentant bien que par-dessus tous les autres fardeaux de leurs épaules on en avait jeté un, à lui tout seul plus lourd que le reste : le fardeau du Doute.
De cette sensation toute une littérature est née, littérature de douleur, de révolte contre le fardeau, de blasphèmes contre le Dieu muet. Mais, après la furie des cris et des interrogations, il y eut une rémittence, et ce fut la littérature de la tristesse, de l’inquiétude et de l’angoisse ; la révolte a été jugée inutile et puérile l’imprécation : assagie par de vaines batailles, l’humanité lentement se résigne à ne rien savoir, à ne rien comprendre, à ne rien craindre, à ne rien espérer, — que de très lointain.
Il y a une île quelque part dans les brouillards, et dans l’île il y a un château, et dans le château il y a une grande salle éclairée d’une petite lampe, et dans la grande salle il y a des gens qui attendent. Ils attendent quoi ? Ils ne savent pas. Ils attendent que l’on frappe à la porte, ils attendent que la lampe s’éteigne, ils attendent la Peur, ils attendent la Mort. Ils parlent ; oui, ils disent des mots qui troublent un instant le silence, puis ils écoutent encore, laissant leurs phrases inachevées et leurs gestes interrompus. Ils écoutent, ils attendent. Elle ne viendra peut-être pas ? Oh ! elle viendra. Elle vient toujours. Il est tard, elle ne viendra peut-être que demain. Et les gens assemblés dans la grande salle sous la petite lampe se mettent à sourire et ils vont espérer. On frappe. Et c’est tout ; c’est toute une vie, c’est toute la vie.
En ce sens, les petits drames de M. Maeterlinck, si délicieusement irréels, sont profondément vivants et vrais ; ses personnages, qui ont l’air de fantômes, sont gonflés de vie, comme ces boules qui semblent inertes et qui, chargées d’électricité, vont fulgurer au contact d’une pointe ; ils ne sont pas des abstractions, mais des synthèses ; ils sont des états d’âme ou, plus encore, des états d’humanité, des moments, des minutes qui seraient éternelles : en somme ils sont réels, à force d’irréalité.
Une telle sorte d’art fut pratiquée jadis, à la suite du Roman de la Rose, par de pieux romanciers qui firent, en des livrets d’une gaucherie prétentieuse, évoluer des abstractions et des symboles. Le Voyage d'un nommé Chrétien (The Pilgrim’s Progress), de Bunyan, le Voyage spirituel, de l’espagnol Palafox, le Palais de l'Amour divin, d’un inconnu, ne sont pas œuvres totalement méprisables, mais les choses y sont vraiment trop expliquées et les personnages y portent des noms vraiment trop évidents. Voit-on sur quelque théâtre libre un drame joué entre des êtres qui se nomment Cœur, Haine, Joie, Silence, Souci, Soupir, Peur, Colère et Pudeur ! L’heure de tels amusements est passée ou n’est pas revenue : ne relisez pas le Palais de l'Amour divin ; lisez la Mort de Tintagiles, car c’est à l’œuvre nouvelle qu’il faut demander ses plaisirs esthétiques, si on les veut complets, poignants et enveloppants. M. Maeterlinck, vraiment, nous prend, nous point et nous enlace, pieuvre faite des doux cheveux des jeunes princesses endormies, et au milieu d’elles le sommeil agité du petit enfant, « triste comme un jeune roi » ! Il nous enlace et nous emporte où il lui plaît, jusqu’au fond des abîmes où tournoie « le cadavre décomposé de l’agneau d’Alladine », — et plus loin, jusque dans les obscures et pures régions où des amants disent : « Que tu m’embrasses gravement... — Ne ferme pas les yeux quand je t’embrasse ainsi... Je veux voir les baisers qui tremblent dans ton cœur ; et toute la rosée qui monte de ton âme... nous ne trouverons plus de baisers comme ceux-ci... — Toujours, toujours !... — Non, non : on ne s’embrasse pas deux fois sur le cœur de la mort... » À de si beaux soupirs toute objection devient muette ; on se tait d’avoir senti un nouveau mode d’aimer et de dire son amour. Nouveau, vraiment ; M. Maeterlinck est très lui-même, et pour rester entièrement personnel, il sait être monocorde : mais cette seule corde, il en a semé, roui, teillé le chanvre, et elle chante douce, triste et unique sous ses languissantes mains. Il a réussi une œuvre vraie ; il a trouvé un cri sourd inentendu, une sorte de gémissement frileusement mystique.
Mysticisme, ce mot a pris en ces dernières années tant de sens les plus divers et même divergents qu’il faudrait le définir à nouveau et expressément chaque fois qu’on va l’écrire. Certains lui donnent une signification qui le rapprocherait de cet autre mot qui semble clair, individualisme ; et il est certain que cela se touche, puisque le mysticisme peut être dit l’état dans lequel une âme, laissant aller le monde physique et dédaigneuse des chocs et des accidents, ne s’adonne qu’à des relations et à des intimités directes avec l’infini ; or, si l’infini est immuable et un, les âmes sont changeantes et plusieurs : une âme n’a pas avec Dieu les mêmes entretiens que ses sœurs, et Dieu, quoique immuable et un, se modifie selon le désir de chacune de ses créatures et il ne dit pas à l’une ce qu’il vient de dire à l’autre. Le privilège de l’âme élevée au mysticisme est la liberté ; son corps même n’est pour elle qu’un voisin auquel elle donne à peine le conseil amical du silence, mais s’il parle elle ne l’entend qu’à travers un mur, et s’il agit elle ne le voit agir qu’à travers un voile. Un autre nom a été donné, historiquement, à un tel état de vie : quiétisme ; cette phrase de M. Maeterlinck est bien d’un quiétiste, qui nous montre Dieu souriant « à nos fautes les plus graves comme on sourit au jeu des petits chiens sur un tapis ». Elle est grave, mais elle est vraie si l’on songe à ce peu de chose qu’est un fait et comment un fait se produit et comment nous sommes entraînés par la chaîne sans fin de l’Action et combien peu nous participons réellement à nos actes les plus décisifs et les mieux motivés. Une telle morale, laissant aux misérables lois humaines le soin des jugements inutiles, arrache à la vie l’essence même de la vie et la transporte en des régions supérieures où elle fructifie à l’abri des contingences, et des plus humiliantes, qui sont les contingences sociales. La morale mystique ignore donc toute œuvre qui n’est point marquée à la fois du double sceau humain et divin ; aussi fut-elle toujours redoutée des