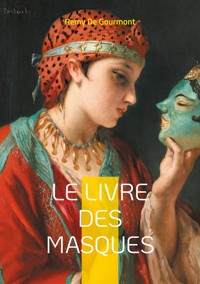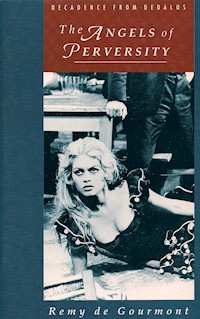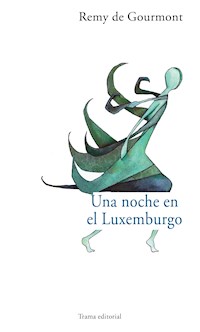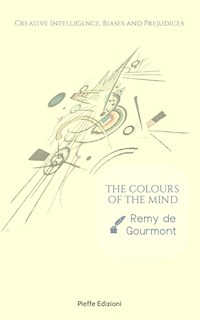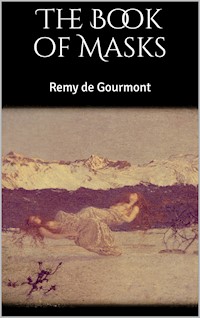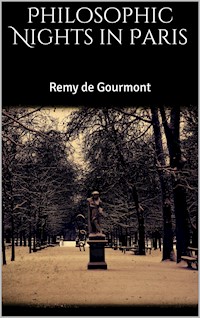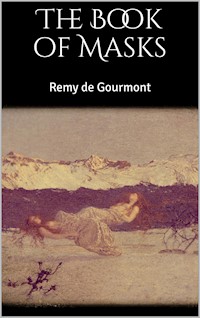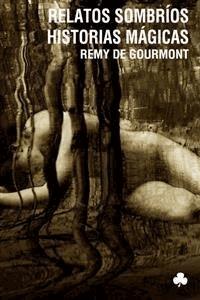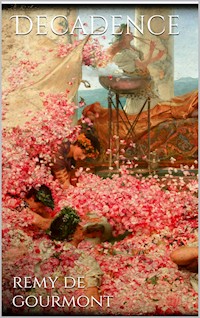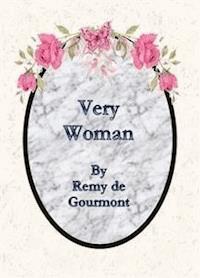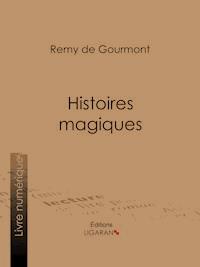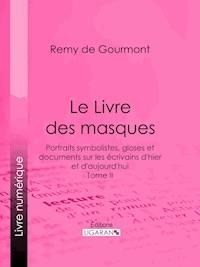
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "FRANCIS JAMMES - Voici un poète bucolique. Il y a Virgile, et peut-être Racan, et un peu Segrais. Nulle sorte de poète n'est plus rare : il faut vivre à l'écart dans les vraies maisons de jadis, à la lisière des bois gardés par les seules ronces, au milieu des ormes noirs, des chênes ridés et des hêtres à la peau douce comme celle d'une amie très aimée..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Si l’on croit nécessaire de connaître la méthode générale qui a guidé l’auteur dans cette seconde série de Masques, on se reportera aux pages placées en tête du premier tome.
Gœthe pensait :
« Quand on ne parle pas des choses avec une partialité pleine d’amour, ce qu’on dit ne vaut pas la peine d’être rapporté. »
C’est peut-être aller loin. La critique négative est nécessaire ; il n’y a pas dans la mémoire des hommes assez de socles pour toutes les effigies : il faut donc parfois briser et jeter à la fonte quelques bronzes injustes et trop insolents. Mais c’est là une besogne crépusculaire ; on ne doit pas convier la foule aux exécutions. Quand nous l’appellerons, ce sera pour qu’elle participe à une fête de gloire.
Certains critiques ont toujours l’air de juges qui, leur sentence rendue, attendent le bourreau.
« Ah ! voici le bourreau ! Nous allons faire un feu de joie et danser autour des cendres de nos amours ! »
Il n’y a plus besoin de bûchers pour les mauvais livres ; les flammes de la cheminée suffisent.
Les pages qui suivent ne sont pas de critique, mais d’analyse psychologique ou littéraire. Nous n’avons plus de principes et il n’y a plus de modèles ; un écrivain crée son esthétique en créant son œuvre : nous en sommes réduits à faire appel à la sensation bien plus qu’au jugement.
En littérature, comme en tout, il faut que cesse le règne des mots abstraits. Une œuvre d’art n’existe que par l’émotion qu’elle nous donne ; il suffira de déterminer et de caractériser la nature de cette émotion ; cela ira de la métaphysique à la sensualité, de l’idée pure au plaisir physique.
Il y a tant de cordes à la lyre humaine ! C’est déjà un travail considérable que d’en faire le dénombrement.
27 février.
Voici un poète bucolique. Il y a Virgile, et peut-être Racan, et un peu Segrais. Nulle sorte de poète n’est plus rare : il faut vivre à l’écart dans les vraies maisons de jadis, à la lisière des bois gardés par les seules ronces, au milieu des ormes noirs, des chênes ridés et des hêtres à la peau douce comme celle d’une amie très aimée ; l’herbe n’est pas un gazon vain tondu pour simuler le velours des sofas : on en fait du foin, que les bœufs mangent avec joie en cognant contre la crèche l’anneau qui attache leur licou ; et les plantes ont une vertu et un nom :
Cela fait partie d’un « mois de mars » raconté par Francis Jammes (pour l’Almanach des Poètes de l’an passé), petit poème qui parut tel qu’une violette (ou une améthyste) trouvée le long d’une haie, parmi les premiers sourires de l’année. Tout entier, il est admirable d’art et de grâce et d’une simplicité virgilienne. C’est le premier fragment connu de ces « Géorgiques Françaises » où de bonnes volontés s’essayèrent jadis, en vain.
C’est avec la même sécurité, la même maîtrise que M. Jammes nous dit les travaux du mois de mars :
Il n’y a sans doute pas aujourd’hui en France un autre poète capable d’évoquer un tableau aussi clair et aussi vrai avec des mots aussi simples, avec une phrase qui semble celle d’une causerie distraite et qui pourtant, comme par hasard, forme des vers charmants, purs et définitifs. Cependant le poète suit bien sagement son calendrier et, comme Virgile oublie un instant les soins que l’on donne aux abeilles pour nous conter l’aventure d’Aristée, M. Francis Jammes, arrivé à la fête des Rameaux, nous dit en quelques vers une histoire de Jésus belle et tendre ainsi que les vieilles gravures que l’on clouait dans les alcôves.
Quand nous aurons (et peut-être l’aurons-nous) un calendrier complet écrit dans ce ton de simplicité pathétique, il y aura d’ajouté aux tomes épars qui sont la poésie française un livre inoubliable.
M. Francis Jammes offrit ses premiers vers au public en 1894. Il devait avoir vingt-cinq ans et sa vie avait été ce qu’elle est restée, solitaire au fond des provinces, vers les Pyrénées, mais non dans la montagne :
Les femmes des paysans « ont la peau en terre brune », mais les matins sont bleus et les soirées sont bleues,
Voilà, tout déchiqueté, vu par bribes, le paysage où évoluèrent les émotions de ce poète dont la solitude a exaspéré et parfois troublé l’originalité. Soucieux d’abord de dire son impression du moment, il se répète volontiers, variant par de faibles nuances les détails de la vie qu’il aime. Mais que de visions émues, que de jolies imaginations, et comme les mots viennent doucement écrire des pages dont la fraîcheur fait envie ! Ainsi le tableau de chaste volupté :
et cet autre, d’un sentiment plus intime :
et la complainte d’amour et de pitié qui commence ainsi :
et (malgré une strophe mauvaise) la discrète élégie que résument ces quatre vers d’une musique si tiède et si lasse :
Après encore un an ou deux d’une vie sans doute toujours pareille, le poète a pris une conscience plus décisive de lui-même ; son émotion devient parfois presque plaintive en même temps que la sensualité de l’homme s’exalte, s’avoue avec moins de pudeur, mais toujours sœur d’un sentiment et alors toujours pure malgré sa franchise et la nudité de ses gestes. Ce triple aspect humain, orgueil, émotion, sensualité, le poème en dialogue, appelé Un Jour, le développe, en couleurs vives et douces : quatre scènes où la poésie vole au-dessus d’une vie monotone et presque triste, quatre images très simples, et même, si l’on veut, naïves, mais d’une naïveté qui se connaît et qui connaît sa beauté. Plus que d’ambitieuses paraphrases c’est bien là la journée (ou la vie) d’un poète, qui perçoit le monde extérieur d’abord comme une sensation brute (ainsi que tout autre homme), puis en dégage aussitôt, en son esprit prompt aux généralisations, la signification symbolique ou absolue. Et tout ce poème est plein de vers admirables et graves, des vers d’un vrai poète dont le génie encore en croissance éclate, tel des rayons de soleil à travers une haie d’acacias :
Ne semble-t-il pas que la gaucherie ou le dédaigneux laisser-aller de ce dernier vers ajoute à la pensée sérieuse comme un sourire ? Il y a beaucoup de ces sourires dans la poésie de M. Francis Jammes. Je ne trouve pas qu’il y en ait trop ; j’aime le sourire.
Voilà donc un poète. Il est d’une sincérité presque déconcertante ; mais non par naïveté, plutôt par orgueil. Il sait que vus par lui les paysages où il a vécu tressaillent sous son regard et que les chênes tout secoués parlent et que les rochers resplendissent comme des topazes. Alors il dit toute cette vie surnaturelle et toute l’autre, celle des heures où il ferme les yeux : et la nature et le rêve s’enlacent si discrètement, dans une ombre si bleue et avec des gestes si harmoniques, que les deux natures ne font qu’une seule ligne, une seule grâce :
Il est grand temps, pour notre bon renom, de donner de la gloire à ce poète et, pour notre plaisir, de respirer souvent cette poésie, qu’il a appelée lui-même une poésie de roses blanches.
Celui-ci fait des ballades. Il ne faut rien lui demander de plus, ou de moins, présentement, il fait des ballades et veut en faire encore, en faire toujours. Ces ballades ne ressemblent guère à celles de François Villon ou de M. Laurent Tailhade ; elles ne ressemblent à rien.
Typographiées comme de la prose, elles sont écrites en vers, et supérieurement mouvementés. Cette typographie a donné l’illusion à d’aimables critiques que M. Paul Fort avait découvert la quadrature du cercle rythmique et résolu le problème qui tourmentait M. Jourdain de rédiger des littératures qui ne seraient ni de la prose ni des vers ; il y a bien de la désinvolture dans ce compliment, mais ce n’est qu’un compliment. Si la ligne qui sépare le vers de la prose est souvent devenue, en ces dernières années littéraires, d’une étroitesse presque invisible, elle persiste néanmoins ; à droite, c’est prose ; à gauche, c’est vers ; inexistante pour celui qui passe, les yeux vagues, elle est là, indélébile, pour celui qui regarde. Le rythme du vers est indépendant de la phrase grammaticale ; il place ses temps forts sur des sons et non sur des sens. Le rythme de la prose est dépendant de la phrase grammaticale ; il place ses temps forts sur des sens et non sur des sons. Et comme le son et le sens ne peuvent que très rarement coïncider, la prose sacrifie le son et le vers sacrifie le sens. Voilà une distinction sommaire qui peut suffire, provisoirement.
La question ne se pose d’ailleurs pas à propos des Ballades Françaises, lesquelles sont bien d’un bout à l’autre en vers, ici très pittoresques, très vifs, là très sobres, très beaux ; et non pas même en vers libres (sauf quelques pages) ; en ce vieux vers « nombreux », mais dégagé heureusement de la tyrannie des muettes, ces princesses qu’on ne sait comment saluer. Avec un instinct sûr d’homme de l’Isle-de-France, il les a remises à leur vraie place, leur imposant quand il le faut le silence qui convient à leur nom.
Et tout ce petit poème, vraiment parfait :
J’aime beaucoup de tels vers ; je n’aime guère que de tels vers, où le rythme par des gestes sûrs affirme sa présence et pour une syllabe de plus, une de moins, ne s’évanouit pas. Qui s’aperçoit que le troisième des vers que voici n’a que onze syllabes accentuées ?
Mais assez de rythmique ; il est temps que nous aimions la poésie et non plus seulement les vers des Ballades Françaises. Elles chantent sur trois tons principaux ; le pittoresque, l’émotion, l’ironie régissent successivement, et parfois en même temps, chacun de ces poèmes dont la diversité est vraiment merveilleuse ; c’est le jardin des mille fleurs, des mille parfums et des mille couleurs. Le livre premier est le plus charmant : c’est celui des ballades qui empruntent à la chanson populaire un refrain, le charme d’un mot qui revient comme un son de cloche, un rythme de ronde, une légende ; on sent que le poète a vécu dans un milieu où cette vieille littérature orale était encore vivante, contée ou chantée. De vieux airs sonnent dans ces ballades d’un art pourtant si nouveau :
La mer brille au-dessus de la baie, la mer brille comme une coquille. On a envie de la pêcher. Le ciel est gai, c’est joli Mai.
C’est doux la mer au-dessus de la haie, c’est doux comme une main d’enfant. On a envie de la caresser. Le ciel est gai, c’est joli Mai.
Voici une ronde (peut-être) qui fera encore mieux entendre sa musique oubliée :
Un gentil page vint à passer, une reine gentille vint à chanter, – Roi ! hou – tu les feras pendre, hou, hou, tu les feras tuer.
Un gentil page vint à chanter, une reine gentille vint à descendre. – Roi ! hou – tu les feras moudre, hou, hou, tu les feras tuer.
Le grand gibet dans l’herbe tendre, la meule dorée dans le grand pré. – Roi ! hou – tu feras moudre, hou, hou, tu les feras pendre.
Un moine blanc vint à passer, un moine rouge vint à chanter : – Roi ! hou tu les feras tondre, hou, hou, pour le moutier.
L’émotion régit le second livre. C’est celui de l’amour, de la nature et du rêve : celui des paysages doux et nuancés, bleu et argent. La mer est d’argent, les saules sont d’argent, l’herbe est d’argent ; l’air est bleu, la lune est bleue, les animaux sont bleus.
L’Aube a roulé ses roues de glace dans l’horizon. La terre se découvre en gammes de jour pâle. Un mont reflète, humide, les dernières étoiles, et les animaux bleus boivent l’herbe d’argent.
Et c’est gai, pur, un peu triste aussi comme quand on regarde l’étendue des campagnes, ou la mer, ou le ciel. Les choses ont une manière si solennelle de se coucher dans la brume, une telle attitude d’éternité quand elles sont couchées que nous devenons graves, tout au moins, à ce spectacle qui trouble la mobilité de nos pensées et les arrête et les fixe douloureusement ; mais il y a une joie dans la vue de la beauté, qui, à certaines heures de la vie, peut dominer les autres sensations et nous préparer à l’état de grâce nécessaire à la communion parfaite. C’est le mysticisme dans sa fraîcheur la plus ingénue et dans son amour le plus éloquent. Ainsi la ballade : L’ombre comme un parfum s’exhale des montagnes. Je veux déclarer que cet hymne est beau comme un des beaux chants de Lamartine :
Laisse nager le ciel entier dans tes yeux sombres et mêle ton silence à l’ombre de la terre : si ta vie ne fait pas une ombre sur son ombre, tes yeux et ta rosée sont les miroirs des sphères.
À l’espalier les nuits aux branches invisibles, vois briller ces fleurs d’or, espoir de notre vie, vois scintiller sur nous – scels d’or des vies futures – nos étoiles visibles aux arbres de la nuit.
Contemple, sois ta chose, laisse penser tes sens, éprends-toi de toi-même épars dans cette vie. Laisse ordonner le ciel à tes yeux, sans comprendre, et crée de ton silence la musique des nuits.
La rime manque, parfois même l’assonance ; on n’y prend garde. C’est, renouvelée par de belles images inédites, ta grande poésie romantique. Mais, sans être unique, une émotion aussi profonde est rare dans les Ballades. Le poète a pour l’humour un penchant qu’il veut satisfaire même hors de propos et voici, après un livre sentimental (vieilles estampes en demi-teinte), toute une bizarre mythologie, Orphée, Silène, Hercule, restaurée avec quelque hardiesse, puis l’extraordinaire Louis XI, curieux homme, et Coxcomb, plus étrange encore, puis des ballades étranges encore et encore, – et pas une où il n’y ait quelque trait d’originalité, de poésie ou d’esprit. Nous avons donc le livre le plus varié et les gestes les plus dispersifs. On a peine, si tôt, à y bien retrouver son chemin, tant les pistes s’enroulent et s’enlacent sous les branches, disparaissent dans les buissons, dans les ruisseaux, dans les mousses élastiques, tant l’animal entrevu est singulier, rapide et mouvant. On a défini M. Paul Fort, dans une intention sans doute amicale : le génie pur et simple. Ironique, cela ne serait pas encore très cruel ; sérieux, cela dit une partie de la vérité. Ce poète en effet est une perpétuelle vibration, une machine nerveuse sensible au moindre choc, un cerveau si prompt que l’émotion souvent s’est formulée avant la conscience de l’émotion. Le talent de Paul Fort est une manière de sentir autant qu’une manière de dire.
Des hommes ne sont pas d’accord avec leur temps ; ils ne vivent jamais de la vie du peuple ; l’âme des foules ne leur apparaît pas bien supérieure à l’âme des troupeaux.
Si l’un de ces hommes réfléchit sur lui-même et arrive à se comprendre et à se situer dans le vaste monde, peut-être va-t-il s’attrister, car il sent autour de lui une invincible étendue d’indifférence, une nature muette, des pierres stupides, des gestes géométriques : c’est la grande solitude sociale. Et, au fond de son ennui, il songe au plaisir simple d’être d’accord, de rire avec naïveté, de sourire d’un air discret, de s’émouvoir aux longues commotions. Mais aussi une fierté peut lui venir de son renoncement et de son isolement, soit qu’il ait adopté la pose du stylite, soit qu’il ait fermé sur ses plaisirs la porte d’un palais.
M. Rebell a choisi ce dernier mode : il se présente à nous dans l’attitude de l’aristocrate heureux et dédaigneux.
En un temps où, petits plagiaires de Sénèque le philosophe, les agents de change, les avocats populaires, les professeurs retirés dans un héritage, les millionnaires, les ambassadeurs, les ténors, les ministres et les banquistes, où toute la « noblesse républicaine », hypocritement joyeuse de vivre, s’attendrit avec soin sur le « sort des humbles », au moment même qu’elle leur met le pied sur la nuque, en ce temps-là, il est agréable d’entendre quelques paroles de franchise et M. Rebell dire : « Je veux jouir de la vie telle qu’elle m’a été donnée, selon toute sa richesse, toute sa beauté, toute sa liberté, toute son élégance ; je suis un aristocrate. »
Cela ne signifie pas qu’insensible à toutes les souffrances naturelles il dédaigne le peuple (comme le bourgeois-type qui hait au-dessus de lui et méprise au-dessous) ; il l’aime au contraire, mars d’un amour trop raisonnable et trop élevé pour que le peuple en soit touché. Au pauvre monde que de stupides sermons ont incliné vers les satisfactions de la vanité et du civisme, il enseignerait volontiers la joie toute simple d’être un brave animal. Les plaisirs intellectuels, à quoi bon en suggérer le désir à des cerveaux infailliblement rétifs aux émotions désintéressées, aux élixirs qui n’ont pas tout d’abord gratté le palais et chauffé le ventre ? Donc « le devoir présent est de guérir les vignes malades et de replanter les vignes détruites, afin d’enivrer la France entière ».
Dans le dialogue où je recueille cette phrase, pour une telle opinion le personnage se fait traiter d’humanitaire et d’utopiste, mais on vient à son aide, l’on prouve qu’il en est de l’intelligence comme d’un fleuve et que de trop nombreuses saignées font baisser son niveau. La conclusion est le vieux panem et circenses, du pain, du vin et les jeux, – et fermer les musées et les bibliothèques « et briser les urnes abominables qui, durant tout un siècle, auront livré à la canaille le destin et la pensée des plus grands hommes ». Opinions, comme on le voit, assez insolentes ; il n’est pas nécessaire de les taxer d’excessives : assez de bons esprits les trouveront monstrueuses, car les bons esprits s’éloignent peu des idées communes.
Transporté dans les œuvres d’imagination, l’aristocratisme de M. Rebell devient obscur, se confond volontiers avec la licence des mœurs. On est un peu dérouté. Il n’est pas bien certain que le gitonisme soit une forme très heureuse du mépris des convenances sociales ; ni que l’opposition d’un cardinal débauché à un capucin malpropre soit une démonstration très probante de la supériorité de l’aristocrate sur le mercenaire ; ni qu’un peintre hystérique et vaniteux nous fasse songer aussitôt à Titien ou à Véronèse ; ni qu’une courtisane familière des bouges évoque sans faillir les images émouvantes de la volupté vénitienne. Il y a bien des défauts et bien de la grossièreté dans cette Nichina qui a mis en lumière le nom de M. Rebell ; mais c’est tout de même une œuvre vivante, amusante et riche. On y voit une Venise à la fois délicate et basse, opulente et sordide, superstitieuse et lubrique, plus près sans doute de l’histoire que de la légende ; c’est pourquoi quelques-uns furent choqués.
Nul, au surplus, n’a cru que ce livre dût être regardé comme capital ; essai qui pour d’autres apparaîtrait un considérable effort, la Nichina n’est qu’un prologue pour Hugues Rebell romancier : on attend de lui des histoires et des combinaisons moins arbitraires, des récits dont la tragi-comédie accoucherait d’une idée. Des idées, il en est riche, autant que le plus opulent penseur d’hier ou d’aujourd’hui : il ne lui manque que de savoir les insérer plus solidement dans le cerveau de ses personnages. Ouvrir les Chants de la pluie et du soleil