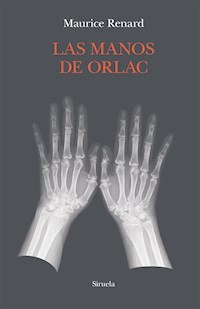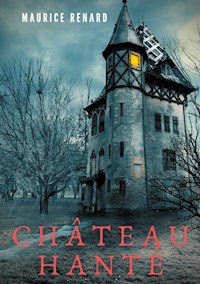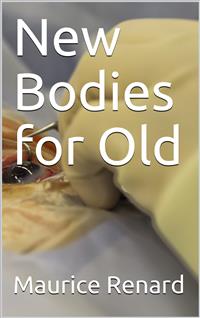1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Cette histoire extraordinaire commence très ordinairement.
À la fin du mois de septembre 1929, le jeune historien Charles Christiani résolut d’aller passer quelques jours à La Rochelle. Spécialisé dans l’étude de la Restauration et du règne de Louis-Philippe, il avait déjà publié, à cette époque, un petit livre très remarqué sur les Quatre Sergents de La Rochelle ; il en préparait un autre sur le même sujet et estimait nécessaire de retourner sur place, pour y consulter certains documents.
Il nous a paru sans intérêt de rechercher pourquoi la famille Christiani était déjà rentrée à Paris, rue de Tournon, à une époque de l’année où les heureux de ce monde sont encore aux bains de mer, en voyage, à la campagne. L’automne se montrait morose, et ce fut, croyons-nous, la seule raison de ce retour un peu prématuré. Car Mme Christiani, sa fille et son fils ne manquaient pas des moyens de mener l’existence la plus large, et disposaient des gîtes champêtres où l’on goûte un repos plus ou moins mouvementé. Deux belles propriétés familiales, en effet, s’offraient à leur choix : le vieux château de Silaz en Savoie, qu’ils délaissaient complètement, et une agréable maison de campagne située près de Meaux ; c’est là qu’ils avaient passé tout l’été.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Le Maître de la lumière
Maurice Renard
1933
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385740863
CHAPITRE PREMIERl’aventure tendre et romanesque
Cette histoire extraordinaire commence très ordinairement.
À la fin du mois de septembre 1929, le jeune historien Charles Christiani résolut d’aller passer quelques jours à La Rochelle. Spécialisé dans l’étude de la Restauration et du règne de Louis-Philippe, il avait déjà publié, à cette époque, un petit livre très remarqué sur les Quatre Sergents de La Rochelle ; il en préparait un autre sur le même sujet et estimait nécessaire de retourner sur place, pour y consulter certains documents.
Il nous a paru sans intérêt de rechercher pourquoi la famille Christiani était déjà rentrée à Paris, rue de Tournon, à une époque de l’année où les heureux de ce monde sont encore aux bains de mer, en voyage, à la campagne. L’automne se montrait morose, et ce fut, croyons-nous, la seule raison de ce retour un peu prématuré. Car Mme Christiani, sa fille et son fils ne manquaient pas des moyens de mener l’existence la plus large, et disposaient des gîtes champêtres où l’on goûte un repos plus ou moins mouvementé. Deux belles propriétés familiales, en effet, s’offraient à leur choix : le vieux château de Silaz en Savoie, qu’ils délaissaient complètement, et une agréable maison de campagne située près de Meaux ; c’est là qu’ils avaient passé tout l’été.
Au moment où nous sommes, le noble et spacieux appartement de la rue de Tournon abritait, en les Christiani, trois êtres parfaitement unis : Mme Louise Christiani, née Bernardi, cinquante ans, veuve d’Adrien Christiani, mort pour la France en 1915 ; son fils Charles, vingt-six ans ; Colomba, sa fille, moins-de-vingt-ans, charmante, à qui nous devons l’adjonction d’un quatrième personnage : Bertrand Valois, le benjamin de nos auteurs dramatiques, le plus heureux fiancé sur le globe terrestre.
Il faut noter que Mme Christiani tenta — sans insister, du reste, — de décider son fils à retarder son départ pour La Rochelle. Elle avait reçu, le matin même, une lettre qui lui semblait motiver un séjour de Charles en Savoie, à ce château de Silaz où l’on allait jamais que pour régler des questions de fermages ou de réparations. Cette lettre émanait d’un antique et dévoué régisseur, le bonhomme Claude (prononcez « Glaude » si vous voulez respecter l’usage local). Il y parlait de diverses affaires relatives à la gestion du domaine, disant que la présence de M. Charles serait bien utile à ce sujet, et que, au surplus, il souhaitait cette présence pour une autre raison qu’il ne voulait pas exposer, parce que « Madame se moquerait de lui, et pourtant, il se passait à Silaz des choses qui le bouleversaient, lui et la vieille Péronne ; des choses extraordinaires dont il fallait absolument s’occuper. »
— Il a l’air affolé, dit Mme Christiani. Tu ferais peut-être bien, Charles, d’aller d’abord à Silaz.
— Non, maman. Vous connaissez Claude et Péronne. Ce sont de vénérables célibataires, mais des primitifs, des superstitieux. Je vous parie qu’il s’agit encore d’une histoire de revenant, de servant, comme ils disent ! croyez-moi, cela peut attendre, j’en suis certain. Et comme j’ai prévenu de mon arrivée le bibliothécaire de La Rochelle, je ne vais pas, vous le pensez bien, lui donner contre-avis en l’honneur de ces excellents mais simples vieillards. Quant aux affaires, aux véritables affaires, rien ne presse, c’est visible.
— À ton aise, mon enfant. Je te laisse libre. Combien de temps resteras-tu à La Rochelle ?
— À La Rochelle même, deux jours exactement. Mais j’ai l’intention de revenir en faisant un petit détour par l’île d’Oléron, que je ne connais pas. J’ai appris tout à l’heure, du concierge, que Luc de Certeuil s’y trouve. Il dispute un tournoi de tennis à Saint-Trojan ; c’est une bonne occasion pour moi…
— Luc de Certeuil… prononça Mme Christiani sans le moindre enthousiasme et même avec une réprobation assez marquée.
— Oh ! soyez tranquille, maman. Je ne nourris pas pour lui une tendresse excessive. Mais enfin, n’exagérons rien. Il est comme bien d’autres, ni mieux ni plus mal ; je serais content de trouver quelqu’un de connaissance dans cette île inconnue de moi ; et je sais qu’il sera très heureux de ma visite.
— Parbleu ! fit Mme Christiani, pendant qu’une lueur d’irritation brillait dans ses yeux noirs.
Et, d’un geste qui révélait son mécontentement, elle lissa les bandeaux presque bleus qui encadraient son visage bistre de Méditerranéenne. Luc de Certeuil lui était antipathique. Il occupait, dans l’immeuble, un appartement de trois pièces, sur la cour ; Charles, peu mondain, ne l’eût sans doute jamais rencontré sans cette circonstance, que l’autre avait mise à profit pour entrer en relations. C’était un joli homme sans scrupules, un sportif, un danseur. Il plaisait aux femmes, malgré son regard déroutant. Mme Christiani l’avait tenu à l’écart jusqu’aux fiançailles de sa fille Colomba : car elle était méfiante et résolue.
— Enfin, dit-elle, penses-tu pouvoir être à Silaz dans une semaine ?
— Assurément.
— Bien. Je vais l’écrire à Claude.
Ces propos s’échangeaient un lundi.
Le jeudi suivant, à deux heures de l’après-midi, Charles Christiani, accompagné du bibliothécaire qui lui avait grandement facilité ses investigations, débouchait sur le port de La Rochelle et cherchait des yeux le vapeur Boyardville, en partance pour l’île d’Oléron.
Son compagnon, M. Palanque, conservateur de la Bibliothèque municipale, le lui désigna ; un steamer de dimensions plus imposantes que Charles ne l’eût imaginé. Le bateau, rangé le long du quai, était animé de cette effervescence humaine qui précède toujours les traversées, si insignifiantes soient-elles. Les mâts de charge, avec un bruit de chaînes déroulées, descendaient des marchandises par les panneaux de cale. Des passagers franchissaient la passerelle.
Depuis de longues années, le Boyardville accomplit quotidiennement le voyage aller et retour de La Rochelle à Boyardville (île d’Oléron), avec escale à l’île d’Aix quand l’état de la mer le permet, c’est-à-dire le plus souvent. L’horaire des départs varie selon les marées. La durée du voyage, dans un sens, est d’environ deux heures ; quelquefois davantage.
M. Palanque accompagna sur le pont le jeune historien, qui déposa sa valise contre la cloison du rouf des premières classes et s’assura d’un de ces fauteuils pliants dit « transatlantiques ».
Le temps, sans être splendide, ne laissait rien à désirer. Bien que le ciel manquât de pureté, le soleil était assez vif pour projeter les ombres et baigner d’une lumière chaude l’incomparable tableau du port de La Rochelle, avec des vieilles murailles et ses tours historiques.
— À Boyardville, disait M. Palanque, vous trouverez aisément une auto qui vous conduira en moins d’une demi-heure à Saint-Trojan. D’ailleurs, en été, il y a peut-être un car qui fait le service.
— J’aurais pu prévenir de mon arrivée l’ami que je vais retrouver il ne se déplace jamais qu’en automobile, — à des allures, du reste, vertigineuses ! — mais il se serait cru obligé de venir me prendre à Boyardville, et je tiens surtout à ne déranger personne.
M. Palanque, qui regardait Charles Christiani le plus ordinairement du monde, surprit un brusque changement dans la physionomie de son interlocuteur : une très brève secousse, aussitôt réprimée, et, dans les yeux, l’éclair que produit tout à coup l’attention subitement éveillée. Malgré lui, M. Palanque suivit la direction de ces regards, attirés vers quelque particularité imprévue et, sans nul doute, des plus intéressantes. Et il découvrit ainsi l’objet d’une curiosité intense à ce point.
Deux jeunes femmes, discrètement mais parfaitement élégantes, issues de la passerelle, mettaient le pied sur le pont.
Deux jeunes femmes ? Un instant d’examen modifiait le premier jugement. La blonde, oui, celle-là, était une jeune femme. Mais la brune ne pouvait être qu’une jeune fille ; elle en portait les marques exquises dans l’éclat juvénile de sa beauté.
— Voici d’aimables compagnes de voyage ! dit le bon M. Palanque, avec l’air de féliciter l’heureux passager.
— Certes ! murmura Charles. Des Rochelloises ? Les connaissez-vous ?
— Je n’ai pas cet honneur et je le regrette ! C’est la première fois qu’il m’est donné de les apercevoir.
— Elle est ravissante, n’est-ce pas ?
— Laquelle ? demanda M. Palanque, en souriant.
— Oh ! dit Charles, d’un ton de reproche, la brune, voyons !
Un commissionnaire, porteur de légers bagages, suivait les deux voyageuses. Sur leur indication, il déposa son fardeau non loin de la valise de Charles Christiani.
La sirène du Boyardville siffla trois fois, dans un jet de vapeur blanche. On allait larguer les amarres.
— Je vous quitte ! dit précipitamment M. Palanque. Bon séjour à Oléron et bon retour à Paris !
Quelques minutes plus tard, le Boyardville, sortant du port de La Rochelle, laissait derrière lui le célèbre décor de donjons et de lanternes et gouvernait cap au sud.
Les deux femmes s’étaient installées dans leur fauteuil de pont. Charles, pour être tout près d’elles, n’eut qu’à s’asseoir dans celui qu’il avait préparé. Les passagers n’étaient pas très nombreux. Abrités dans une sorte d’encoignure, ces trois « premières classes » se trouvaient relativement isolées.
Charles écouta les propos de ses voisines. Elles parlaient d’ailleurs librement, et point n’était besoin de prêter l’oreille pour entendre ce qu’elles disaient. La jeune femme blonde, d’un blond très pâle, faisait, à elle seule, presque tous les frais de la conversation. Sa voix faible et languissante était infatigable. Charles en jugeait énervantes les molles inflexions. Quant à la jeune fille brune, elle se bornait à répliquer sobrement, lorsque cela était motivé par des : « Tu ne trouves pas ? » « Dis, Rita ? » qui la forçaient à répondre, sous peine d’incivilité. Elle le faisait alors avec calme, d’une voix grave et profonde, musicale.
Donc, elle s’appelait Rita. Et son amie : Geneviève. Rien ne venait apprendre à Charles leurs noms de famille ; mais, à la façon dont elles s’entretenaient de La Rochelle, il lui fut facile de comprendre qu’elles venaient d’y passer quarante-huit heures pour visiter la ville. Puis certaines phrases lui révélèrent qu’après cette excursion instructive on regagnait Oléron où l’on villégiaturait depuis quelques temps déjà. Il fut question de matches de tennis. Le mot « Saint-Trojan » revint plusieurs fois : c’était là qu’on rentrait, là qu’on séjournait. Il fut parlé, du côté blond, de « mon oncle, mes cousins, mon frère » ; du côté brun, de « ma mère, mes parents ». Des noms passèrent, familiers, celui-ci entre autres : Luc de Certeuil.
Singulièrement satisfait, comme toutes les fois qu’un homme constate en sa faveur la connivence du hasard, Charles Christiani pensa se présenter lui-même et tout de suite. Il lui parut décent, toutefois, de patienter encore et d’attendre l’occasion quelconque qui ne manquerait pas de lui en fournir un prétexte à peu près admissible. Ce prétexte, il s’arrangerait, au besoin, pour le faire naître.
Mais le hasard continua de lui être favorable, — si étrangement favorable même que le jeune homme en conçut la merveilleuse assurance d’une main providentielle dirigeant les événements au mieux de ses désirs et de son bonheur.
La conversation de Mlle Geneviève X… et de Mlle Rita Z… se ralentissait. Épuisé le premier élan, les devis s’espaçaient, d’autant plus aisément que Rita n’avait jamais rien fait pour les alimenter. Le grand bateau berçait sa masse au gré d’une mer tranquille. Une jolie brise vivifiante courait dans l’espace. La jeune fille s’empara d’un sac, y prit un livre et l’ouvrit en disant :
— Il faut que je finisse.
Or, ce livre n’était autre que le dernier ouvrage de Charles Christiani : Les Quatre Sergents de La Rochelle, ce récit court et substantiel qu’il avait composé sur la demande d’un éditeur et qui constituait, évidemment, un excellent petit bouquin à l’usage des touristes.
Il vit — avec quel ravissement ! — la belle inconnue s’absorber dans la lecture de son œuvre et dévorer les pages qui lui restaient à lire. C’était pour lui une joie profonde et d’une qualité rare. Rita, cette mystérieuse Rita, ignorait qu’il fût là, tout près, et elle lui donnait le régal d’une admiration indéniablement sincère, elle qui l’avait subjugué au premier coup d’œil et qu’il venait de placer soudainement avant toutes les femmes de la terre.
Mais Rita ferma le volume et, le portant machinalement jusqu’à sa joue, se prit à rêver.
— Fini ? questionna Geneviève. Toujours emballée ?
La voix grave précisa :
— C’est vraiment très, très bien.
Là-dessus, Charles se rendit compte que, s’il voulait intervenir, le moment en était arrivé. Déjà la louange que Rita lui avait décernée rendait la situation quelque peu gênante pour lui, pour elle et pour Geneviève qui avait révélé « l’emballement » de la lectrice. Laisser les jeunes femmes s’engager plus avant dans la voie de l’éloge, c’eût été compromettre sottement la suite de l’aventure. Sa délicatesse, au surplus, protestait. Il se leva et, ôtant son chapeau, dit avec une bonne grâce mêlée de confusion :
— Pardonnez-moi, madame, et vous aussi, mademoiselle, mais j’ai surpris bien involontairement des coïncidences qui m’enchantent : c’est que vous allez où je vais moi-même, à Saint-Trojan : que nous avons un ami commun, Luc de Certeuil. Par surcroît, mademoiselle, le livre dont vous venez d’achever la lecture est d’un auteur à qui je suis très attaché.
« Permettez-moi donc de me présenter à vous : Charles Christiani.
Comme il l’avait prévu et redouté, son intrusion causa un grand trouble. Elles avaient commencé par le regarder avec des yeux étonnés ; puis, à mesure qu’il s’expliquait, leurs joues s’étaient violemment colorées ; et maintenant il pouvait les voir devant lui, rouges comme deux roses rouges et leurs jeunes poitrines se soulevant très fort.
— Monsieur, fit Rita, je suis charmée…
Charles, aussitôt, reprit la parole. Il appréhendait le silence embarrassé qui, sans cela, eût laissé l’une et l’autre sans voix. Aussi bien, il avait son idée, — une idée qui lui livrerait à coup sûr le nom de son adorable admiratrice.
— Ce serait pour moi, dit-il, en armant son stylo, un vrai plaisir de vous dédicacer ce petit volume, puisqu’il ne vous a pas déplu. M’en donnez-vous l’autorisation ?
Rita, souriante, hocha la tête :
— J’en serais flattée, monsieur, mais ce livre ne m’appartient pas. Il est à mon amie, ici présente : Mme Le Tourneur, qui sera, n’en doutez pas, très heureuse de votre dédicace.
L’historien des Quatre Sergents s’inclina, contraignant son sourire à rester sur sa bouche, bien que ce sourire-là n’y fût point disposé. Car Mme Le Tourneur, au lieu de se récrier et d’offrir immédiatement le volume à Rita, gardait un mutisme exaspérant.
— J’aurai donc l’agrément de vous en envoyer un exemplaire, fit-il en se tournant vers la jeune fille.
Mais, sur le point de lui demander, à ce propos, son nom et son adresse, il s’arrêta. Le mauvais ton du procédé le retenait de l’employer, en infraction à toutes les règles du savoir-vivre, qu’on observait encore, grâce à Dieu, dans sa famille et dans son monde.
Il écrivit, sur la page du titre, quelques lignes d’une galanterie classique, au-dessous du nom de Geneviève Le Tourneur. En suite de quoi, celle-ci, charmée, lut la dédicace, la fit lire à Rita, enfin replaça le livre dans le sac d’où il était sorti et dont le cuir fauve portait ses initiales : G. L. T. Les autres sacs et mallettes n’étaient marquées d’aucun signe.
« Je suis vraiment inexcusable de me montrer si peu dans les salons, pensait Charles. C’est proprement idiot. Sans cela, il y a belle lurette que je la connaîtrais. Qu’importe ! Elle est exquise ; elle m’admire un peu ; elle est, indubitablement, d’excellente famille… Il fait beau ! Dieu, qu’il fait beau ! »
C’était, comme on voit, le « coup de foudre » dans toute sa magnificence. Mais, cette fois, à l’inverse des cas les plus communs, tout semblait prouver que la foudre était tombée en même temps dans les deux sens et que deux éclairs, jaillis de deux êtres, s’étaient croisés, si bien que cet échange d’étincelles avait frappé l’un et l’autre, simultanément, d’une commotion puissante, inouïe et délicieuse. Voilà qui est rare.
Cette pauvre Geneviève Le Tourneur, ayant assumé la responsabilité de chaperonner Rita, s’aperçut très vite de la réalité. Elle le fit bien voir en s’agitant, en remuant les doigts sur un piano imaginaire, en prêtant à son visage une expression effarée.
Mais Rita ne remarquait rien, ou se riait de tout.
Geneviève semblait ne plus exister pour elle, qui s’abandonnait aux joies d’un dialogue admirablement banal, mais où ils se complaisaient, elle et Charles, à s’entendre parler tour à tour. Charles ne pouvait douter des sentiments de Rita ; à vrai dire, dans l’état de son cœur, il n’en eût pas douté, même si ces sentiments n’avaient pas été tels qu’il les souhaitait. Geneviève étant femme et spectatrice sans passion, ne s’y trompait pas.
Ainsi, quoique vainement, donnait-elle ces témoignages d’inquiétude et de réprobation. Délaissée, elle finit par se lever, et, jetant à Rita un regard chargé d’une foule d’avertissements, elle s’éloigna d’un pas nonchalant.
Ce fut pour revenir presque aussitôt et pour dire :
— Nous arrivons à l’île d’Aix.
Elle avait l’air contente de rompre l’intimité de ce doux entretien, auquel les Grecs auraient donné le nom chantant « d’oaristys ».
Charles et Rita purent s’éveiller.
— Déjà ! s’écrièrent-ils à l’unisson.
Le bateau virait. L’île d’Aix leur apparut. Alors, parmi les groupes de passagers, un matelot circula et fit savoir que, par exception, l’escale serait d’une demi-heure et non de quelques minutes, à cause d’un débarquement de marchandises plus important que d’habitude. « Les touristes qui désiraient descendre à terre y étaient autorisés. »
— Je connais l’île d’Aix, dit Rita. Je l’ai visitée l’année dernière avec mes parents. Mais je la reverrais volontiers.
— Moi, je ne la connais pas, fit Geneviève, mais crois-tu qu’en une demi-heure on ait le temps…
— C’est tout petit. On peut très bien se rendre compte de l’aspect général. M. Christiani, lui non plus, n’est jamais venu… Monsieur, voulez-vous descendre avec nous ?
— À vos ordres ! accepta joyeusement l’interpellé.
Il admirait la décision de Rita, l’ardeur contenue qui émanait de sa svelte personne, le feu sombre de ses prunelles et, quand elle le regardait bien en face, tout ce que ses yeux décelaient de franchise, de volonté, avec, parfois, l’ombre énigmatique d’une pensée profonde, consciente des actes, de leur importance et de leurs suites. Cette petite fille était « quelqu’un ». Une force. Une intelligence. Une énergie. Une vraie femme, surtout, vers laquelle il se sentait attiré par mille influences, jusqu’à l’esprit aventureux, jusqu’au mystère féminin qu’il devinait en elle. Et puis quelque chose encore agissait pour l’aimanter vers tant de grâce et de beauté : la sourde conviction — illusoire peut-être ! — qu’ils étaient tous deux, on ne sait comment, du même pays sentimental ; qu’un même climat réglait leur tempérament et que, parlant le même langage, leurs cœurs avaient une patrie commune dans l’Europe de l’amour.
— Allons ! dit-elle.
Le Boyardville pivotait, machine arrière, machine avant, coups de timbre, grincements des chaînes du gouvernail. On jetait les amarres. Un rassemblement de passagers s’était formé à la coupée, prêts à débarquer. Ils pouvaient contempler les murs des fortifications et, plus haut, devant la bastille reculée du sémaphore, deux tours jumelles, d’un blanc cru : l’une surmontée d’un lanterneau, l’autre d’un écran de verre rouge.
La passerelle relia le vapeur à l’extrémité d’un môle.
— Venez vite ! reprit Rita. Nous allons traverser le village et donner un coup d’œil sur les champs…
Ils allongèrent le pas et devancèrent rapidement le gros des touristes.
Des ponts-levis déserts. Des corps de garde sans soldats. Une place d’armes verdoyante et ombragée, dans son cadre de glacis et de talus géométriques. Au bout : un village blême et silencieux, où l’on respire un air qui n’est plus d’aujourd’hui.
Geneviève dit, s’adressant à Charles :
C’est bien d’ici, n’est-ce pas, que Napoléon est parti pour Sainte-Hélène ?
Le jeune historien précisa, en quelques mots ce chapitre tragique de l’épopée impériale. Il s’en acquitta brièvement, soucieux de ne faire aucun étalage de sa science. Le sujet, pourtant, l’intéressait à titre personnel. Non qu’il eût la moindre velléité d’écrire sur Napoléon ier. Mais l’histoire de l’empereur était liée à l’histoire de son aïeul, le capitaine corsaire César Christiani, né à Ajaccio comme Napoléon et le même jour que lui, de sorte que « l’autre » l’avait toujours protégé, en mémoire de cette conjoncture qui lui semblait fatidique.
Il ne pouvait être question de visiter le musée napoléonien installé dans la maison dite « de l’Empereur » : le temps faisait défaut. Ils se contentèrent de marcher moins vite en passant devant la porte vieillotte, avec ses marches usées et ses humbles colonnes, par où l’on peut dire que l’homme de Waterloo sortit de France pour n’y jamais rentrer, du moins vivant.
Encore des ponts-levis, ou plutôt des ponts qui, jadis, avaient levis… Des fossés d’eau dormante. Et, devant les trois visiteurs, bordée à droite par une anse gracieuse, au fond par des bois moutonnants, à gauche par des ouvrages militaires couverts de gazon : une petite plaine ensoleillée.
Toute l’île, à peu de chose près, était là.
— Il est inutile d’aller plus loin, déclara Rita. Le temps nous manque. C’est regrettable, parce que là-bas, à la lisière opposée des bois, on a la vue la plus belle sur le pertuis d’Antioche, l’île de Ré, La Rochelle, etc… N’y songeons pas.
— Il faut revenir au port, décida Geneviève. Nous n’avons plus que treize minutes.
— Je connais un raccourci. Par là, sur notre gauche, en longeant la côte de l’île, nous serons tout de suite arrivés. Et, en passant, nous verrons la plage qui est gentille. L’année dernière, nous sommes restés trois jours ici, mes parents et moi ; j’aurais voulu y rester des semaines ! Mais papa s’ennuyait…
— Et il ne devait pas le cacher ! s’égaya Mme Le Tourneur. Quel ours !
Rita eut un froncement de sourcils presque imperceptible, et se rembrunit. Elle marchait à côté de Charles, coude à coude, dans l’étroit chemin jaunâtre. Peu de femmes allaient, sur les chemins de la vie, d’une démarche aussi harmonieuse.
Charles, sensible déjà à tout ce que ressentait la fine jeune fille, l’enveloppait d’un regard aussi aimant qu’attentif, mais sans oser la questionner au sujet de ce père qui était un « ours ».
Elle releva la tête et lui sourit gaiement.
— Tenez ! dit-elle. Vous voyez : l’île d’Oléron !
Ils avaient passé sous une voûte qui, là, perce un talus, et ils se trouvaient en face de la mer.
À l’horizon, une ligne solide, terminée par le trait vertical d’un phare, séparait du grand ciel lumineux l’étendue verte des flots.
— Vous êtes sûre que c’est un raccourci ? demanda Charles en consultant sa montre.
— Dépêchons-nous ! fit Mme Le Tourneur.
Rita n’avait rien répondu. Elle suivait, la première, le sentier sinueux qui serpentait, non loin du rivage, entre des blocs de pierre, à travers une herbe folle poussée haut et dru. Cette voie semblait zigzaguer à plaisir.
Tout à coup, derrière la masse des buttes au delà desquelles on apercevait les sommets du sémaphore et du double phare, le mugissement du Boyardville se fit entendre par trois fois. Signal du départ imminent.
— Ça y est ! grommela Geneviève. J’en étais certaine. Nous voilà bien !
Charles supposa que le bateau sifflerait encore avant de reprendre la mer. « N’était-ce pas la coutume ? »
Rita poursuivit son chemin silencieusement. Ses compagnons, cheminant à la file indienne, ne voyaient pas son visage.
Comme ils arrivaient à la plage, où plusieurs baigneurs s’ébattaient, un grand vapeur se montra par l’arrière, s’éloignant et paraissant sortir du bloc d’arbres et de roches qui l’avait masqué jusque-là.
— Eh bien ! dit Charles, paisiblement. C’est le Boyardville.
— Oh ! Rita ! Vraiment ! gémit Mme Le Tourneur.
— Je suis désolée, ma petite Geneviève…
— Ah ! fit la jeune femme, contractée. Qu’allons-nous faire, maintenant ? C’est drôle, oui, tu peux rire !…
— Mais je ne ris pas, Geneviève. Seulement, qu’y puis-je ? Nous avons manqué le bateau, c’est une chose qui arrive à tout le monde…
— On nous attend à Saint-Trojan. On nous attend même, certainement, à Boyardville… reprocha la plaintive petite dame.
Elle baissa les paupières sous le regard de Rita qui souriait toujours, mais dont les yeux venaient de prendre une certaine fixité. Leur douceur, sans se démentir, dénonçait un calme si profond, si absolu, qu’elle en devenait dominatrice.
— Et nos bagages ! récrimina Geneviève d’un ton vaincu.
Charles ne disait rien. Une joie immense le comblait. Il avait la certitude que Rita venait d’exécuter un plan préconçu. Elle n’était pas de celles qui se trompent de cette façon, et elle savait singulièrement ce qu’elle voulait. Qu’avait-elle voulu ? Passer vingt-quatre heures avec lui, dans la retraite de cette île de silence et de quiétude. Car ils savaient bien, tous les trois, que le Boyardville ne repasserait que le lendemain dans l’après-midi, allant vers Oléron. Pour quelle raison s’était-elle résolue à ce subterfuge quelque peu romanesque ?
Romanesque, elle ? Charles hésitait à le croire. Non, non, si elle avait fait cela, c’est qu’elle avait compris qu’une aussi belle occasion ne se représenterait pas de longtemps et que, rentrée à Saint-Trojan, elle ne s’appartiendrait plus comme aujourd’hui, reprise qu’elle serait par les obligations du monde, du monde curieux, malveillant, cancanier, sous l’autorité d’un père qui ne badinait pas… Voulait-elle étudier Charles à loisir, mieux qu’elle n’eût pu le faire en toute autre circonstance ? Avait-elle cédé tout simplement à l’envie de prolonger un tendre tête-à-tête que la présence de Geneviève sanctionnait sans trop le gêner ? Qu’importe ! Il y avait dans cette action, certainement préméditée, tant d’indépendance mise si fermement au service d’une telle inclination, que Charles, ébloui, en perdait la tête.
Il attendit, pour parler, que sa gorge se desserrât. D’ailleurs, on s’était remis en marche et le village fut soudain tout près d’eux, au détour d’un mamelon.
— Je vais télégraphier à Boyardville et à Saint-Trojan, dit Rita. L’hôtelier de Boyardville gardera nos bagages jusqu’à demain.
— Il pourrait peut-être nous envoyer chercher par un cotre à moteur ? suggéra Geneviève.
Négligeant sa proposition, Rita lui prit le bras :
— Viens avec moi à la poste. Pendant ce temps-là M. Christiani sera assez bon pour s’occuper de nos chambres. Il y a deux hôtels, l’un contre l’autre, monsieur, au coin de la Grande Rue et de la place d’Armes. Voulez-vous y aller ?
Il crut comprendre qu’elle jugeait opportun de causer seule à seule avec son amie. Elle désirait sans doute achever de se la concilier, ce qui ne se pouvait faire, Charles étant présent, que par une manœuvre de regards et de mines notoirement insuffisants.
De fait, quand elles le rejoignirent, il trouva Mme Le Tourneur beaucoup plus souriante et tout à fait prête, semblait-il, à jouer jusqu’au bout son rôle de jeune duègne complaisante. La suite démontra, au surplus, qu’elle y était des plus aptes.
Les deux hôtelleries de l’île d’Aix sont exiguës. Des quelques chambres dont elles se composent, une seule était libre ; on y mettrait une couchette supplémentaire et les jeunes femmes, ainsi, passeraient une nuit supportable. Quant à Charles, il devrait se contenter, dans l’autre établissement, d’un canapé auquel des couvertures seraient adjointes. La saison balnéaire n’était pas close et les habitués de l’île profitent, jusqu’au bout, du repos qu’ils y trouvent.
Mme Le Tourneur parut satisfaite d’un arrangement qui séparerait, sous des toits différents, le sommeil de Rita d’avec celui de Charles. Rassurée sur ce point et se conformant peut-être aux instructions qu’elle venait de recevoir, elle se déclara un peu lasse, disposée à s’étendre sur un lit jusqu’au dîner…
Ses compagnons d’infortune repartirent, enfin seuls, et dénichèrent sans tarder, non loin du village, une banquette de gazon qui avait l’air de les attendre, sous de beaux arbres. De là, entre les terre-pleins buissonneux d’une embrasure d’artillerie, on découvrait un pan de mer en forme de trapèze. Le soir commençait à venir. Le soleil baissait dans un ciel empourpré, de plus en plus ardent…
Et, de plus en plus, à mesure qu’ils causaient, le cœur de Charles s’embrasait. Et, de plus en plus, il savourait le ravissement de la merveilleuse aventure pimentée d’un mystère que Rita s’appliquait à entretenir.
Qui était-elle ? Au fond, cela n’avait pas d’importance, puisqu’ils se plaisaient mutuellement, puisqu’elle montrait une éducation sans défaut et un esprit élevé. Aussi, Charles accepta-t-il docilement le jeu piquant du secret et ne fit-il rien pour violer l’incognito de sa compagne.
L’atmosphère qui se dégageait d’un pareil accord exhalait un parfum spécial, curieux, amusant : celui des intrigues et des contes. Chassant de nouveau le mot « romanesque » qui revenait pourtant se proposer avec une insistance significative, Charles pensa qu’on voulait l’éprouver, s’assurer de sa conscience et de ses sentiments, acquérir la certitude qu’on était aimée pour soi-même, en dehors de toute considération étrangère à l’être, à l’âme et au cœur.
Était-elle, par exemple, très pauvre ? Tout le démentait : sa robe et l’ensemble de ce qu’elle portait, ses mains charmantes et pures, l’indéfinissable assurance qui empreint les traits dont nulle angoisse ne monte jamais crisper les lignes sereines.
Alors, était-elle très riche ? Trop riche ? Redoutait-elle que Charles, mû par des scrupules tout-puissants, ne reculât devant des millions ? Voulait-elle, auparavant, l’attacher par des liens si solides que rien au monde ne pût les desserrer ?
En tout cela, Charles ne discernait avec sagesse qu’une raison de plus de l’aimer, puisque tout cela, qu’elle qu’en fût la cause, lui prouvait qu’elle l’aimait.
Ils s’aimaient ! L’évidence en éclatait pour eux, lorsque, à la nuit tombante, ils regagnèrent, pour y dîner, l’un des hôtels. Ils s’aimaient ! Cette chose prodigieuse, inimaginable, s’était produite, brusque comme un choc, violente et étourdissante comme une sorte d’attaque divinement morbide, une espèce de voluptueux transport au cerveau qui, d’une exquise manière, eût modifié le régime de leur sang.
Mme Le Tourneur, assise près de la porte, à la terrasse de l’hôtel, les entrevoyait revenant. Elle manqua d’être effrayée à leur approche, comme si, dans l’ombre du crépuscule, ils eussent fait de la lumière.
Tout le temps du dîner, qui fut de coquillages et de poissons principalement, elle éprouva la même impression, et s’efforça de dissimuler l’embarras d’être en tiers entre deux victimes aussi pantelantes et aussi rayonnantes du dieu Amour. Elle ne savait cacher, pourtant, ni cet embarras ni le trouble qui l’envahissait elle-même peu à peu, d’être baignée dans cette irradiation frémissante dont ils étaient, si l’on peut dire, les bienheureux émetteurs.
Le pire, en ce qui la concerne, fut que la veillée s’éternisa. Rita mit une obstination farouche à la prolonger fort avant dans la nuit. Charles, qui l’eût suivie au bout de l’espace et du temps, subissait avec délices cette fantaisie noctambule. Enfin l’on céda aux objurgations suppliantes de Mme Le Tourneur, et, vers deux heures du matin, la séparation fut acceptée.
Le jour n’avait pas acquis toute sa force lorsque Charles descendit dans la rue.
Le silence pesait sur le village mort. Néanmoins, des pas légers firent résonner des marches de bois, dans les profondeurs de l’autre hôtellerie. C’était Rita. Elle avait juré de ne pas perdre une minute des heures qu’elle avait conquises.
À sa vue, Charles sentit s’évanouir un doute que la solitude et la lucidité matinale entretenaient en lui. Quel doute ? Celui-ci. Après tout, il s’était peut-être abusé ; il prenait peut-être ses désirs pour des réalités ; ce bateau, Rita peut-être n’avait aucunement désiré le manquer…
La jeune fille n’eut qu’à surgir dans l’encadrement de la porte et tout redevint très simple et favorable.
Elle était fraîche comme au sortir d’un cabinet de toilette où rien n’eût manqué des raffinements du luxe. Son teint de brune, sans poudre, s’échauffait aux pommettes comme le vermeil reflète l’aurore. Sa chevelure sombre et brillante avait des nuances bleues. L’air, autour d’elle, sentait le matin, parmi le matin.
Mais des persiennes claquèrent au seul étage de la maison. Ébouriffée, les cheveux dans les yeux, lourds encore de sommeil et ses bras blancs levés, Geneviève angoissée, criait :
— Rita !
— Quoi donc ? lui fut-il répondu avec une tranquille et joyeuse ironie.
— Oh ! mon Dieu ! Tu es là ! Je me suis réveillée. Je ne t’ai pas vue près de moi. Alors…
Ils se mirent à rire.
— Allons, descends, dépêche-toi, conseilla Rita. J’ai une idée. Nous allons organiser quelque chose. Tu m’en diras des nouvelles !
Pudique, d’une main relevant ses boucles blondes, de l’autre se voilant le sein, Geneviève, faisant retraite, se lamenta :
— Oui, j’y vais. Quelque chose ? Qu’est-ce que c’est encore ?
Sitôt descendue, elle en eut l’explication. Il s’agissait d’aller déjeuner à cet endroit dont Rita leur avait parlé la veille, à la lisière du bois, face au nord. La journée s’annonçait particulièrement belle. L’épicerie et la cuisine des auberges fourniraient les éléments d’un repas très convenable.
Geneviève acquiesça, soulagée. Elle avait appréhendé des éventualités plus redoutables qu’un déjeuner sur l’herbe.
Les préparatifs de la petite fête occupèrent toute la matinée. Cela rompit à propos un désœuvrement qu’il faut toujours éviter. Si mince qu’elle fût, cette coopération mit néanmoins en valeur la communauté de goûts de Charles et de Rita, ou, du moins, l’agrément qu’ils prenaient à adopter les vues et les prédilections l’un de l’autre.
Un âne se trouva qui transporta sur son échine les paniers de provisions. On longea, à sa suite, le rivage de la baie si agréablement incurvée. Puis une faible montée conduisit à l’orée d’un bois qu’on traversa.
Et bientôt — car l’île est restreinte — ils atteignirent le but de leur expédition. C’était, à la corne du bois, dans le haut d’une falaise rocheuse, ce qu’on pourrait appeler un kiosque de verdure. Le sol était moussu et souple. Un ombrage hospitalier tamisait une lumière cristalline. L’abri, bien que forestier, offrait un confortable intérieur et un caractère poétique qu’on ne pouvait définir qu’en évoquant les « bocages » des romances surannées.
Cependant, au bas de la falaise, l’Océan faisait blanchir ses écumes, et, golfe immense, il montait jusqu’à moitié du ciel, se bordant de minces bandes fumeuses ou blêmes, frappées çà et là de soleil, et qui étaient l’île de Ré et le littoral de la France.
Nous prétendons que c’est là l’un des plus charmants points de vue qui soient sur la côte de l’Atlantique.
Rita, qui s’en souvenait si bien, eut la joie de savoir que Charles, lui aussi, s’en souviendrait.
Le déjeuner ne laissa rien à désirer, sinon qu’il parut court. La journée s’avançait. Et Rita, tout à coup, devint mélancolique, c’est-à-dire qu’un moment vint où elle perdit la force de maîtriser sa tristesse croissante.
Charles se rapprocha d’elle, assise sur un dos de mousse, les yeux perdus dans les espaces. Ah ! qu’aurait-il donné pour lui rendre sa belle gaîté ! Mais une déférence, une délicatesse impérieuses l’empêchaient d’intervenir dans cette mélancolie, soit avec des mots, soit avec le geste qui tentait sa main et la sollicitait de s’avancer tendrement vers celle de Rita.
Aussi bien, lui aussi voyait sans allégresse la fin de ce prologue plein de fantaisie. Tous deux avaient besoin d’un dérivatif, et qui fût sérieux. Mme Le Tourneur cueillait des bruyères à l’écart. Charles et Rita, suivant la pente de leurs pensées, causèrent gravement.
Et toujours ils tombaient d’accord. Toujours, en toute chose, leurs opinions coïncidaient. Instruit dans les principes rigides d’une éducation sans faiblesse, Charles mettait au-dessus de tout la religion de la famille, la fidélité irréductible aux traditions ancestrales, l’amour filial et le respect des institutions, des croyances et des lois domestiques sur lesquelles se fondent les seuls foyers durables. Et Rita, loin de s’effaroucher d’une telle profession de foi, l’écoutait en l’approuvant. Et chacun était fort ému de découvrir en soi une pareille harmonie de jugements, qu’il s’agît de petites questions ou des plus grandes.
Ainsi le temps s’écoula, riche de leur réunion, pauvre d’une séparation que Charles supputait passagère, mais qui, tout de même, approchait — et revêtit soudain un aspect matériel, une forme visible et mouvante : celle d’une fumée grise au-dessus d’un point noir qui, là-bas, du côté de La Rochelle, grossissait sur la mer et semblait descendre vers eux.
— Le voilà ! soupira la jeune fille.
— Bah ! fit-il d’un air intentionnellement détaché.
Et ils se regardèrent sans plus rien dire et sans bouger, se donnant la clarté de leurs yeux et le sourire presque douloureux de ces lèvres qui ne s’étaient pas même effleurées.
— En route ! dit-elle. Geneviève ! le Boyardville.
Charles, songeant qu’il lui faudrait, dans trois jours, s’éloigner d’elle pour un temps, connut la misère d’une détresse enfantine.
Deux heures plus tard, le Boyardville entrait dans le chenal du port oléronnais. Le cœur battant, Charles et Rita voyaient défiler les sables de la rive, ses fourrés de jeunes pins, ses maisons, le quai.
Des voitures variés, compagnardes ou somptueuses se groupaient. Au bord du chenal, un gentleman d’un certain âge brandissait son chapeau. Près de lui, les mains dans les poches de ses larges culottes, un grand garçon tête nue, fouillait des yeux l’assemblée arrivante des passagers.
— Ah ! dit dolemment Mme Le Tourneur, Rita, tu vois, mon oncle est venu nous chercher avec M. de Certeuil !
Elle agita son écharpe. Le mouchoir de Charles se déploya. Rita leva la main gauche ; mais sa main droite, cachée par le bordage, saisit le poignet de son voisin et ils s’étreignirent ainsi, secrètement, — passionnément.
CHAPITRE iiun cyclone dans un cœur
Un vif étonnement s’était peint au visage de Luc de Certeuil lorsque soudain il avait aperçu Charles Christiani sur le pont du Boyardville. Et tout de suite il avait pris soin de donner à sa surprise une expression de joie superlative qu’elle n’offrait peut-être pas au début. Charles le vit fort bien, et cela ne lui fit ni chaud ni froid. Il connaissait le personnage, le savait de son temps, et le prenait pour ce qu’il était. De l’attitude du camarade, il déduisit que Rita, lorsqu’elle avait télégraphié de l’île d’Aix, s’était abstenue d’annoncer l’arrivée de son compagnon inopiné — abstention bien naturelle, puisque Charles lui avait confié son désir de ne déranger et par conséquent de ne prévenir personne.
Les trois voyageurs, parmi les autres, mirent le pied sur le sol d’Oléron.
— Eh bien ! s’écria l’oncle de Mme Le Tourneur, en riant. Vous en faites de belles ! En voilà une équipée !
Geneviève prit sa voix la plus aiguë et ses intonations les plus sinueuses :
— Mon oncle, je vous présente M. Charles Christiani, l’historien, qui a partagé nos souffrances.
Luc de Certeuil n’avait pas encore repéré que, dans la foule, Charles et les deux femmes formaient un groupe.
— Comment ! s’exclama-t-il avec stupéfaction. Vous vous connaissez ! Ça, alors ! Ça, alors !
Et il laissait voir un amusement prodigieux, tandis que les serrements de main, les inclinations, les amabilités s’échangeaient de part et d’autre.
Rita, peu bruyante, souriait sans gaîté.
— Tiendrons-nous tous les cinq dans votre voiture ? demanda l’oncle à Luc de Certeuil. Si j’avais su, j’aurais pris la mienne…
— Ne vous inquiétez pas ! fit distraitement le sportsman, qui n’était pas encore revenu de son étonnement. Mon tacot en a vu d’autres ! On sera un peu comprimé, derrière, et voilà tout. Vous monterez devant, monsieur, près de moi.
Il avait pris familièrement le bras de Charles, et, cependant que tous se dirigeaient vers les voitures :
— Mais quelle bonne surprise, Christiani ! Quelle gentille idée ! Vous ne pouviez pas me faire plus de plaisir ! Alors, si je comprends bien, vous aussi vous avez raté le bateau à l’île d’Aix ! C’est tordant !…
Charles n’aima pas beaucoup la grimace joyeuse qui accompagnait l’appréciation de Luc. Rita marchait à côté d’eux ; il voulut interroger le visage de la jeune fille, mais ne rencontra qu’un masque au sourire impénétrable. D’ailleurs, en cette aventure, l’opinion de Luc de Certeuil lui était, au fond, totalement indifférente.
— J’espère, reprit celui-ci que vous avez apporté votre raquette ? Où sont vos bagages ?
On allait les oublier. Il y fut pourvu. Pendant quoi, Charles expliqua qu’il ne ferait à Saint-Trojan qu’un séjour rapide, quatre ou cinq jours au maximum.
— Bah ! Nous verrons ! affirma Luc de Certeuil, qui avait recouvré toute sa désinvolture. Il ne faut jamais jurer de rien !
En fait, le voyageur songeait à prolonger son voyage. Somme toute, il était libre ! Rien ne le rappelait impérativement à Paris. Il y avait bien cette histoire du château de Silaz et la promesse qu’il avait faite à sa mère d’aller en Savoie dans la huitaine… À la pensée de sa mère, un sourire lui vint. Quand elle saurait pourquoi son fils ne tenait pas sa parole, Mme Christiani serait la plus heureuse des mamans !
Une question, cependant, lui brûlait les lèvres. Il aurait voulu se trouver un instant seul avec Luc, pour la lui poser. Mais il comprit qu’un peu de patience lui serait encore nécessaire. On était arrivé auprès de la voiture, et Luc procédait à des arrangements destinés à permettre, dans cet élégant véhicule, l’accession de cinq créatures humaines et de plusieurs sacs et valises.
Au premier abord, le problème paraissait insoluble. L’auto, revêtue d’un vernis écarlate, était de ces types « sport » que nos jeunes gens affectionnent, au mépris de tout autre. C’est dire qu’elle s’allongeait à ras de terre et que l’emplacement réservé à ses occupants leur était mesuré autant qu’il est possible.
— Beaucoup de chic, votre auto, dit Charles.
— Cent billets, laissa tomber l’autre négligemment.
« Allons, pensa Charles, on ne fera jamais de cet aristocrate un gentilhomme. D’autre part, je voudrais bien savoir où il a trouvé les « cent billets » en question ! »
Cependant il se faisait tout mince, car Geneviève et Rita s’écartant, lui avaient laissé entre elles un logement aussi étroit qu’enviable. Devant eux, Luc, au volant, se retourna et s’assura, d’un œil railleur, qu’ils étaient parés. En même temps, la mitrailleuse de l’échappement libre, cher aux sportifs, se mit à pétarader. Et le démarrage s’exécuta comme d’un fougueux mustang à qui son cow-boy rend la main et qui, d’une lançade, se jette en avant.
Deux virages, à l’entrée et au sortir d’un pont. En quelques secondes, ils fuyaient le long d’un chenal à plus de cent à l’heure. Et bientôt il fallut ralentir, la route raboteuse décrivant force courbes à travers une plaine sans charme, coupée de fossés d’eau.
« Tout s’arrange toujours mieux qu’on ne le craint, se disait Charles. Je supposais que nous allions être immédiatement séparés, et… c’est le contraire. »
Il sentait, pressée contre lui par l’exiguïté du siège, cette forme infiniment précieuse vers laquelle, à présent, comme vers un aimant inconcevable, toutes ses « lignes de force » convergeaient. Son cœur battait au contact d’un être qui lui semblait choisi entre tous les êtres, de même qu’entre les choses il y a des choses suprêmement rares, délicates, riches et pures : des choses en or, en dentelles, en diamant. Et pour la première fois, Charles comprenait les vieux mots : « idole », « déesse », « divinité » ; ils perdaient pour lui tout ridicule et il lui fallait bien reconnaître que ces vieux mots-là disaient avec une adorable exactitude ce qu’ils voulaient dire.
Aurait-il jamais, pour cette petite fée, assez d’attentions, de prévenances, d’égards ? De quels bras sanctifiés la porterait-il, aux heures de fatigue, au passage des gués de la vie ? De quelles pieuses caresses ses mains pour la toucher, devraient-elles s’ailer ?…
L’automobile traversa des villages blancs aux toits vieux rose, aux volets vivement colorés. Luc annonça successivement : « Les Allards, Dolus ». On coupa une route droite, alignant sa double rangée d’arbres. La chaussée s’embellit. Des bois frais s’approfondirent. On en sortit, pour en côtoyer d’autres, à travers une succession de hameaux propres comme linge en armoire. Au bout d’un quart d’heure, la petite voiture rouge et ronflante s’engagea sur une ligne droite, en lisière de forêt. Sa vitesse dépassa le cent vingt-cinq. On revit la mer, sur la gauche, au delà de marais. Enfin, Rita dit :
— Saint-Trojan.
L’hôtel s’élevait devant la plage. Pour y parvenir, on avait traversé de part en part la bourgade et roulé sur une large avenue au milieu des pins. Luc arrêta sa voiture à la hauteur d’un passage entre deux haies taillées. Dans le fond : un décor de roseraie, avec des joueurs de tennis qui couraient çà et là, sautant aux balles invisibles.
— Plus loin, à cause des bagages ! implora Geneviève.
— Vos désirs sont des ordres, dit Luc.
Et il poussa plus avant, en face d’un perron.
Le vestibule, les salles étaient vides.
— Tout le monde est dehors, dit l’oncle.
Rita et Mme Le Tourneur s’étaient esquivées prestement. Luc de Certeuil conduisit Charles au bureau et demanda pour lui une belle chambre sur la mer.
— Faites-moi l’amitié de m’accompagner, dit Charles. J’ai hâte de vous poser une question.
— Très volontiers ! fit l’autre, intrigué.
Ils montèrent ensemble.
La chambre était spacieuse. Par la fenêtre ouverte à deux battants, on découvrait la passe des Couraux, le commencement du pertuis de Maumusson et dans la distance, bornant la vue, la côte du continent, avec le donjon du fort Chapus, en avancée. Contre le ciel immense et déjà plus sombre, des mouettes, à grands coups d’ailes, s’entre-croisaient. On entendait les cris des enfants sur la plage.
Quand la porte se fut refermée sur le départ de la femme de chambre :
— Mon cher Certeuil, dit Charles Christiani, ma façon d’être doit vous sembler un peu bizarre. Pardonnez-moi… Vous voyez devant vous un homme assez ému… Voilà : cette jeune fille, Mlle Rita… Elle a fait sur moi une profonde impression…
Luc, sans rien dire, le considérait d’un air si indéchiffrable que Charles s’interrompit un instant et, à son tour, fixa curieusement les yeux qui le fixaient.
— Qu’y a-t-il ? reprit Charles, légèrement démonté.
— Rien. Je vous écoute avec beaucoup d’intérêt.
— Rien, vraiment ? J’aurais cru…
— C’est-à-dire que, enfin… Vous devez bien penser, mon cher ami, que je ne serai pas le seul à éprouver quelque surprise…
— Quoi ! dit Charles très gaiement. Parce que je ne danse pas, parce que je ne vais pas dans le monde, parce que je suis un explorateur d’archives et de bibliothèques, va-t-on croire à des vœux perpétuels et me prendre pour un moine ? Dites ?
Luc de Certeuil affecta de cligner les yeux précipitamment, pour manifester son incompréhension.
— Vous voudrez bien m’excuser, dit-il. Je n’y suis plus. Quelque chose m’échappe. Pour ne pas dire : plusieurs choses…
— Lesquelles ? de grâce ?…
— D’abord… Enfin, mon cher, voyons, réellement, est-ce à moi de vous rappeler… Allons ! vous me faites marcher !
— Pardon, pardon, dit Charles qui se troublait et parlait maintenant d’une voix changée. Je n’ai pas rêvé, cependant. N’est-elle pas charmante ? Pleine d’esprit ? Irréprochable ?
— Certes ! confirma Luc sans quitter son rictus ironique.
— Je ne suppose pas qu’il y ait rien à dire sur ses parents. Honnêtes, eh ?
— D’accord !
— De son côté, donc, pas une ombre au tableau. Alors, alors… serait-ce de mon côté que… Mais je ne vois rien, moi, de ce côté-là !…
— Une seconde, mon cher. Je pensais vous connaître et, même en cet instant, j’ai la conviction, en effet, que je vous connais très bien. Mais nous nous débattons certainement dans un imbroglio. Il n’est pas possible que, vous, vous parliez comme vous venez de le faire. Dans ces conditions… Oh ! je serais suffoqué qu’on se fût joué de vous, qu’on vous eût abusé, pour se divertir… Et cependant, si invraisemblable que ce soit, je ne découvre pas d’autre explication…
— Comment ! s’indigna Charles.
— Pas d’autre ! Il faut, mon cher ami, qu’on vous ait livré un faux nom.
— On ne m’a livré aucun nom ! Et c’est justement cela que je voulais vous demander : qui est-elle ?
Un silence.
— Qui est-elle ?
Charles crispait ses mains aux épaules de Luc, dont les lèvres closes souriaient avec une expression de malaise.
— Marguerite Ortofieri, dit-il enfin. Rita, pour ses amies.
Affreusement pâle, Charles s’écarta de lui.
Le silence était retombé. Debout devant la fenêtre, assommé par la révélation, l’infortuné regardait, sans les voir, voler les mouettes. Il répéta, scandant les syllabes :
— Marguerite Ortofieri !
Et s’assit lentement, le front dans les mains.
De longs instants passèrent sur sa prostration.
Luc de Certeuil réfléchissait profondément. Les sourcils froncés et l’œil mobile, il examinait tantôt cet homme abîmé dans ses propres méditations, et tantôt, lui aussi, les oiseaux, le ciel, la mer, la côte lointaine, grand tableau lumineux qui attirait les regards.
Son attitude témoignait d’un travail intérieur très intense, d’hésitations, d’incertitudes et d’ignorance. Puis ses traits s’apaisèrent, il s’approcha de Charles et, doucement, fraternellement, lui posa la main sur l’épaule.
— Allons ! dit-il avec bienveillance.
Charles, paraissant sortir d’un profond sommeil, démasqua son visage.
— Je vous demande pardon, dit-il. Je ne suis qu’un sot. Un étourdi sans excuses, tout au moins.
— Des excuses, on en a toujours. Il est certain que si Mlle Ortofieri s’était nommée à vous, comme elle devait le faire… En somme, elle vous a mystifié. Pas très méchamment peut-être. Quand même : mystifié. Dans cette conjoncture, vous cacher son vrai nom, c’était presque vous donner un faux nom. C’est regrettable.
— Vous vous trompez, dit Charles. Je me mets à sa place et je pense que j’aurais agi précisément comme elle. Se trouvant tout à coup en présence d’un homme correct qui n’a d’autre tort, à ses yeux, que de s’appeler Christiani, alors qu’elle se nomme Ortofieri, elle a préféré, par courtoisie, par délicatesse, ne pas le repousser brutalement, en lui jetant ce nom d’Ortofieri, comme on claque une porte au nez d’un rustre !
— Soit, accepta Luc. Mais tout à l’heure, en vous voyant si chaud, j’avais l’impression fort nette que là ne s’était pas bornée cette… courtoisie.
— Que voulez-vous dire ?
— J’essaie de vous démontrer que vous n’êtes pas le seul responsable de votre déconvenue. Soyez juste envers vous-même. Une admiration, quand elle n’est pas encouragée, ne se développe pas si vite ni si bellement. Sachant qui vous êtes, sachant que cette intrigue de bal masqué serait fatalement sans lendemain, Mlle Ortofieri est reprochable d’avoir poussé la politesse jusqu’à l’amabilité. C’était pousser le jeu jusqu’à la témérité.