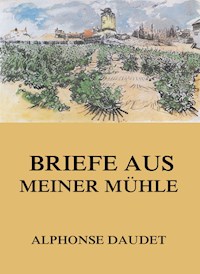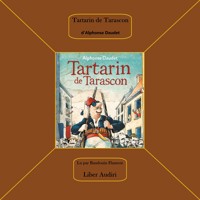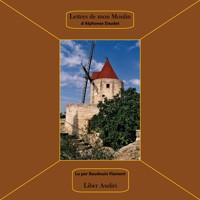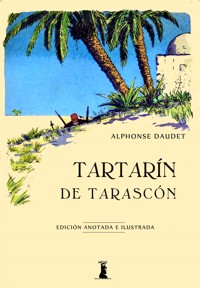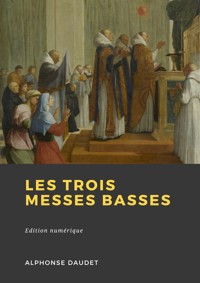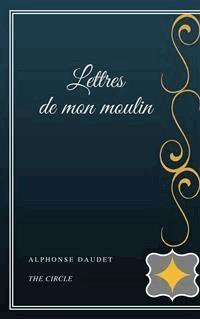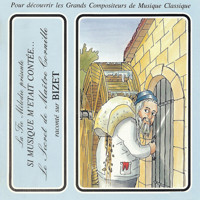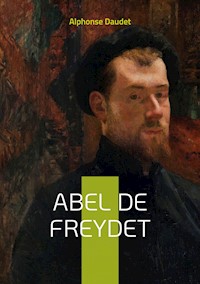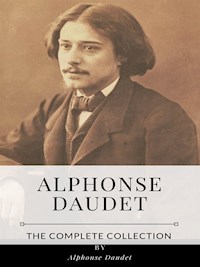1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alphonse Daudet
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le premier roman d'un célèbre écrivain qui cache à peine une autobiographie à la fois tendre et violente. L'histoire est celle d'un petit provincial pauvre et fragile dont on va suivre le parcours semé d'embûches, d'une enfance difficile à une maturité douloureuse. Cette sorte d'Education sentimentale avant l'heure s'adresse tout particulièrement aux adolescents à l'âme romantique et joue sur une identification très forte du lecteur à ce Petit Chose souvent si démuni devant la terrible école de la vie. Le style, de facture classique, fait de cette œuvre un des romans les plus représentatifs de la littérature du 19e siècle et a valu à son auteur le surnom de "Dickens français".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Alphonse Daudet, né à Nîmes (Gard) le 13 mai 1840 et mort à Paris le 16 décembre 1897, est un écrivain et auteur dramatique français. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Alphonse Daudet naît à Nîmes le 13 mai 1840. Après avoir suivi les cours de l'institution Canivet à Nîmes, il entre en sixième au lycée Ampère. Alphonse doit renoncer à passer son baccalauréat à cause de la ruine en 1855 de son père, commerçant en soieries. Il devient maître d'étude au collège d'Alès. Cette expérience pénible lui inspirera son premier roman, Le Petit Chose (1868). Daudet rejoint ensuite son frère à Paris et y mène une vie de bohème. Il publie en 1859 un recueil de vers, Les Amoureuses. L'année suivante, il rencontre le poète Frédéric Mistral. Il a son entrée dans quelques salons littéraires, collabore à plusieurs journaux, notamment Paris-Journal, L'Universel et Le Figaro. En 1861, il devient secrétaire du duc de Morny (1811-1865) demi-frère de Napoléon III et président du Corps Législatif. Ce dernier lui laisse beaucoup de temps libre qu'il occupe à écrire des contes, des chroniques mais meurt subitement en 1865 : cet événement fut le tournant décisif de la carrière d'Alphonse. Après cet évènement, Alphonse Daudet se consacra à l'écriture, non seulement comme chroniqueur au journal Le Figaro mais aussi comme romancier. Puis, après avoir fait un voyage en Provence, Alphonse commença à écrire les premiers textes qui feront partie des Lettres de mon Moulin. Il connut son premier succès en 1862-1865, avec la Dernière Idole, pièce montée à l'Odéon et écrite en collaboration avec Ernest Manuel - pseudonyme d'Ernest Lépine. Puis, il obtint, par le directeur du journal L'Événement, l'autorisation de les publier comme feuilleton pendant tout l'été de l'année 1866, sous le titre de Chroniques provençales. Certains des récits des Lettres de mon Moulin sont restés parmi les histoires les plus populaires de notre littérature, comme La Chèvre de monsieur Seguin, Les Trois Messes basses ou L'Élixir du Révérend Père Gaucher. Le premier vrai roman d'Alphonse Daudet fut Le Petit Chose écrit en 1868. Il s'agit du roman autobiographique d'Alphonse dans la mesure où il évoque son passé de maître d'étude au collège d'Alès (dans le Gard, au nord de Nîmes). C'est en 1874 qu'Alphonse décida d'écrire des romans de mœurs comme : Fromont jeune et Risler aîné mais aussi Jack (1876), Le Nabab (1877) – dont Morny serait le "modèle" – les Rois en exil (1879), Numa Roumestan (1881) ou L'Immortel (1883). Pendant ces travaux de romancier et de dramaturge (il écrivit dix-sept pièces), il n'oublia pas pour autant son travail de conteur : il écrivit en 1872 Tartarin de Tarascon, qui fut son personnage mythique. Les contes du lundi (1873), un recueil de contes sur la guerre franco-prussienne, témoignent aussi de son goût pour ce genre et pour les récits merveilleux. Daudet subit les premières atteintes d'une maladie incurable de la moelle épinière, le tabes dorsalis, mais continue de publier jusqu'en 1895. Il décède le 16 décembre 1897 à Paris, à l'âge de 57 ans.
Partie 1
Chapitre1 LA FABRIQUE
Je suis né le 13 mai 18…, dans une ville du Languedoc où l'on trouve, comme dans toutes les villes du Midi, beaucoup de soleil, pas mal de poussière, un couvent de carmélites et deux ou trois monuments romains.
Mon père, M. Eyssette, qui faisait à cette époque le commerce des foulards, avait, aux portes de la ville, une grande fabrique dans un pan de laquelle il s'était taillé une habitation commode, tout ombragée de platanes, et séparée des ateliers par un vaste jardin.
C'est là que je suis venu au monde et que j'ai passé les premières, les seules bonnes années de ma vie.
Aussi ma mémoire reconnaissante a-t-elle gardé du jardin, de la fabrique et des platanes un impérissable souvenir, et lorsque à la ruine de mes parents il m'a fallu me séparer de ces choses, je les ai positivement regrettées comme des êtres.
Je dois dire, pour commencer, que ma naissance ne porta pas bonheur à la maison Eyssette. La vieille Annou, notre cuisinière, m'a souvent conté depuis comme quoi mon père, en voyage à ce moment, reçut en même temps la nouvelle de mon apparition dans le monde et celle de la disparition d'un de ses clients de Marseille, qui lui emportait plus de quarante mille francs ; si bien que M. Eyssette, heureux et désolé du même coup, se demandait, comme l'autre, s'il devait pleurer pour la disparition du client de Marseille, ou rire pour l'heureuse arrivée du Petit Daniel… Il fallait pleurer, mon bon monsieur Eyssette, il fallait pleurer doublement.
C'est une vérité, je fus la mauvaise étoile de mes parents. Du jour de ma naissance, d'incroyables malheurs les assaillirent par vingt endroits. D'abord nous eûmes donc le client de Marseille, puis deux fois le feu dans la même année, puis la grève des ourdisseuses, puis notre brouille avec l'oncle Baptiste ?, puis un procès très coûteux avec nos marchands de couleurs, puis, enfin, la révolution de 18…, qui nous donna le coup de grâce.
À partir de ce moment, la fabrique ne battit plus que d'une aile ; petit à petit, les ateliers se vidèrent : chaque semaine un métier à bas, chaque mois une table d'impression de moins. C'était pitié de voir la vie s'en aller de notre maison comme d'un corps malade, lentement, tous les jours un peu. Une fois, on n'entra plus dans les salles du second. Une autre fois, la cour du fond fut condamnée. Cela dura ainsi pendant deux ans ; pendant deux ans, la fabrique agonisa. Enfin, un jour, les ouvriers ne vinrent plus, la cloche des ateliers ne sonna pas, le puits à roue cessa de grincer, l'eau des grands bassins, dans lesquels on lavait les tissus, demeura immobile, et bientôt, dans toute la fabrique, il ne resta plus que M. et Mme Eyssette, la vieille Annou, mon frère Jacques et moi ; puis, là-bas, dans le fond, pour garder les ateliers, le concierge Colombe et son fils le petit Rouget.
C'était fini, nous étions ruinés.
J'avais alors six ou sept ans. Comme j'étais très frêle et maladif, mes parents n'avaient pas voulu m'envoyer à l'école. Ma mère m'avait seulement appris à lire et à écrire, plus quelques mots d'espagnol et deux ou trois airs de guitare, à l'aide desquels on m'avait fait, dans la famille, une réputation de petit prodige. Grâce à ce système d'éducation, je ne bougeais jamais de chez nous, et je pus assister dans tous ses détails à l'agonie de la maison Eyssette. Ce spectacle me laissa froid, je l'avoue ; même je trouvai à notre ruine ce côté très agréable que je pouvais gambader à ma guise par toute la fabrique, ce qui, du temps des ouvriers, ne m'était permis que le dimanche. Je disais gravement au petit Rouget :
« Maintenant, la fabrique est à moi ; on me l'a donnée pour jouer. » Et le petit Rouget me croyait. Il croyait tout ce que je lui disais, cet imbécile.
À la maison, par exemple, tout le monde ne prit pas notre débâcle aussi gaiement. Tout à coup, M. Eyssette devint terrible : c'était dans l'habitude une nature enflammée, violente, exagérée, aimant les cris, la casse et les tonnerres ; au fond, un très excellent homme, ayant seulement la main leste, le verbe haut et l'impérieux besoin de donner le tremblement à tout ce qui l'entourait. La mauvaise fortune, au lieu de l'abattre, l'exaspéra. Du soir au matin, ce fut une colère formidable qui, ne sachant à qui s'en prendre, s'attaquait à tout, au soleil, au mistral, à Jacques, à la vieille Annou, à la Révolution, oh ! surtout à la Révolution !… À entendre mon père, vous auriez juré que cette révolution de 18…, qui nous avait mis à mal, était spécialement dirigée contre nous. Aussi, je vous prie de croire que les révolutionnaires n'étaient pas en odeur de sainteté dans la maison Eyssette. Dieu sait ce que nous avons dit de ces messieurs dans ce temps. là… Encore aujourd'hui, quand le vieux papa Eyssette (que Dieu me le conserve !) sent venir son accès de goutte, il s'étend péniblement sur sa chaise longue, et nous l'entendons dire : « Oh ! ces révolutionnaires !… » À l'époque dont je vous parle, M. Eyssette n'avait pas la goutte, et la douleur de se voir ruiné en avait fait un homme terrible que personne ne pouvait approcher. Il fallut le saigner deux fois en quinze jours. Autour de lui, chacun se taisait ; on avait peur.
À table, nous demandions du pain à voix basse. On n'osait pas même pleurer devant lui. Aussi, dès qu'il avait tourné les talons, ce n'était qu'un sanglot, d'un bout de la maison à l'autre ; ma mère, la vieille Annou, mon frère Jacques et aussi mon grand frère l'abbé, lorsqu'il venait nous voir, tout le monde s'y mettait. Ma mère, cela se conçoit, pleurait de voir M. Eyssette malheureux ; l'abbé et la vieille Annou pleuraient de voir pleurer Mme Eyssette ; quant à Jacques, trop jeune encore pour comprendre nos malheurs – il avait à peine deux ans de plus que moi – il pleurait par besoin, pour le plaisir.
Un singulier enfant que mon frère Jacques ; en voilà un qui avait le don des larmes ! D'aussi loin qu'il me souvienne, je le vois les yeux rouges et la joue ruisselante. Le soir, le matin, de jour, de nuit, en classe, à la maison, en promenade, il pleurait sans cesse, il pleurait partout. Quand on lui disait :
«Qu'as-tu ?» il répondait en sanglotant : « Je n'ai rien. » Et, le plus curieux, c'est qu'il n'avait rien. Il pleurait comme on se mouche, plus souvent, voilà tout. Quelquefois M. Eyssette, exaspéré, disait à ma mère : « Cet enfant est ridicule, regardez-le… c'est un fleuve. » À quoi Mme Eyssette répondait de sa voix douce : « Que veux-tu, mon ami ? cela passera en grandissant ; à son âge, j'étais comme lui. » En attendant, Jacques grandissait ; il grandissait beaucoup même, et cela ne lui passait pas. Tout au contraire, la singulière aptitude qu'avait cet étrange garçon à répandre sans raison des averses de larmes allait chaque jour en augmentant. Aussi la désolation de nos parents lui fut une grande fortune… C'est pour le coup qu'il s'en donna de sangloter à son aise, des journées entières, sans que personne vînt lui dire : « Qu'as-tu ? » En somme, pour Jacques comme pour moi, notre ruine avait son joli côté.
Pour ma part, j'étais très heureux. On ne s'occupait plus de moi. J'en profitais pour jouer tout le jour avec Rouget parmi les ateliers déserts, où nos pas sonnaient comme dans une église, et les grandes cours abandonnées, que l'herbe envahissait déjà, Ce jeune Rouget, fils du concierge Colombe, était un gros garçon d'une douzaine d'années, fort comme un bœuf, dévoué comme un chien, bête comme une oie et remarquable surtout par une chevelure rouge, à laquelle il devait son surnom de Rouget. Seulement, je vais vous dire : Rouget, pour moi, n'était pas Rouget. Il était tout à tour mon fidèle Vendredi, une tribu de sauvages, un équipage révolté, tout ce qu'on voulait. Moi-même, en ce temps-là, je ne m'appelais pas Daniel Eyssette : j'étais cet homme singulier, vêtu de peaux de bêtes, dont on venait de me donner les aventures, master Crusoe lui-même. Douce folie ! Le soir, après souper, je relisais mon Robinson, je l'apprenais par cœur ; le jour, je le jouais, je le jouais avec rage, et tout ce qui m'entourait, je l'enrôlais dans ma comédie. La fabrique n'était plus la fabrique ; c'était mon île déserte, oh ! bien déserte.
Les bassins jouaient le rôle d'Océan. Le jardin faisait une forêt vierge. Il y avait dans les platanes un tas de cigales qui étaient de la pièce et qui ne le savaient pas.
Rouget, lui non plus, ne se doutait guère de l'importance de son rôle. Si on lui avait demandé ce que c'était que Robinson, on l'aurait bien embarrassé ; pourtant je dois dire qu'il tenait son emploi avec la plus grande conviction, et que, pour imiter le rugissement des sauvages, il n'y en avait pas comme lui.
Où avait-il appris ? Je l'ignore… Toujours est-il que ces grands rugissements de sauvage qu'il allait chercher dans le fond de sa gorge, en agitant sa forte crinière rouge, auraient fait frémir les plus braves.
Moi-même, Robinson, j'en avais quelquefois le cœur bouleversé, et j'étais obligé de lui dire à voix basse ! « Pas si fort, Rouget, tu me fais peur. » Malheureusement, si Rouget, imitait le cri des sauvages très bien, il savait encore mieux dire les gros mots d'enfants de la rue et jurer le nom de Notre-Seigneur. Tout en jouant, j'appris à faire comme lui, et un jour, en pleine table, un formidable juron m'échappa je ne sais comment, Consternation générale ! « Qui t'a appris cela ? Où l'as-tu entendu ? » Ce fut un événement. M. Eyssette parla tout de suite de me mettre dans une maison de correction ; mon grand frère l'abbé dit qu'avant toute chose on devait m'envoyer à confesse, puisque j'avais l'âge de raison. On me mena à confesse. Grande affaire ! Il fallait ramasser dans tous les coins de ma conscience un tas de vieux péchés qui traînaient là depuis sept ans. Je ne dormis pas de deux nuits ; c'est qu'il y en avait toute une panerée de ces diables de péchés ; j'avais mis les plus petits dessus, mais c'est égal, les autres se voyaient, et lorsque, agenouillé dans la petite armoire de chêne, il fallut montrer tout cela au curé des Récollets, je crus que je mourrais de peur et de confusion…
Ce fut fini. Je ne voulus plus jouer avec Rouget ; je savais maintenant, c'est saint Paul qui l'a dit et le curé des Récollets me le répéta, que le démon rôde éternellement autour de nous comme un lion, quaerens quem devoret ? Oh ! ce quaerens quem devoret, quelle impression il me fit ! Je savais aussi que cet intrigant de Lucifer prend tous les visages qu'il veut pour vous tenter ; et vous ne m'auriez pas ôté de l'idée qu'il s'était caché dans la peau de Rouget pour m'apprendre à jurer le nom de Dieu. Aussi, mon premier soin, en rentrant à la fabrique, fut d'avertir Vendredi qu'il eût à rester chez lui dorénavant. Infortuné Vendredi ! Cet ukase lui creva, le cœur, mais il s'y conforma sans une plainte. Quelquefois je l'apercevais debout, sur la porte de la loge, du côté des ateliers ; il se tenait là tristement ; et lorsqu'il voyait que je le regardais, le malheureux poussait pour m'attendrir les plus effroyables rugissements, en agitant sa crinière flamboyante ; mais plus il rugissait, plus je me tenais loin. Je trouvais qu'il ressemblait au fameux lion quaerens. Je lui criais : « Va-t'en ! tu me fais horreur. » Rouget s'obstina à rugir ainsi pendant quelques jours ; puis, un matin, son père, fatigué de ses rugissements à domicile, l'envoya rugir en apprentissage, et je ne le revis plus.
Mon enthousiasme pour Robinson n'en fut pas un instant refroidi. Tout juste vers ce temps-là, l'oncle Baptiste se dégoûta subitement de son perroquet et me le donna. Ce perroquet remplaça Vendredi. Je l'installai dans une belle cage au fond de ma résidence d'hiver ; et me voilà, plus Crusoé que jamais, passant mes journées en tête-à-tête avec cet intéressant volatile et cherchant à lui faire dire : « Robinson, mon pauvre Robinson !» Comprenez-vous cela ?
Ce perroquet, que l'oncle Baptiste m'avait donné pour se débarrasser de son éternel bavardage, s'obstina à ne pas parler dès qu'il fut à moi… Pas plus « mon pauvre Robinson» qu'autre chose ; jamais je n'en pus rien tirer. Malgré cela, je l'aimais beaucoup et j'en avais le plus grand soin.
Nous vivions ainsi, mon perroquet et moi, dans la plus austère solitude, lorsqu'un matin il m'arriva une chose vraiment extraordinaire. Ce jour-là, j'avais quitté ma cabane de bonne heure et je faisais, armé jusqu'aux dents, un voyage d'exploration à travers mon île… Tout à coup, je vis venir de mon côté un groupe de trois ou quatre personnes, qui parlaient à voix très haute et gesticulaient vivement. Juste Dieu ! des hommes dans mon île ! Je n'eus que le temps de me jeter derrière un bouquet de lauriers roses, et à plat ventre, s'il vous plaît… Les hommes passèrent près de moi sans me voir… Je crus distinguer la voix du concierge Colombe, ce qui me rassura un peu ; mais, c'est égal, dès qu'ils furent loin je sortis de ma cachette et je les suivis à distance pour voir ce que tout cela deviendrait…
Ces étrangers restèrent longtemps dans mon île.
Ils la visitèrent d'un bout à l'autre dans tous ses détails. Je les vis entrer dans mes grottes et sonder avec leurs cannes la profondeur de mes océans. De temps en temps ils s'arrêtaient et remuaient la tête.
Toute ma crainte était qu'ils ne vinssent à découvrir mes résidences… Que serais-je devenu, grand Dieu !
Heureusement, il n'en fut rien, et au bout d'une demi-heure, les hommes se retirèrent sans se douter seulement que l'île était habitée. Dès qu'ils furent partis, je courus m'enfermer dans une de mes cabanes, et passai là le reste du jour à me demander quels étaient ces hommes et ce qu'ils étaient venus faire.
J'allais le savoir bientôt.
Le soir, à souper, M. Eyssette nous annonça solennellement que la fabrique était vendue, et que, dans un mois, nous partirions tous pour Lyon, où nous allions demeurer désormais.
Ce fut un coup terrible. Il me sembla que le ciel croulait. La fabrique vendue !… Eh bien, et mon île, mes grottes, mes cabanes ? Hélas ! l'île, les grottes, les cabanes, M. Eyssette avait tout vendu ; il fallait tout quitter. Dieu, que je pleurais !…
Pendant un mois, tandis qu'à la maison on emballait les glaces, la vaisselle, je me promenais triste et seul dans ma chère fabrique, Je n'avais plus le cœur à jouer, vous pensez… oh ! non… J'allais m'asseoir dans tous les coins, et regardant les objets autour de moi, je leur parlais comme à des personnes ; je disais aux platanes : « Adieu, mes chers amis !» et aux bassins : « C'est fini, nous ne nous verrons plus ! » Il y avait dans le fond du jardin un grand grenadier dont les belles fleurs rouges s'épanouissaient au soleil. Je lui dis en sanglotant : «Donne-moi une de tes fleurs.» Il me la donna. Je la mis dans ma poitrine, en souvenir de lui. J'étais très malheureux.
Pourtant, au milieu de cette grande douleur, deux choses me faisaient sourire : d'abord la pensée de monter sur un navire, puis la permission qu'on' m'avait donnée d'emporter mon perroquet avec moi.
Je me disais que Robinson avait quitté son île dans des conditions à peu près semblables, et cela me donnait du courage.
Enfin, le jour du départ arriva. M. Eyssette était déjà à Lyon depuis une semaine. Il avait pris les devant avec les gros meubles. Je partis donc en compagnie de Jacques, de ma mère et de la vieille Annou. Mon grand frère l'abbé ne partait pas, mais il nous accompagna jusqu'à la diligence de Beaucaire ?, et aussi le concierge Colombe nous accompagna. C'est lui qui marchait devant en poussant une énorme brouette chargée de malles. Derrière venait mon frère l'abbé, donnant le bras à Mme Eyssette.
Mon pauvre abbé, que je ne devais plus revoir !
La vieille Annou marchait ensuite, flanquée d'un énorme parapluie bleu et de Jacques, qui était bien content d'aller à Lyon, mais qui sanglotait tout de même… Enfin, à la queue de la colonne venait Daniel Eyssette, portant gravement la cage du perroquet et se retournant à chaque pas du côté de sa chère fabrique.
À mesure que la caravane s'éloignait, l'arbre aux grenades se haussait tant qu'il pouvait par-dessus les murs du jardin pour la voir encore une fois… Les platanes agitaient leurs branches en signe d'adieu…
Daniel Eyssette, très ému, leur envoyait des baisers à tous, furtivement et du bout des doigts.
Je quittai mon île le 30 septembre 18…
Chapitre2 LES BABAROTRES
O CHOSES de mon enfance, quelle impression VOUS m'avez laissée! Il me semble que c'est hier, ce voyage sur le Rhône. Je vois encore le bateau, ses passagers, son équipage; j'entends le bruit des roues et le sifflet de la machine. Le capitaine s'appelait Géniès, le maître coq Montélimart. On n'oublie pas ces choses-là.
La traversée dura trois jours. Je passai ces trois jours sur le pont, descendant au salon juste pour manger et dormir. Le reste du temps, j'allais me mettre à la pointe extrême du navire, près de l'ancre.
Il y avait là une grosse cloche qu'on sonnait en entrant dans les villes: je m'asseyais à côté de cette cloche, parmi des tas de cordes; je posais la cage du perroquet entre mes jambes et je regardais. Le Rhône était si large qu'on voyait à peine ses rives.
Moi, je l'aurais voulu encore plus large, et qu'il se fût appelé: la mer! Le ciel riait, l'onde était verte.
Des grandes barques descendaient au fil de l'eau. Des mariniers, guéant le fleuve à dos de mules, passaient près de nous en chantant. Parfois, le bateau longeait quelque île bien touffue, couverte de joncs et de saules: «Oh! une île déserte!» me disais-je dans moi-même; et je la dévorais des yeux…
Vers la fin du troisième jour, je crus que nous allions avoir un grain. Le ciel s'était assombri subitement; un brouillard épais dansait sur le fleuve; à l'avant du navire on avait allumé une grosse lanterne, et, ma foi, en présence de tous ces symptômes, je commençais à être ému… À ce moment, quelqu'un dit près de moi: «Voilà Lyon!» En même temps la grosse cloche se mit à sonner. C'était Lyon.
Confusément, dans le brouillard, je vis des lumières briller sur l'une et sur l'autre rive; nous passâmes sous un pont, puis sous un autre. À chaque fois l'énorme tuyau de la cheminée se courbait en deux et crachait des torrents d'une fumée noire qui faisait tousser… Sur le bateau, c'était un remue-ménage effroyable. Les passagers cherchaient leurs malles; les matelots juraient en roulant des tonneaux dans l'ombre. Il pleuvait…
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!