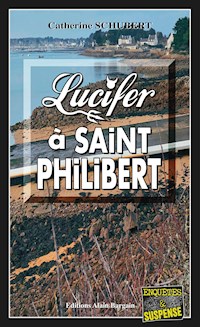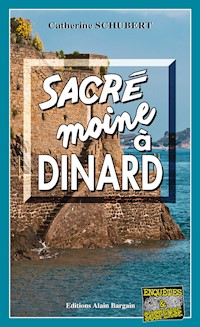Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une série de meurtres dans la région de Rennes et dans le Morbihan lancent le commandant Vaudrin sur la piste d'un tueur en série !
Victor Vaudrin, commandant de police à Rennes, est confronté au crime odieux d’une octogénaire. Parmi les proches de la victime, on trouve un jardinier irakien clandestin, l’auxiliaire de vie de la vieille dame, mariée à un homme violent, et l’un de ses petits-fils, adhérent d’un parti d’extrême droite.
Deux ans auparavant, une autre personne âgée a été tuée dans les mêmes conditions, à Plaudren, dans le Morbihan. Pire, il y a un an, une retraitée allemande a été découverte assassinée près de Perros-Guirec. Ce crime va obliger le commandant Vaudrin à faire équipe avec la section de recherches de Saint-Brieuc, et notamment son chef, le capitaine Marc Morini.
Cette enquête à rebondissements va les mener le long des routes bretonnes, sur les traces d’un tueur en série particulièrement monstrueux.
Un polar qui vous emmènera sur les routes bretonnes à la recherche d'un meurtrier qui n'a pas froid aux yeux !
EXTRAIT
Le corps de la vieille femme gît sur la chaise. Avec la faiblesse d’un pantin en fin de vie, sa main gauche tremble doucement. Elle se lamente, des larmes glissent sur ses joues brûlantes.
Assis en face d’elle, son tortionnaire scrute son travail avec satisfaction.
L’arcade sourcilière gauche est ouverte, la paupière droite gonflée cache un iris vitreux. Des lèvres fendues coule un filet de sang, dont les gouttes viennent mourir sur la nappe brodée pour y dessiner des flaques rougeâtres.
Sur l’avant-bras droit tailladé de sa victime, il a sculpté un « V ». Puis, heureux du résultat, il a continué ses entailles, comme un enfant gribouillant sur une feuille blanche.
Elle geint, appelle Thérèse. Il ricane, puis se lève avant de la gifler. Sa tête vacille. Elle frémit de tous ses membres. Il hurle.
— Thérèse ! Thérèse ! Mais ta fille ne viendra pas. Tout le monde dort à cette heure de la nuit, tu es seule avec moi. Tu comprends ? Il n’y a que toi et moi ici, nous sommes deux amoureux savourant une nuit d’automne.
Son rire fait apparaître une dentition jaunâtre.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Catherine Schubert - Originaire de Bretagne, l’amour me mène très jeune en Allemagne. Mère de trois enfants, j’ai parcouru en famille une partie du monde. Aujourd’hui, je partage ma vie entre les Côtes d’Armor et la Bavière. Passionnée d’écriture et de philosophie, j’aime relater la complexité des relations humaines, les blessures, les frustrations qui peuvent parfois conduire au crime.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
Je remercie particulièrement Doris Amann-Hahn et Éric Amann de m’avoir encouragée après la lecture de Odeur de sang à Penvénan, ainsi que Catherine Oudoul et Frédérique Menez.
Merci aux Mordues de Thriller, Émilie Genet, Isabelle Le Boedeckerriguy, Corinne Mathieu-Dekokere, Mylène Nivelle et Laurianne Pondaven pour leurs commentaires et retours sur le site des Mordus.
Merci à ma sœur Christine, ma cousine Maryse et mon mari Rainer.
PROLOGUE
Lundi 24 septembre 2012 – 2 h 17
Le corps de la vieille femme gît sur la chaise. Avec la faiblesse d’un pantin en fin de vie, sa main gauche tremble doucement. Elle se lamente, des larmes glissent sur ses joues brûlantes.
Assis en face d’elle, son tortionnaire scrute son travail avec satisfaction.
L’arcade sourcilière gauche est ouverte, la paupière droite gonflée cache un iris vitreux. Des lèvres fendues coule un filet de sang, dont les gouttes viennent mourir sur la nappe brodée pour y dessiner des flaques rougeâtres.
Sur l’avant-bras droit tailladé de sa victime, il a sculpté un « V ». Puis, heureux du résultat, il a continué ses entailles, comme un enfant gribouillant sur une feuille blanche.
Elle geint, appelle Thérèse. Il ricane, puis se lève avant de la gifler. Sa tête vacille. Elle frémit de tous ses membres. Il hurle.
— Thérèse ! Thérèse ! Mais ta fille ne viendra pas. Tout le monde dort à cette heure de la nuit, tu es seule avec moi. Tu comprends ? Il n’y a que toi et moi ici, nous sommes deux amoureux savourant une nuit d’automne.
Son rire fait apparaître une dentition jaunâtre.
Elle frissonne. La chaudière éteinte n’apporte aucune chaleur dans la grande pièce d’ordinaire agréable à vivre. Elle a peur d’attraper froid mais, sans pouvoir la contrôler, une idée lui traverse l’esprit. Elle est saisie d’effroi. Elle ne tombera plus jamais malade. Son histoire s’arrêtera avant l’aube. Elle le sait, elle le sent. Elle sourit. Elle ne reverra plus le jeune médecin qui lui rendait visite régulièrement.
Debout devant la chaise, il la frappe de nouveau en l’insultant. Des mots pleuvent, suivis de gifles. Des larmes brouillent son œil gauche. Elle voudrait connaître les raisons de cette folie qui s’abat sur elle. Comment pourrait-elle comprendre ? Le jeune docteur dit que, à 87 ans, elle perd peu à peu la tête.
Elle a beau réfléchir, trier les pensées qui traversent son cerveau fatigué, aucune réponse ne vient la rassurer.
Il se rassied et marmonne des syllabes incompréhensibles. Dans le silence de la cuisine, on entendrait une mouche voler. Seul le bruit des aiguilles de la pendule accrochée au mur résonne doucement.
Il se laisse bercer par le tic-tac de l’horloge avant de s’assoupir. Elle n’a pas la force de se détacher. Il l’a bien ficelée. Elle sent la mort approcher. Elle ne la redoute plus. Elle craint juste cette violence. Elle prie Dieu de la laisser mourir pendant qu’il somnole. Dieu n’entend pas, ne répond pas. Elle est seule face à son bourreau et va mourir, abandonnée de tous.
Elle a si souvent imaginé sa mort. Elle avait espéré s’éteindre dans son sommeil. S’endormir et ne pas se réveiller. La plus douce des morts.
Un bruit le réveille. Il ouvre les yeux et s’étire en bâillant bruyamment. Elle tressaille et redoute de nouveaux coups. Il cherche d’où vient ce clapotis étrange. Il se lève, se dirige vers l’évier sous le regard angoissé de la vieille dame. Le robinet est bien fermé. Une odeur âcre lui pique le nez. Il se retourne vers la chaise. Elle tremble de tous ses membres. Il s’approche d’elle avant de la frapper en hurlant :
— Mais tu pisses par terre ! Grosse cochonne, tu vas me le payer.
Des larmes glissent sur ses joues blêmes. Elle voudrait s’excuser mais aucun son ne parvient du fond de sa gorge. Elle se demande pourquoi cet acharnement. Même si elle n’a plus toute sa tête, comme lui répète Valentine, elle est capable de comprendre certaines choses.
Valentine ! C’est le seul espoir qui lui reste. Pourtant, à cette heure de la nuit, elle sait qu’elle ne viendra pas et, au petit matin, il sera sans doute trop tard. Avec le peu de lucidité qui lui reste, elle a pitié de sa femme de ménage. C’est elle qui la découvrira, morte, mutilée, torturée. À moins que son tortionnaire n’ait pitié d’elle. Elle est si âgée, si faible, si seule.
— Voilà ta punition, madame Poncelet ! s’exclame-t-il en insistant sur le nom de la vieille dame, afin de lui rappeler qu’il ne s’est pas trompé d’adresse, qu’il ne l’a pas choisie par hasard.
Elle tremble encore plus, de froid, d’effroi. Il prend brusquement sa main. Elle grimace de douleur. La cire de la bougie trace un sillon sur sa peau ridée, puis pénètre les cicatrices encore ouvertes de son bras. Elle a mal, très mal. Pourtant, elle n’arrive plus à geindre. Elle attend juste la Grande Faucheuse. Sa peau boursouflée lui inflige un supplice atroce. Elle espère désormais décéder rapidement. Elle en veut à ce cœur solide qui continue à battre. Elle sent les pulsations dans son cou. Elle les compte pour oublier la douleur. Elle espère percevoir les battements s’affaiblir.
Cette idée de mourir la tranquillise. Louis l’attend certainement. Elle le sait. Pourtant, son bourreau n’a pas l’intention de la laisser partir trop vite. Le jeu doit durer. Il lui a dédié cette nuit. C’est un chat, et elle est sa souris.
Elle est assise depuis plusieurs heures déjà ; son dos octogénaire n’apprécie guère cette position prolongée. Ses pieds enflés la font terriblement souffrir. Elle a froid et ne souhaite plus qu’une chose, retrouver son lit, oublier ce cauchemar et dormir.
L’individu qui la retient prisonnière se place derrière la chaise. Il la coiffe doucement avec ses mains en chantonnant une vieille comptine. Elle reprend espoir ; pourtant, son corps n’y croit plus. Elle est saisie d’un frisson qui lui transperce les vertèbres. Il poursuit sa chansonnette tout en laissant glisser les cheveux blancs entre ses doigts aux ongles mal soignés. Elle sent sa sueur qui lui arrache une moue de dégoût. Il chante le refrain :
— Alouette, je te plumerai, alouette, gentille alouette…
Son haleine de chacal lui donne la nausée.
Une douleur atroce la surprend brutalement. Elle sent des gouttes de liquide chaud perler dans son cou avant d’aller mourir sur sa poitrine. Sa belle robe de nuit dentelée se tache de sang. De son œil gauche, elle aperçoit un bout de son oreille entre le pouce et l’index de son geôlier. Elle pleure doucement, prisonnière entre ses mains.
Mais pourquoi l’a-t-elle laissé pénétrer dans l’entrée peu avant 19 heures ? C’était la deuxième fois qu’il se présentait. La première fois, la rencontre s’était bien terminée. Il avait l’air si charmant, prévenant. Certes, il est laid, gros et court sur pattes ; son crâne est déformé, sans doute par des forceps mal employés à sa naissance. Il a un œil bien plus grand que l’autre, le nez tordu et une peau marquée par de nombreuses cicatrices, assurément des souvenirs d’acné juvénile.
Anthony Quinn dans le rôle de Quasimodo lui paraît plus séduisant.
Puis vers 20 heures, juste avant le journal de Gilles Bouleau, il l’a quittée, non sans avoir eu la gentillesse de lui apporter une tisane. Elle s’est assoupie. À son réveil, elle était assise sur cette chaise.
— Bon, on va poursuivre notre petite soirée en amoureux, tu veux bien ?
Elle est saisie d’épouvante. Il ouvre un paquet d’aliments pour chien acheté chez un discounter.
— Lapin et saumon, drôle de mélange, j’espère que tu vas apprécier.
Il dispose sur la table, prend quelques croquettes.
— Vas-y, mange ! C’est ton dîner.
Elle ne réagit pas. Il hurle :
— Mange ces croquettes !
Elle en prend une avant de la mettre dans la bouche. Cependant, sans son dentier, elle ne parvient pas à la croquer. Elle essaie de l’avaler mais sa gorge est si sèche qu’elle craint de s’étouffer.
— Mange ! On ne va pas y passer la nuit.
Ses hurlements ne lui font désormais plus peur. La mort lui semble si douce, si complice et si amicale qu’elle ne redoute plus son persécuteur. À 18 ans, elle avait rejoint un groupe de résistance à Carantec, dont Louis était le chef. Elle se sent pousser des ailes.
— Mange ou je te force à avaler ces croquettes !
Elle le fixe droit de son œil valide et garde la tête haute. Elle ne tremble plus et se surprend à fredonner le chant des partisans.
— Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne ? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme. Ce soir, l’ennemi connaîtra le prix…
Il se lève pour la gifler, si violemment qu’elle saigne du nez. Elle ne le quitte pas du regard. Il prend des croquettes dans le creux de sa main, puis il bourre la bouche de sa victime jusqu’à ce qu’elle s’étouffe.
Elle cherche de l’air mais ses voies respiratoires obstruées ne peuvent plus oxygéner son corps meurtri. La peau de son visage bleuit.
— Eh bien, voilà, comme ça, tu me plais mieux. Tu es belle et tu n’emmerderas plus personne avec tes caprices et ta voix chevrotante.
Son cœur a cessé de battre. Il est 3 h 43.
Il se réjouit de ce spectacle qu’il a composé et mis en scène. Seul ce chant de révolte n’était pas prévu au programme. Mais il sait faire face à toutes les situations.
Après avoir avalé un morceau de fromage et bu un verre de vin, il s’allonge sur le divan du salon.
— Elle s’en faisait pas, la vieille, murmure-t-il après avoir admiré l’étiquette de la bouteille.
À 5 heures, la sonnerie de son portable le réveille. Il se lève et se rend dans la cuisine pour rallumer des bougies, qu’il dispose en « V » devant le corps de la vieille dame. Il contemple une dernière fois le visage tuméfié de sa victime et semble satisfait.
Il quitte la belle maison en sifflotant. Dans le jardin, un chat s’éloigne à son passage.
— C’est ça, barre-toi, sale bête.
Cette année encore, il a accompli sa mission. Dehors, les rues sont dépeuplées. Dans ce quartier chic de Rennes, les gens rêvent dans de beaux draps, bien loin de se douter du drame. C’est un secteur calme, proche du parlement breton. Il prend le premier métro.
Assis dans la rame, il pense à l’année prochaine. Il lui reste désormais 364 jours pour trouver une prochaine victime. Il va se laisser le temps de bien la choisir, afin de réussir sa mise en scène. Il est heureux et se fiche des rares personnes qui détournent leur regard en le croisant. Il y est habitué et sait que, avec un peu de gentillesse et d’humour, il arrive à se faire apprécier. Parfois, devant des gamins apeurés, il mime un monstre et hurle en courant vers eux. Ça l’amuse.
I
Lundi 24 septembre 2012 – 6 h 45 – 88 jours avant la fin du monde selon le calendrier maya
Je m’appelle Victor Vaudrin, j’ai 46 ans, je suis flic et j’ai vu le jour à Goulven, pas loin de Lesneven, pays du kig ha farz. C’est ce que répétait une de mes tantes après avoir connu l’amour dans un restaurant routier de Landivisiau.
Cela explique sans doute une bedaine à peine visible. J’aurais pu privilégier le sport mais, de ma mère, j’ai hérité de l’amour de la bonne chère. Elle adore cuisiner.
Afin de compléter le tableau, sachez que mon enfance fut heureuse et choyée. Certes, mon père décéda le même jour que le général de Gaulle, mais nous n’avions pas encore vraiment fait connaissance.
Il était postier, distribuait le courrier à vélo en sifflotant par tous les temps et payait les mandats aux heureux bénéficiaires. Sur sa bicyclette, il rendit l’âme un après-midi d’automne. Crise cardiaque à 35 ans, c’est loin d’être banal pour un homme qui n’avait aucun vice.
Je remarquai son absence au noir qui habilla soudainement ma mère, elle qui aimait tant les coloris fleuris, et à la compassion exagérée de ma maîtresse d’école, qui se crut obligée de me changer de place. J’atterris donc au premier rang de la classe et c’est ainsi que je devins bon élève.
Fière de mes bonnes notes, ma mère rêvait de me voir devenir médecin ou astronaute. Bref, un de ces métiers prestigieux qui rendent riches et célèbres. Pourtant, on ne décide pas de sa vie, on la vit. C’est ce que disait ma grand-mère. Après des études de droit, je choisis la police comme d’autres choisissent la magistrature.
Flic, c’est un boulot à part. Certains vous haïssent sans vous connaître, parce que c’est dans l’air du temps de détester les flics, d’autres recherchent votre compagnie, persuadés de connaître un Rambo ou un Bruce Willis dans son meilleur rôle. Je ne suis ni l’un ni l’autre. Et il y a ceux qui ont zappé l’ère du numérique et vous croient capable de faire sauter leurs contraventions.
Côté amour, ce n’est pas la bérézina, loin de là. J’ai réussi à me faire aimer d’une femme, même de deux. La première m’a quitté pour un courtier en assurances. Cependant, elle m’a donné le plus beau des cadeaux, une fille âgée de 15 ans, Chloé. Même si elle se comporte actuellement comme un cadeau empoisonné, je ne perds pas espoir de la voir devenir raisonnable. Elle est ma raison de vivre.
Ma deuxième compagne est journaliste dans un quotidien local Rennes Matin. Je sais, la police et la presse font rarement bon ménage. Responsable de la rubrique “Justice et faits divers”, Sandra répète m’avoir à l’œil. Nous essayons de gérer au maximum. Ce n’est pas toujours évident.
Levé ce matin avec la douloureuse sensation que cette journée allait bouleverser mon existence à jamais, je tressaille devant un café froid. La sonnerie du réveil avait résonné comme à son habitude, trop tôt et horripilante pour un début de semaine.
On venait de fêter le mariage d’un cousin de Gourin. Vous connaissez la famille ? On se voit pour les mariages, les baptêmes et surtout pour les enterrements. On se scrute, s’amuse de l’embonpoint des uns et de la calvitie des autres, on s’émeut devant les derniers-nés de la fratrie et l’on se promet de ne pas attendre plusieurs années pour se revoir, sachant qu’il faudra un autre événement, triste ou heureux, pour se rassembler.
Chloé s’était enfermée dans la salle de bains et refusait d’en sortir avant d’avoir essayé toutes sortes de coiffures. Elle se vengeait d’une interdiction de sortie prévue en milieu de semaine, ce que je refusais catégoriquement lorsqu’elle vivait sous mon toit, c’est-à-dire, une semaine sur deux.
— Il a fallu que cette conne de Julia fête son anniversaire quand je suis chez toi. Putain, maman et Yannick sont bien plus cools que toi.
— Maman et Yannick sont bien plus cools que toi ! Je crois rêver ! Mais regarde tes notes, ma pauvre fille. De plus, on a dit : « En dehors des vacances scolaires, pas de sortie en semaine. »
— Pardon ? Tu as dit que je n’avais pas le droit de sortir en semaine ! Moi, j’étais contre ! Tu te conduis avec moi comme un flic ! Yannick, lui au moins, il me comprend et il m’aime. D’ailleurs, on pourrait croire que c’est lui mon père.
L’argument me transperça l’estomac avec violence ; néanmoins, j’avais décidé de rester ferme. Et puis, même sans me l’avouer, je n’aimais pas savoir Chloé sortir après la tombée de la nuit. Un réflexe professionnel, sans doute.
Enfin sous la douche, je cherchais à lutter contre ce sentiment pesant qui m’avait décontenancé à l’aube. D’ordinaire, on m’appréciait pour mon côté “terre à terre” et je me surprenais à ressentir l’insaisissable. L’eau glacée coulait le long de mes tempes pour venir rafraîchir mon cou et mes épaules, avant de saisir mes reins. Je réfléchissais aux dernières affaires en cours.
En claquant la porte violemment, Chloé avait fait vibrer la fenêtre de la salle de bains et je sursautai bêtement. La lame de rasoir incisa douloureusement ma joue droite. Décidément, ce lundi débutait bien mal.
Je pensais à Michel qui, par tous les temps, arpentait le bitume devant le commissariat. Impossible pourtant de préciser depuis quand il sillonnait le trottoir d’un pas lent, mais ferme, boitant légèrement de la jambe gauche. Un an ou deux, plus peut-être ?
Michel faisait partie de ces gens qui sont toujours là, mais que l’on ne voit jamais.
Commandant au service régional de police judiciaire de Rennes, affecté au commissariat du 22, boulevard de la Tour-d’Auvergne, je m’attendais toujours au pire. C’est le commissariat central de la ville et, la nuit, les problèmes arrivaient avec la frénésie des moucherons qui s’écrasent sur les pare-brise.
Enfant, je me demandais si ces insectes savaient qu’ils mouraient en venant se jeter sur la vitre de la voiture que conduisait mon père.
Depuis, j’ai compris que nous n’étions pas toujours maîtres de nos propres vies. Ébriété, drogue, prostitution et vol se côtoyaient ici sans se voir.
À l’aube, les uns partaient vers le palais de justice, les autres rentraient chez eux, d’autres encore atterrissaient à l’hôpital psychiatrique.
II
Lundi 24 septembre 2012 – 7 h 26
Il n’était pas encore 7 h 30 quand je garai mon deux-roues dans la cour du commissariat, à côté d’une carcasse de voiture de police incendiée dans une cité.
Planté devant le poste de garde à alpaguer des passants pressés, Michel m’avait salué respectueusement. Son visage illuminé d’un grand sourire reflétait une quiétude qui m’interpellait malgré moi. Je lui posai toujours la même question, intrigué par la sérénité que dégageait ce personnage.
— T’es bien tôt aujourd’hui ? Tu dors donc si peu ?
Fidèle à son habitude, il m’avait fixé de ses grands yeux bleus emplis d’un apitoiement altruiste exagéré à mon goût et m’avait sorti sa rengaine favorite, la menace apocalyptique.
— La parole de Dieu n’attend pas, Commissaire. Dieu n’appelle qu’une seule et unique fois. En vérité, je vous le dis, n’attendez plus pour vous repentir.
Ce qui me dérangeait chez Michel, c’était son manque d’imagination. Pourtant, j’appréciais lorsqu’il m’appelait commissaire. En fait, Michel ne s’appelait pas Michel. D’après ses papiers, il se nommait Hugues Mercier. En hommage à Nostradamus qui, de son temps, avait arpenté les rues pour soigner les pestiférés, nous l’avions rebaptisé Michel. Il n’était pas bien méchant, juste persuadé d’être investi d’une mission divine.
— Ne t’inquiète pas pour mon âme, Michel, je veille à sa santé. Mais toi, fais gaffe, une seule plainte et tu dégages pour toujours de ce trottoir. Tu sais que tu n’es que toléré ici.
— Commissaire, je ne veux pas ennuyer les gens mais les sauver. C’est ici que la parole de Celui qui m’envoie doit être entendue.
Impossible pour moi de dire si Michel croyait vraiment ce qu’il disait, jusqu’à imaginer qu’il ne nous restait que si peu de temps à vivre. Je savais juste qu’il était âgé de 73 ans et avait passé une partie de sa vie à bourlinguer. Sa barbe grisonnante, presque blanche, qui tombait sur sa poitrine lui donnait un air de vieux missionnaire du temps des léproseries indiennes. Il était grand, bien bâti, habillé de manière très sobre mais propre et maniait la langue de Balzac avec aisance. C’était notre Michel et le jour où il ne serait plus là, il nous manquerait certainement.
— Il chut du ciel une grande étoile qui flambait comme une torche ; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources*.
— Je vois, je crois avoir déjà entendu ça quelque part.
— Moquez-vous de l’Apocalypse de saint Jean, Commissaire. Dieu m’a parlé et, dans mon cœur, j’ai lu ses pensées. Les Mayas l’avaient prophétisé avant moi.
Pour la millième fois, Michel m’annonçait la fin du monde pour le 21 décembre de cette année. Nous restait-il encore trois mois à vivre ? Je trouvais cette idée ridicule, pourquoi 2012 et non 2015 ou 2018 ?
Une crampe d’estomac me fit soudainement grimacer. Mais si Michel avait raison, quel dommage de ne pas attendre au moins Noël. J’aimais bien Noël et ses douces senteurs, presque mélancoliques. J’aimais particulièrement la dinde farcie, le champagne, les huîtres de Belon et le regard ébloui de ma fille devant les cadeaux offerts malgré un compte en banque rachitique.
Comme c’était souvent le cas, j’étais le premier de l’équipe au turbin. Certes, il y avait des collègues de nuit qui patrouillaient encore, dans les couloirs du commissariat, le regard assombri par le manque de sommeil et la voix enrouée des matins difficiles. Il y avait ceux aussi qui tapaient les ultimes lignes d’un rapport à faire suivre.
Et il y avait les autres, qui fumaient la dernière cigarette devant la porte, en dissertant sur les problèmes scolaires de leurs marmots et les fins de mois difficiles.
Derrière le comptoir de l’accueil, Marilyne Dumont, surnommée “Marilou”, 46 ans, dont près de vingt-cinq dans la police, s’attaquait déjà à la pile de paperasses accumulées au cours des dernières vingt-quatre heures.
À ses côtés, Patrick, de dix ans son cadet, rédigeait la fin d’un rapport sans intérêt, commencé la veille.
— Salut, Marilou. Salut, Patrick. Tout va bien, ce matin ? Pas encore de problème à régler ?
— Bonjour, Commandant. Pour l’instant, tout va bien. Par contre, la nuit a été pareille à une nuit de fin de week-end, d’après les collègues. Trois tapages nocturnes, deux personnes en état d’ivresse, une bagarre entre toxicos qui a mal tourné. Et pour vous, alors, cette noce ? La mariée a bien dit « oui » au moins ?
Avec un ventre dodu qui ressemblait à un tonneau de bière, un crâne chauve à la Yul Brynner et une moustache qui n’avait rien à envier à celle de Salvador Dalí, Patrick n’en loupait pas une pour sortir une grosse blague. Seuls un accent chopé à Roubaix et l’amour de la cervoise attestaient ses origines nordiques.
— Eh bien, non, répliquai-je, tapant du poing sur le comptoir, la traîtresse n’a pas dit « oui ». Elle s’est présentée devant le maire et a dit qu’elle n’épouserait pas ce con-là, car elle en aimait un autre, rencontré la veille au soir. On croit que ça n’arrive que dans les films ces trucs-là, et pourtant, je l’ai bien vécu.
Le gardien de la paix Patrick Moreau laissa échapper un cri sourd et, la main sur ses lèvres, me fixa avec effroi avant de déclarer d’une voix secouée par cette nouvelle.
— Non ? C’est vrai ? Merde, alors ! Ça dut être un choc pour votre cousin. Putain, mais c’est pas possible de faire une chose pareille. Pauvre homme.
— Couillon, va ! Tu vois pas que le commandant te fait marcher ? Il se moque de toi et de tes blagues à dix sous.
Je reconnaissais bien là Marilou. D’ailleurs, seule une femme pouvait réagir aussi rapidement. Le gardien de la paix fronça les sourcils, penaud de s’être fait avoir comme un bleu.
— Je rigole, Patrick, je rigole. Bien sûr que la mariée a dit « oui ». De toute manière, elle ne pouvait pas faire autrement et vous savez pourquoi ?
Je ne leur laissai pas le temps de répondre, poursuivant avec sérieux.
— Parce que mon cousin est un bon parti, un vrai charcutier qui travaille encore à la mode d’antan. Chez lui, tout est naturel. Du vrai cochon de chez nous et on vient même de Châteauneuf-du-Faou pour acheter sa cochonnaille, alors que sa charcuterie est située à Langonnet, c’est pour dire. J’ai encore la pitance qui me reste sur la panse. C’est fou, ce qu’on peut manger pendant deux jours. Jamais, j’aurais cru ça. Sans compter la bibine. Enfin, on ne se marie qu’une première fois.
Je devais paraître bien mal en point pour que Marilou aille fouiller dans son sac à main.
— T’as plutôt l’air barbouillé. T’as des soucis ?
— Rien de spécial, juste une mauvaise nuit. J’ai fait un affreux cauchemar. Une vieille dame qu’on torturait avant de l’assassiner.
Patrick siffla en hochant la tête, une manière de me démontrer sa solidarité de flic. Nous avions tous besoin de nos nuits pour reprendre des forces.
— Tu veux un cachet pour calmer tes crampes ? J’en ai toujours sur moi. C’est bien connu, nous les femmes, on a l’estomac fragile. C’est vous qui buvez et c’est nous qui trinquons.
— Ah, ça y est, Commandant ! Comme vous pouvez le constater, c’est la mesquinerie féminine qui se réveille de si bon matin. Et dire que je vais me la farcir toute la journée.
La gardienne-chef Marilyne Dumont ne semblait nullement avoir apprécié la remarque de son adjoint, qui se vengeait du « couillon, va » mal digéré. Elle resta d’abord stupéfaite, ce qui ne dura que l’instant de reprendre son souffle. Puis, elle dirigea l’index droit vers son subalterne, le regard franchement agacé par cette marque d’irrespect, avant de le menacer.
— Je crois que je vais vous laisser vous débrouiller entre amoureux. N’est-ce pas ? Entre tourtereaux, on se comprend toujours mieux. Moi, j’ai pas mal de boulot qui m’attend à l’étage.
Le visage de la gardienne-chef venait de virer au rouge, plus par colère que par gêne. J’avais appuyé sur la corde sensible, ce qu’elle détestait le plus au monde.
— Ce n’est pas la peine d’en rajouter, Commandant. Si je devais me farcir ce zouave jour et nuit, il y aurait longtemps que je l’aurais étranglé de mes propres mains.
J’acquiesçai d’un signe de tête avant de prendre la pilule qu’elle me tendait et qui devait me réconcilier rapidement avec mon estomac. Avec sa dizaine de kilos superflus, un visage poupard à la peau rosée, et un chignon en bataille qu’elle recoiffait à longueur de journée, Marilyne Dumont acceptait difficilement un refus. Pourtant, elle était une partie de l’âme de ce commissariat. Je l’avais vue souvent se placer entre deux protagonistes afin d’empêcher une bagarre. Je l’avais même surprise en train de convaincre une femme de retirer une plainte, afin d’éviter à une mère de famille des ennuis pour 50 euros. Je l’avais vue consoler un homme qui venait de perdre son épouse. Elle savait être dure, tendre et diplomate à la fois.
*Apocalypse de saint Jean.
III
La solitude accentua encore plus la sensation étrange qui me nouait la gorge depuis mon réveil. La pilule de Marilou ne faisait que peu d’effet. Pour tuer dans l’œuf cette impression oppressante, j’essayai l’autodérision, me convainquant que je me faisais du mouron, que ces idées noires étaient le fruit d’un reste d’alcool ingurgité lors des noces cousinales. Pourtant, à intervalle régulier, mes yeux fixaient le combiné du téléphone, comme s’ils avaient le pouvoir d’en retenir la sonnerie. Il fallait que je me concentre sur les enquêtes en cours afin d’oublier ce trouble étouffant.
Et du boulot, l’équipe en avait assez jusqu’à la fin de l’année. Je rigolai en silence. Nous en avions juste assez pour voir arriver la fin du monde prophétisée par les Mayas et Michel.
Nous étions sur une sale affaire de proxénétisme, dont les victimes étaient des filles venues du Nigeria et du Burkina Faso. Une affaire qui alliait criminalité et politique ; bref, tout ce que je détestais. Nous avions déjà arrêté l’un de leurs souteneurs, un Camerounais de 35 ans, officiellement maçon dans une petite entreprise de BTP dirigée par son oncle.
Restait à trouver des preuves pour confondre l’oncle d’Ahmadou Mbango, qui niait connaître les agissements de son neveu. Louise et Marion en avaient fait une affaire personnelle, bien décidées à mettre hors d’état de nuire le vieux Camerounais. Voilà, ça, c’était notre boulot et nous n’avions qu’à le faire le mieux possible.
*
Comme chaque matin, j’avais allumé la vieille cafetière abandonnée par un collègue parti en retraite et je me laissai bercer par l’eau qui perlait, libérant un arôme exotique qui excitait mes narines. Sans plus tarder, j’en avalai une tasse, dans l’espoir de retrouver des idées claires. À travers l’une des fenêtres qui donnaient sur le boulevard de la Tour-d’Auvergne, le soleil pointait doucement le bout de son nez. Encore une belle journée en perspective.
Je m’apprêtais à me reverser une tasse de café lorsque des cris dans le couloir me firent sursauter violemment. Je me précipitai. C’était un collègue qui se débattait avec un homme tenant à peine sur ses jambes mais qui, avec le peu de force qui lui restait, refusait d’avancer. Accoudé contre la porte ouverte, j’observai cet individu à moitié nu vociférer contre le gardien de la paix Morillon. La scène était presque comique.
— Eh bien, Marcel, t’as des soucis ? Tu veux que j’appelle des renforts ?
— Ce n’est pas la peine, Commandant, un collègue a déjà essayé de lui faire signer une déposition pour destruction sur la voie publique. Il a détérioré un parcmètre, pensant que c’était un distributeur de billets de banque qui refusait de lui donner des sous. Pas vrai, Savatier ?
Le regard vitreux de l’alcoolique n’indiquait aucune réponse précise. On entendait juste son souffle court et bruyant.
— Mais vu qu’il est saoul comme un Polonais, impossible d’obtenir ce que nous souhaitons.
Marcel semblait stupéfait. Pour ma part, j’hésitais entre la consternation par solidarité avec le pochetron, les collègues et le parcmètre.
— Ah, je vous assure, Commandant, c’est comme parler à un mur. Pourtant, il faut que je lui passe les pinces avant qu’il ne me file entre les doigts. Parce qu’il a beau être totalement saoul, il reste fort comme deux Vikings. Même s’il n’irait pas loin, il est encore capable de blesser quelqu’un.
Tout en parlant, le gardien de la paix Morillon passa les menottes aux poignets maigres de son prisonnier avec une dextérité professionnelle, avant de le tirer doucement pour le faire avancer. Encore plus énervé d’être entravé, l’ivrogne cracha son venin d’une voix féroce.
— Putain de flics de merde, toujours à emmerder les pauvres gars comme moi. Mais moi, je vous le dis, moi, Sylvain, je ne vais pas me laisser faire. Oui, Sylvain ne va pas se laisser faire. Vous avez peut-être réussi à tuer mon père, mais moi, vous ne m’aurez pas.
— C’est ça, c’est ça, on t’a compris. Ton paternel est mort depuis longtemps déjà, faut passer à autre chose maintenant. Allez, viens, et arrête de gesticuler comme un singe enchaîné.
Je savais qu’un homme saoul fabule. Néanmoins, les traits de mon visage avaient dû changer sous l’effet de surprise, jusqu’à attirer l’attention de Morillon, qui s’arrêta brusquement de marcher. Savatier sursauta. Ses poignets entravés paraissaient encore plus maigres dans ces anneaux de fer.
— C’est quoi, cette histoire de paternel, demandai-je, intrigué par cet ivrogne qui nous accusait d’avoir tué son père alors qu’il paraissait avoir atteint lui-même l’âge d’être grand-père.
Morillon passa la main devant son front, comme s’il souhaitait chasser une mouche devant ses yeux.
— Rien de grave, Commandant, je connais Savatier depuis longtemps, il raconte cette vieille histoire depuis des lustres. Son père a été arrêté par la police en 1945. Condamné à la guillotine, il a été gracié quelques mois plus tard sur l’ordre du général de Gaulle et condamné à cinq ans de prison. Bref, ça remonte à Mathusalem. Si on n’a pas de bol, il va nous chanter le chant des partisans et on n’arrivera plus à l’arrêter.
— Mon père, c’était un type bien, il a fait partie d’un groupe de résistants à Carantec, avec Louis Poncelet, et c’est vous qui l’avez tué. Vous êtes le déshonneur de la France.
— C’est ça, c’est ça, allez, avance. On n’y peut rien si ton père a préféré se suicider après avoir été gracié. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut oublier maintenant. C’est vieux, tout ça.
Morillon avait raison. Il fallait oublier cette vieille histoire et j’étais rassuré, il y avait prescription.
— Bon, n’oublie pas de le faire ausculter.
— Bien sûr, Commandant, le médecin doit arriver d’ici quelques minutes. On l’a fait prévenir. Mais ne vous inquiétez pas trop, c’est un habitué. Pas vrai, Savatier, que t’es un habitué ?
L’ivrogne grogna, se laissant désormais tirer, aussi obéissant qu’un ours de cirque.
— C’est juste que ça tombe toujours sur moi. Je dois attirer les alcoolos, comme la merde attire les mouches.
Morillon avait rigolé de sa propre blague, que moi-même je ne trouvais pas vraiment drôle. Une carrure de rugbyman, une chevelure rousse et un visage tacheté lui avaient conféré le surnom d’“Irlandais”, même s’il était originaire de Vendée.
Quant à Savatier, c’était peut-être un habitué de la maison, mais il n’était pas question de se retrouver avec un moribond sur les bras. Vu son état et son âge, le “Polonais” risquait d’y laisser des plumes. Rassuré d’une complicité unissant les deux hommes, je refermai la porte de mon bureau.
Louise avait débarqué vers 8 h 30. Sur son visage pâle, deux yeux cernés me regardaient avec surprise. Je devais donc faire si peur.
— À te voir, on pourrait presque croire que c’est toi qui attends un bébé. T’as l’air plus crevé que moi. T’as fait la bringue des bringues ? Ah, le mariage de ton cousin, pas vrai ?
Le mariage tombait à point pour expliquer ma “sale gueule”.
— Je vieillis et je m’aperçois que je supporte de moins en moins bien l’alcool. Et toi, tu as l’air d’avoir l’estomac tout retourné. Encore tes nausées matinales ?
Louise acquiesça d’un signe de tête, posant sa veste sur le dossier de sa chaise. Je remarquai sa taille moins affinée qu’à l’ordinaire et repensai à ma femme, avant l’arrivée de Chloé.
— C’est une fille, j’en suis sûre. Il paraît que les nausées sont plus violentes avec les grossesses de filles que celles de garçons. Enfin, encore un mois ou deux et j’oublierai que je suis enceinte. Ensuite, mon gros ventre me le rappellera de nouveau.
La main sur l’abdomen, elle dessina un cercle et poursuivit.
— Vous avez du bol, vous, les mecs, pas vrai ? Mais n’oublie pas ta promesse, Vic, pas de favoritisme. Je veux continuer le terrain jusqu’au bout.
Désireux de ne pas contrarier Louise, je jurai de tenir cette promesse que je regrettais déjà. C’est simple, je ne pouvais jamais rien refuser à une femme. Cela avait débuté avec ma mère après la mort de mon père. Je connaissais la capitaine Louise Le Gouarec depuis une dizaine d’années. Elle avait commencé sa carrière à Angoulême, puis le hasard l’avait ramenée à Rennes. Elle était l’un des éléments féminins de l’équipe et, pour couronner le tout, Lucien, son mari, tenait un petit resto à Saint-Jacques-de-la-Lande où l’on mangeait l’un des meilleurs homards grillés de Bretagne. C’était une des raisons pour laquelle Louise était adorée dans le service. L’amour ne passait-il pas toujours par les tripes ?
— Au fait, devine qui j’ai rencontré juste avant d’arriver ici ?
Je n’avais pas besoin de chercher bien loin pour trouver la réponse.
— Michel ? C’est vraiment rien d’exceptionnel, il est toujours là ! En fait, tu ne peux jamais le louper.
— Mais non, pas lui, allez, essaie de trouver.
J’avais beau réfléchir, je ne voyais pas quelle autre personne avait croisé le chemin de Louise de si bon matin.
— J’ai trouvé ! Madame Le Borgne.
— Exact, mais tu ne devineras jamais ce que lui a fait son mari hier soir.
Là, nous étions dans la multiplicité des possibilités, tant monsieur Le Borgne, d’après les déclarations de son épouse, possédait un esprit aussi imaginatif que dérangé, proche du sadisme.
— J’écoute.
Au regard de Louise, je compris qu’elle ne se satisfaisait pas de ma réponse.
— Non, non, je suis désolée, tu pourrais au moins faire un effort et essayer de trouver. Vas-y, Vic, cherche !
J’élucubrai le pire.
— Il a noyé le chat.
— Mais non, madame Le Borgne n’a pas de chat.
— Il a jeté le poisson dans les toilettes.
— T’es pas drôle, Vic. Tu ne joues pas le jeu. Bon, je vais te le dire, sinon on va y passer la journée. Figure-toi qu’il a enfilé sa chemise de nuit toute neuve, celle qu’elle avait achetée vendredi matin, et qu’il a pissé dedans. J’ai quand même réussi à la calmer, en espérant qu’elle ne reviendra plus aujourd’hui.
— Pauvre femme, ce ne doit pas être facile tous les jours, me surpris-je à compatir.
— Tu parles, pour elle, tout est désormais plus simple.
Je préférai ne pas répondre à cette affirmation, considérant qu’une femme enceinte voyait les choses toujours différemment. Par bonheur et malgré un début de grossesse difficile sur le plan digestif, Louise recommença avec son thème préféré, la cuisine. Comme si l’évocation des petits ragoûts mijotés par son mari l’aidait à combattre ses haut-le-cœur. En l’écoutant, l’eau me vint à la bouche et mon estomac me rappela que, depuis la noce, je n’avais rien avalé. Le cachet offert par Marilou commençait doucement à faire de l’effet. Un seul croissant ferait l’affaire, à la condition qu’il fût au beurre. Au moment où l’odeur de la viennoiserie me revenait en mémoire, la sonnerie du téléphone retentit.
Fort heureusement, la sensation de faim avait étouffé le sentiment étrange qui m’avait tourmenté au réveil. J’avais décroché en sifflotant un air de guinguette. Pourtant, et contre toute attente, la voix de Fabien Laroche me rappela brutalement à la réalité. Je comprenais que je n’avais pas rêvé. Aujourd’hui, une nouvelle tranche de ma vie allait débuter. Je le sentais au plus profond de mes entrailles. Je tressaillis violemment.
Je ne souhaitais rien changer de mon existence, me considérant comme un homme heureux et comblé. Assurément, il y a toujours au fond de nous-mêmes des désirs fous, comme celui de devenir riche et à l’abri du besoin. Il faut bien rêver. Ma mère me disait que j’étais appelé à un grand destin, et pensait avec sérieux que je finirais ministre de l’Intérieur. Alors pour me rassurer, je me persuadais que cette journée m’amènerait tôt ou tard à Paris, place Beauvau. Je pensais à Chloé. La blancheur de mon visage dut effrayer Louise, qui m’interrogea, le regard suppliant. Je balbutiai.
— 35, rue Victor-Hugo, une vieille femme torturée et assassinée dans son pavillon.
— Quelle horreur, s’écria la future mère, la main toujours posée sur le ventre, avant de poursuivre, alors, on y va ?
Malgré le choc de cette nouvelle, elle semblait plutôt rassurée de constater que rien de personnel ne venait de s’abattre sur moi. Sans doute avait-elle pensé également à Chloé et son tempérament intrépide.
— Encore une vieille dame, c’est dégueulasse de s’en prendre à des personnes âgées, marmonna Louise en attrapant sa veste.
— Dégueulasse, dégueulasse ! C’est toujours dégueulasse de s’en prendre à quelqu’un, jeune ou vieux. Personne ne mérite de mourir assassiné.
— T’as raison. En plus, ce matin, en entendant Michel rabâcher toujours les mêmes conneries, j’ai un frisson glacial qui m’a traversé le corps.
La pâleur de son visage démontrait le malaise qui la médusait d’effroi. Je cherchai à la rassurer, me sentant concerné par le futur bébé.
— Ce sont les aléas de la grossesse, c’est normal, tu as des responsabilités désormais et tu n’aimes pas entendre ce genre de propos défaitistes. Une future maman aime les fleurs, les belles couleurs, le soleil. Demande à ton mari de t’emmener en vacances, une semaine à ne rien faire, juste profiter des palmiers, du sable fin et de l’océan turquoise.
Louise secoua la tête, une lueur ironique au fond des prunelles.
— On croirait que c’est toi qui as porté Chloé, ma parole ! De plus, si tu souhaites un jour quitter la grande maison, ouvre une agence de voyages, ça t’ira très bien. Quant à Lucien, tu peux oublier. Jamais il n’acceptera de fermer le restaurant ne serait-ce que deux jours de suite.
IV
Je me demandais si, au 35, rue Victor-Hugo, situé près du parlement de Bretagne, nous allions nous rendre sur le lieu d’un cambriolage qui avait mal tourné ou sur un meurtre d’origine familiale ?
Trois kilomètres nous séparaient du lieu du crime. Louise avait proposé de prendre le volant. Je ne m’y étais pas opposé. Ce court trajet me permettrait peut-être de rassembler mes pensées éparpillées. Yeux mi-clos, je laissais à travers la vitre entrouverte le soleil caresser mon visage. Pendant que la voiture roulait, j’essayais de tuer ces douleurs d’estomac qui me pourrissaient la vie. Une sensation d’oppression au niveau du bras gauche me fit penser à mon père. Il fallait que je me ressaisisse. En tant que chef de groupe, j’avais des responsabilités vis-à-vis de mes hommes.
Louise gara la voiture devant un immense portail, avant d’enfiler un brassard orange avec l’inscription « Police » qui ornait maladroitement sa veste en jean délavée. Depuis ce début de grossesse, elle appréhendait davantage les visions épouvantables qui accompagnaient souvent les scènes de crime. Sa première réaction en pénétrant dans un appartement ou une maison était de s’assurer que des toilettes étaient à sa portée. Mais elle tenait le choc avec courage et détermination.
Ma grand-mère disait qu’un jardin reflétait l’âme de ceux qui l’habitaient. D’un coup d’œil furtif, je balayai le parc magnifiquement entretenu, afin de repérer différentes possibilités pour un meurtrier de fuir. Apparemment, seule cette grille en fer forgé couleur bleu ciel d’été que je refermai et qui grinça doucement permettait de pénétrer dans la propriété. En effet, les murs d’enceinte d’au moins deux mètres étaient squattés par des buissons d’aubépines et de rosiers sauvages.
Sur un banc en pierre, un chat qui somnolait paisiblement leva son museau à notre passage puis, désintéressé par notre visite, bâilla avant de baisser de nouveau le nez sur ses pattes avant. À cet instant, j’aurais aimé être un chat et dormir sous ce soleil matinal. Adieu, place Beauvau.
L’allée centrale, recouverte de gravillons blancs, menait à l’entrée principale de la maison. Elle croisait d’autres chemins, plus petits, certains recouverts de copeaux de bois, d’autres par des dalles en pierres naturelles. À vue d’œil, le terrain représentait plus de trois mille mètres carrés, une fortune pour ce quartier huppé de Rennes. Nous avancions d’un pas alerte, l’esprit préoccupé par ce qui nous attendait. Sous un chêne pédonculé, un banc en bois invitait au repos. Un peu plus loin, un saule pleureur donnait généreusement de l’ombre à une mare aux canards.
D’emblée, la beauté de ce parc m’avait ébloui. Au loin, un érable du Japon servait de perchoir à un couple de merles qui chantaient à tue-tête.
Nous n’étions plus qu’à deux pas de la porte d’entrée. Pourtant, je ne me lassais pas de contempler cet endroit qui, en temps normal, devait respirer la joie de vivre. À moins que le cadre ne fût trompeur. Sur notre droite, ornant un gazon anglais, un buis taillé en triple boule faisait la part belle à deux céanothes nichés sur un tapis de bruyère d’hiver. Plus loin, au sud, des rosiers toujours en fleurs luttaient sans grande difficulté contre l’arrivée de l’automne qui s’annonçait. Tous nos sens étaient en éveil.
Un délicieux mélange de lavande, de sauge officinale, d’origan doré et de menthe poivrée embaumait une tonnelle en bois recouverte de vignes.
— Il y a du thym citronné et du romarin pas très loin. Ça me rappelle le gigot d’hier midi.
Décidément, Louise ne pensait qu’à manger. Elle renifla bruyamment pour tenter de localiser les herbes qu’utilisait Lucien dans sa cuisine. Comme dans les jardins suspendus de Babylone, des jarres où poussaient du thym, du romarin, de l’estragon et de la citronnelle pendaient, accrochées par des chaînes aux poutres de la tonnelle. Dans ce paradis terrestre, un crime avait été commis. Ce qui semblait le rendre encore plus affreux.
Nous étions arrivés devant la porte en chêne massif, pourvue d’un hublot en forme de cœur.
Deux portes-fenêtres ornées de volets en bois, de même couleur que le portail et la porte principale, délimitaient la demeure recouverte de lierre.
Le bruit de nos pas avait fait fuir une salamandre, qui chercha refuge derrière une gouttière chargée de récupérer l’eau de pluie.
La fenêtre de gauche donnait sur un salon dominé par une immense cheminée en pierre, aux rebords en noyer sculpté. Sur un buffet en bois avec des portes délicatement ciselées en forme d’éléphants barrissant, une pendule égrenait le temps. Près de l’âtre, garni d’une couverture en patchwork, un rocking chair en osier et son repose-pied en cuir marocain conviaient à la sieste. Une odeur de cendres froides envahissait encore la pièce. Je savais par expérience qu’un feu de cheminée laissait une empreinte odorante plusieurs jours après son extinction.
Ce parfum de bois brûlé ressuscita furtivement des souvenirs enfouis depuis longtemps dans ma mémoire. Je pensai avec nostalgie à la chaumière de mes grands-parents et entendis le crépitement du feu que surveillait mon grand-père en fumant sa pipe.
Près d’un guéridon, une méridienne en tissu fleuri permettait de lire un de ces nombreux ouvrages enfermés dans une grande bibliothèque aux portes vitrées. Au fond du salon, sur un sofa recouvert d’un édredon aux couleurs pastel, un album photos resté ouvert laissait découvrir des images d’un passé lointain.
Sur les murs, d’autres photographies retraçaient des moments d’histoires singulières. L’équipe scientifique était encore en action dans la cuisine, ce qui me donna le temps de jeter un coup d’œil sur les clichés, espérant rattraper un instant de cette vie qui venait de s’éteindre.
— En regardant les photos, on va peut-être apprendre des choses sur la vieille dame.
J’avais parlé pour moi-même ; cela m’arrivait souvent de penser à voix haute. J’espérais cerner des bribes de vie de la victime pour me rapprocher peu à peu de son meurtrier. À moins d’un rôdeur, que son chemin avait amené par hasard dans cette maison paisible, avant de quitter la ville, son forfait commis.
— J’ai déjà vu cet homme quelque part, mais où ? La voix de Louise m’avait arraché un léger frisson. Elle fixait la photographie accrochée au-dessus de la cheminée et, à la concentration qu’elle portait à ce portrait, je compris qu’elle cherchait par tous les moyens à mettre un nom sur cet individu. Je me rapprochai de ma collègue pour tenter de résoudre l’énigme. Sur la photographie, l’homme avait 70 ans environ, une moustache et des cheveux grisonnants, l’œil brillant et un cigare entre l’index et le majeur droit. Je posai ma main sur l’épaule de Louise. Elle avait raison.
— C’est vrai, maintenant que tu me le dis, je me rappelle avoir déjà vu cette photo dans un journal. Pourtant, impossible de me souvenir de qui il s’agit. La mémoire me joue des tours.
— Tu sais, on voit tellement de portraits. Je pense que, au contraire, on demande énormément à notre mémoire.
Louise tentait de me rassurer à propos de mes doutes concernant l’âge de ma mémoire. Ma mère répétait qu’une mémoire s’entretenait. Pourtant, la capitaine n’avait pas tort. On voyait tant de photos de suspects, de victimes, on était amenés à rencontrer tant de gens que notre cerveau devait fournir un travail presque surhumain pour se souvenir des noms de toutes ces personnes.
— En tout cas, tu peux constater que c’est bien le même homme partout, sur toutes les photos ou presque. Ce doit être l’époux.
À les voir sur les clichés, le doute était difficilement permis. Sur les photographies prises tout au long d’une vie, le couple respirait le bonheur. Ils avaient voyagé du nord au sud, de l’est à l’ouest, rencontré des nomades dans le désert, des pêcheurs africains, admiré les pyramides, la grande muraille de Chine et la Place rouge. Je les imaginais devant les temples d’Angkor, le mausolée de Lénine, la statue du Christ rédempteur à Rio et le temple maya de Yucatan. Et en tant d’autres lieux encore.
Une idée traversa soudainement mon esprit. Avaient-ils fait, lors d’un voyage, une mauvaise rencontre ?
Il fallait être riches pour parcourir le globe, et la fortune attisait souvent les convoitises. Je savais, pour ma part, que ni ma paye ni ma retraite de policier ne me permettrait de telles randonnées.
— En tout cas, ils n’ont pas l’air de se priver beaucoup. Certes, avec Lucien, nous avons vu les pyramides, il y a trois ans de cela, mais je suis prête à parier que nous n’avons pas séjourné dans le même hôtel qu’eux.
Louise avait eu la même pensée que moi. Je lui tapotai gentiment l’épaule.
— Eh oui, Louise, tu as tout compris, nous avons choisi le mauvais métier, c’est aussi simple que cela. Et puis, à quoi bon voir la muraille de Chine ? Là-bas, tu serais privée de la cuisine de ton Lucien.
Elle sourit, amusée par cette idée saugrenue. Je fus rassuré pour le bébé, qui ne méritait pas une mère dépressive.
Une photographie m’intrigua plus que les autres. C’était un cliché noir et blanc pris des années auparavant.
— Regarde, Louise, ici, cette photo, elle est différente des autres. D’abord, ils ne sont pas seuls et il y a quelque chose qui m’interpelle.
Avec la désinvolture de la jeunesse, trois filles et cinq garçons riaient, les yeux rivés vers le ciel. Je méditai à voix haute.
— Tu vois, là, on reconnaît bien notre couple. D’ailleurs, il lui tient la main et elle est aux anges. Mais qui sont les autres ? On ne les voit sur aucune autre photo. Celui qui se tient derrière eux, je crois l’avoir vu également, mais impossible de te dire où. Pourtant, c’est plutôt récent, mais où ? Ne me le demande pas !
Mains dans les poches de son jean, Louise s’approcha du cliché, qu’elle se mit à observer avec le professionnalisme d’un photographe devant son œuvre. Mais je savais qu’elle n’admirait pas la qualité artistique de la photographie jaunie par le temps. À son nez qui se retroussait doucement dès qu’elle réfléchissait, j’avais compris qu’elle venait de déceler un détail que je n’avais pas encore découvert.
— Regarde, Vic, les hommes portent tous des bérets basques. Cela ne te dit rien ?
Sans grande conviction, j’acquiesçai d’un léger mouvement de tête. Soudainement, une idée traversa mon esprit. Je venais de saisir où Louise voulait en venir. Cette photo avait été prise pendant l’Occupation. Même si rien ne pouvait le confirmer, il semblait s’agir d’un groupe de maquisards. J’en arrivai à cette déduction grâce à l’arme que portait un des jeunes hommes. Je ne savais pas encore si cette photographie, prise dans une clairière, en catimini, revêtait une importance particulière. La victime était âgée et il n’y avait rien d’étrange à ce qu’elle et son compagnon eurent connu la guerre. Pourtant, je continuai de parcourir les autres photographies, dans l’espoir de dénicher un détail essentiel.
Je ne voyais que leurs sourires et, dans ces sourires, se reflétait l’amour.
Des voix provinrent de la cuisine. L’équipe scientifique était sur le départ. Je n’aimais pas me trouver dans leurs pattes et déranger leur travail primordial. Il suffisait parfois de peu, d’un cheveu, d’une goutte de salive pour confondre un assassin. Tous les indices devaient être préservés. Un arôme de café envahit peu à peu le couloir. Louise m’attendait dans le corridor, illuminé d’un soleil levant, qui menait aux autres pièces de la maison. Près d’un radiateur, une chaise et un coussin plein de poils noirs, que le chat, apparemment, squattait lorsque le temps devenait inconfortable.
Au-dessus d’une commode en bois, un miroir agrandissait le vestibule de façon magique. L’image de mon visage s’y refléta. Les cernes sous mes yeux s’étaient creusés. Dernières séquelles d’un mariage trop arrosé ? Je vieillissais et mon foie souhaitait me le rappeler. L’odeur de café devenait plus persistante. La cuisine était proche. Mon estomac se rebella.
*
Le médecin légiste, un petit homme étrange et secret, était arrivé le premier, suivi aussitôt du brigadier-chef André Buissière et du gardien de la paix Barnabé Brignan. Puis, dix minutes s’étaient écoulées avant l’arrivée de Fabien Laroche et deux collègues de la police scientifique.