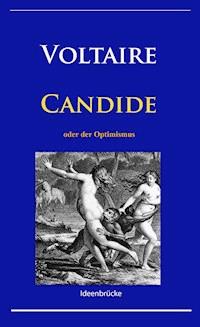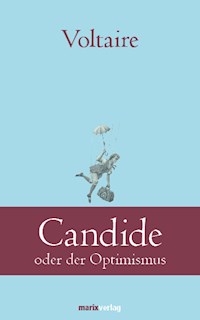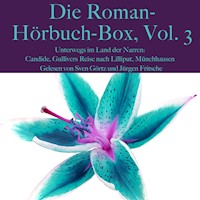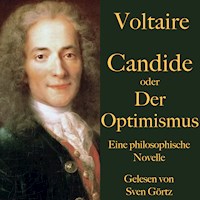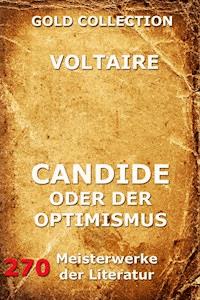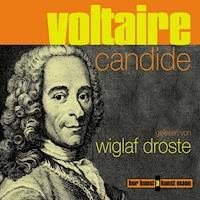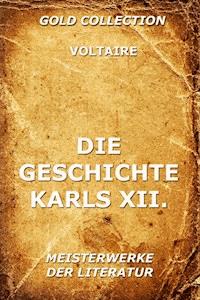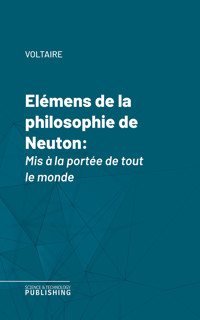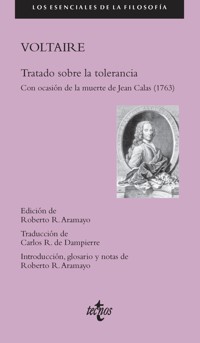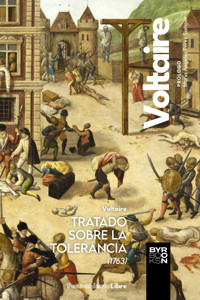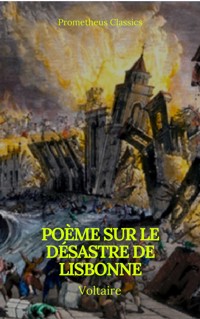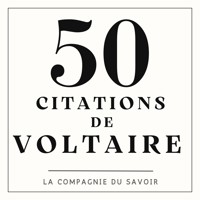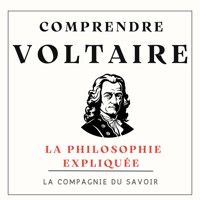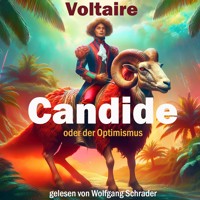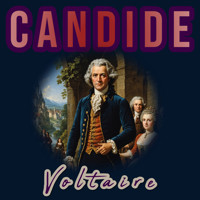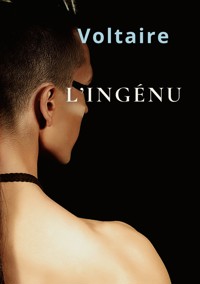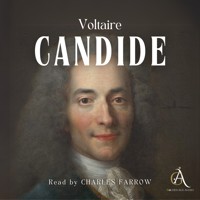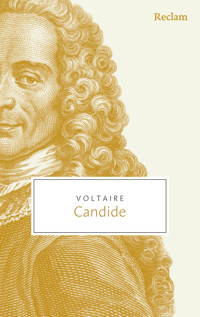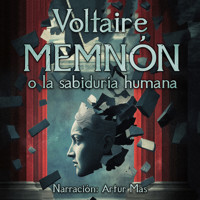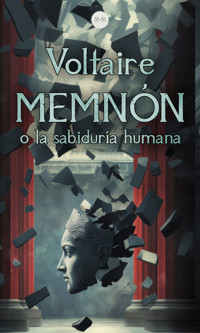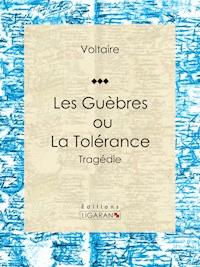
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je suis las de servir. Souffrirons-nous, mon frère, Cet avilissement du grade militaire ? N'avez-vous avec moi, dans quinze ans de hasards, Prodigué votre sang dans les camps des Césars Que pour languir ici loin des regards du maître, Commandant subalterne et lieutenant d'un prêtre ? Apamée à mes yeux est un séjour d'horreur. J'espérais près de vous montrer quelque valeur. Combattre sous vos lois, suivre en tout votre exemple ; Mais vous n'en recevez que des..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335067477
©Ligaran 2015
L’Avertissement des Éditeurs de Kehl pour cette pièce était bien court : j’ose dire qu’il l’était trop.
La tragédie des Guèbres, commencée le 1er août 1768, fut faite en douze jours. Elle était, disait Voltaire, l’ouvrage d’un jeune homme fort maigre, et qui avait quelque feu dans deux yeux noirs, qui se disait possédé du diable, et qui intitulait sa pièce tragédie plus que bourgeoise. En même temps qu’il écrivait cela, il expédiait le manuscrit à Paris. Mais il refit bientôt les trois premières scènes du cinquième acte, fit au quatrième acte des changements pareils, retoucha aussi les trois premiers actes. D’Argental avait demandé des adoucissements sur la prêtraille ; mais c’était la chose impossible, la pièce n’étant fondée que sur l’horreur que la prêtraille inspire. C’était assez d’un tel sujet pour éveiller l’attention des censeurs dramatiques ; il importait donc de cacher le nom de l’auteur. Voltaire pensa d’abord à donner cette tragédie comme l’ouvrage posthume de Guimond de la Touche (mort en 1760), et comme étant originairement une tragédie chrétienne ; un peu plus tard, ce fut sur le compte de Desmahis (mort en 1764) ; et les premières éditions portent en effet : Par M. D ** M ****. Un passage de la préface, resté longtemps manuscrit, et qui ne fut publié que dans les éditions de Kehl, nomme en toutes lettres cet auteur ; ce qui n’était pas sans inconvénient, car c’était s’exposer à des réclamations de la part des héritiers ; en retranchant a l’impression la fin de la préface, c’était se mettre à l’abri de ces réclamations. Quelques personnes expliquent les initiales D.M. par De Morza, nom mis par Voltaire aux notes de l’Ode sur la mort de la margrave de Bareuth, et à d’autres ouvrages.
Mais ces précautions vulgaires lui parurent insuffisantes : il tenait par-dessus tout à ne pas être soupçonné d’être l’auteur, et ne trouva rien de mieux à faire pour cela que de se dédier sa pièce. La ruse n’était pas nouvelle ; Voltaire lui-même l’avait employée quelques années auparavant, en se faisant adresser les Lettres sur la Nouvelle Héloïse.
L’édition des Guèbres, qu’il fit faire à Genève (sans nom de ville), contient une Préface de l’Éditeur, et une Épître dédicatoire à M. de Voltaire. L’embarras était dans la mesure à donner aux éloges que devait contenir la dédicace. Il faut convenir que, s’ils sont assez grands pour faire croire qu’ils étaient d’une plume étrangère, et comme il le dit : « Ce qu’on me dit dans la dédicace est d’une nécessité absolue dans la position où je me trouve », il n’y a rien d’exagéré ni de trop vague. Une seule phrase semble trahir l’auteur, c’est celle où il parle des obligations que lui ont les libraires ; c’était une occasion toute naturelle de répondre aux calomnies qu’on avait répandues contre lui, et qu’on répète encore aujourd’hui, quelque injustes qu’elles soient.
Cette édition de Genève avait été faite pour les étrangers ; quatre exemplaires en furent envoyés à Paris : ils y sont très rares, et ce n’est que dans la riche collection de M. de Soleinne que j’ai trouvé un exemplaire de cette édition, qui est intitulée les Guèbres, ou la Tolérance, tragédie, par M. D ** M ****, 1769, in-8° de 116 pages. Une réimpression faite à Paris (sans nom de ville), en 82 pages in-8°, porte seulement ce titre : les Guèbres, tragédie, par M. D.M. ; elle contient la Préface de l’Éditeur, mais non l’Épître dédicatoire. Aucun de ces deux morceaux ne se retrouve dans une troisième édition, à Rotterdam, chez Reinier Leers (à Genève, chez les frères Cramer), 1769, in-8° de IV et 104 pages. Mais cette troisième édition, qui est encadrée, et qui est de novembre 1769. Contient un Discours historique et critique qui paraissait pour la première fois.
L’Épître dédicatoire n’a pas non plus été reproduite dans l’édition in-4°. Cela explique comment elle a échappé aux éditeurs de Kehl, et à tous ceux qui m’ont précédé.
Le suffrage des lecteurs ne suffisait pas à Voltaire. Il eût bien voulu que la pièce fût jouée : il espérait qu’elle le serait à Paris avec un prodigieux succès. Mais un procureur du roi du Châtelet, nommé Moreau, s’opposa à la représentation. Voltaire tourna ses vues sur Lyon ; le zèle de Bordes y échoua devant les mauvaises dispositions de Montazet, confrère de Voltaire à l’Académie française, archevêque de Lyon, et qui n’était pourtant qu’un prêtre de Vénus.
D’Alembert, qui savait combien était vif le désir de Voltaire que les Guèbres fussent mis au théâtre, lui écrivit que la pièce avait été ou devait être jouée à Toulouse. C’était pousser la flatterie bien loin. La tragédie de la Tolérance ne pouvait se représenter dans la ville dont le parlement avait fait rouer Calas. Quoique Voltaire parle aussi de représentations qui se préparaient à Grenoble et à Orangis, il est douteux que les Guèbres aient été joués sur aucun théâtre, même sur celui de Ferney, Mme Denis se trouvant à Paris dans les derniers mois de 1768, où Voltaire aurait pu vouloir essayer sa pièce.
J’ai, dans mon Avis en tête des Scythes, parlé de la Lettre à un ami de province sur les Scythes et les Guèbres.
Janvier 1832.
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE, DE CELLES DE FLORENCE, DE LONDRES, DE PÉTERSBOURG, DE BERLIN, ETC. GENTILHOMME ORDINAIRE DU ROI TRÈS-CHRÉTIEN, ANCIEN CHAMBELLAN DU ROI DE PRUSSE.
À qui dédierons-nous la tragédie de la Tolérance qu’à vous qui avez enseigné cette vertu pendant plus de cinquante années ? Tout le monde a retenu ces vers de la Henriade où le héros de la France, et le vôtre, dit à la reine Élisabeth :
Quel est celui de vos ouvrages où vous n’ayez pas rendu les fanatiques persécuteurs odieux et la religion respectable ? Votre Traité de la Tolérance n’est-il pas le code de la raison et de l’humanité ? N’avez-vous pas toujours pensé et parlé comme le vénérable Berwick, évêque de Soissons, qui, dans son mandement de 1757, dit expressément que nous devons regarder les Turcs comme nos frères ?
De plus de mille voyageurs qui sont venus chez vous depuis que vous êtes retiré dans notre voisinage, on sait qu’il ne s’en est pas trouvé un seul qui n’ait adopté vos maximes ; et parmi ces voyageurs illustres on a compté des souverains.
S’il est encore des hommes atroces qui ressemblent en secret aux prêtres des furies de la tragédie des Guèbres, il est partout des souverains, des guerriers, des magistrats, des citoyens éclairés, qui imitent le César de cette tragédie singulière.
Nous la présentons à l’auteur de la Henriade et de tant de tragédies dictées par l’amour du genre humain, à l’auteur citoyen dont la vérité a toujours conduit la plume, soit lorsque ses vers rendaient le grand Henri IV encore plus cher aux nations, soit quand il célébrait en prose le roi Louis XIV si brillant et son successeur si chéri ; soit quand il peignait le grand siècle qui n’est que trop passé, et le siècle plus raffiné, plus philosophique, le siècle des paradoxes, dans lequel nous sommes ; l’un qui fut celui du génie, l’autre qui est celui des raisonnements sur le génie, mais qui est aussi celui de la science plus répandue, et surtout de la science économique : nous vous présentons, dis-je, les Guèbres comme un ouvrage que vous avez inspiré.
C’est à ceux de notre profession surtout à vous faire des remerciements. Vous nous avez comblés de vos bienfaits. Acceptez cet hommage public ; nous ne serons jamais au nombre des ingrats.
Le jeune auteur des Guèbres, qui se regarde comme votre disciple, et qui veut être inconnu, nous a expressément recommandé de vous dire tout ce que nous vous disons ici. Nous parlons en son nom comme au nôtre.
Nous avons l’honneur d’être avec un profond respect,
Monsieur,
Vos très humbles et très obéissants serviteurs,
GABRIEL GRASSET, et associés.
Le poème dramatique intitulé les Guèbres était originairement une tragédie chrétienne ; mais après les tragédies de Saint Genest, de Polyeucte, de Théodore, de Gabinie, et de tant d’autres, l’auteur de cet ouvrage craignit que le public ne fût enfin dégoûté, et que même ce ne fût en quelque façon manquer de respect pour la religion chrétienne de la mettre trop souvent sur un théâtre profane. Ce n’est que par le conseil de quelques magistrats éclairés qu’il substitua les Parsis, ou Guèbres, aux chrétiens. Pour peu qu’on y fasse attention, on verra qu’en effet les Guèbres n’adoraient qu’un seul Dieu, qu’ils furent persécutés comme les chrétiens depuis Dioclétien, et qu’ils ont dû dire à peu près pour leur défense tout ce que les chrétiens disaient alors.
L’empereur ne fait à la fin de la pièce que ce que fit Constantin à son avènement, lorsqu’il donna dans un édit pleine liberté aux chrétiens d’exercer leur culte, jusque-là presque toujours défendu ou à peine toléré.
M. D.M., en composant cet ouvrage, n’eut d’autre vue que d’inspirer la charité universelle, le respect pour les lois, l’obéissance des sujets aux souverains, l’équité et l’indulgence des souverains pour leurs sujets.
Si les prêtres des faux dieux abusent cruellement de leur pouvoir dans cette pièce, l’empereur les réprime. Si l’abus du sacerdoce est condamné, la vertu de ceux qui sont dignes de leur ministère reçoit tous les éloges qu’elle mérite.
Si le tribun d’une légion, et son frère qui en est le lieutenant, s’emportent en murmures, la clémence et la justice de César en font des sujets fidèles et attachés pour jamais à sa personne.
Enfin la morale la plus pure et la félicité publique sont l’objet et le résultat de cette pièce. C’est ainsi qu’en jugèrent des hommes d’État élevés à des postes considérables, et c’est dans cette vue qu’elle fut approuvée à Paris.
Mais on conseilla à l’auteur de ne la point exposer au théâtre, et de la réserver seulement pour le petit nombre de gens de lettres qui lisent encore ces ouvrages. On attendait alors avec impatience plusieurs tragédies plus théâtrales et plus dignes des regards du public, soit de M. du Belloy, soit de M. Le Mierre, ou de quelques autres auteurs célèbres. M. D.M. n’osa ni ne voulut entrer en concurrence avec des talents qu’il sentait supérieurs aux siens ; il aima mieux avoir droit à leur indulgence que de lutter vainement contre eux ; et il supprima même son ouvrage, que nous présentons aujourd’hui aux gens de lettres : car c’est leur suffrage qu’il faut principalement ambitionner dans tous les genres ; ce sont eux qui dirigent à la longue le jugement et le goût du public. Nous n’entendons pas seulement par gens de lettres les auteurs, mais les amateurs éclairés qui ont fait une étude approfondie de la littérature : Qui vitam excoluere per artes ; ce sont eux que le grand Virgile place dans les champs Élysées parmi les ombres heureuses, parce que la culture des arts rend toujours les âmes plus honnêtes et plus pures.
Enfin nous avons cru que le fond des choses qui sont traitées dans ce drame pourrait ranimer un peu le goût de la poésie, que l’esprit de dissertation et de paradoxe commence à éteindre en France malgré les heureux efforts de plusieurs jeunes gens, remplis de grands talents, qu’on n’a peut-être pas assez encouragés.
Historique et critique à l’occasion de la tragédie des Guèbres
On trouvera dans cette nouvelle édition de la tragédie des Guèbres, exactement corrigée, beaucoup de morceaux qui n’étaient point dans les premières. Cette pièce n’est pas une tragédie ordinaire dont le seul but soit d’occuper pendant une heure le loisir des spectateurs, et dont le seul mérite soit d’arracher, avec le secours d’une actrice, quelques larmes bientôt oubliées. L’auteur n’a point cherché de vains applaudissements, qu’on a si souvent prodigués sur les théâtres aux plus mauvais ouvrages encore plus qu’aux meilleurs.
Il a seulement voulu employer un faible talent à inspirer, autant qu’il est en lui, le respect pour les lois, la charité universelle, l’humanité, l’indulgence, la tolérance : c’est ce qu’on a déjà remarqué dans les préfaces qui ont paru à la tête de cet ouvrage dramatique.