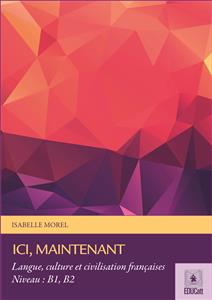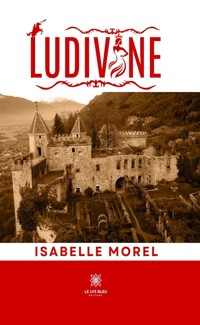
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Au XIII siècle, à Épierre en Maurienne, Anthelme, héritier des Seigneurs de la Combe de Savoie, tombe follement amoureux de Ludivine, une jeune villageoise. Cependant, Mahaut de Miolans, la mère d’Anthelme, a d’autres projets pour son fils. Résolus à défier le sort, Anthelme et Ludivine s’embarquent dans une aventure qui les conduira bien au-delà de leurs attentes. Que leur réserve l’avenir ? Leur amour, mis à rude épreuve, survivra-t-il aux défis qu’ils devront surmonter ?
À PROPOS DE L'AUTRICE
Isabelle Morel, enseignante de français à l’Université Catholique de Milan, a publié plusieurs ouvrages. En 2019, elle a sorti "Où sont passées les capucines de maman ?" aux éditions Muse. Par la suite, elle a publié "Ovada è un filo di seta" en 2020 et "Aleramo, un ponte fra Francia e Italia" en 2024, tous deux aux éditions Brè Edizioni.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isabelle Morel
Ludivine
Roman
© Lys Bleu Éditions – Isabelle Morel
ISBN : 979-10-422-4310-4
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Chapitre 1
Épierre, mai 1200
Ludivine venait juste de terminer le travail que sa mère lui avait demandé ; elle devait trier les simples qu’elle avait ramassées dans le jardin de plantes officinales, à côté du verger, car il n’y en avait plus dans le pot où on les conservait. Elles étaient indispensables, surtout certaines d’entre elles comme le millepertuis, avec ses petites fleurs jaunes qu’on utilisait en cas de brûlures, l’achillée pour ses vertus cicatrisantes et le lys qui soignait les blessures des serpents.
C’était une belle journée de mai, il faisait bon, une lumière blanchâtre, translucide, filtrait à travers la toile cirée de la fenêtre et invitait à la promenade, si bien que la jeune fille décida d’aller se promener le long de la rivière en contrebas de la maison. Elle passa devant le moulin à eau et le four où tout le village cuisait son pain et se dirigea vers le pont en bois qui permettait d’atteindre l’autre berge de l’Arc, qui formait des anses sablonneuses où le courant était moins fort et on pouvait se baigner.
La forêt de la Maurienne, un touffu entrelacs de chênes, hêtres, érables, châtaigniers, noyers, ormes faisait place à des clairières le long de l’Arc bordées de bouleaux et de saules. À certains endroits, la rivière s’élargissait et le courant baissait, formant, parfois, de petits lacs comme celui au-delà du pont, en allant vers le plateau de Saint-Alban. Ludivine savait très bien que sa mère ne voulait pas du tout qu’elle allât se promener toute seule loin des chemins du village, mais l’air tiède du printemps et l’envie pressante de se baigner avaient eu le dessus sur l’obéissance. Elle chantonnait « Margueton va-t-à l’eau, avec son cruchon » en marchant et bientôt elle descendit sur la grève, ôta son bliaud et sa chemise et plongea dans l’eau cristalline.
Tellement prise par l’assouvissement de son désir de se fondre dans la nature rayonnante autour d’elle, elle ne s’était pas aperçue qu’elle n’était pas seule. À quelques mètres de là, dissimulé par les branches d’un saule, un cavalier observait la scène bucolique, une nymphe blonde qui se baignait nue dans les eaux claires de l’Arc.
Tout à coup le vol d’un canard effraya le cheval qui s’ébroua et Ludivine se rendit compte de son inconscience, elle ne savait pas quoi faire, sortir de l’eau toute nue, rester où elle était, par chance le cavalier partit au gallot et la jeune fille se rhabilla de toute hâte et courut à la maison consciente qu’elle l’avait échappé belle. Quand elle arriva à la maison, elle monta directement dans sa chambre et se jeta essoufflée sur le lit. C’était une belle maison en pierre sèche, solide, sur deux étages, entourée d’un grand jardin clôturé, composé d’un potager, un verger sur la partie arrière, et sur le devant, il y avait un grand tilleul avec une table, des bancs et un puits. Au rez-de-chaussée, la pièce principale était la grande cuisine où trônait une cheminée habitable, deux bancs sur le côté permettaient de se chauffer et de contrôler le chaudron, où cuisait lentement la nourriture. Sur la gauche, une petite porte permettait d’accéder à l’étuve, une autre porte, à gauche de la cheminée, donnait sur le jardin potager, au milieu de la pièce, une grande planche rectangulaire en bois massif, posée sur des tréteaux, servait de plan de travail pendant la journée, le soir, la cuisinière et l’intendante la retiraient pour étendre les nattes pour la nuit. Sur la droite, en passant sous un arc en pierre sèche, on entrait dans la salle de séjour. Cette pièce, plus petite que la cuisine, était chauffée par une autre cheminée, de plus modestes dimensions, il y avait une grande table où les Fourniers prenaient leurs repas, une fenêtre donnant sur l’arrière, la porte d’entrée, à deux vantaux en bois cerclé de fer, ouvrait sur le jardin devant la maison, il y avait aussi un grand bahut surmonté d’un chandelier et un escalier en bois, qui menait à l’étage avec ses trois chambres à coucher.
Isembour, la mère de Ludivine, n’était pas à la maison, elle était allée au marché avec son intendante Adeline ; Georges, le mari d’Adeline, jardinier de son état, les avaient emmenées avec une charrette tirée par un cheval.
La maison était vide et silencieuse depuis que les deux frères de Ludivine s’étaient mariés et avait bâti leur propre demeure, non loin de la maison familiale. Ils travaillaient avec leur père, contrôlaient l’activité du moulin et du four, tenaient les contacts avec les clients ; le moulin ne servait pas seulement à moudre le blé, l’orge, le seigle et l’épeautre, mais aussi à scier du bois et à couper les métaux.
Couchée à plat ventre sur son lit, Ludivine réfléchissait, elle n’avait pas réussi à reconnaître le cavalier qui l’épiait et elle se demandait de qui il pouvait bien s’agir. Elle connaissait tout le monde au village et elle était sûre que ce n’était sûrement pas un des jeunes de son âge. Elle éprouvait un mélange de frayeur et de curiosité, en même temps, qui la faisait sentir coupable ; ce dont elle n’avait aucun doute c’est qu’elle ne dirait rien à sa mère.
De retour du marché, Isembour raconta les dernières nouvelles qui circulaient en ce mois de mai 1200 : le royaume de France avait été frappé d’interdit par le pape Innocent III, parce que le roi de France Philippe Auguste avait répudié sa deuxième femme Ingeburge de Danemark et épousé Agnès de Méranie, mais, en cette année, le roi s’était incliné et avait reconnu pour épouse légitime Ingeburge, surtout à l’occasion des noces de Blanche de Castille avec le prince Louis. On racontait que la reine d’Angleterre Aliénor, déjà très âgée, était allée chercher sa petite-fille Blanche jusqu’en Castille pour l’amener à la cour de France. Isembour était très frappée par cette nouvelle parce que dans sa jeunesse, sa mère, avait vu la reine de France Aliénor et le roi Louis VII en route pour la deuxième croisade, quand ils avaient traversé la Maurienne pour se rendre à Naples et s’embarquer pour Constantinople.
Elle avait été émerveillée par la beauté et l’élégance de cette jeune reine, grande, blonde, au regard brillant, dont la robe de velours vert émeraude resplendissait de perles et de broderie d’or et elle lui avait raconté tout ce qu’elle savait de cette reine. Le couple royal avait passé une nuit au château d’Épierre du comte de Savoie, où l’attendait Richard vicomte de La Chambre et il avait été accueilli par tous les villageois qui jetaient des fleurs à leurs pieds. Plus tard, plusieurs fois elle avait entendu des troubadours et des ménestrels chanter la beauté de dame Aliénor dans le style de l’amour courtois qui était né, justement, à la cour de Poitiers du duc d’Aquitaine Guillaume IX, grand-père d’Aliénor.
La sœur aînée d’Isembour, Béraude, était née aveugle, et, depuis toute petite, elle avait montré une passion pour les chants d’Église, on aurait dit qu’en chantant les psaumes elle réussissait à admirer ce que sa cécité l’empêchait de voir, elle s’épanouissait en chantant. Ses parents, alors, pour lui permettre de se consacrer à sa passion et dans l’espoir, aussi, qu’ayant une belle voix pure, cela puisse devenir une profession, l’avait conduite chez les moniales du couvent de Sainte-Thècle à Saint-Jean-de-Maurienne, qui était un centre de culture en même temps que de prière. Elle y avait appris les lettres, le latin, la poésie courtoise, mais, au fil du temps, elle s’était tellement plu à cette vie calme, régulière, à l’abri des dangers de l’extérieur, qu’elle avait voulu prendre le voile.
Toute la famille d’Isembour allait deux fois par an lui rendre visite, et à l’occasion de sa prise d’habit, l’Évêque avait fulminé contre les femmes telles qu’Aliénor, qui quittent leur mari et ne respectent pas les liens sacrés du mariage.
En effet, la reine de France, Aliénor, dès son retour de Terre sainte, avait fait les démarches pour obtenir l’annulation de son mariage avec Louis VII, sous prétexte qu’il y avait consanguinité. Cela avait fait grand scandale dans le royaume de France et dans les autres comtés, ou duchés, y compris le comté de Maurienne, surtout quand, quelques mois plus tard, elle avait épousé Henri Plantagenet, fringant jeune homme, aux cheveux roux et aux taches de rousseur, plus jeune qu’elle et était devenue reine d’Angleterre. Mais Aliénor n’était pas une femme comme tant d’autres, elle était spéciale, unique dans son genre, à l’époque.
Elle avait grandi à la cour la plus raffinée de son temps, la cour de Poitiers de son père Raymond ; elle avait appris le latin, la musique et la littérature, mais aussi l’équitation et la chasse.
Devenue reine de France, elle avait été critiquée pour sa conduite, ses tenues jugées indécentes et ses goûts luxueux, pour la première fois au royaume des Francs, elle avait créé des ateliers de tapisseries. Elle achetait beaucoup de bijoux et de robes, et elle avait fait venir d’Aquitaine des troubadours qui osaient chanter leur amour pour la reine. Elle rayonnait à la cour de France grâce à sa culture et à son inclination pour les arts.
À l’occasion de la deuxième croisade, elle avait accompagné Louis VII et avait invité le célèbre troubadour Jaufré Rudel à la suivre, emmenant toute une suite, logée dans de nombreux chariots.
La découverte de l’Orient, avec ses fastes et ses mystères, avait fasciné Aliénor alors que le roi Louis, à la piété austère et rigoureuse, en était rebuté. Les causes de discorde entre les deux époux s’étaient ajoutées aux difficultés du voyage. Elle avait 24 ans à l’époque, une santé à toute épreuve, et une superbe endurance aux longues chevauchées. Mais si quantité de chariots transportaient robes de rechange, fourrures, voiles, selles et harnachements, bijoux et cuisines, le périple n’en était pas pour autant moins long et moins dangereux.
Sur la route de Terre sainte, jalonnée de cadavres, de chevaliers ou de pauvres gens, Aliénor avait résisté à la traversée de déserts, avec la faim, la soif et les flèches turques pour seules compagnies.
La mésentente dans le couple royal était de notoriété publique, cependant, le divorce n’était pas chose courante à cette époque. Après son mariage avec le fougueux Henri, duc de Normandie, une nouvelle vie, brillante s’était ouverte à la reine. Elle avait partagé son temps entre l’Angleterre, la Normandie et ses terres d’Aquitaine, traversant la Manche dans un sens puis dans l’autre, infatigable, visitant les terres de son époux et les siennes, dispensant grâces et faveurs, administrant en véritable chef d’État l’Angleterre en l’absence du roi. Ces voyages ne faisaient pas peur à Aliénor, elle les entreprenait avec fougue, souvent enceinte. Alors qu’elle n’avait donné que deux filles à Louis, en onze ans de mariage, les grossesses s’étaient succédé avec Henri I. D’une santé florissante, elle supportait ces multiples grossesses très rapprochées, donnant naissance à 9 enfants, dont le dernier à plus de 40 ans.
Isembour aimait à raconter à ses enfants les prouesses de cette maîtresse femme qu’elle avait admirée depuis sa plus tendre enfance et qu’elle jalousait dans son for intérieur. Elle avait appris, au cours des dernières années, qu’Aliénor avait cruellement souffert à cause des infidélités de son époux et en particulier, à cause de sa liaison avec Rosamund Clifford qui était encore jeune et très belle.
C’est à cette occasion qu’Henri, l’époux tant aimé, avait pensé au divorce, mais, par la suite, il s’était contenté d’emprisonner Aliénor, pendant 15 ans, dans différents châteaux d’Angleterre. Elle avait été libérée seulement à la mort de Rosamund.
Isembour avait 38 ans en 1200 et elle pouvait imaginer ce qu’avait dû ressentir son idole, dont la beauté resplendissante était flétrie par les années, les grossesses, les chevauchées, et qui était à présent trahie, repoussée, emprisonnée, loin des fastes de la cour, songeant à son époux brûlant d’amour et de convoitise pour une autre femme, dont la beauté et la fraîcheur de la jeunesse en avaient ensorcelé plus d’un.
Elle aimait encore Bertrand Fournier après vingt-deux ans de vie commune, mais elle ne savait pas s’il lui avait toujours été fidèle. Tandis qu’elle était perdue dans ses pensées, Ludivine se présenta à elle et lui demanda de lui raconter pour la énième fois sa rencontre avec son père.
Isembour lui parla alors de sa famille, qui habitait Argentine, où l’on exploitait les mines de fer et d’argent depuis l’Antiquité. Son père, Thierry Argenteuil, avait une fonderie et une forge connues des seigneurs de Miolans et de La Chambre, qui s’y approvisionnaient en armures et épées ; les évêques y faisaient fondre des cloches pour leurs évêchés et pour les paroisses. Il avait ainsi fait fortune et était devenu le principal notable du village. Il habitait avec sa femme Gertrude et ses enfants dans une belle demeure en pierre, à la lisière du bois, il l’avait décorée avec des objets en fer forgé et un portail par où on entrait dans le jardin clos entourant la maison.
De ces dix enfants, cinq seulement avaient atteint l’âge adulte, trois garçons travaillaient avec lui, la fille aînée était devenue religieuse et Isembour s’était mariée à 16 ans.
Elle avait rencontré le père de Ludivine, Maître Bertrand, à la fête de mai de l’an 1175, qui avait lieu à Épierre ; ce jour-là, elle portait un bliaud bleu ciel et ses cheveux blonds, étaient entrelacés de rubans de la même couleur, elle dansait riant à gorge déployée, ce qui arrondissait ses joues rosies par l’échauffement, elle était ravissante de jeunesse et de fraîcheur et Bertrand s’était épris d’elle dès qu’il l’avait vue.
Il était allé chercher des branches d’arbres couvertes de feuilles, que l’on appelle, mais et il les avait attachées au-dessus de la porte de Isembour pour lui manifester son attirance. Partout fleurissaient les muguets et les aubépines, que les jeunes filles arrangeaient en guirlandes odorantes qu’elles portaient autour du cou. Pendant la journée on organisait des danses qui permettaient aux jeunes gens d’approcher et de frôler en passant la jeune fille de son choix.
Bertrand était un beau garçon bien bâti, plus grand que la moyenne des autres jeunes gens, il avait les cheveux roux bouclés et portait un bliaud vert et des chausses d’un vert plus pâle en lin, et des brodequins en cuir mou. Beaucoup de jeunes filles l’avaient remarqué, car il ne passait pas inaperçu par sa carrure et ses cheveux flamboyants au soleil. Mais depuis que Bertrand avait croisé, le premier jour de la fête de mai, le regard bleu d’Isembour, il était sous le charme, elle était devenue sérieuse et avait fixé sa tignasse cuivrée, assez insolite dans la région, d’un regard profond qui l’avait transpercé. Puis elle avait continué à danser une carole de plus en plus rapide qui faisait virevolter son bliaud en soie bleu ciel, garni à l’encolure par des muguets brodés. Ces cheveux blonds ondoyaient formant une chape d’or autour d’elle, elle était belle.
Isembour se souvenait encore de l’émotion très forte qu’elle avait ressentie à la vue de ce grand gaillard plein d’énergie qui n’arrêtait pas de la fixer. « Ton père était le plus beau garçon de toute la vallée, toutes les filles n’avaient d’yeux que pour lui et, pourtant, c’est moi qu’il regardait. »
« Quelle chance, ma mère, de savoir que c’était lui que vous vouliez épouser, comment pouviez-vous en être sûre ? »
« Ma douce, je ne pensais pas du tout au mariage ! En fait, je ne pensais pas, je sentais, je ressentais un besoin urgent qu’il me serre dans ses bras, qu’il me passe sa chaleur, je voulais le contact, sentir la force de ses muscles, l’odeur de sa peau, et lui, de son côté, éprouvait les mêmes sensations. »
« Était-il gentil avec vous, ma mère ? »
« Oh oui, même s’il ne parlait pas beaucoup, son regard était ensorcelant, nous étions allés nous promener dans les alentours d’Argentine, nous nous étions couchés dans l’herbe, il caressait mon visage et me disait des mots d’amour, que j’étais une fée sortie des bois pour lui jeter un charme, qu’il ne pensait qu’à moi du soir au matin et quand il m’embrassait j’avais l’impression de me dissoudre, de fondre comme le fer incandescent… »
« Combien de temps après vous êtes-vous mariés », demanda Ludivine, troublée par l’émotion d’Isembour.
« Nous n’avons pas attendu longtemps ! C’était trop dangereux, nous n’aurions pas pu nous arrêter à temps, tellement notre désir de nous unir était fort ! Il demanda ma main à mes parents et un mois après nous étions mari et femme. »
« Comment a été le mariage ? Et votre surcot, de quelle couleur il était ? »
« Oh ça a été une très belle fête, c’était en juin, peu avant les fêtes de la Saint-Jean, la nature resplendissait autour de nous, les près embaumaient de senteurs enivrantes, ils étaient maculés du jaune des genêts, des pissenlits et du millepertuis, du rouge des coquelicots et des églantiers.
Les tilleuls étaient en fleurs et répandaient leur parfum suave. La chaleur exacerbait les senteurs de foin, de miel et de sève. Le parterre de l’église d’Épierre était jonché d’herbes odorantes et de fleurs et je portais sur ma cotte de soie blanche un surcot vert pâle surpiqué de petites fleurs blanches et de perles, les mêmes qui entrelaçaient mes cheveux. J’étais si heureuse ! »
« Que vous deviez être belle, ma mère ! »
« Pas plus belle que vous, ma douce, vos cheveux sont blond vénitien et quand le soleil les caresse, ils prennent des nuances dorées et cuivrées, vous êtes plus grande et plus mince, une ravissante jeune fille en fleur ! »
« Merci, ma mère, mais je ne connais pas les émotions dont vous m’avez parlé ! »
« Patience, ma petite fille, le temps viendra où vous rencontrerez quelqu’un qui les réveillera en vous ! »
Les parents d’Isembour avaient accepté la demande de Bertrand après s’être renseignés sur lui et avoir appris qu’il venait d’une famille sérieuse, son père, Martin Fournier, avait un moulin et un four à Épierre et Bertrand avait appris le métier et savait utiliser la force de l’eau pour scier le bois, moudre le blé, l’épeautre, l’orge, le seigle.
Grâce à lui, son père avait pu construire un four où tout le village faisait cuire son pain. Les premiers temps de leur mariage, Isembour et Bertrand avaient vécu avec leurs parents. Puis les enfants étaient arrivés, deux garçons d’abord et le jeune couple avait dû changer de logis. Ils étaient allés vivre dans une grande maison à l’extérieur du village d’Épierre, pas loin de la rivière et du moulin. La maison en pierre sèche était composée d’une cuisine avec une grande cheminée vivable et une grande salle pour les repas d’où montait un escalier en colimaçon en fer forgé, grand-œuvre du père d’Isembour, qui conduisait à l’étage des chambres à coucher.
Avec le temps, Isembour avait pu se permettre des vitres aux fenêtres qui ouvraient sur le jardin fleuri, protégé l’été par de grands tilleuls, autour du puits, grimpait un églantier et tout autour poussaient des glaïeuls ; la fenêtre de la cuisine, par contre, donnait sur le verger et le potager à l’arrière de la maison, cerisiers, pommiers, pruniers s’entendaient parfaitement avec les choux, les pois, les courgettes et au printemps régalaient la maisonnée avec une profusion de fleurs blanches et roses.
Isembour avait brodé des rideaux en lin et des nappes pour les jours de fête qu’elle rangeait soigneusement dans des coffres en bois, sur une desserte trônaient deux chandeliers et des brocs, des gobelets d’étain et des écuelles. La chambrière tous les matins couvrait le dallage d’herbes vertes, allumait le feu dans les cheminées, allait cueillir des fleurs et des branches qu’elle apportait à Isembour qui en faisait de beaux bouquets et les disposait dans la salle.