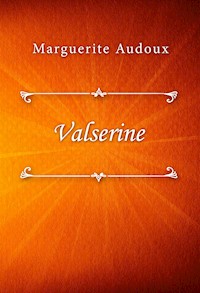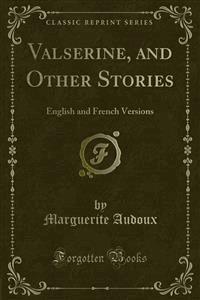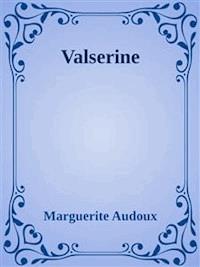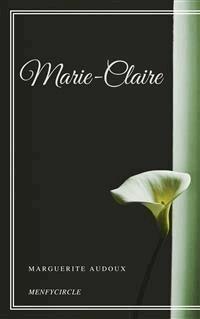1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Marie-Claire est un roman de Marguerite Audoux publié en 1910 et qui a reçu la même année le prix Femina. C’est la première œuvre de son auteur et à ce titre la plus autobiographique.
Résumé
| Marie-Claire évoque l’enfance et l’adolescence de l’auteur. La première partie relate la mort de la mère, le départ du père et les neuf années passées à l’orphelinat, l’Hôpital général de Bourges, période difficile, éclairée cependant par la présence tutélaire de sœur Marie-Aimée. La deuxième partie se situe à la ferme de Villevieille, où les premiers patrons de Marie-Claire, Maître Sylvain et Pauline, entourent la petite bergère d’une affection bienveillante. Dans la troisième partie, la jeune fille s’éprend d’Henri Deslois, le frère de la fermière qui a succédé à Pauline. La mère du jeune homme interdit à Marie-Claire de revoir Henri. Celle-ci retourne alors au couvent, où elle revoit sœur Marie-Aimée avant de partir pour Paris… |
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
PRÉFACE
PREMIÈRE PARTIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
DEUXIÈME PARTIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TROISIÈME PARTIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MARGUERITE AUDOUX
MARIE-CLAIRE
ROMAN
Eugène Fasquelle, 1911
Raanan Editeur
Livre numérique 314 | édition 2
PRÉFACE
Francis Jourdain, un soir, me confia la vie douloureuse d’une femme dont il était le grand ami.
Couturière, toujours malade, très pauvre, quelquefois sans pain, elle s’appelait Marguerite Audoux. Malgré tout son courage, ne pouvant plus travailler, ni lire, car elle souffrait cruellement des yeux, elle écrivait.
Elle écrivait non avec l’espoir de publier ses œuvres, mais pour ne point trop penser à sa misère, pour amuser sa solitude, et comme pour lui tenir compagnie, et aussi, je pense, parce qu’elle aimait écrire.
Il connaissait d’elle une œuvre, Marie-Claire, qui lui paraissait très belle. Il me demanda dela lire. J’aime le goût de Francis Jourdain, et j’en fais grand cas. Sa tournure d’esprit, sa sensibilité me contentent infiniment… En me remettant le manuscrit, il ajouta :
— Notre cher Philippe admirait beaucoup ça… Il eût bien voulu que ce livre fût publié. Mais que pouvait-il pour les autres, lui qui ne pouvait rien pour lui ?…
Je suis convaincu que les bons livres ont une puissance indestructible… De si loin qu’ils arrivent, ou si enfouis qu’ils soient dans les misères ignorées d’une maison d’ouvrier, ils se révèlent toujours… Certes, on les déteste… On les nie et on les insulte… Qu’est-ce que cela fait ? Ils sont plus forts que tout et que tout le monde.
Et la preuve c’est que Marie-Claire paraît, aujourd’hui, en volume, chez Fasquelle.
Il m’est doux de parler de ce livre admirable, et je voudrais, dans la foi de mon âme, y intéresser tous ceux qui aiment encore la lecture. Comme, moi-même, ils y goûteront des joies rares, ils y sentiront une émotion nouvelle et très forte.
Marie-Claire est une œuvre d’un grand goût.Sa simplicité, sa vérité, son élégance d’esprit, sa profondeur, sa nouveauté sont impressionnantes. Tout y est à sa place, les choses, les paysages, les gens. Ils sont marqués, dessinés d’un trait, du trait qu’il faut pour les rendre vivants et inoubliables. On n’en souhaite jamais un autre, tant celui-ci est juste, pittoresque, coloré, à son plan. Ce qui nous étonne surtout, ce qui nous subjugue, c’est la force de l’action intérieure, et c’est toute la lumière douce et chantante qui se lève sur ce livre, comme le soleil sur un beau matin d’été. Et l’on sent bien souvent passer la phrase des grands écrivains : un son que nous n’entendons plus, presque jamais plus, et où notre esprit s’émerveille.
Et voilà le miracle :
Marguerite Audoux n’était pas une « déclassée intellectuelle », c’était bien la petite couturière qui, tantôt, fait des journées bourgeoises, pour gagner trois francs, tantôt travaille chez elle, dans une chambre si exiguë qu’il faut déplacer le mannequin pour atteindre la machine à coudre.
Elle a raconté comment, lorsque en sa jeunesse elle gardait les moutons dans une ferme de la Sologne, la découverte, dans un grenier,d’un vieux bouquin lui révéla le monde des histoires. Depuis ce jour-là, avec une passion grandissante, elle lut tout ce qui lui tombait sous la main, feuilletons, vieux almanachs, etc. Et elle fut prise du désir vague, informulé, d’écrire un jour, elle aussi, des histoires. Et ce désir se réalisa, le jour où le médecin, consulté à l’Hôtel-Dieu, lui interdit de coudre, sous peine de devenir aveugle.
Des journalistes ont imaginé que Marguerite Audoux s’écria alors : « Puisque je ne peux plus coudre un corsage, je vais faire un livre. »
Cette légende, capable de satisfaire, à la fois, le goût qu’ont les bourgeois pour l’extraordinaire et le mépris qu’ils ont de la littérature, est fausse et absurde.
Chez l’auteur de Marie-Claire, le goût de la littérature n’est pas distinct de la curiosité supérieure de la vie, et ce qu’elle s’amusa à noter, ce fut, tout simplement, le spectacle de la vie quotidienne, mais encore plus ce qu’elle imaginait, ce qu’elle devinait de l’existence des gens rencontrés. Déjà, ses dons d’intuition égalaient ses facultés d’observation… Elle ne parlait jamais à quiconque de cette « manie » de griffonner, et brûlait ses bouts de papier, quelle croyait ne pouvoir intéresser personne.
Il fallut que le hasard la conduisît dans un milieu où fréquentaient quelques jeunes artistes, pour qu’elle se rendît compte combien les séduisait, combien les empoignait son don du récit. Charles-Louis Philippe l’encouragea particulièrement, mais jamais il ne lui donna de conseils. Adressés à une femme dont la sensibilité était si éduquée déjà, la volonté si arrêtée, le tempérament si affirmé, il les sentait encore plus inutiles que dangereux.
À notre époque, tous les gens cultivés, et ceux qui croient l’être, se soucient fort de retour à la tradition et parlent de s’imposer une forte discipline… N’est-il pas délicieux que ce soit une ouvrière, ignorant l’orthographe, qui retrouve, ou plutôt qui invente ces grandes qualités de sobriété, de goût, d’évocation, auxquelles l’expérience et la volonté n’arrivent jamais seules ?
La volonté, d’ailleurs, ne fait pas défaut à Marguerite Audoux, et quant à l’expérience, ce qui lui en tient lieu, c’est ce sens inné de la langue qui lui permet non pas d’écrire comme une somnambule, mais de travailler sa phrase, de l’équilibrer, de la simplifier, en vue d’un rythme dont elle n’a pas appris à connaîtreles lois, mais dont elle a, dans son sûr génie, une merveilleuse et mystérieuse conscience.
Elle est douée d’imagination, mais entendons-nous, d’une imagination noble, ardente et magnifique, qui n’est pas celle des jeunes femmes qui rêvent et des romanciers qui combinent. Elle n’est ni à côté ni au delà de la vie ; elle semble seulement prolonger les faits observés, et les rendre plus clairs. Si j’étais critique, ou, à Dieu ne plaise, psychologue, j’appellerais cette imagination une imagination déductive. Mais je ne me hasarde pas sur ce terrain périlleux.
Lisez Marie-Claire… Et quand vous l’aurez lue, sans vouloir blesser personne, vous vous demanderez quel est parmi nos écrivains — et je parle des plus glorieux — celui qui eût pu écrire un tel livre, avec cette mesure impeccable, cette pureté et cette grandeur rayonnantes.
Octave Mirbeau.
PREMIÈRE PARTIE
1
Un jour, il vint beaucoup de monde chez nous. Les hommes entraient comme dans une église, et les femmes faisaient le signe de la croix en sortant.
Je me glissai dans la chambre de mes parents, et je fus bien étonnée de voir que ma mère avait une grande bougie allumée près de son lit. Mon père se penchait sur le pied du lit, pour regarder ma mère, qui dormait les mains croisées sur sa poitrine.
Notre voisine, la mère Colas, nous garda tout le jour chez elle. À toutes les femmes qui sortaient de chez nous, elle disait :
— Vous savez, elle n’a pas voulu embrasser ses enfants.
Les femmes se mouchaient en nous regardant, et la mère Colas ajoutait :
— Ces maladies-là, ça rend méchant.
Les jours qui suivirent, nous avions des robes à larges carreaux blancs et noirs.
La mère Colas nous donnait à manger et nous envoyait jouer dans les champs. Ma sœur, qui était déjà grande, s’enfonçait dans les haies, grimpait aux arbres, fouillait dans les mares et revenait le soir les poches pleines de bêtes de toutes sortes qui me faisaient peur et mettaient la mère Colas bien en colère.
J’avais surtout une grande répugnance pour les vers de terre. Cette chose rouge et élastique me causait une horreur sans nom, et s’il m’arrivait d’en écraser un par mégarde, j’en ressentais de longs frissons de dégoût. Les jours où je souffrais de points de côté, la mère Colas défendait à ma sœur de s’éloigner. Mais ma sœur s’ennuyait et voulait quand même m’emmener. Alors, elle ramassait des vers, qu’elle laissait grouiller dans ses mains, en les approchant de ma figure. Aussitôt, je disais que je n’avais plus mal, et je me laissais traîner dans les champs.
Une fois, elle m’en jeta une grosse poignée sur ma robe. Je reculai si précipitamment que je tombai dans un chaudron d’eau chaude. La mère Colas se lamentait en me déshabillant. Je n’avais pas grand mal ; elle promit une bonne fessée à ma sœur, et comme les ramoneurs passaient devant chez nous, elle les appela pour l’emmener.
Ils entrèrent tous les trois avec leurs sacs et leurs cordes ; ma sœur criait et demandait pardon, et moi j’avais bien honte d’être toute nue.
2
Mon père nous emmenait souvent dans un endroit où il y avait des hommes qui buvaient du vin ; il me mettait debout entre les verres, pour me faire chanter la complainte de Geneviève de Brabant. Tous ces hommes riaient, m’embrassaient, et voulaient me faire boire du vin.
Il faisait toujours nuit quand nous revenions chez nous. Mon père faisait de grands pas en se balançant ; il manquait souvent de tomber ; parfois, il se mettait à pleurer tout haut en disant qu’on avait changé sa maison. Alors, ma sœur poussait des cris, et, malgré la nuit, c’était toujours elle qui finissait par retrouver notre maison.
Il arriva un matin que la mère Colas nous accabla de reproches, disant que nous étions des enfants de malheur, qu’elle ne nous donnerait plus à manger, et que nous pouvions bien aller retrouver notre père, qui était parti on ne savait où. Quand sa colère fut passée, elle nous donna à manger comme d’habitude ; mais, quelques instants après, elle nous fit monter dans la carriole du père Chicon. La carriole était pleine de paille et de sacs de grains. J’étais placée derrière, dans une sorte de niche, entre les sacs ; la voiture penchait en arrière et chaque secousse me faisait glisser sur la paille.
J’eus une très grande peur tout le long de la route ; à chaque glissade, je croyais que la carriole allait me perdre, ou bien que les sacs allaient s’écrouler sur moi.
On s’arrêta devant une auberge. Une femme nous fit descendre, secoua la paille de nos robes, et nous fit boire du lait. Tout en nous caressant, elle disait au père Chicon :
— Alors, vous pensez que leur père les voudra ?
Le père Chicon branla la tête en cognant sa pipe contre la table ; il fit une grimace avec sa grosse lèvre et il répondit :
— Il est peut-être parti encore plus loin. Le fils à Girard m’a dit qu’il l’avait rencontré sur la route de Paris.
Le père Chicon nous mena ensuite dans une belle maison, où il y avait un perron avec beaucoup de marches.
Il causa longtemps avec un monsieur qui faisait de grands gestes et qui parlait de tour de France. Le monsieur mit sa main sur ma tête, et il répéta plusieurs fois :
— Il ne m’avait pas dit qu’il avait des enfants.
Je compris qu’il parlait de mon père, et je demandai à le voir. Le monsieur me regarda sans répondre, puis il demanda au père Chicon :
— Quel âge a donc celle-ci ?
— Dans les cinq ans, dit le vieux.
Pendant ce temps, ma sœur jouait sur les marches avec un petit chat.
La carriole nous ramena chez la mère Colas, qui nous reçut en bougonnant et en nous bousculant ; quelques jours après, elle nous fit monter en chemin de fer, et le soir même nous étions dans une grande maison où il y avait beaucoup de petites filles.
Sœur Gabrielle nous sépara tout de suite. Elle dit que ma sœur était assez grande pour aller aux moyennes, tandis que moi je resterais aux petites.
Sœur Gabrielle était toute petite, vieille, maigre, et courbée ; elle dirigeait le dortoir et le réfectoire. Au dortoir, elle passait un bras sec et dur entre notre chemise et le drap, pour s’assurer de notre propreté, et elle fouettait à heure fixe, et avec des verges, celles dont les draps étaient humides.
Au réfectoire, elle faisait la salade dans une immense terrine jaune.
Les manches retroussées jusqu’aux épaules, elle plongeait et replongeait dans la salade ses deux bras noirs et noueux, qui sortaient de là tout luisants et gouttelants, et qui me faisaient penser à des branches mortes, les jours de pluie.
3
J’eus tout de suite une amie.
Je la vis venir vers moi en se dandinant, l’air effronté.
Elle n’était guère plus haute que le banc sur lequel j’étais assise. Elle appuya ses coudes sans façon sur moi, et elle me dit :
— Pourquoi ne joues-tu pas ?
Je répondis que j’avais mal au côté.
— Ah oui, reprit-elle ; ta maman était poitrinaire, et sœur Gabrielle a dit que tu mourrais bientôt.
Elle grimpa sur le banc, s’assit en faisant disparaître sous elle ses petites jambes ; puis elle me demanda mon nom, mon âge, m’apprit qu’elle s’appelait Ismérie, qu’elle était plus vieille que moi, et que le médecin disait qu’elle ne grandirait jamais. Elle m’apprit aussi que la maîtresse de classe s’appelait sœur Marie-Aimée, qu’elle était très méchante et punissait sévèrement les bavardes.
Elle sauta tout d’un coup sur ses pieds en criant :
Augustine !
Sa voix était comme celle d’un garçon, et ses jambes étaient un peu tordues.
À la fin de la récréation, je l’aperçus sur le dos d’Augustine, qui la balançait d’une épaule sur l’autre, comme pour la jeter à terre. En passant devant moi, elle me cria de sa grosse voix :
— Tu me porteras aussi, dis ?
Je fis bientôt la connaissance d’Augustine.
4
Un mal d’yeux que j’avais s’aggrava. La nuit, mes paupières se collaient l’une contre l’autre, de sorte que j’étais complètement aveugle, jusqu’à ce qu’on me les eût baignées. Ce fut elle qui fut chargée de me conduire à l’infirmerie. Tous les matins, elle venait me prendre au petit dortoir. Je l’entendais venir depuis la porte. Ce n’était pas long ; elle me saisissait la main, et m’entraînait du même pas qu’elle était venue, sans s’occuper si je me cognais aux lits.
Nous traversions les couloirs comme le vent, et descendions les deux étages comme une avalanche ; mes pieds rencontraient une marche de temps en temps ; je descendais comme on tombe dans le vide ; Augustine avait une main ferme qui me tenait solidement.
Pour aller à l’infirmerie, il fallait passer derrière la chapelle, puis devant une petite maison toute blanche ; là, on redoublait de vitesse.
Un jour que, n’en pouvant plus, j’étais tombée sur les genoux, elle me releva avec une tape sur la tête, en disant :
— Dépêche-toi donc, on est devant la maison des morts.
Tous les jours ensuite, dans la crainte que je tombe, elle m’avertissait quand nous étions devant la maison des morts.
J’avais surtout peur de la peur d’Augustine. Puisqu’elle courait si fort, c’est qu’il y avait du danger. J’arrivais à l’infirmerie en nage et sans souffle ; quelqu’un me poussait sur une petite chaise, et mon point de côté était passé depuis longtemps quand on venait me laver les yeux.
Ce fut encore Augustine qui me conduisit dans la classe de sœur Marie-Aimée. Elle prit une voix timide pour dire :
— Ma Sœur, voilà la nouvelle.
Je m’attendais à une rebuffade, mais sœur Marie-Aimée me sourit, m’embrassa plusieurs fois, et dit :
— Tu es trop petite pour être sur un banc. Je vais te mettre ici.
Et elle me fit asseoir sur un petit banc, dans le creux de son pupitre.
Comme il y faisait bon dans ce creux de pupitre ! Comme la chaleur des jupes de laine caressait mon corps tout meurtri par les escaliers de bois et de pierres !
Souvent deux pieds se posaient de chaque côté de mon petit banc et je me trouvais étroitement enclavée entre deux jambes nerveuses et chaudes. Une main tâtonnante m’appuyait la tête sur les jupes entre les genoux, et sous cette main douce, et sur cet oreiller chaud, je m’endormais.
Quand je m’éveillais, l’oreiller se transformait en table. La même main y déposait des débris de gâteaux, de menus morceaux de sucre, et quelques bonbons.
Autour de moi, j’entendais vivre le monde.
Une voix pleurait :
— Non, ma Sœur, ce n’est pas moi.
Des voix criardes disaient :
— Si, ma Sœur, c’est elle.
Au-dessus de ma tête, une voix pleine et chaude imposait silence, en s’accompagnant de coups de règle sur le pupitre, qui résonnaient et faisaient dans mon creux un bruit énorme.
Parfois, il se faisait un grand mouvement. Les pieds se retiraient de mon petit banc, les genoux se rapprochaient, la chaise remuait, et je voyais se pencher vers mon nid une guimpe blanche, un menton mince, des dents fines et pointues, et enfin deux yeux caressants qui m’apportaient la confiance.