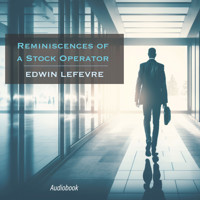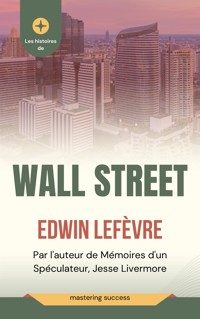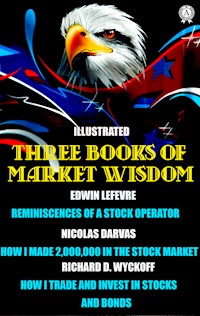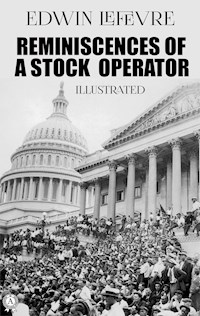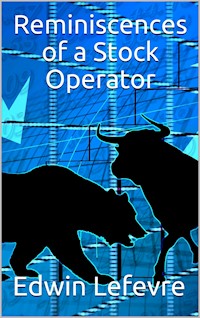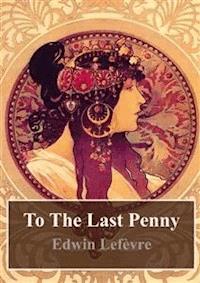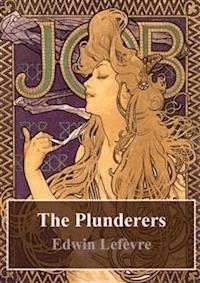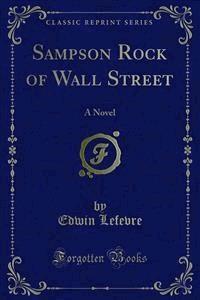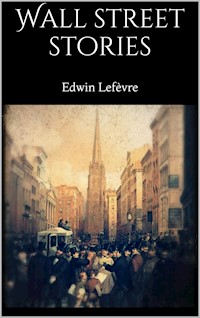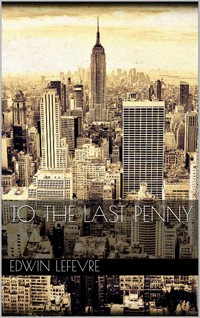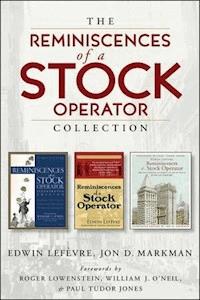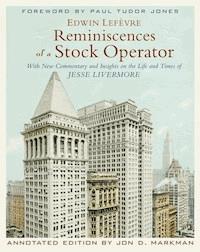9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jason Nollan
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Voici l'histoire du plus grand trader de la bourse de Wall Street !
"Mémoires d'un spéculateur retrace la vie du plus talentueux trader de tous les temps, Jesse Livermore. L'auteur y raconte son parcours depuis l'âge de 15 ans lorsqu'il gagna ses premiers 1000 dollars, puis ses premiers 10 000 dollars jusqu'à devenir une légende de Wall Street !
Cette édition annotée se veut complète en apportant tant un éclairage sur la méthode de trading de Livermore que sur sa vie affective et familiale par la biographie incluse en fin d'ouvrage.
Comme il le souligne lui-même à maintes reprises, les dimensions psychologiques et émotionnelles jouent constamment un rôle crucial dans les décisions prises sur les marchés. Savoir les reconnaître et les maîtriser est souvent ce qui fait la différence entre les "gagnants et les perdants."
Jusqu'à ce jour, Jesse Livermore est connu pour :
- sa clairvoyance
- son style
- sa méthode de trading
- ses principes intemporels
- son analyse technique des marchés
- son money management
- la gestion de ses émotions
- Et bien plus encore...
Jesse Livermore a connu la fortune puis la ruine, et de nouveau la fortune. Comment ? Découvrez-le au travers de cette épique biographie et apprenez auprès d'un des plus grands traders de son époque, voire de toute l'histoire !
Ils en parlent :
« Le meilleur livre de Bourse que j'ai lu est certainement Mémoires d'un spéculateur. J'en garde toujours plusieurs exemplaires à mon bureau pour mes nouveaux collaborateurs. » Martin Zweig
« Le livre le plus divertissant jamais écrit sur l'investissement demeure Mémoires d'un spéculateur, d'Edwin Lefèvre. » The Seattle Times
« Après 20 ans de nombreuses relectures, ce livre demeure l'un de mes grands favoris. » Kenneth Fisher, Forbes
« Dans le cadre des interviews que j'ai conduites avec une trentaine des plus grands traders de notre époque, je soulevais dans chacune de mes conversations un certain nombre de questions de base. L'une d'elles étant la suivante : "Y a-t-il un livre que vous avez trouvé plus particulièrement utile et que vous recommanderiez à tout trader débutant ?" La réponse de loin la plus fréquente était Mémoires d'un spéculateur. » Jack Schwager
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
MÉMOIRES D’UN SPÉCULATEUR
L’HISTOIRE DE JESSE LIVERMORE LE PLUS TALENTUEUX SPÉCULATEUR DE WALL STREET
Par Edwin LEFÈVRE
Copyright© 2021 by Publishing President™
All rights reserved, including the right to reproduce this book or portion thereof in any form whatsoever.
Copyright© 2021 by Publishing President. ™ All rights reserved, including the right to reproduce this book or portion thereof in any form whatsoever.
Copyright© 2021, Publishing President. ™ Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle du contenu, de la couverture ou des icônes par quelque procédé que ce soit (électronique, photocopie, bandes magnétiques ou autre) est interdite sans les autorisations dePublishing President. ™
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’Auteur ou de ses ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Table des matières
Chapitre 1 : Premiers pas
Chapitre 2 : The Boy Trader
Chapitre 3 : Le grand boom de 1901
Chapitre 4 : Des courtiers de mauvaise foi
Chapitre 5 : « C’est un marché haussier ! »
Chapitre 6 : Une sacrée intuition
Chapitre 7 : L’art du trading
Chapitre 8 : Retour à la case départ
Chapitre 9 : Des vacances loin d’être de tout repos
Chapitre 10 : La ligne de moindre résistance ou l’une des clés du succès
Chapitre 11 : Le Roi du coton
Chapitre 12 : Percy Thomas
Chapitre 13 : Une erreur loin d’être anodine
Chapitre 14 : La quête du rebond
Chapitre 15 : L’épisode du café
Chapitre 16 : Des tuyaux non sans conséquences
Chapitre 17 : Intuition ou expérience ?
Chapitre 18 : Mes affaires au Tropical Trading
Chapitre 19 : La manipulation, la clé de la réussite économique
Chapitre 20 : James R. Keene, la légende des manipulateurs
Chapitre 21 : L’Imperial Steel et Pete Products, des géants difficiles à gérer
Chapitre 22 : Une promesse à tenir et des querelles naissantes
Chapitre 23 : Faire face aux raids de baissiers
Chapitre 24 : Le public face aux lois du marché
Biographie de Jesse Livermore
BONUS* (À lire maintenant)
BIBLIOGRAPHIE
Chapitre 1 : Premiers pas
La fin du collège fut pour moi le moment même où j’intégrai la vie active. Je décrochai un poste en tant qu’assistant de cotation au sein d’un bureau de courtage. On peut dire que j’étais doué pour les chiffres. À l’école, j’avais étudié l’équivalent de trois ans d’arithmétiques en une seule année. Et pour cause, j’étais particulièrement bon en calcul mental. En tant qu’assistant de cotation, mon rôle consistait à afficher les chiffres sur le grand tableau présent dans la salle des clients. L’un des clients s’asseyait habituellement près du téléscripteur et annonçait les prix à voix haute. L’exercice était loin d’être trop rapide pour moi : j’avais une excellente mémoire des chiffres. Aucun problème à ce niveau-là.
Le bureau employait plusieurs autres personnes. Évidemment, je me liai d’amitié avec les autres employés, néanmoins, la charge de travail que j’avais lorsque le marché était actif me tenait trop occupé entre 10 heures et 15 heures pour me laisser le temps de bavarder avec qui que ce soit. De toute façon, cela ne m’intéressait guère et encore moins durant les heures de travail.
Néanmoins un marché animé n’était pas suffisant pour empêcher mon esprit de penser au travail. Pour moi, ces cours ne représentaient ni des prix d’actions ni des dollars par action ; à mes yeux, il s’agissait avant tout de chiffres. Bien sûr, ils avaient un sens. Ils changeaient constamment et c’est justement tout ce qui pouvait m’intéresser. Pourquoi changeaient-ils ? Je l’ignorais. Je dirais même que je m’en fichais et que je ne pensais pas vraiment à cela. Je constatais seulement qu’ils changeaient. C’est tout ce qui devait occuper mon esprit environ cinq heures par jour et deux heures de plus les samedis : ils changeaient constamment.
C’est de cette manière que j’ai commencé à m’intéresser aux comportements que pouvaient adopter les prix. Comme je l’ai déjà évoqué précédemment, je pouvais compter sur ma mémoire des chiffres. Je pouvais me rappeler en détail comment les prix avaient évolué la veille, juste avant de grimper ou de chuter. Mon penchant pour le calcul mental se révéla être bien pratique.
Je remarquais que tant en cas de hausse qu’en cas de baisse, les prix des actions étaient en quelque sorte susceptibles d’adopter certaines habitudes. Il y avait une infinité de cas similaires et ces précédents avaient pour utilité de me guider. J’étais à peine âgé de quatorze ans, mais après avoir procédé à des centaines d’observations dans mon esprit, je me suis retrouvé à tester leur exactitude en les comparant au comportement des actions d’un jour à l’autre. Il m’a fallu très peu de temps avant que je ne parvienne à anticiper les évolutions des prix. Mon seul guide, comme je pourrais le réaffirmer, était leurs performances précédentes. J’avais leur « fil conducteur » en tête. Je cherchais à ce que les cours des actions y soient alignés. Je les avais « chronométrés », si vous voyez ce que je veux dire.
Vous pouvez, par exemple, repérer où l’achat est à peine meilleur que la vente. Une bataille se déroule sur le marché boursier, et cette sorte de bande enregistrante est votre télescope. Vous pouvez compter sur elle dans sept cas sur dix.
Une autre leçon que j’ai très vite apprise est qu’il n’y a rien de nouveau à Wall Street. C’est tout bonnement impossible, car la spéculation est vieille comme le monde. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur le marché boursier s'est déjà produit avant et se reproduira dans le futur. Je n’ai jamais oublié cela. Je suppose que j'arrive à me rappeler quand et comment les choses se produisent. Le fait que je me souvienne de cette façon est justement ce qui me permet de gagner en expérience.
Je me suis tellement intéressé à ce jeu et j'étais si anxieux d'anticiper les avancées et les déclins de toutes les actions actives que je me suis acheté un petit carnet où j’ai commencé à noter toutes mes observations. Ce n'était pas un simple registre de transactions imaginaires comme ceux que de nombreuses personnes tiennent simplement dans le but de gagner ou de perdre des millions de dollars sans prendre la grosse tête ou aller à l'hospice. Il s’agissait plutôt d’une sorte de registre de mes succès et de mes échecs, car plus que l’observation des mouvements probables, j'étais surtout intéressé par la vérification de mes anticipations, en d'autres termes, vérifier si j'avais raison.
Disons par exemple qu'après avoir étudié chaque fluctuation qu’une action active avait en une journée, je concluais qu'elle se comportait comme elle le faisait toujours avant de marquer huit ou dix points. Et bien ensuite, je notais l’action et le prix du lundi, et en prenant en compte les performances passées, j'écrivais comment je prévoyais qu’elles fluctueraient mardi et mercredi. Par la suite, je vérifiais si cela concordait avec les vraies transcriptions.
C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser au message de la bande. Dès le début, les fluctuations ont été associées dans mon esprit à des mouvements croissants ou décroissants. Bien sûr, il y a toujours une raison derrière ces fluctuations, mais la bande ne s'intéresse pas au pourquoi du comment. Elle ne donne pas d'explications. Je ne lui ai pas demandé pourquoi
lorsque j'avais quatorze ans, et je ne le lui demande pas plus aujourd'hui, à quarante ans.
La raison pour laquelle une certaine action varie aujourd'hui d’une certaine manière peut demeurer inconnue pendant deux ou trois jours, ou semaines, ou mois. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire ? Votre travail autour de la bande se fait maintenant et non pas demain. La raison peut bien attendre. Mais vous devez impérativement agir dans l’immédiat ou vous risquez d’être perdu. Je vois souvent cela se produire. Vous vous souviendrez que Hollow Tube a baissé de trois points l'autre jour alors que le reste du marché suivait brusquement. C’était un fait. Le lundi suivant, vous voyiez que les directeurs n’ont pas déclaré le dividende.S’en était la raison. Ils avaient parfaitement conscience de ce qu'ils allaient faire, et même s'ils n'ont pas vendu l’action eux-mêmes, au moins ils ne l’achetaient pas. Il n'y avait pas d'achat en interne, aucune raison pour que ça ne casse pas.
En tous les cas, j'ai gardé mon petit carnet de notes pendant peut-être six mois. Au lieu de rentrer chez moi dès que je finissais mon travail, je choisissais les chiffres que je voulais et j'étudiais leurs changements, toujours à la recherche de répétitions et de parallélismes entre les comportements, apprenant en même temps à lire la bande sans même en être conscient à l’époque.
Un jour, l'un des employés du bureau, plus âgé que moi, vint me voir là où je déjeunais et me demanda discrètement si j'avais de l'argent.
« Pourquoi veux-tu le savoir ? demandai-je.
- Eh bien, a-t-il dit, j'ai un tuyau formidable sur Burlington. Je vais tenter de le jouer si je peux trouver quelqu'un pour m'accompagner.
- Comment ça, le jouer ? », demandai-je. Pour moi, les seules personnes qui jouaient ou pouvaient jouer les tuyaux étaient les clients, de vieux joueurs avec un tas d'argent. Pourquoi ? Tout simplement, car ça coûte des centaines, voire des milliers de dollars, d’intégrer la partie. C'était comme posséder une voiture privée et avoir un cocher portant un chapeau de soie.
« C'est ce que je veux dire, joue-le ! dit-il. Combien est-ce que tu as ?
- Combien te faut-il ?
- Eh bien, je peux échanger cinq actions en misant cinq dollars.
- Comment comptes-tu le jouer ?
- Je vais acheter tous les Burlington que le bucket shop (maison de courtage qui exécute des ordres pour le compte d’un client) me laissera prendre, avec l'argent que je lui donnerai en marge, a-t-il dit. Ça va sûrement grimper. C'est comme ramasser de l'argent. On va doubler le nôtre en un clin d'œil.
- Attends ! lui dis-je en sortant mon petit carnet de notes. »
J’étais non pas intéressé par le fait de doubler mon argent, mais plutôt par ce qu’il disait concernant la hausse de Burlington. Si cela se révélait vrai, mon carnet de notes devait le montrer. J'ai regardé. Effectivement, d'après mes calculs, Burlington se comportait comme elle le faisait habituellement avant de grimper. Je n'avais jamais rien acheté ou vendu de ma vie, et je n'avais jamais parié avec les autres garçons. Mais tout ce que je voyais-là me prouvait qu’il s’agissait d’une opportunité en or de tester l'exactitude de mon travail, de mon hobby. J'ai tout de suite compris que si cela ne marchait pas en pratique, il y avait peu de chance que ma théorie puisse intéresser qui que ce soit. Alors je lui ai donné tout ce que j'avais, et avec nos ressources mises en commun, il alla dans l'un des bucket shops les plus proches et acheta des actions Burlington. Deux jours plus tard, nous encaissions des bénéfices. J'ai fait un profit de 3,12 $.
Après cette première transaction, je me mis à spéculer à mon propre compte dans les bucket shops. Je pris l’habitude d’y aller à l'heure du déjeuner pour acheter ou vendre, ça n’a jamais eu de différence à mes yeux. Je jouais un système et non pas une action favorite
ou des opinions soutenues. Tout ce que je connaissais, c'était l’aspect arithmétique de la chose. En fait, mon système était la manière idéale d'opérer dans un bucket shop, où tout ce qu'un trader fait se résume à parier sur les fluctuations telles qu'elles sont imprimées par le téléscripteur sur la bande.
Il m’a fallu très peu de temps avant que je ne commence à encaisser beaucoup plus d'argent des bucket shops que ce que je gagnais de mon travail au bureau de courtage. Je décidai donc de démissionner. Mes parents se sont bien sûr opposés, mais ils ne pouvaient pas dire grand-chose quand ils virent ce que je gagnais. Je n'étais qu'un enfant et les salaires moyens des employés de bureau n'étaient pas très élevés. Je me débrouillais bien mieux à mon propre compte.
J'avais quinze ans quand j'obtins mes premiers mille dollars et que je déposai les billets devant ma mère, tous gagnés en quelques mois dans les bucket shops, en plus de ce que j'avais déjà ramené à la maison. Ma mère réagit très mal. Elle voulait que je les mette à la caisse d'épargne, hors de portée de toute tentation. Elle disait que c'était plus d'argent qu'aucun garçon de 15 ans n’avait jamais gagné, en partant de zéro. Elle ne croyait pas vraiment que c'était de l’argent véritable. Elle avait l'habitude de s'inquiéter et de se faire du souci à ce sujet. Mais je ne pensais à rien d'autre qu'à continuer à prouver que mes chiffres étaient bons. C'est tout là le plaisir qu’il y avait : avoir raison rien qu’en utilisant sa tête. Si j'avais raison en testant mes prédictions avec dix actions, j'aurais dix fois plus raison en les remplaçant par cent actions. Pour moi, c'est tout ce que signifiait d’avoir plus de marge - j'avais d’autant plus vigoureusement raison. Plus de courage ? Non ! Aucune différence ! Si tout ce que je possède est dix dollars et que je les risque, je fais preuve de beaucoup plus de courage que lorsque je risque un million alors que j'ai un autre million de côté.
Quoi qu'il en soit, à quinze ans, je gagnais bien ma vie grâce au marché boursier. Je commençai dans les plus petits bucket shops, là où celui qui négociait vingt actions à la fois était suspecté d'être John W. Gates déguisé ou J. P. Morgan voyageant incognito. Les bucket shops à cette époque s’appuyaient rarement sur leurs clients. Ils n'en avaient pas besoin. Il y avait bien d'autres moyens de soutirer de l’argent aux clients, et ce, même lorsqu’ils devinaient correctement. L'affaire était extrêmement rentable. Quand elle était menée légitimement, je veux dire aussi honnêtement que les bucket shops le pouvaient, les fluctuations prenaient soin de tirer les ficelles. Pas besoin d’un énorme mouvement pour effacer une marge de seulement trois quarts de point. De plus, aucun mauvais payeur ne pourrait jamais réintégrer le jeu. Il n'aurait aucune transaction.
Je n'avais pas de coéquipier. Je gardais mes affaires pour moi. De toute façon, c'était une affaire individuelle. C'était grâce à ma tête, n'est-ce pas ? Soit les prix montaient comme je l’avais prédit, sans l'aide d’aucun amis ou partenaires, soit ils allaient dans l'autre sens, et personne ne pouvait les arrêter par gentillesse envers moi. De ce fait, je ne voyais aucun intérêt à parler de mes affaires à quelqu'un d'autre. J'ai des amis, bien sûr, mais mon système a toujours été le même : l'affaire d'un seul homme. C'est pourquoi j'ai toujours fait cavalier seul.
Comme c'était possible de le prévoir, il n'a pas fallu longtemps pour que les bucket shops m'en veuillent de les avoir battus. J'entrais et je déposais ma marge, mais ils la fixaient sans même faire un geste pour la saisir. Ils me disaient qu'il n'y avait rien à faire. C'est à ce moment-là qu'ils commencèrent à m'appeler le « Boy Plunger ». J’étais tout le temps contraint de changer de courtier, allant d'un bucket shop à l’autre. À tel point que j'étais obligé de leur donner un nom fictif. Je commençais léger, seulement par quinze ou vingt actions. Parfois, lorsqu’ils devenaient méfiants, je faisais exprès de perdre au début avant de les piéger comme il se doit. Bien sûr, au bout d'un moment, je finis par leur coûter trop cher, ils me disaient alors d'aller voir ailleurs et de ne pas interférer avec les dividendes des propriétaires.
Une fois, quand l’un des grands établissements avec lequel je commerçais depuis des mois me ferma ses portes, je pris la décision de leur soutirer un peu plus d'argent. Ce bucket shop détenait des parts à travers toute la ville, dans les halls d'hôtel et dans les villes voisines. J’allai dans l’une des succursales de l'hôtel, y posai quelques questions au directeur et finis par pouvoir y faire mon trading habituel. Mais dès que je jouai un stock actif à ma façon, il commença à recevoir des messages du bureau central lui demandant qui était derrière ces opérations. Le directeur me transmit ce qu'ils lui avaient été demandé alors je lui dis que mon nom était Edward Robinson et que je venais de Cambridge. Il téléphona à son supérieur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais à l'autre bout du fil, on voulait savoir à quoi je ressemblais. Quand le directeur m’informa de cela, je lui répondis : « Dites-lui que je suis un petit gros aux cheveux brun foncé et à la barbe touffue ! » Mais il me décrivit à la place, et alors qu’il écoutait la réponse, son visage devint rouge, il raccrocha et m’ordonna de partir.
« Que vous ont-ils dit ? lui demandai-je poliment.
- Ils ont dit, je cite : "Espèce d'imbécile, on ne t'avait pas dit de rester loin des affaires de Larry Livingston ? Et tu l'as délibérément laissé nous escroquer 700 $ !" ». Il n’ajouta pas ce qu'ils lui avaient dit d'autre.
J'essayai par la suite les autres filiales l'une après l'autre, mais elles apprirent toutes à me reconnaître et mon argent n'étaitle bienvenu dans aucun de leurs bureaux. Je ne pouvais même pas entrer pour regarder les cotations sans que des employés ne m'insultent. J'essayai de les convaincre de me laisser pratiquer en établissant de longs intervalles et en répartissant mes visites entre eux. Pourtant cela ne fonctionna pas.
Finalement, il ne m'en restait plus qu'un, et c'était le plus grand et le plus riche de tous : le Cosmopolitan Stock Brokerage Company.
Le Cosmopolitan était classé A-1 et faisait d'énormes affaires. Il possédait des succursales dans toutes les villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre. Ils acceptèrent mes transactions, j'achetais et vendais alors des actions, et je gagnais et perdais de l’argent pendant des mois, mais à la fin, le même scénario se reproduisit. Ils ne refusèrent pas mes opérations comme le firent les petits établissements. Oh, non pas par fair-play, mais parce qu'ils savaient pertinemment que cela leur donnerait une mauvaise image s’il venait à être publié la nouvelle selon laquelle ils refusaient les transactions d'un type juste parce que celui-ci s'avéra ramasser un peu d'argent. Toutefois, ils prirent une mesure encore pire : ils me firent placer une marge de trois points et m'obligèrent à payer une prime d'abord d'un demi-point, puis d'un point. Quel handicap! Comment ? Facile ! Supposons que Steel se vende à 90 et que vous l’achetiez. Votre ticket dit, normalement : "Lot dix Steel à 90⅛." Si vous ajoutez un point de marge, cela signifiait que si cela s’effondrait à 89¼, vous perdiez automatiquement la totalité. Dans un bucket shop, le client n'est pas importuné par des exigences de plus de marge ou n'est pas obligé de dire à son courtier de vendre pour tout ce qu'il peut obtenir.
Mais quand le Cosmopolitan a rajouté cette prime, il s’agissait vraiment d’un coup bas. Cela signifiait que si le prix était de 90 au moment de mon achat, au lieu que mon billet ne dise : "Lot Steel à 90⅛", on pouvait lire : "Lot Steel à 91⅛." Pourquoi ? Car cette action pouvait avancer d'un point et quart après que je ne l'ai acheté et dans tous les cas je perdrais toujours de l'argent si je stoppais la transaction. En plus de cela, en insistant aussi pour que je place une marge de trois points dès le début, ils réduisirent ma capacité de négociation de deux tiers. Néanmoins, ça restait le seul bucket shop qui acceptait de faire affaire avec moi, et je devais accepter leurs conditions ou bien arrêter totalement mon activité.
Bien sûr, j'avais des hauts et des bas, mais j'en ressortis gagnant dans l'ensemble. Cependant, les gens du Cosmopolitan n'étaient tout de même pas satisfaits de l'horrible handicap qu'ils m'avaient assigné, car il aurait dû suffire à arrêter n'importe qui. Ils essayèrent de me doubler, en vain. Je parvins à m’échapper grâce à l'une de mes intuitions.
Le Cosmopolitan, comme je l'ai dit, était mon dernier recours. C'était le plus riche bucket shop de la Nouvelle-Angleterre, et en règle générale, il n’imposait aucune limite à une transaction.Je pense que j'étais le plus gros joueur individuel qu'ils aient eu parmi lesclients réguliers, qui venaient tous les jours. Ils disposaient d’un beau bureau et du tableau de cotation le plus grand et le plus complet que je n’aie jamais vu. Il s'étendait sur toute la longueur de la grande salle et il y était noté des choses plus incroyables les unes que les autres.J’entends par là : les actions négociées sur les bourses de New York et de Boston,le coton, le blé, les provisions, les métaux... en somme, tout ce qui était acheté et venduà New York, Chicago, Boston et Liverpool.
Vous savez comment ils négociaient dans les bucket shops. Vous donniez votre argent à un employé et lui disiez ce que vous vouliez acheter ou vendre. Il regardait la bande ou le tableau de cotation et tirait de là le prix, le dernier, bien sûr. Il inscrivait également l'heure sur le ticket de sorte qu'il se lise presque comme un rapport de courtier ordinaire, c'est-à-dire qu’il était marqué qu'ils avaient acheté ou vendu pour vous tant de parts de telles actions, à tel prix, à telle heure, tel jour et combien d'argent ils ont reçu de votre part. Lorsque vous vouliez clôturer votre transaction, vous alliez voir l’employé, le même ou un autre selon l’endroit, et vous le lui disiez. Il prenait le dernier prix ou, si l'action n'avait pas été active, il attendait la prochaine cotation qui sortait sur la bande. Il écrivait ce prix et l'heure sur votre ticket, le validait et vous le rendait, puis vous alliez à la caisse et récupériez la somme marquée. Bien évidemment, quand le marché se retournait contre vous et que le prix dépassait la limite fixée par votre marge, votre transaction se clôturait d’elle-même automatiquement et votre ticket devenait un simple bout de papier de plus.
Dans les bucket shops plus modestes, où les gens étaient autorisés à négocier d’aussi petites quantités que cinq actions, les tickets étaient sous forme de petits feuillets, de couleurs différentes selon l'achat ou la vente, et parfois, comme par exemple dans les marchés haussiers en ébullition, les établissements étaient durement touchés parce que tous les clients étaient des « haussiers » et avaient tous raison. Alors le bucket shop déduisait à la fois les commissions d'achat et de vente et si vous achetiez une action à 20, le ticket indiquait 20¼. Vous n'aviez donc que ¾ d'un point de course pour votre argent.
Mais le Cosmopolitan était le meilleur établissement de la Nouvelle-Angleterre. Il avait des milliers de clients et malgré cela, je suis convaincu que j'étais le seul homme dont ils avaient peur. Ni la prime meurtrière ni la marge de trois points qu'ils m’obligèrent à mettre ne réduisirent considérablement mes transactions. Je continuai à acheter et vendre autant qu'ils
qu'ils me le permettaient. À tel point que j'avais parfois une ligne de 5000 parts.
Eh bien, le jour où se produisit ce que je compte vous raconter, j'étais à court de 3500 actions de Sugar. Je disposais de sept gros tickets roses pour cinq cents actions chacun. Le Cosmopolitan utilisait de grands papiers laissant un espace vierge sur lequel ils pouvaient écrire une marge supplémentaire. Évidemment, les bucket shops ne demandent jamais de marge supplémentaire. Plus le budget est mince, mieux c'est pour eux, car leur profit réside dans votre perte. Dans les petites boutiques, si vous vouliez faire encore plus de marge sur votre transaction, ils vous feraient un nouveau ticket, afin de pouvoir vous faire payer la commission d'achat et ne vous donneraient que ¾ de point sur chaque baisse de point, car ils calculaient aussi la commission de vente exactement comme s’il s’agissait d’une nouvelle transaction.
Ce jour-là, je me souviens que j'avais accumulé plus de 10 000 $ de marges.
J’étais à peine âgé de vingt ans lorsque j'accumulai pour la première fois dix mille dollars en espèces. Et vous auriez dû entendre ma mère. Vous auriez pensé que 10 000 dollars en espèces représentaient plus que n'importe qui pouvait avoir sur soi, à l’exception près du vieux John D. Elle avait l’habitude de me conseiller de me satisfaire de cela et de me tourner vers des affaires plus ordinaires. J'eus du mal à la convaincre que je ne gagnais pas de l’argent en faisant des paris, mais plutôt en faisant des calculs. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était que dix mille dollars représentaient beaucoup d'argent et parallèlement tout ce que je voyais, c'était plus de marge.
J'avais placé mes 3500 actions de Sugar à 105¼. Il y avait un autre type dans la pièce, du nom de Henry Williams, qui était à court de 2500 actions. J'avais l'habitude de m'asseoir près du téléscripteur et d’annoncer les cotations pour le garçon qui s’occupait du tableau. Le prix adopta le même comportement que je prévoyais. Il baissa rapidement de quelques points et s'arrêta le temps d’une courte pause avant de se remettre à baisser. Le marché boursier était plutôt calme et tout semblait plutôt prometteur. Puis tout à coup, Sugar montra une certaine hésitation que je n’appréciai pas. Je commençai à éprouver un certain mal à l'aise. Je pensai que je devais sortir du marché. Puis la vente se fit à 103, ce qui était bas, compte tenu de la journée, mais au lieu de me sentir plus confiant, je me sentais plus incertain. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais j’avais du mal à mettre le doigt dessus. Or si quelque chose arrivait sans que je ne sache d’où, je ne pouvais en aucun cas rester sur mes gardes face à elle. Dans ce cas, je ferais mieux de quitter le marché.
Vous savez, je ne fais pas les choses à l'aveuglette. Je n'aime pas ça. Je ne le fais jamais. Même en étant enfant, j’exigeais de savoir pourquoi je devais faire certaines choses. Mais cette fois-ci je n'avais aucune raison spécifique à me donner, et pourtant cela me procura un inconfort insupportable. J'appelai un type que je connaissais, Dave Wyman, et je lui dis : « Dave, prends ma place ici. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Attends un peu avant d'annoncer le prochain prix de Sugar, d'accord ? ».
Il me dit qu'il le ferait, je me levai donc et lui donnai ma place près du téléscripteur afin qu'il puisse annoncer les prix à l’employé en charge. Je sortis mes sept billets de Sugar de ma poche et marchai jusqu'au comptoir, là où se trouvait l’employé qui marquait les tickets à chaque clôture de transaction. Mais je ne savais pas vraiment pourquoi je devais quitter le marché, alors je suis resté là, appuyé contre le comptoir, mes tickets dans la main, hors de vue de l’employé. Très vite, j'entendis le cliquetis d'un télégraphe et je vis Tom Burnham, le greffier, tourner rapidement la tête et écouter. J'ai alors senti que quelque chose ne tournait pas rond et décidai de ne pas attendre plus longtemps. C'est alors que Dave Wyman, près du téléscripteur, commença : « Su… », et aussi vite que l'éclair je déposai mes tickets sur le comptoir devant l'employé en criant : « Clôture Sugar ! » avant que Dave n’ait fini d'annoncer
le prix. Donc, sans surprise, l’établissement dut clôturer mon Sugar à la dernière cotation. Ce que Dave était sur le point d’annoncer s’avéra être 103 à nouveau.
D'après ma prédiction, Sugar aurait déjà dû dépasser les 103. Quelque chose ne tournait pas rond. J'avais l'impression que se tramait un piège dans les environs. Quoi qu’il en soit, le télégraphe fonctionnait désormais comme un fou et je remarquai que Tom Burnham, le greffier, avait laissé mes tickets là où je les avais posés, sans les marquer, et qu'il écoutait le cliquetis comme s'il attendait quelque chose. Alors je lui criai: « Hey, Tom, que diable attends-tu ? Marque le prix sur ces tickets : 103 ! Ne traîne pas ! ».
L’ensemble de la salle m'entendit et tourna son regard vers nous en demandant quel était le problème, car, voyez-vous, si le Cosmopolitan n’avait jamais connu de mauvaise posture, on ne pouvait être sûr de rien, et une panique liée à un bucket shop peut commencer tout comme une panique bancaire. Si un client devient méfiant, les autres suivent le mouvement immédiatement. Tom avait l'air renfrogné, mais il s'approcha et marqua mes tickets : « Clôturé à 103 » et poussa les sept vers moi. Il avait vraiment l’air amer.
Disons que la distance entre Tom et le caissier ne dépassait pas les deux mètres. Mais je n’avais même pas encore atteint le caissier pour récupérer mon argent que Dave Wyman, près du téléscripteur, cria, excité : « Mon Dieu ! Sugar, 108 ! ». Mais il était trop tard, alors je ris et appelai Tom : « Ça n'a pas marché cette fois, n'est-ce pas, mon vieux ? ».
Évidemment, il s’agissait d’un coup monté. À nous deux, Henry Williams et moi étions à court de six mille actions de Sugar. Ce bucket shop avait non seulement récupéré ma marge et celle d'Henry, mais il y avait probablement aussi beaucoup d'autres déficits Sugar au sein du bureau, peut-être huit ou dix mille actions en tout. Supposons qu'ils avaient 20 000 dollars de marge sur Sugar. Cela était suffisant pour payer le magasin afin de perturber la bourse de New York et nous anéantir. À l’époque, dès lors qu’un magasin se retrouvait avec trop de haussiers sur une certaine action, il était courant de demander à un courtier de faire suffisamment baisser le prix de cette action pour forcer tous les clients vers la sortie. Cela coûtait rarement au bucket shop plus de quelques points sur quelques centaines d'actions et leur permettait de gagner des milliers de dollars.
C'est justement ce que le Cosmopolitan utilisa pour nous avoir Henry Williams et moi ainsi que les autres déficitaires. Leurs courtiers à New York firent monter le prix jusqu'à 108. Bien sûr, il rechuta tout de suite après, mais Henry et beaucoup d'autres furent anéantis. Chaque fois que se produisait une forte baisse inexpliquée suivie d’une reprise instantanée, les journaux de l'époque appelaient ça un "bucket-shop drive".
Et l’ironie dans l’histoire, c'est que pas plus tard que dix jours après le coup monté du Cosmopolitan, un opérateur de New York leur fit perdre plus de soixante-dix mille dollars. Cet homme, qui était un acteur clé du marché à son époque et un membre de la bourse de New York, s’était fait un nom en tant que baissier pendant la fameuse panique de Bryan en 1996. Il se heurtait toujours aux règles de la Bourse qui l'empêchaient de réaliser certains de ses plans aux dépens de ses collègues. Un jour, il se dit qu'il n'y aurait pas de plaintes, ni de la part de la Bourse ni des autorités de police, s'il s'emparait de certains de leurs gains mal acquis. Dans l’exemple que j’évoque ici, il envoya trente-cinq hommes pour jouer le rôle de clients. Ils se rendirent à la fois au bureau principal et dans les plus grandes filiales. Un même jour à la même heure, les agents achetèrent tous autant de parts d'un certain stock que les directeurs le leur permettaient. Ils avaient pour instruction de s’éclipser en douce avec un certain profit. Bien sûr, ce qu'il fit, c'est distribuer des tuyaux haussiers sur cette action à ses copains, puis il alla au parquet de la Bourse et fit monter le prix, aidé par les traders de la salle, qui le trouvaient beau joueur. En prenant soin de choisir la bonne action pour ce coup, il n'eut aucun mal à faire monter le prix de trois ou quatre points. Ses agents présents dans les bucket shops encaissèrent comme convenu.
Un type m’informa que l’instigateur de ce coup avait empoché soixante-dix mille dollars nets, et ses agents avaient compensé leurs dépenses et leur salaire en plus. Il répéta ce jeu plusieurs fois à travers tout le pays, punissant les plus grands bucket shops de New York, Boston, Philadelphie, Chicago, Cincinnati et St. Louis. Une de ses actions préférées était Western Union, parce qu'il était particulièrement facile de faire bouger une action semi-active comme celle-là de quelques points à la hausse ou à la baisse. Ses agents l'achetaient à un certain prix, la vendaient avec un profit de deux points, puis vendaient à découvert et prenaient trois points de plus. À ce propos, je lus l'autre jour que cet homme était mort, pauvre et dans la tourmente. S'il était mort en 1896, il aurait au moins eu une colonne sur la première page de chaque journal new-yorkais. Or finalement, on ne lui réserva que deux lignes sur la cinquième.
Chapitre 2 : The Boy Trader
Entre la découverte du coup monté mis en place par la Cosmopolitan Stock Brokerage Company qui était prête à me battre si le lourd handicap imposé par la marge de trois points et la prime d'un point et demi le leur permettaient, et les indices montrant qu'ils ne voulaient de toute façon pas de mes affaires, je décidai rapidement d'aller à New York, où je pourrais négocier dans le bureau d'un des membres de la Bourse de New York. Je ne voulais pas d'une succursale de Boston, où les cotations devaient être télégraphiées. Je voulais être proche de la source originale. J’arrivai à New York à l'âge de 21 ans, apportant avec moi tout ce que j'avais, c’est-à-dire deux mille cinq cents dollars.
Je vous avais dit que j'avais dix mille dollars lorsque j’avais vingt ans, et ma marge réalisée sur cette affaire Sugar était de plus de dix mille dollars. Mais je n'ai pas toujours gagné. Mon plan de transaction était assez solide et triomphait plus souvent qu’il n’échouait. Si je m'y étais tenu, j'aurais peut-être eu raison sept fois sur dix. En fait, je gagnais toujours de l'argent quand j'étais sûr d'avoir raison avant même de commencer. Ce qui me battit fut de ne pas avoir l’intelligence suffisante pour m'en tenir à mon propre jeu, c'est-à-dire de jouer sur le marché uniquement lorsque j'étais convaincu que les antécédents favorisaient mon jeu. Il y a un temps pour chaque chose, mais je l’ignorais. Et c'est précisément ce qui bat tant d'hommes à Wall Street qui sont pourtant très loin d’être mauvais.Il y a d’un côté, l'idiot ordinaire, qui opte toujours pour le mauvais choix, et de l’autre, il y a le fou de Wall Street, convaincu de devoir réaliser des transactions tout le temps. Mais en réalité, il y a très peu de raisons qui justifieraient qu’un homme doive acheter ou vendre des actions quotidiennement, d’autant plus qu’il est peu probable qu’il détienne une connaissance suffisante pour faire de son jeu un jeu intelligent.
Je l'avais prouvé. Chaque fois que je lisais la bande en me basant sur mon expérience, je gagnais de l'argent, mais dès lors que j’adoptais un jeu stupide, je perdais. Après tout, je n’étais pas une exception, n'est-ce pas ? Il y avait l'énorme tableau de cotation qui me toisait, en face, le téléscripteur en marche, et les gens qui réalisaient leurs transactions et regardaient leurs tickets se transformer en argent ou en papier gaspillé. Bien sûr, je laissai le besoin d'excitation prendre le dessus sur mon jugement. Dans un bucket shop où votre marge ne tient qu’à un fil, vous ne jouez pas longtemps. Vous êtes contraint d’abandonner trop facilement et rapidement. Le désir d'action constante ne tenant pas compte des conditions sous-jacentes est responsable de nombreuses pertes à Wall Street, et ce, même parmi les professionnels, qui ont l’impression de devoir ramener un peu d'argent à la maison tous les jours, comme s'ils travaillaient pour un salaire ordinaire. Je n'étais qu'un enfant, rappelez-vous. (J’ignorais à l’époque ce que j'appris après, ce qui me fit, quinze ans plus tard, attendre deux longues semaines et voir une action sur laquelle j'étais très optimiste monter de trente points avant que je ne sente que c'était sûr de l'acheter. J'étais fauché et j'essayais de me refaire, par conséquent, je ne pouvais pas me permettre de jouer de manière imprudente. Je devais avoir raison, et pour cela j’attendais donc). C'était en 1915. Il s’agit d’une longue histoire. Je la raconterai plus tard lorsque le moment viendra. Passons maintenant à l'étape où, après des années d'entraînement à les battre, je laissai les bucket shops me dépouiller de la plupart de mes gains.
Avec mes yeux grands ouverts, qui plus est ! Et ce n'était pas non plus la seule période de ma vie où je le fis. Un opérateur en bourse doit combattre beaucoup d'ennemis coûteux en son sein. Quoi qu'il en soit, j’étais venu à New York avec 2500 dollars. Ici, il n'y avait pas de bucket shops à qui on pouvait faire confiance. La Bourse et la police ensemble avaient réussi à les fermer hermétiquement. De plus, je voulais trouver un endroit où la seule limite imposée à mes transactions serait la taille de ma mise. Certes, elle n’était pas très grande, mais j’étais certain qu’elle ne demeurerait pas ainsi pour toujours. Le plus important au départ était de trouver un endroit où je n'aurais pas à m'inquiéter d'obtenir une affaire honnête. Donc je me rendis à un établissement de la bourse de New York qui avait une filiale chez moi où je connaissais certains des employés. Depuis le temps, ils avaient fait faillite. Je n'y restai pas longtemps, et pour cause, je n'aimais pas l'un des partenaires, ce qui me fait d’ailleurs aller ensuite chez A. R. Fullerton & Co. Quelqu'un avait dû leur parler de mes premières expériences, car il ne leur fallut pas longtemps avant qu'ils ne se mettent tous à m'appeler « The Boy trader ». Certes, j'avais toujours eu l'air jeune. C'était un handicap à certains égards,
mais cela m'avait obligé à me battre pour ce qui était à moi car beaucoup avaient essayé de profiter de ma jeunesse. Les gens des bucket shops, voyant quelle sorte de gamin j'étais, avaient toujours pensé que j'étais un imbécile qui avait de la chance et c'était, à leurs yeux, la seule raison pour laquelle je les battais si souvent.
Eh bien ce n’était plus le cas, et ce, encore six mois avant que je ne sois fauché. J'étais un trader plutôt actif et j'avais une sorte de réputation de gagnant. Je suppose que mes commissions s'élevaient à une certaine somme. Je fis fructifier mon compte un peu, mais, sans surprise à la fin, je perdis. Je jouais prudemment, mais j’étais contraint de perdre. La raison en était simple : c'était dû à mon remarquable succès dans les bucket shops !
Mon système ne me permettait de battre le jeu que dans un bucket shop, où je pariais sur les fluctuations. Ma lecture des bandes était exclusivement liée à cela. Quand j'achetais, le prix était là, sur le tableau des cotations, juste en face de moi. Avant même d'acheter, je connaissais exactement le prix que j'allais devoir payer pour mes actions. Et je pouvais toujours vendre sur le champ. Je pouvais m’en tirer avec succès, car j’étais aussi rapide que l’éclair. (Je pouvais faire confiance à ma chance ou couper court à ma perte en une fraction de seconde). Il arrivait que, parfois, par exemple, j'étais certain qu'une action allait bouger d'au moins un point. Eh bien, je n'avais pas à la monopoliser, je pouvais prendre un point de marge et doubler mon argent en un clin d'œil ; ou bien je prenais un demi-point. Sur un total d’une ou deux centaines d'actions par jour, cela ne s’avérait pas si mal à la fin du mois, n’est-ce pas ?
Le problème pratique avec ce système était, évidemment, que même si les bucket shops avaient les ressources suffisantes pour amortir une grosse perte régulière, ils ne le feraient pas. Ils n'auraient pas un client sur place qui aurait le mauvais goût de gagner tout le temps.
En tout cas, ce qui s’avérait être un système parfait pour les opérations dans les bucket shops ne fonctionna pas dans le bureau de Fullerton. Là-bas, j'étais réellement en train d’acheter et de vendre des actions. Le prix du Sugar sur la bande pouvait être de 105 que je pouvais déjà voir une baisse de trois points arriver. En réalité, au moment même où le téléscripteur affichait 105 sur la bande, le prix réel de la Bourse pouvait être de 104 ou 103. Entre cet instant et le moment où mon ordre de vente de mille actions est exécuté par l’employé de Fullerton, le prix pouvait être encore plus bas. J’étais dans l’impossibilité de savoir à quel prix j'avais vendu mes mille actions avant de recevoir un rapport du greffier. Alors que j'aurais sûrement amassé trois mille dollars sur la même transaction dans un bucket shop, je pouvais ne pas gagner un centime dans un établissement boursier. Évidemment, j'ai pris un cas extrême, mais le fait est que dans le bureau d'A.R. Fullerton, la bande me parlait toujours d'histoire ancienne, aussi lointaine que mon système puisse remonter, et je ne m'en rendais pas compte.
Et puis, il faut aussi noter que, si mon ordre était suffisamment important, alors, ma propre vente aurait tendance à faire encore plus baisser le prix. Dans le bucket shop, je n'avais pas besoin de réfléchir aux conséquences de mes propres transactions. J'avais perdu à New York parce que le jeu était tout à fait différent. Ce n'est pas tant le fait que je jouais désormais honnêtement qui me fit perdre, mais plutôt le fait que je le jouais par ignorance. On me disait souvent que j’étais un bon lecteur de bande. Mais être expert en lecture de la bande ne me sauva pas. J'aurais pu m'en sortir beaucoup mieux si j'avais été moi-même sur le parquet, un négociant de chambre. Dans une foule particulière, peut-être aurais-je pu adapter mon système aux conditions qui se présentaient à moi. Mais, bien sûr, si j'en étais arrivé à opérer à un tel niveau, par exemple, le système m'aurait fait défaut de manière équivalente, compte tenu de l'effet de mes propres transactions sur les prix.
En bref, je ne connaissais pas réellement le jeu de la spéculation boursière. J'en connaissais une partie, certes assez importante, qui m'avait été très utile en permanence. Mais si moi, avec tout ce que je connaissais déjà, je perdais quand même, quelle chance avait l'outsider de gagner, ou même, d’encaisser un quelconque gain ?
Il ne me fallut pas longtemps pour me rendre compte que quelque chose n'allait pas dans mon jeu, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Il y avait des moments où mon système fonctionnait à merveille, et puis, tout d’un coup, j’enchaînais les échecs les uns après les autres. Je n'avais que 22 ans, rappelez-vous ; non pas que mon orgueil m’empêchait de reconnaitre ma faute, mais c’est juste qu'à cet âge, personne ne sait grand-chose.
Les gens du bureau étaient très gentils avec moi. Je ne pouvais pas plonger comme je le souhaitais à cause de leurs exigences de marge, mais le vieil A.R. Fullerton et le reste de l'entreprise étaient si gentils avec moi qu'après six mois de transactions actives, j'avais non seulement perdu tout ce que j'avais apporté avec moi et tout ce que j'avais gagné, mais j'avais même récolté des dettes de quelques centaines de dollars envers la société.
Me voilà, un simple enfant, qui n'avait jamais quitté sa maison, complètement fauché ; mais je savais que rien ne clochait avec moi ; seulement avec mon jeu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je ne perds jamais mon sang-froid à cause de la bourse. Je ne me dispute jamais avec la bande. Se fâcher contre le marché ne vous mène nulle part.
J'étais si pressé de reprendre les transactions que je ne perdis pas une minute pour aller voir le vieux Fullerton et lui dis : « Dites, A.R., prêtez-moi cinq cents dollars ».
« Pour quoi faire ? demanda-t-il.
- Il me faut de l'argent.
- Pour quoi faire ? répéta-t-il.
- Pour la marge, bien sûr, ai-je dit.
- Cinq cents dollars ? » dit-il, en fronçant les sourcils. « Tu sais qu'ils attendent de toi que tu gardes une marge de 10 %, ce qui signifie mille dollars sur cent actions. Il vaut mieux te donner un crédit…
- Non », le coupai-je, « Je ne veux pas de crédit ici. Je dois déjà quelque chose à la société. Ce que je veux, c'est que vous me prêtiez cinq cents dollars pour que je puisse me remettre en marche et revenir. »
« Comment comptes-tu t'y prendre ? demanda le vieux A. R.
- Je vais aller faire quelques transactions dans un bucket shop, lui répondis-je.
- Fais-le ici, dit-il.
- Non », répondis-je. « Je ne suis pas encore sûr de pouvoir battre le jeu dans ce bureau, mais je suis sûr de pouvoir soutirer de l'argent des bucket shops. Je suis familier avec ce jeu. J'ai des notions que je maitrise et qui justement ne s’appliquent pas ici. »
Il me laissa faire, et je sortis du bureau d’où le « Boy Terror » des bucket shops, comme ils m'appelaient, avait perdu tout ce qu’il possédait. Je ne pouvais pas retourner chez moi car les bucket shops ne voudraient pas avoir affaire à moi. New York était hors de question ; il n'y en avait aucun qui faisait des affaires à cette époque. Ils me disaient que dans les années 90, Broad Street et New Street en étaient remplis. Mais bizarrement, il n’y en avait aucun quand j'en avais justement besoin. Alors après avoir mûrement réfléchi, je décidai d'aller à St Louis. J'avais entendu parler de deux entreprises là-bas qui faisaient d'énormes affaires dans tout le Midwest. Leurs profits devaient probablement être énormes. Ils possédaient des filiales dans des dizaines de villes. En fait, on m'avait même dit qu'il n'y avait pas de concurrent dans la région capable de se comparer à eux en termes de volume d'affaires. Ils fonctionnaient ouvertement et les meilleurs joueurs y faisaient des transactions sans aucun scrupule. Un type m'avait même dit que le propriétaire d'une des filiales était un vice-président de la Chambre de Commerce, mais cela ne pouvait pas être à St. Louis. Quoi qu'il en soit, c'était là que je me rendais, muni de mes cinq cents dollars dans l’espoir de ramener un petit pactole à utiliser comme marge dans le bureau d’A.R. Fullerton & Co., membres de la bourse de New York.
Quand j’arrivai à St. Louis, j’allais à l'hôtel, me lavai et sortis à la recherche des bucket shops. L'un était la J. G. Dolan Company, et l'autrele H. S. Teller & Co. Je savais que je pouvais les battre. J'allais jouertrès prudemment, avec soin et de façon conservatrice. Ma seule crainte était que quelqu'unpuisse me reconnaître et me dénoncer, parce que les bucket shops de tout le paysavaient eu vent du Boy Trader. Tout comme des maisons de jeu, ils obtiennent tous les ragots circulant dans le milieu.
Dolan était plus proche que Teller, c’est pourquoi j'y allai en premier. J'espérais être autorisé à y faire des transactions pendant quelques jours avant qu'ils ne me disent d’aller ailleurs. Je pénétrai le lieu. C'était un endroit énorme et il devait y avoir pas moins de deux cents personnes qui fixaient les cotations. J'étais ravi, parce que dans une telle foule j'avais plus de chances de passer inaperçu. Je restai debout à fixer le tableau jusqu'à ce que je choisisse l'action pour mon opération initiale.
Je regardai autour de moi et vis l’employé chargé des ordres au guichet où l’on était supposé déposer notre argent et obtenir notre ticket. Il me regardait, alors je m’approchai et lui demandai : « C'est ici que vous négociez le coton et le blé ? »
« Oui, fiston, me dit-il.
- Puis-je acheter aussi des actions ?
- Tu peux si tu as de l'argent, répondit-il.
- Oh, j'ai tout ce qu'il faut, ne t’inquiète pas, dis-je en fanfaronnant.
- Tout ce qu’il faut, n'est-ce pas ? dit-il en souriant.
- Combien d'actions puis-je acheter pour cent dollars ? demandai-je, agacé.
- Cent ; si vous avez les cent.
- J'ai les cent. Oui ; et deux cents même ! lui dis-je.
- Oh, mon Dieu ! s’exclama-t-il.
- Vous n'avez qu'à m'acheter deux cents actions, répliquai-je sèchement.
- Deux cents quoi ? » demanda-t-il, sérieux à présent. C'étaient les affaires.
Je regardai à nouveau le tableau comme pour deviner sagement et lui dis : « Deux cents Omaha.
- Très bien ! dit-il. Il prit mon argent, le compta et écrivit le ticket.
- Quel est votre nom ? » me demanda-t-il, et je répondis : « Horace Kent ».
Il me donna le ticket et je partis m'asseoir parmi les clients pour attendre que le rouleau grossisse. J’eus rapidement de l’action et échangeai plusieurs fois ce jour-là. Le jour suivant aussi. En deux jours, je gagnai deux mille huit cents dollars, et j'espérais qu'ils me laisseraient finir la semaine. Au rythme où j'allais, ce ne serait pas si mal. Ensuite je m'attaquerais à l'autre
bucket shop, et si je bénéficiais de la même chance là-bas, je retournerais à New York muni d’une liasse de billets avec laquelle je pourrais faire quelque chose.
Le matin du troisième jour, en allant au guichet timidement, pour acheter cinq cents B.R.T., l’employé me dit : « Dites, M. Kent, le patron veut vous voir. »
Je savais que le jeu était fini. Mais je lui demandai quand même : « Il veut me voir à propos de quoi ? »
« Je ne sais pas.
- Où est-il ?
- Dans son bureau privé. Allez par-là. » Et il me montra une porte.
J’entrai dans la pièce. Dolan était assis à son bureau. Il se retourna et me dit : « Assieds-toi, Livingston. »
Il m'indiqua une chaise. Mon dernier espoir s’envola. J’ignorais comment il avait découvert qui j'étais, peut-être en consultant le registre de l'hôtel.
« Pourquoi voulez-vous me voir ? l’interrogeais-je.
- Écoute, gamin. Je n'ai rien contre toi, tu vois ? Rien du tout. Tu vois ?
- Non, je ne vois pas, dis-je.
Il se leva de sa chaise pivotante. C'était un grand gaillard. Il me dit : « Viens par ici, Livingston, veux-tu bien ? » et il se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit et désigna les clients dans la grande salle.
« Tu les vois ? me demanda-t-il.
- Voir quoi ?
- Ces gars-là. Regarde-les, petit. Il y en a trois cents ! Trois cents pigeons ! Ils nous nourrissent, ma famille et moi. Tu vois ? Trois cents pigeons ! Et puis toi, tu arrives, et en deux jours tu ramasses plus que ce que je ne reçois des trois cents autres en deux semaines. Ce n’est pas du business, gamin, pas pour moi ! Je n'ai rien contre toi. Tu es le bienvenu avec ce que tu as. Mais plus maintenant. Il n'y a plus rien ici pour toi !
- Pourquoi, je…
- C’est tout. Je t’ai vu arriver avant-hier et je n'ai pas aimé ton air. C'est vrai, je l’avoue, je ne l’ai pas aimé. J’ai tout de suite senti l’imposteur. J'ai appelé cet abruti-là (il désignait le greffier coupable ) et lui ai demandé ce que tu avais fait, alors quand il m'a répondu, je lui ai dit : "Je n'aime pas l’allure de ce type. C'est un imposteur !" Et ce gros naïf m’a dit :"Imposteur, mon œil, patron ! Il s'appelle Horace Kent, et c'est un gamin de la rue qui joue l’adulte. Tout va bien ! " Alors, je l'ai laissé faire ce qu'il voulait. Ce fichu employé m'a coûté deux mille huit cents dollars. Je ne t’en veux pas, mon garçon. Mais le coffre est désormais fermé pour toi.
- Écoutez..., commençai-je.
- C’est toi qui vas m’écouter, Livingston, dit-il. J'ai entendu parler de toi. Je gagne ma vie en truquant les paris des pigeons, et toi, tu n'as rien à faire ici. J'ai l'intention d'être fairplay donc je te laisse la liberté de repartir avec ce que tu nous as volé. Mais te laisser plus que ça ferait de moi un idiot, maintenant que je sais qui tu es. Alors hors de ma vue, fiston ! »
Je quittai l’établissement de Dolan avec mes deux mille huit cents dollars de profits. Celui de Teller était dans le même pâté de maisons. J'avais découvert que Teller était un homme très riche qui gérait aussi beaucoup de salles de billard. Je décidai de me rendre au bucket shop. Je me demandais s'il serait plus sage de commencer modérément et de grimper jusqu'à mille actions ou plutôt de commencer par un gros coup, en partant du principe que je ne pourrai peut-être pas échanger plus d'un jour. Les gens deviennent très vite sages lorsqu'ils sont en train de perdre et je voulais acheter mille actions B.R.T. J’étais sûr de pouvoir en tirer quatre ou cinq points. Mais s'ils avaient des soupçons ou si trop de clients se positionnaient sur cette même action, ils pourraient ne pas me laisser opérer du tout. Je décidai donc qu’il valait peut-être mieux disperser mes transactions au début et commencer petit.
L’endroit n’était pas aussi grand que chez Dolan, mais les installations étaient plus belles et le public était manifestement de meilleure qualité. Cela me convenait parfaitement et je décidai donc d'acheter mes mille B.R.T. Je m’approchai alors du guichet approprié et dis à l’employé : « Je voudrais acheter des B.R.T. quelle est la limite ?
- Il n'y a pas de limite, répondit-il. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, si vous avez l'argent suffisant.
- Achetez mille cinq cents actions, dis-je en sortant ma liasse de ma poche pendant que l’employé commençait à rédiger le ticket.
C'est alors que je vis un petit homme roux pousser l’employé hors du comptoir. Il se pencha et me dit : « Écoute, Livingston, retourne chez Dolan. On ne veut pas de tes affaires.
- Attendez au moins que j'obtienne mon ticket, dis-je. Je viens d'acheter un petit B.R.T.
- Tu n'auras pas de ticket ici », répliqua-t-il. Entre-temps, d'autres employés s’étaient rassemblés derrière lui et me regardaient. « Ne reviens plus jamais ici pour faire tes transactions. Nous ne les accepterons pas. Compris ? »
Cela ne servait à rien de s'énerver ou d'essayer d'argumenter, alors je retournai à l'hôtel, payai ma note et pris le premier train pour New York. C'était dur. Je voulais récupérer un vrai pactole, mais ce Teller ne me laissait même pas faire une seule transaction.
Je revins à New York, remboursai à Fullerton ses cinq cents dollars, et commençai à échanger de nouveau avec l'argent de St. Louis. J'eus de bonnes et de mauvaises périodes, néanmoins je m’en sortais quand même avec un certain profit. Après tout, je n'avais pas grand-chose à oublier de mon apprentissage ; seulement à saisir le fait qu'il y avait bien plus de choses qui entraient dans le jeu de la spéculation boursière que ce que j'avais envisagé avant d'aller au bureau de Fullerton. Je ressemblais à l’un de ces amateurs de puzzle, faisant les mots croisés dans le supplément du dimanche. Il n'est pas satisfait tant qu'il ne l’a pas résolu. Eh bien, je voulais certainement trouver la solution à mon puzzle. Je pensais en avoir fini avec les transactions dans les bucket shops. Mais je me trompais.
Environ deux mois après mon retour à New York, un vieux type vint dans le bureau de Fullerton. Il connaissait A.R. On disait qu’il possédait dans le temps une série de chevaux de course. Il était clair qu'il avait connu de meilleurs jours. Je fus présenté au vieux McDevitt. Il racontait à la foule qu’une bande d'escrocs des champs de courses de l'Ouest venait tout juste de réussir un coup de maître à St. Louis. Le diable en chef, dit-il, était un propriétaire de salle de billard du nom de Teller.
« Quel Teller ? lui demandai-je.
- H.S. Teller.
- Je connais ce gars, dis-je.
- Il est mauvais, dit McDevitt.
- Il est bien pire que ça », dis-je, « Et j'ai d’ailleurs une petite affaire à régler avec lui.
- C'est-à-dire ?
- La seule façon qui me permette d’atteindre n'importe lequel des mauvais joueurs, c’est à travers leur porte-monnaie. Je ne peux pas le toucher à St. Louis pour le moment, mais un jour j’y parviendrai » Et j’expliquai à McDevitt ce que je lui reprochais.
« Eh bien, dit le vieux Mac, il a essayé de se faire une place ici à New York, sans succès, alors il a ouvert un endroit à Hoboken. Le mot est passé qu'il n'y avait pas de limite au jeu et que comparé à la caisse de l’établissement, le Rock of Gibraltar semblait avoir l'ombre d'une petite puce.
- Quel genre d'endroit ? » Je pensais qu'il parlait d’une salle de billard.
- Un bucket shop, dit McDevitt.
- Vous êtes sûr que c'est ouvert ?
- Oui, j'ai croisé plusieurs gars qui m'en ont parlé.
- Ce ne sont que des ouï-dire, dis-je. Pouvez-vous vérifier avec certitude s'il est en marche, et aussi à quel point ils laissent réellement un homme échanger?
- Bien sûr, fiston, répondit McDevitt. J'irai moi-même demain matin et je reviendrai te le dire. »
C'est ce qu'il fit. Il semblerait que Teller faisait déjà de grosses affaires et qu'il voulait prendre tout ce qu'il pouvait obtenir. C'était le vendredi. Le marché avait été en hausse toute la semaine (à noter que c'était il y a vingt ans, rappelez-vous) et il y avait la certitude que le relevé bancaire du samedi montrerait une grande baisse de la réserve excédentaire. Cela servirait d'excuse conventionnelle aux grandes chambres de trading pour sauter sur le marché et essayer de secouer certains des faibles comptes des maisons de commission. Il y aurait les réactions habituelles qui interviennent généralement dans la dernière demi-heure de trading, en particulier pour les actions autour desquelles le public avait été le plus actif. Ces actions, bien sûr, seraient aussi celles sur lesquelles les clients de Teller seraient les plus actifs, et le bucket shop pourrait être heureux de voir des ventes à découvert sur ces titres. Il n'y a rien de plus agréable que de rouler les pigeons dans les deux sens, et rien de plus facile, avec des marges d'un point.
Ce samedi matin, je me rendis à Hoboken, chez Teller. Ils avaient aménagé une grande salle réservée aux clients dotée d’un épatant tableau de cotation et d’une équipe complète de commis et d’un policier spécial vêtu de gris. Il y avait environ vingt-cinq clients.
Je me mis à discuter avec le directeur. Il me demanda ce qu'il pouvait faire pour moi. Je lui répondis qu'il ne pouvait rien faire, qu'un homme pouvait gagner beaucoup plus d'argent compte tenu du hasard et que la liberté de parier toute votre liasse pouvait vous conduire à empocher des milliers de dollars en quelques minutes, au lieu d'acheter des petites miettes de stocks et d'avoir à attendre des jours, voire des semaines. Il commença à me dire à quel point le marché boursier était plus sûr, combien certains de leurs clients avaient gagné et comment n’importe qui pouvait être suffisamment satisfait s’il misait lourd, à tel point qu’on aurait juré qu’il s’agissait d’un courtier ordinaire qui achetait et vendait vos actions à la Bourse. Il devait sûrement penser que je me dirigeais vers une salle de billard et il voulait donc profiter de mon argent avant que les autres ne le grignotent, car il m’informa que je devais me dépêcher étant donné que le marché fermait à midi le samedi. Cela me permettrait de libérer mon après-midi et de le consacrer à d'autres occupations. Je pourrais même avoir un plus gros pactole à transporter avec moi, si je parvenais à choisir les bonnes actions.
Comme j’avais l'air de ne pas le croire, il continua à déblatérer. Je regardais l'horloge. À 11h15, je dis : « Très bien » puis je me mis à lui donner des ordres de vente sur différentes actions. Je lui tendis deux mille dollars en liquide qu’il fut très heureux de recevoir. Il me dit qu'il était convaincu que j'allais me faire beaucoup d'argent et espérait que je reviendrais souvent.
Tout se passa comme je l'avais prévu. Les traders se ruèrent vers les actions pour lesquelles ils pensaient qu'ils trouveraient le plus de stops, et, bien sûr, les prix dégringolèrent. Je parvins à clôturer mes transactions juste avant la ruée des cinq dernières minutes sur les couvertures habituelles des traders.
Finalement, cinq mille cent dollars me revenaient. J’allai donc les encaisser.
« Je suis ravi d'être passé », annonçai-je au gérant, en lui donnant mes tickets.
« Dites, me dit-il, je ne peux pas vous donner tout cela. Je ne m’attendais pas à une telle performance. J’aurai ton argent lundi matin, parole d’honneur.
- D'accord. Mais d'abord, je vais prendre tout ce que vous avez pour l’instant, dis-je.