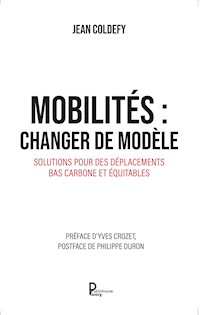
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Les mobilités sont l’un des premiers facteurs d’émissions de gaz à effet de serre en France. La crise des Gilets jaunes a cependant montré que décarboner les mobilités nécessite de prendre en compte les différences de situations. Quels sont les enjeux territoriaux et sociaux des mobilités ? Comment décarboner les déplacements de manière équitable ? Combien cela coûtera-t-il et qui paiera ? Comment compenser pour les plus fragiles ? Quels impacts sur la gouvernance publique ? Telles sont les questions auxquelles ce livre essaie de répondre en analysant précisément les enjeux et en déconstruisant les simplismes en vogue. Parvenir à une neutralité carbone est un challenge immense. Les solutions existent et nécessitent plus de cohésion sociale et territoriale. La crise climatique pourrait ainsi aider la société française à se retrouver un destin commun.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ingénieur de l’École centrale de Lille,
Jean Coldefy est directeur des programmes d’ATEC ITS France et conseiller du président de Transdev. Il a été adjoint du service mobilité urbaine de la métropole de Lyon après avoir été responsable d’activité sur les mobilités et l’innovation dans une société de conseil. Élu local pendant douze ans, il est membre du comité scientifique de France Mobilités et a participé à l’écriture de la loi d’orientation des mobilités. Il assiste des entreprises et des collectivités dans leurs projets de mobilité. Il intervient dans plusieurs écoles du supérieur et universités.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
PRÉFACE
Faut-il croire les décideurs publics français et européens quand ils affichent des engagements climatiques très ambitieux ? La question mérite d’être posée, à tout le moins dans le secteur des transports qui, depuis une vingtaine d’années, n’a pas atteint les objectifs fixés dans les livres blancs de l’Union européenne (2001, 2011) ou le Grenelle de l’environnement. Le report modal de la route vers le rail n’a pas eu lieu, sauf localement. L’inertie des organisations et les contraintes financières ont empêché le développement de l’offre de transport public, notamment ferroviaire. Les émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité n’ont pas diminué si on prend en compte le transport aérien.
Ce triple échec justifie que l’on s’interroge sur la crédibilité des politiques publiques. Cependant, comme il n’y a pas de doute sur la réalité du changement climatique et de ses effets, il est crucial de prendre au sérieux ces engagements. C’est ce que fait Jean Coldefy dans cet ouvrage en évitant la facilité des solutions faussement radicales, celles qui proposent de substituer la décroissance à la croissance, le « toujours moins » au « toujours plus », l’assignation à résidence à la libre circulation des biens et des personnes. De tels discours sont simplistes. Ils ne font qu’enjamber la difficulté : « il n’y a qu’à » changer les modes de vie et certains semblent rêver de dictature climatique, ce qui signifie un climat de dictature !
Or, nous vivons et souhaitons demeurer dans des sociétés démocratiques. Prendre au sérieux la nécessité de décarboner les transports suppose donc de bien comprendre le monde où nous vivons et les fondements des comportements individuels et sociaux. Les deux premiers chapitres rappellent l’avènement de l’abondance, qui a permis un accroissement des dépenses publiques plus rapide que le PIB. Les inégalités, sans disparaître, sont à un niveau historiquement bas conduisant à une large démocratisation de l’accès à l’automobile, à la propriété immobilière et plus récemment au transport aérien. Ce mouvement d’ensemble n’empêche pas la persistance de fortes disparités sociales et territoriales que les politiques publiques combattent… en encourageant les mobilités dans leur triple dimension : des déplacements plus faciles qui dilatent l’espace-temps des programmes d’activités. Même le télétravail, qui réduit les déplacements dans l’immédiat, se traduit à terme par un allongement de la distance domicile-travail et un effet rebond sous la forme de nouveaux couples activités-localisations.
Les modes de vie sont donc bien ancrés dans une logique du « toujours plus ». Comme elle n’est pas soutenable, comment changer de paradigme ? Le chapitre trois présente un florilège d’actions qui ont parfois une pertinence locale, mais ne constituent pas des solutions globales. Toutes sont implicitement fondées sur la croyance au principe de substitution. Au vu des médiocres résultats des vingt dernières années, on ne parle plus de report modal, mais on promeut l’usage du vélo, la ville du quart d’heure, la gratuité des transports collectifs, les zones à faibles émissions, la baisse des vitesses. Ces thèmes ne sont pas à rejeter, mais ils ne concernent qu’une très faible partie des déplacements, ce sont des outils de régulation propres aux centres des grandes villes où se réalisent moins de 3 % des distances parcourues et des émissions de gaz à effet de serre. Que faire pour le reste des territoires ?
Les trois derniers chapitres proposent des réponses à cette question en montrant tout d’abord la nécessité, mais aussi les limites du progrès technique que représentent l’électrification des automobiles et le recours à des carburants non fossiles. La croissance économique étant, non pas l’accroissement infini des volumes produits et consommés, mais la combinaison du progrès technique et des changements de structure, elle est nécessaire, mais sous une forme plus exigeante. D’abord parce que le progrès technique doit être orienté vers l’économie des moyens, ce qui disqualifie les leurres comme Hyperloop ou la démocratisation des voyages spatiaux. Ensuite parce que la transition énergétique va alourdir le processus productif. Le partage entre consommation et investissement va se faire au bénéfice de ce dernier. Corollaire de ce changement de structure, des financements plus importants doivent être orientés vers les transports collectifs et la production d’énergie renouvelable. La décarbonation des transports va donc peser sur le budget des ménages, par la fiscalité et la tarification. C’est aussi pour cela que la croissance économique est nécessaire. Le rationnement de la production n’est pas plus une solution que le rationnement des individus.
Le monde de la décarbonation sera, pour les mobilités, plus contraignant que celui qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui. L’acceptabilité des contraintes à venir sur le taux de remplissage et le report vers les autocars express ou le train demandera une évolution de la gouvernance et de la régulation des transports. Les autorités organisatrices de la mobilité doivent avoir un champ d’action étendu, qui ne se limitera pas à l’organisation de l’offre de transports publics. Ces derniers, notamment le ferroviaire, devront, grâce à l’ouverture à la concurrence, se faire à coût réduit, pour s’aligner sur ce qui est observé dans les pays voisins. Toutes ces transformations seront délicates, mais elles sont plus réalistes que de vouloir changer radicalement les modes de vie. C’est tout l’intérêt du travail de Jean Coldefy : substituer aux chimères du rationnement supposé heureux, la voie étroite de la montée en puissance progressive de contraintes acceptables sur les mobilités.
Yves CrozetProfesseur émérite à Sciences Po LyonLaboratoire Aménagement Économie Transports (LAET-CNRS)
INTRODUCTION
« Je suis pessimiste par l’intelligence, mais optimiste par la volonté. »
Antonio Gramsci
Avec la crise des Gilets jaunes et le réchauffement climatique, les mobilités sont devenues un enjeu politique majeur, ce qui n’était pas arrivé depuis des décennies. En effet, les infrastructures de transports, routières, ferroviaires, de transports en commun urbains ont longtemps été vues par les décideurs comme des objets d’intendance au service de politiques plus vastes, et notamment l’attractivité et le désenclavement des territoires. Il est certain que l’accès aux territoires et leur compétitivité dépendent en partie (mais en partie seulement) de l’efficacité du système de mobilité. Les mobilités sont fondamentales pour la vie des ménages et des entreprises. Sans mobilité efficace, le pays reviendrait en 1900 où l’on effectuait 4 km par jour en moyenne, contre 40 aujourd’hui (hors déplacement international). Les émeutes et manifestations de l’automne 2018 ainsi que les conférences pour le climat (COP21, COP26) nous rappellent que subsistent néanmoins de très fortes inégalités pour se déplacer. Les mobilités pèsent lourd dans le bilan carbone du pays : 30 % des émissions, dont 16 % pour la seule voiture. La mobilité concerne ainsi des enjeux cruciaux pour le pays : d’équité, de cohésion sociale et territoriale, d’environnement, économiques. Remettre du lien entre les territoires, développer l’économie, maintenir la température en dessous de 1,5 °C passera nécessairement par une adaptation de notre système de mobilité.
Ce livre est issu de trente ans d’expérience dans les mobilités, dans les mondes privé et public, en France et en Europe. Les échanges avec des universitaires de disciplines diverses m’ont permis de relire mon expérience et d’en tirer les enseignements en termes de bonnes et de moins bonnes pratiques. Il tente de donner les clés de lecture pour analyser les mobilités du quotidien, déconstruire des idées reçues et propose les solutions pour assurer les deux enjeux clés de la décennie qui s’ouvre : relier les territoires, les catégories professionnelles, les générations et décarboner les mobilités. Il s’adresse à tous ceux qui veulent comprendre et agir dans ce secteur passionnant parce qu’au cœur du fonctionnement de nos sociétés et porteurs d’enjeux cruciaux pour l’avenir.
Après un éclairage sur les déterminants de la mobilité et les intérêts à agir des acteurs du système de mobilité, nous ferons un historique et une présentation de la géographie des systèmes urbains en France. Le livre aborde ensuite les enjeux en matière de décarbonation et d’équité, en les détaillant territorialement. La troisième partie, en utilisant les grilles de lecture précédentes, permettra d’évaluer la pertinence des discours actuels sur la mobilité et ce qui apparaît souvent à tort comme des évidences. Les solutions techniques, économiques et d’aménagement répondant aux enjeux seront décrites. Cette partie intègre l’apport des outils numériques dans les mobilités, les coopérations entre acteurs publics et privés qu’elles supposent. L’hystérèse de la crise Covid sera également évoquée. Enfin nous terminerons sur les deux points essentiels que sont la question des financements et celle de la gouvernance territoriale.
La démarche suivie est celle d’un croisement de plusieurs disciplines et se veut toujours scientifique : partir du réel que des données et sources multiples permettent de décrire pour poser correctement les enjeux et problèmes, afin de proposer ensuite des solutions qui devraient, nous l’espérons, les résoudre. Au terme de ce livre, le lecteur devrait être en mesure de répondre à des questions simples mais essentielles comme celles-ci :
–En quoi les mobilités sont-elles concernées par le réchauffement climatique ?
–En quoi la crise des Gilets jaunes est-elle liée à la mobilité ?
–Qu’est-ce que l’étalement urbain, en quoi impacte-t-il la mobilité ?
–Y a-t-il une voie entre la fin du monde symbolisée par le réchauffement climatique et la fin du mois qu’incarnent les Gilets jaunes ?
–En quoi la voiture est-elle un problème ou une solution pour la mobilité ?
–Rendre les transports en commun gratuits va-t-il faire baisser l’usage de la voiture ?
–Le vélo n’est-il pas la solution pour réduire le trafic automobile ?
–Comment les technologies pourraient-elles nous aider à résoudre les problèmes de mobilité et d’émissions de GES, en particulier le véhicule électrique ?
–Après la crise du Covid, les mobilités seront-elles différentes ?
–Quelles sont les solutions permettant de réduire les émissions de la mobilité ? Combien cela coûtera-t-il et qui paiera ?
Comprendre pour agir est aujourd’hui fondamental parce que l’horloge climatique tourne et que la décarbonation de nos économies, ce changement majeur de notre histoire récente, va mettre en tension notre société, déjà fragmentée. Les bonnes intentions ne suffisent pas, l’enfer en est pavé. Il faut ainsi, comme le définissait Max Weber, sortir d’une éthique de conviction – qui omet d’évaluer l’efficacité et les conséquences de ses décisions – pour passer à l’éthique de responsabilité – qui au contraire évalue l’impact des options avant de prendre une décision. Michel Rocard l’exprimait autrement quand il disait que « faire de la politique, c’est prendre des décisions après avoir écouté les experts et les scientifiques ». Alors que les collapsologues prospèrent dans une société française profondément pessimiste, que les médias et les réseaux sociaux simplifient à outrance les problèmes, des voies existent pour adapter notre système de mobilité aux enjeux du XXIe siècle : relier les territoires et réduire fortement d’ici moins de dix ans nos émissions de CO2. Cela impose une démarche rigoureuse qui parte du réel, propose des solutions efficientes (c’est-à-dire qui fonctionnent en mobilisant au minimum nos ressources) et que le corps social soit en mesure d’accepter. Elles exigeront une adaptation collective de certaines de nos habitudes et de nos modes actuels de raisonnement. Opposer la décision politique à la rationalité technique est une impasse et a peu de sens dans une société démocratique : le personnel politique, s’il peut exprimer une vision et une ambition, se fait aussi l’écho des souhaits de la population. Si des choix sont techniquement souhaitables, ils doivent aussi être politiquement réalisables. Il est aisé de se cantonner dans une approche technique pour ne pas dire technocratique, en laissant au politique la charge de la mise en œuvre. Armand Jean du Plessis de Richelieu, dit le cardinal de Richelieu, écrivait ainsi que « la politique est l’art de rendre possible le nécessaire ». Si les objectifs sont clairs, c’est le chemin qui est compliqué, entre les injonctions des militants environnementaux et les demandes des citoyens dans toute leur diversité, entre Greta Thunberg et les Gilets jaunes. Construire ce chemin et ces solutions n’est cependant pas hors de portée d’un pays comme la France. Ce livre se veut ainsi résolument réaliste et optimiste à la fois, confiant dans la capacité des générations à relever le gant du réchauffement climatique et à construire une société plus rassemblée.
1COMPRENDRE LES MOBILITÉS :LES PRINCIPALES CLÉS DE LECTURE
Un monde d’abondance
Nous vivons dans un monde d’abondance comme l’humanité n’en a jamais connu. Les progrès réalisés depuis deux siècles sont considérables. En France, en 1750, la moitié des enfants mouraient avant l’âge de 10 ans et l’espérance de vie ne dépassait pas 25 ans. En 1801, elle passe à 37 ans, atteint 45 ans en 1900, 62 ans en 1945 (la question de la retraite se posait en d’autres termes qu’aujourd’hui) et 82 ans en 2017 : un quasi-doublement en un siècle. Le taux de mortalité infantile était de 145 pour mille en 1900, de 77 en 1945 et de 3,7 en 2016. Par comparaison, l’espérance de vie actuelle de la plupart des pays africains et asiatiques est de 60 ans, et le taux de mortalité infantile des pays les plus pauvres va de 95 (Angola) à 70 pour mille (Afghanistan). Ainsi la mort a quasiment été évacuée de notre quotidien avec une espérance de vie multipliée par trois en deux siècles et une mortalité infantile divisée par quarante. Cela peut expliquer sans doute la sidération qui fut la nôtre quand la crise Covid nous a touchés : la mort faisait de nouveau irruption de manière massive en touchant des êtres en bonne santé et nos aînés ne sont plus là pour nous rappeler ce que fut leur quotidien durant la première moitié du XXe siècle.
Figure 1 : Évolution de l’espérance de vie en France de 1700 à 2020 – Source Insee et INED, J. Coldefy.Les périodes de guerres ou de pandémies ne sont pas représentées.
La France est aujourd’hui l’un des pays où le taux de pauvreté et de persistance dans la pauvreté sont parmi les plus faibles au monde. En 1987, le rapport Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde, sur la base des revenus monétaires nécessaires pour assurer l’essentiel, chiffrait à 4,5 % de la population les personnes en précarité. Au niveau mondial, moins de 10 % de la population vit aujourd’hui dans la pauvreté extrême (seuil de 2 $/jour), c’était 85 % en 1820, 40 % en 1980 (source Banque mondiale). Depuis 1990, 1,2 milliard d’humains sont sortis de l’extrême pauvreté, essentiellement en Inde et en Chine.
Ces progrès sont les fruits de la croissance économique qui a émergé d’abord au Royaume-Uni au XVIIIe siècle puis s’est étendue à l’ensemble de l’Europe, aux USA avant de toucher les pays d’Asie et d’Amérique du Sud et bien sûr la Chine. L’économiste et historien Angus Maddison a reconstitué les évolutions du PIB sur des séries temporelles longues. Le PIB par habitant est resté similaire de l’an zéro à l’an mille, pour croître de 50 % jusqu’en 1800. C’est alors que le décollage a eu lieu. Ainsi en France entre 1800 et 2020, le PIB a été multiplié par plus de 75 et plus de 30 ramené à l’habitant.
Figure 2 : Évolution du PIB par habitant pour la France de 1800 à 2020 – Jean Coldefy, données CGEDD, 2021.
Les générations nées après 1945 n’ont pas connu pour l’essentiel la grande précarité ni la mortalité massive. Le recul à avoir sur notre époque exceptionnelle est ainsi nécessaire parce qu’elle induit un changement de paradigme : dans un monde d’abondance, la ressource rare n’est plus le revenu, c’est le temps.
Cette dimension est fondamentale pour comprendre les mobilités. On ne raisonne pas de la même façon quand son revenu alimentaire est assuré et que l’on est sorti de la précarité. Ainsi en termes de revenus, en euros constants, le salaire moyen a été multiplié par près de quatre depuis 1950. Le pouvoir d’achat s’est constamment amélioré jusqu’à la crise de 2008 (il stagne depuis pour toutes les classes de revenus selon l’Insee), et la consommation a suivi la même évolution. Le montant annuel de consommation par personne est aujourd’hui quatre fois plus élevé qu’en 1960. Le sociologue Jean Viard a raison de souligner que nous disposons de bien plus de temps en dehors du travail. Il note ainsi qu’en 1900, compte tenu de l’espérance de vie et du temps de sommeil, d’études et de travail, il restait à chacun 100 000 heures disponibles. En 2000, ce chiffre a été multiplié par quatre pour atteindre 400 000 heures. C’est bien parce que nous avons accompli de prodigieux gains de productivité que nos revenus se sont accrus, et que nous avons pu consacrer une part de ces gains à libérer du temps. C’est la croissance de la productivité qui a permis de baisser le temps consacré au travail et de l’augmenter pour les études et les loisirs.
Figure 3 : Évolution du revenu disponible brut et de la consommation finale des ménages entre 1960 et 2020. Données Insee, J. Coldefy.
Le revenu disponible brut des ménages comprend les revenus d’activité et les revenus du patrimoine, augmentés des prestations sociales, diminués des impôts et cotisations sociales versées. Les chiffres sont corrigés de l’inflation.
La préférence pour la vitesse, à la recherche du temps perdu
Dans un tel contexte, on comprend mieux le goût pour la vitesse : si la ressource rare est le temps, nous allons tout faire pour ne pas en perdre, car quel que soit le revenu, une journée fera toujours vingt-quatre heures. C’est ainsi que la vitesse de déplacement s’est accrue très fortement, quasiment autant que le PIB par habitant depuis un siècle. En 1900, alors que le moyen quotidien de déplacement de l’immense majorité des Français était la marche, nous parcourions 4 km par jour, une heure de marche. Un siècle plus tard, avec l’avènement de la voiture et sa démocratisation, nous faisons en moyenne 40 km en une journée, toujours pour la même durée moyenne : une vitesse multipliée par dix, comme le PIB par habitant. Depuis 2000, cette distance est stable parce que les gains de vitesse ne progressent plus, sauf pour les déplacements internationaux : là aussi c’est la démocratisation de l’avion, avec les compagnies low cost, qui a fait décoller l’usage avec des distances qui sont passées de 100 km par habitant par an en 1960 à 2 500 en 2019.
L’histoire de la mobilité, depuis toujours, est celle de la vitesse et des moyens pour s’en affranchir. Avant la révolution industrielle et le développement de la machine à vapeur puis des moteurs à explosion, il y avait une véritable « tyrannie de la distance » pour reprendre l’expression de Paul Bairoch dans son histoire des villes. En effet déplacer des marchandises prenait du temps et donc nécessitait des vivres à transporter. La capacité d’emport étant limitée par la force physique de l’homme ou de l’animal, les distances l’étaient forcément aussi. Les progrès techniques vont faire voler en éclats cette loi d’airain : avec l’accroissement des vitesses de déplacement, c’est la possibilité de s’approvisionner ou de vendre plus loin qui est offerte aux hommes. Les chemins de fer d’abord, puis la voiture pour les distances de moyenne portée, les bateaux et l’avion pour la longue portée vont être le moyen d’accroître les possibilités d’échanges entre des territoires qui étaient auparavant obligés de ne compter que sur eux-mêmes pour survivre. Des agriculteurs, des commerçants, des industriels puis des touristes vont ainsi avoir accès à des populations et territoires bien plus importants que ce que la marche ou le cheval leur permettaient. L’innovation dans les transports fut l’une des courroies de transmission de l’accroissement des revenus et a permis la résilience des territoires avec l’approvisionnement des populations même en cas de mauvaises récoltes : la fin du XIXe siècle marque celle des famines en France.
L’histoire de la vitesse est celle du remplacement de modes lents par des modes plus rapides avec en particulier la voiture qui se généralise au XXe siècle. En 1950, posséder une voiture était un luxe. Le fordisme, qui standardise la production et fait baisser les coûts, la croissance économique qui fait croître fortement le pouvoir d’achat, permettent une diffusion large d’un outil individuel, rapide, et flexible compte tenu du nombre de kilomètres de routes. Le parc automobile français passe de 2 millions de voitures en 1950 à 36 millions fin 2019. En 1960, 25 % des ménages possèdent une voiture, 85 % en 2019. La hausse des revenus et la concurrence vont faire baisser la part du budget consacré à l’automobile qui est devenu un bien normal. Elle n’est plus pour la majeure partie de la population un produit de luxe relevant du statut, mais un outil indispensable relevant des dépenses contraintes.
Cet accroissement et la démocratisation de la vitesse ont pour conséquence principale de multiplier les opportunités pour les individus et les entreprises et d’intensifier et diversifier très fortement les programmes d’activités. Cela se traduit par une sécurité économique plus forte, la hausse des niveaux de vie, et donc des kilomètres parcourus et en conséquence des gaz à effet de serre. Voilà pourquoi moins on est pauvre, plus on émet de gaz à effet de serre : il ne s’agit pas d’une caste de privilégiés, mais tout simplement de populations qui sont sorties de la survie grâce aux progrès techniques et au développement économique qu’ils ont induit. La propagation du processus à de nouveaux pays, notamment les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et d’autres, a permis de sortir du dénuement extrême de centaines de millions de personnes. C’est une bonne nouvelle dans la lutte contre la pauvreté. Ce n’en est pas une pour le climat.
La courbe qui suit illustre pour les États-Unis l’impact de l’accroissement des vitesses : c’est une échelle logarithmique qui indique sur la courbe en noir le nombre total de kilomètres parcourus par habitant par jour, 4 km en 1900, 70 km en 2000 et en couleurs les kilomètres parcourus pour chaque mode. On voit très clairement le remplacement des modes lents par des modes rapides, le décollage de la voiture et plus tard de l’avion compte tenu de la superficie du pays.
Figure 4 : Évolution des distances parcourues par habitant par jour, J. H. Ausubel, C. Marchetti, P. S. Meyer, 1998, « Toward green mobility : the evolution of transport, European Review ».
En France, les travaux du chercheur Aurélien Bigo ont permis de reconstituer depuis 1960 des séries similaires. Nous y avons adjoint le PIB pour montrer la corrélation forte entre PIB et distances parcourues, corrélation qui s’est atténuée depuis avec la fin des gains de vitesse pour les distances nationales, mais qui perdure pour les longues distances avec la démocratisation et donc le développement de l’avion. Chaque Français en moyenne réalise ainsi 47 km par jour, dont 7 en avion international (2 500 km/an).
Figure 5 : Évolution des distances parcourues par habitant par an en France (échelle de gauche), et du PIB par habitant par an (échelle de droite). Données : Aurélien Bigo et Insee. Jean Coldefy.
Figure 6 : Évolution des parts modales kilométriques en France 1960-2018, Aurélien Bigo.La part modale représente la répartition des déplacements selon les modes de transports. Elle est souvent exprimée en nombre de déplacements et plus rarement en kilomètres. Lecture : la voiture représentait 63 % des kilomètres parcourus en 1960, 80 % en 2018. Échelle de gauche pour tous les modes sauf la voiture qui est sur l’échelle de droite.
L’usage répandu est d’analyser les mobilités en termes de parts modales, c’est-à-dire en termes de nombre de déplacements. Or cette notion, si elle rend compte en partie de l’occupation de l’espace public en ville, n’est pas adaptée quand on parle d’émissions de gaz à effet de serre ou de finances : c’est en voyageur.kilomètre qu’il faut alors raisonner, puisque les parts modales en nombre de déplacements mettent sur le même plan le déplacement de 300 m pour acheter son pain avec celui de 30 km pour aller travailler. Sur Paris la part modale kilométrique de la voiture n’est que de 10 % contre 25 % en nombre de déplacements ; les transports en commun représentent 61 % des kilomètres, mais 32 % des déplacements.
La répartition des kilomètres parcourus entre les différents modes de transport par l’ensemble des Français depuis 1960 suit une évolution similaire à celle constatée aux États-Unis : les modes rapides remplacent les modes lents. Cette prédominance de la voiture s’explique aisément : c’est un mode rapide, individuel, qui permet donc de partir quand on le souhaite et de rejoindre quasiment tout point du territoire. Autant d’avantages déterminants dans une société où c’est le temps qui prime. Pourtant, si la voiture est un fantastique outil pour se déplacer, sans dépendre de personne, pourquoi est-elle autant décriée aujourd’hui ?
La grille d’analyse des économistes / Les ressources rares et les intérêts à agir des acteurs
Répondre à la question de la place de la voiture conduit pour les économistes à analyser la mobilité au travers des acteurs du système, de leurs objectifs et des ressources rares :
– Les personnes en déplacement, polarisées, on l’a vu, sur leur ressource rare : le temps. Le coût vient en second avec un accent plus ou moins fort selon les situations et les revenus. Le confort du mode de transport dans toute l’acception de ce terme (place disponible, sécurité, services annexes comme la connectivité Internet et GSM… etc.) peut aussi avoir une place importante.
– Les fournisseurs et opérateurs de services de mobilité : constructeurs automobiles, opérateurs de transports en commun (train, métro, bus, car, avion), qui, comme toute entreprise, ont besoin de faire des bénéfices pour durer, investir et innover.
– Les autorités publiques, dont l’objectif est d’assurer l’accessibilité aux aménités des territoires, c’est-à-dire permettre aux citoyens d’aller au travail, d’emmener les enfants à l’école, de faire des courses, d’aller chez le docteur, se divertir… etc.
Les acteurs publics, selon les territoires, sont confrontés à des contraintes diverses. Tous ont à agir dans le cadre de budgets publics contraints. Ce qui distingue les villes des territoires ruraux, particulièrement en Europe avec une structure urbaine et un bâti anciens, c’est la rareté de l’espace public. Et comme c’est un bien commun, c’est-à-dire un bien public qui peut être saturé ou détruit, et qu’il est rare, il faut le réguler. Voilà pourquoi les grandes villes considèrent la voiture comme un problème et les campagnes comme une solution.
Une ville peut connaître la thrombose du fait d’une circulation trop intense. Pour éviter cela, elles ont déployé des transports en commun qui permettent de déplacer plus de monde en économisant l’espace public. Ce faisant, elles ont subventionné les mobilités individuelles. Les campagnes et les petites villes ne sont pas soumises à la congestion, puisque la densité de population y est faible. La voiture est une solution qui permet par ailleurs d’épargner les budgets publics, compte tenu du coût des transports en commun. Dans ces territoires, la puissance publique vient en aide aux personnes qui ne peuvent pas ou plus conduire : les enfants, les personnes aux faibles revenus qui ne peuvent pas avoir accès à la voiture. Pour les premiers, ce sont les transports scolaires qui pallient la dépendance à d’autres pour se déplacer, pour les seconds, ce sont des systèmes de transports à la demande, que l’on peut apparenter à un taxi collectif. Le poids médiatique en France des villes-centres des grandes agglomérations induit ainsi une perception exclusive de la voiture comme une nuisance : ce n’est pas vrai pour les territoires ruraux et c’est en partie vrai dans les grandes agglomérations puisque la voiture c’est l’autonomie des personnes et des possibilités de déplacement très fortes pour réaliser son programme d’activité, notamment pour aller travailler.
Figure 7 : Image utilisée pour visualiser la problématique de l’espace public en ville… et prolongée pour montrer qu’une voiture individuelle qu’elle soit électrique ou autonome n’y changera rien.
De son côté, le voyageur va chercher à optimiser ses déplacements et minimiser son temps de parcours. Or plus l’on va vite, plus on consomme de l’espace compte tenu des distances de sécurité. C’est la fameuse courbe des ingénieurs du trafic, la relation entre la vitesse et le débit, c’est-à-dire le nombre de véhicules par heure.
À un certain niveau de vitesse, le débit chute. Or la priorité d’une autorité publique est de faire fonctionner la ville en faisant circuler un maximum de personnes à une vitesse acceptable pour le voyageur, mais aussi cohérente avec l’espace public disponible. Privilégier la vitesse n’est ainsi pas toujours possible ni souhaitable. Les intérêts des autorités publiques et des voyageurs ne sont pas forcément convergents ce qui explique les débats sur les limitations de vitesse et la difficulté des politiques publiques de mobilité urbaine.
Figure 8 : Relation débit/vitesse sur des voies sans intersections (autoroutes, boulevard périphérique)1.
Cette problématique n’est pas aisée à résoudre pour les élus en charge de l’espace public. Chaque acteur va solliciter son espace : le piéton avec des trottoirs plus larges, le cycliste pour des pistes cyclables, voire des pistes express pour les cyclistes rapides – illustrant ainsi le goût pour la recherche des gains de temps qui n’est pas l’apanage des automobilistes –, l’habitant et le commerçant pour des places de stationnement, les transports en commun pour des voies réservées. C’est une équation difficile dans les vieilles villes européennes denses avec des largeurs de voies qui sont limitées comparativement aux villes nouvelles ou aux USA. Déployer une voie cyclable ou une voie bus demande des études, des concertations avec toutes les parties prenantes et de la pédagogie pour rechercher et trouver des solutions.
Le tableau ci-après présente les performances des différents modes de déplacement en termes de débit et de vitesse moyenne. Le débit, c’est-à-dire le nombre de personnes transportées par unité de temps, est le critère permettant d’économiser la ressource rare qu’est l’espace public : plus il est élevé, moins l’espace public est consommé. La vitesse prise en compte dans le tableau n’est pas la vitesse de pointe, mais celle constatée dans les territoires en prenant en compte les temps de parcours de porte à porte. Les villes vont privilégier les modes de transport qui consomment le moins d’espace public. Ce sera en conséquence ceux qui maximisent le débit. Les transports publics ont ainsi un débit jusque 24 fois supérieur à celui de la voiture et, en ville, des vitesses moyennes comparables, voire supérieures. Les voitures, si elles sont rapides et flexibles, consomment fortement l’espace public avec un taux moyen de remplissage de 1,6 personne en moyenne2, variant selon les activités (par exemple 1,05 pour les trajets domicile-travail, mais bien plus pour les vacances et loisirs). C’est ce qui explique l’engouement actuel pour le vélo, qui consomme trois fois moins d’espace public que la voiture pour des vitesses moyennes équivalentes, mais avec un débit cependant inférieur. Le vélo est également bien plus consommateur d’espace que le transport public. Hormis en Île-de-France, le train transporte peu de personnes compte tenu de la faiblesse des fréquences.
Débit (*)
Vitesses moyennes
Voiture
800 véhicules/h/voie en ville soit 1 400 personnes/h en moyenne, 2000 véhicules/h/voie sur autoroute, soit 3 200 personnes/h en moyenne Débit fort
10 m2 au sol/voiture à l’arrêt et bien plus avec l’accroissement de la vitesse3
20 km/h en heure creuse en ville, 7 en heures de pointe en ville
50 km/h en 1re couronne
70 km/h en 2de couronne
120 km/h sur autoroute
Vélo
1 600 vélos/h/voie en ville
Débit moyen
3 m2 au sol/vélo
10 à 20 km/h selon les mollets du cycliste ou la présence d’une assistance électrique
Transports publics urbains (fréquence de 3 min)
RER : 34 000 personnes/h
Métro : 8 000 personnes/h
Tramway : 5 000 personnes/h
Bus : 3 000 personnes/h
Débit très fort
RER : 50 km/h
Métro : 30 km/h
Tramway : 20 km/h
Bus : de 10 (Paris) à 20 km/h (Lyon)
TER (fréquence de 15 min)
1 200 à 2 000 personnes/h selon la taille de la rame et si les rames sont avec ou sans étage
Débit faible aujourd’hui, mais potentiellement très fort si la fréquence augmente
100 km/h vitesse de croisière, 30 km/h de porte à porte
TGV
1 000 places par TGV duplex soit entre Paris et Lyon 2 000 personnes/h Débit fort
300 km/h vitesse de croisière et 150 km/h de porte à porte
Avion
130 places (A319) jusque 800 places (A380)
Débit faible
800 km/h vitesse de croisière et 300 km/h de porte à porte
(*) nombre de personnes par heure
Figure 9 : Tableau des débits et des vitesses des différents modes de transport selon les territoires, J. Coldefy.
Cette lutte pour l’espace public et la divergence entre intérêts publics et individuels s’illustre parfaitement avec les GPS automobiles comme Waze. Pour faire gagner quelques secondes aux automobilistes, ces applications proposent des parcours dans des zones résidentielles ou devant des écoles. En réponse, les collectivités déploient des ralentisseurs coûteux et des changements des plans de circulation venant diminuer l’efficacité des déplacements. On est dans un jeu perdant-perdant. La mobilité du XXIe siècle sera intelligente si elle réalise le bon compromis entre les intérêts de ces trois groupes d’acteurs : des temps de parcours optimums pour le citoyen en déplacement, des espaces publics urbains préservés pour la collectivité, des modèles économiques pour les opérateurs et des finances publiques soutenables. Vouloir en finir avec la vitesse, c’est oublier ce qu’elle a permis et constitue un vœu pieux : on ne reviendra pas sur les avantages de la vitesse, même s’il faut dans les centres des grandes villes en limiter les inconvénients. La réalité c’est la fin des gains de vitesse qui se traduit par une stabilité des distances parcourues depuis 2000, comme nous l’avons vu. Pour la mobilité urbaine, l’homme a touché ses limites sur ce plan. La vitesse outre qu’elle a induit des possibilités étendues pour les individus avec comme conséquence une consommation importante d’espace public, a aussi considérablement changé la forme des villes et les systèmes urbains.
1 En ville, le principe est le même, mais le débit chute très vite si les carrefours à feux sont mal réglés ou s’ils sont bloqués par des véhicules étant engagés sans avoir pu traverser sur leur temps de vert.
2 Source ministère des Transports, SDES et Insee, et Enquête nationale transports déplacements (ENTD).
3 Voir les travaux de Frédéric HÉRAN.





























