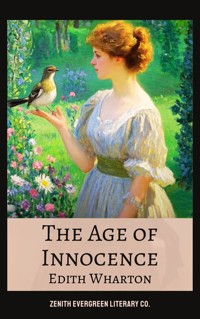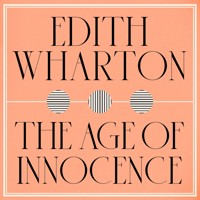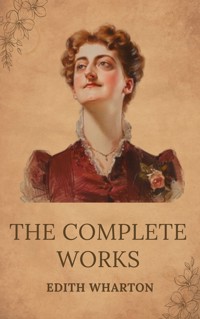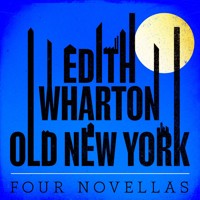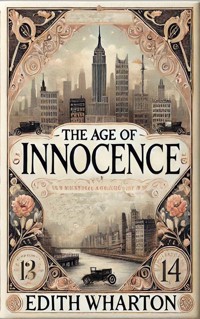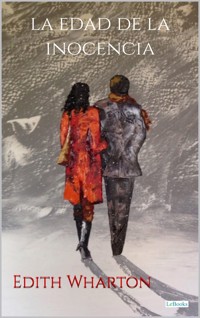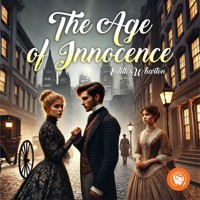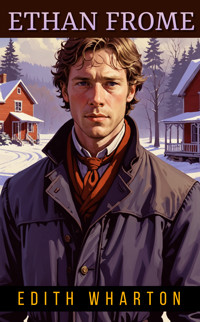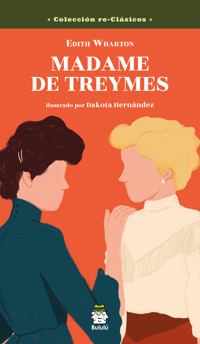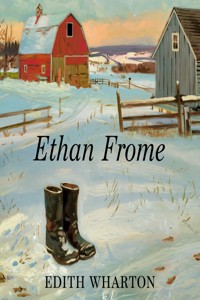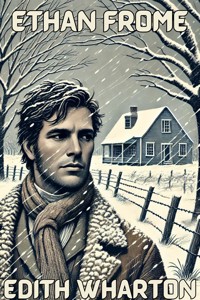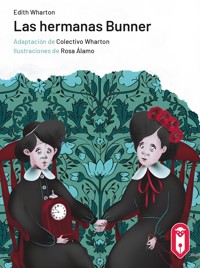0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Youcanprint
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Edith Wharton est une romancière, nouvelliste, poétesse et essayiste américaine. Première femme à recevoir le prix Pulitzer du roman et à être nommée docteur honoris causa de l'université de Yale. Œuvres: La Tragédie de la Muse, Lendemain, Le Confessionnal, L'Échéance, Les Deux Autres, Chez les heureux du monde, L'Ermite et la Femme sauvage, Le Verdict, Les Metteurs en scène, Le Bilan ou Les Lettres, Sous la neige, Visites au front.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Photograph of writer Edith Wharton, taken by E. F. Cooper, at Newport, Rhode Island. Cabinet photograph. Courtesy of the Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University.
Œuvres
La Tragédie de la Muse
Lendemain
Le Confessionnal
L’Échéance
Les Deux Autres
Chez les heureux du monde
L’Ermite et la Femme sauvage
Le Verdict
Les Metteurs en scène
Le Bilan
ou Les Lettres
Sous la neige
Visites au front
Les Metteurs en scène (recueil)
La Tragédie de la Muse
Edith Wharton
Les Metteurs en scène
Traduction par Mme M. P. B..Plon, 1909 (p. 179-209).
LA TRAGÉDIE DE LA MUSE
I
Plus tard Danyers se complut à se figurer qu’il avait reconnu Mrs Anerton du premier coup ; mais cette imagination était naturellement absurde, n’ayant vu d’elle auparavant aucun portrait. Elle affectait de garder un anonymat strict, et refusait sa photographie même aux plus privilégiés. Il n’avait en outre jamais obtenu de Mrs Memorall, en qui il vénérait et cultivait l’amie de cette femme, qu’une phrase de vague impressionnisme : « Elle est comme ces anciennes estampes où les traits ont la valeur d’un coloris… »
Cependant, le jeune homme était presque certain d’avoir pensé à Mrs Anerton tandis qu’il déjeunait dans le restaurant désert de l’hôtel. Il s’était aussitôt dit à lui-même, ayant levé la tête à l’approche d’une dame qui s’était placée à une table près de la fenêtre : « Il se pourrait bien que ce fût elle… »
Dès ses années d’étudiant à Harvard[1], — il était encore assez jeune pour penser à ce temps comme à une époque infiniment éloignée, — Danyers avait rêvé de Mrs Anerton, la Silvia de l’immortel cycle de sonnets de Vincent Rendle, la Mrs A… de la Vie et les Lettres du même Vincent Rendle. Ce nom avait pour tabernacle quelques-uns des plus nobles vers anglais du dix-neuvième siècle, — et de tous les siècles passés ou futurs, comme Danyers, avec un jugement mûri, continuait à le croire. La première lecture de certains poèmes de Rendle : l’Antinoüs, la Pia Tolomei, les Sonnets à Silvia, avait fait époque dans le développement de Danyers, et l’exquise harmonie, l’ampleur, la signification de ces vers semblaient croître à mesure qu’on apportait à leur interprétation plus d’expérience de la vie, une sensibilité plus affinée, alors que, dans son adolescence, Danyers n’avait perçu que la parfaite et presque austère beauté de la forme, la subtile alternance des voyelles, l’élan et la plénitude de l’émotion lyrique, il vibrait maintenant au sens serré de chaque ligne, à l’allusion de chaque mot. Son imagination était sans cesse entraînée sur de nouvelles traces, sans cesse stimulée par le sentiment qu’au delà de ce qu’il avait découvert, d’autres régions, plus merveilleuses encore, attendaient qu’on les explorât. À l’époque de la mort du grand homme, Danyers, encore à l’Université, avait écrit sur la poésie de Rendle l’essai qui remporta le prix. Il avait coulé les poèmes éphémères de sa propre période de romantisme dans le moule que Rendle avait le premier donné au mètre anglais. Et quand apparurent, deux ans plus tard, la Vie et les Lettres, quand la Silvia des sonnets prit corps et devint Mrs A…, le jeune homme engloba dans son culte pour Rendle la femme qui avait inspiré, non seulement des vers aussi divins, mais encore une prose si facile, si tendre, incomparable. Danyers ne devait jamais oublier le jour où Mrs Memorall mentionna ses relations avec Mrs Anerton. Il fréquentait cette Mrs Memorall depuis un peu plus d’un an, et il l’avait, jusqu’alors, assez dédaigneusement classée parmi les coureuses de célébrités. Un après-midi, et tout en lui mettant un morceau de sucre dans son thé, elle lui dit, à brûle-pourpoint :
— Est-ce bien, cette fois ? Vous êtes presque aussi difficile que Mary Anerton.
— Que Mary Anerton ?…
— Oui, je ne peux jamais me rappeler comment elle aime son thé. C’est ou bien du citron avec du sucre, ou sans sucre, ou de la crème sans ni l’un ni l’autre, et de toute façon le thé ne doit être versé dans la tasse qu’en dernier lieu. Et si l’on ne s’est pas bien souvenu, il faut tout recommencer. Je suppose que Vincent Rendle prenait son thé comme cela et que c’est devenu un rite…
— Comment ! vous connaissez Mrs Anerton ?…
— Et ai-je vu une fois Shelley lui-même[2] ?… Miséricorde ! Mais oui !… Elle et moi nous avons été à l’école ensemble. Vous savez qu’elle est Américaine ? Nous avons passé presque un an dans un pensionnat des environs de Tours. Après quoi, elle retourna à New-York et je la perdis de vue jusqu’après son mariage. Elle et Anerton ont séjourné un hiver à Rome, pendant que mon mari y était attaché à notre Légation, et nous l’y voyions beaucoup, fit Mrs Memorall, avec un sourire de réminiscence. C’était le fameux hiver…
— L’hiver où ils se sont connus ?…
— Précisément. Par malheur, j’ai quitté Rome peu avant que la rencontre n’eût lieu. N’est-ce pas de la guigne ? J’aurais pu figurer dans la Vie et les Lettres. Vous savez qu’il mentionne même cette stupide Mme Vodki chez laquelle la présentation eut lieu…
— Et elle, l’avez-vous vue beaucoup par la suite ?
— Pas du vivant de Rendle. Elle vivait presque exclusivement en Europe. Je la voyais bien de temps en temps, quand j’étais sur le continent, mais elle était si absorbée, si préoccupée, qu’on se sentait toujours de trop. En réalité, elle ne tenait qu’à ses amis à lui, et s’était peu à peu séparée de tous les siens à elle. Maintenant, c’est très différent. Elle est affreusement seule. Elle s’est remise à m’écrire quelquefois, et, l’année dernière, ayant su que j’allais en Europe, elle me demanda de la rejoindre à Venise. J’y ai passé une semaine avec elle.
— Et Rendle ?
Mrs Memorall sourit et secoua la tête :
— On ne m’a jamais laissé jeter même un simple coup d’œil sur le dieu. Aucun de ses anciens amis à elle ne l’a jamais rencontré, sinon par hasard. Les mauvaises langues disent que c’est pour cela qu’elle l’a gardé si longtemps. Si quelqu’un arrivait pendant qu’il était là, aussitôt le dieu était mis à l’abri dans le cabinet d’Anerton, et le mari montait la garde jusqu’au départ du malencontreux visiteur. Anerton était d’ailleurs bien plus ridicule que sa femme. Mary était trop fine pour perdre la tête, ou du moins pour laisser voir qu’elle l’avait perdue, mais Anerton était incapable de cacher combien il était fier de cette conquête. J’ai vu Mary sur des épingles, quand il appelait Rendle « notre poète ». Il fallait toujours au grand homme une certaine place à table, hors du courant d’air et pas trop loin du feu. Il lui fallait sa boîte de cigares à laquelle personne n’avait le droit de toucher, sa table à écrire dans le salon de Mary, et Anerton ne se lassait pas de raconter les idiosyncrasies de l’idole : Comment Rendle ne coupait jamais les bouts de ses cigares, quoique lui-même, Anerton, il lui eût donné un coupe-cigares en or, incrusté d’un saphir étoile, comment la table du maître était toujours encombrée, comment la domestique avait l’ordre de toujours porter à sa maîtresse le panier à papier, avant de le vider, de peur qu’une strophe immortelle ne tombât dans les balayures.
— Les Anerton ne se sont donc jamais séparés ?
— Se séparer ? Dieu garde ! Anerton n’aurait pas voulu quitter Rendle. Et d’ailleurs, il aimait beaucoup sa femme.
— Et elle ?
— Elle avait compris qu’il était de ces époux prédestinés au ridicule, et elle n’essayait jamais de lutter là contre.
Danyers apprit encore par Mrs Memorall que Mrs Anerton, dont le mari était mort quelques années avant leur poète, partageait maintenant son existence entre Rome, où elle avait un petit appartement, et l’Angleterre, où elle allait parfois rendre visite à ceux de ses amis qui avaient connu Rendle. Après l’avoir perdu, elle s’était consacrée à la publication de quelques œuvres de jeunesse dont il lui avait laissé le soin. Une fois cette tâche accomplie, elle n’avait guère eu d’occupation bien définie. À leur dernière rencontre, Mrs Memorall l’avait trouvée désemparée et découragée.
— Rendle lui manque trop. Elle a une vie trop vide maintenant. Je le lui ai dit. Je lui ai dit qu’elle devrait se remarier…
— Elle ! se remarier !
— Et pourquoi pas, je vous prie ? Elle est encore une jeune femme, — ce que beaucoup de gens appelleraient jeune, interrompit Mrs Memorall, comme par parenthèse, et avec un regard vers le miroir. Pourquoi ne pas accepter l’inévitable et recommencer la vie ? Tous les chevaux du Roi et tous les hommes du Roi[3] ne ramèneraient pas Rendle, et d’ailleurs elle ne l’a pas épousé, lui, quand elle le pouvait…
Danyers, voyant manier son idole si indélicatement, eut comme un léger frisson. Mrs Memorall ne comprenait-elle donc pas quelle faute d’orthographe c’eût été que ce mariage ? Se figure-t-on Rendle « régularisant sa situation » avec Silvia, car c’est ainsi que le monde eût envisagé les choses ? Comme une telle réparation eût vulgarisé leur passé ! C’eût été restaurer un chef-d’œuvre. Et combien exquise et rare devait être la sensibilité d’une femme qui, au mépris des convenances, malgré sa propre inclination, peut-être, avait préféré arriver à la postérité comme Silvia plutôt que comme Mrs Vincent Rendle !
À dater de ce jour, Mrs Memorall devint intéressante aux yeux de Danyers. Elle était comme un tome de mémoires incohérents et sans table, dans lequel il se plongeait patiemment, avec l’espoir de trouver çà et là, enfouie sous des couches de poudreuses fadaises, une précieuse allusion à l’objet de ses pensées. Quelques mois plus tard, ayant publié son mince premier volume, où le juvénile essai sur Rendle, très retouché, figurait auprès d’une douzaine « d’appréciations » quelque peu soulignées, il en offrit un exemplaire à Mrs Memorall qui, à sa surprise, lui annonça, peu après, qu’elle avait envoyé le livre à Mrs Anerton.
Après un délai convenable, Mrs Anerton adressa ses remerciements à son amie. Danyers fut admis au privilège de lire les quelques lignes par lesquelles, et en termes qui trahissaient l’habitude de « reconnaître » des hommages semblables, elle parlait de « l’intuition et de la sensibilité » de l’auteur, et se disait « charmée de cette occasion… », etc. Il partit désappointé, sans bien se rendre compte de ce qu’il avait espéré.
Au printemps d’après, quand il alla en Europe, Mrs Memorall lui offrit des lettres d’introduction pour tout le monde, depuis l’archevêque de Cantorbéry jusqu’à Louise Michel, sans toutefois lui en donner pour Mrs Anerton. Danyers savait, par une conversation antérieure, que Silvia nourrissait des préventions contre les gens qui se présentaient avec des lettres. Il savait aussi qu’elle voyageait l’été. Elle ne devait guère retourner à Rome avant l’expiration de son congé à lui. L’espoir de la rencontrer n’était donc pas compris dans son itinéraire.
La dame, dont l’entrée interrompit son solitaire repas dans le restaurant désert de l’Hôtel Villa d’Este, s’était assise. Son profil se découpait sur la vitre, et son front bombé, son nez aquilin et délicat, sa lèvre un peu dédaigneuse, rappelaient vaguement la silhouette de Marie-Antoinette. Dans la toilette et les mouvements de cette femme, jusque dans la courbe des poignets, tandis qu’elle se versait son café, Danyers crut distinguer un je ne sais quoi qui excluait à la fois toute idée de banalité et d’excentricité. C’était évidemment une femme qui avait été très excédée et passionnément intéressée. Le garçon lui apporta un Secolo, et comme elle se penchait sur le journal, Danyers observa que les cheveux enroulés au-dessus de son front commençaient à grisonner. Mais sa taille était droite et svelte et elle avait le dos élancé d’une jeune fille.
La vague du touriste anglo-saxon n’avait pas encore déferlé vers les lacs. À l’exception d’une ou deux familles italiennes et d’un jeune homme bossu accompagné d’un abbé, Danyers et la dame étaient seuls dans les salles de marbre de la Villa d’Este.
Comme il rentrait d’une course matinale dans la montagne il la vit assise à une des petites tables au bord du lac. Elle écrivait, et auprès d’elle s’amoncelaient livres et journaux. Ce soir-là ils se rencontrèrent de nouveau dans le jardin. Il avait fait quelques pas au dehors pour fumer une dernière cigarette avant le dîner et il la trouva assise sous la voûte obscure des chênes-lièges, près des marches qui descendent à l’embarcadère. Elle était penchée sur la balustrade et regardait l’eau, et elle se retourna au bruit de son approche. Elle avait noué une écharpe de dentelle noire autour de sa tête, et ce fond sombre donnait à son visage amaigri un aspect malheureux. Plus tard, il se rappela que ses yeux, en rencontrant son regard à lui, exprimaient moins une douleur qu’un profond mécontentement.
À sa grande surprise, elle vint droit à lui et le retint d’un geste :
— Monsieur Lewis Danyers, je crois ?…
Il s’inclina.
— Je suis Mrs Anerton. J’ai vu votre nom sur la liste des étrangers et je désire vous remercier d’un essai sur la poésie de M. Rendle, ou plutôt vous dire combien je l’ai apprécié. Le livre m’a été envoyé par Mrs Memorall l’hiver dernier…
Ses paroles avaient un son égal et monotone, comme si l’habitude d’un débit conventionnel eût enlevé à sa voix des accents plus spontanés, mais son sourire était charmant.
Ils s’assirent sur un banc de pierre sous les chênes verts et elle dit à Danyers tout le plaisir que lui avait procuré son essai. Elle trouvait que c’était le meilleur morceau du livre. Il y avait certainement mis plus de sa propre personnalité que dans le reste. N’avait-elle pas raison d’en conclure qu’il avait été très profondément influencé par l’art de M. Rendle ? Pour comprendre, il faut aimer, et il semblait, à elle, qu’il avait parfois pénétré plus avant qu’aucun autre critique la pensée intime du poète. Il y avait naturellement certains problèmes auxquels il n’avait pas touché, certains aspects de cet esprit si complexe qu’il n’avait peut-être pas saisis…
— Mais aussi, vous êtes bien jeune, conclut-elle doucement, et l’on ne peut pas vous souhaiter encore l’expérience qu’impliquerait une compréhension plus complète.
II
Elle resta un mois à la Villa d’Este, et Danyers la vit tous les jours. Elle montrait un plaisir très franc à sa société, mais ce plaisir était si évidemment fondé sur leur commune vénération pour Rendle, que le jeune homme pouvait en jouir sans arrière-pensée de fatuité. Au début, il n’était pour la jeune femme qu’un grain d’encens de plus sur l’autel de sa Divinité ; puis, insensiblement, une note plus personnelle s’introduisit dans leurs rapports. S’il continuait à lui plaire uniquement parce qu’il appréciait Rendle, elle le distinguait du moins d’une manière absolue dans le troupeau des autres admirateurs du poète.
Danyers fut frappé de cette attitude si parfaite envers la mémoire du grand homme. Mrs Anerton ne proclamait ni ne désavouait son identité littéraire. Pour ceux qui savaient le secret et que cela intéressait, elle était franchement Silvia. Pourtant il n’y avait pas de trace de l’Égérie dans sa manière d’être. Elle parlait souvent des livres de Rendle, rarement de lui-même, et il n’y avait aucune conjugalité posthume, aucun usage du prénom possessif dans ses abondantes réminiscences. Elle ne se lassait jamais de décrire la vie intellectuelle du maître, ses habitudes de pensée et de travail. Elle connaissait l’histoire de chaque poème, par quelle scène ou quel épisode chaque image avait été évoquée ; combien de fois, dans une certaine strophe, les mots avaient été déplacés ; le temps qu’il avait mis à chercher telle métaphore ; elle avait même une explication pour ce vers impénétrable qui faisait le tourment des critiques, la joie des détracteurs, le dernier vers du poème : le Vieil Odysseus.
Danyers sentait qu’en parlant de toutes ces choses, elle n’était pas un simple écho de l’esprit de Rendle. Si sa personnalité avait paru absorbée par celle du maître, c’est simplement qu’ils pensaient de même, et non point parce qu’il pensait, lui, pour elle. La postérité incline à considérer les femmes chantées par les poètes comme des clous auxquels le hasard leur a fait suspendre leurs guirlandes ; mais l’esprit de Mrs Anerton était comme un jardin fertile où l’imagination de Rendle avait nécessairement pris racine et fleuri. Danyers s’en aperçut bientôt : le poète avait dû à l’union de cette nature avec la sienne plus d’un fil, et des plus précieux, de son complexe tissu mental. En un certain sens, Silvia avait elle-même créé les Sonnets à Silvia.
Au fur et à mesure que son intimité avec Mrs Anerton grandissait, Danyers avait l’impression d’arriver en intrus dans cette vie déjà si remplie.
Être la gardienne de la personnalité intime de Rendle, la porte, si l’on peut dire, du sanctuaire, avait semblé au jeune homme un privilège si complet ! Quelle place y restait-il parmi des souvenirs aussi envahissants pour une actualité aussi infime que la sienne ? Puis, soudain, il découvrit que Mrs Memorall y avait vu plus juste : son heureuse amie était ennuyée aussi bien que solitaire !
— Vous avez eu en partage plus qu’aucune autre femme… s’était-il écrié un jour.
Et un sourire éclaira sa méprise d’une lueur ironique. Insensé qu’il était de n’avoir pas vu qu’elle n’avait pas eu assez, qu’elle était jeune encore, — est-ce que les années comptent ? — qu’elle était tendre, humaine, femme enfin, — que les vivants ont besoin des vivants !
À dater de là, quand ils gravirent les allées en pente du parc, se reposant dans un des petits temples ruinés, ou contemplant, à travers un rideau de feuillage, le lointain éclair azuré du lac, ils ne parlèrent plus exclusivement de Rendle ou de littérature. Elle encourageait Danyers à se raconter lui-même, à lui confier ses ambitions. Elle lui posait de ces questions qui sont chez une femme fine l’équivalent d’un conseil :
— Vous devriez écrire, disait-elle, en formulant la plus exquise flatterie que peuvent exprimer des lèvres humaines.
Naturellement il écrirait. Pourquoi ne pas entreprendre à son tour quelque chose de grand ? Il ferait du moins de son mieux, avec la résolution que son mieux serait le mieux. Rien d’autre n’eût paru suffisant au jeune homme avec un tel mandat dans les oreilles. Comme elle l’avait deviné ! — Comme elle avait soulevé et démêlé ses ambitions éparses, mis en éveil son esprit, avec ce Fiat lux !
C’était leur dernier jour ensemble, et il se sentait heureux sans avoir d’espoir défini.
— Oui, vous devriez écrire, et un livre sur Lui, reprit-elle doucement.
Danyers eut un sursaut ; il commençait à ne plus aimer cette façon avec laquelle Rendle apparaissait sans se faire annoncer.
— Vous le devriez, insista-t-elle. Il faudrait donner une interprétation complète, un résumé de son style, de ses intentions, montrer sa théorie de la vie et de l’art. Personne ne pourrait le faire aussi bien…
— Comment mener à bien cette œuvre, sans vous ?… murmura-t-il.
— Je pourrais vous aider, je vous aiderais naturellement.
Tous deux demeurèrent silencieux, regardant le lac…
Il fut convenu qu’il la rejoindrait six semaines plus tard, à Venise. Là ils parleraient du livre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III
Lago d’Iseo, 14 août.
« En vous disant au revoir, hier, je vous ai promis de revenir à Venise, dans une semaine, et de vous y donner une réponse. Je n’ai pas été honnête avec vous, Danyers, je n’avais ni l’intention de revenir à Venise, ni celle de vous revoir. Je vous fuyais et je veux continuer à vous fuir. Si vous ne le voulez pas, moi je le dois. Il faut que quelqu’un vous empêche d’épouser une femme désenchantée, et qui a… Mais vous dites que les années ne comptent pas. Pourquoi compteraient-elles, après tout, puisque vous ne devez pas m’épouser ?…
« C’est là ce que je n’ose pas retourner vous dire : « Vous ne devez pas m’épouser. » Nous avons eu notre mois ensemble à Venise (quel bon mois, n’est-il pas vrai ?), et maintenant vous allez rentrer chez vous et écrire un livre, n’importe lequel, sauf celui dont nous n’avons pas parlé ! Et moi je resterai ici condamnée à l’attitude de mes souvenirs, comme une espèce de Tithon femelle ! Ah ! quelle monotonie dans cette immortalité obligatoire !
« Mais vous saurez du moins la vérité. Je vous aime assez, vous, ou, sinon vous, votre amour, pour vous la devoir, cette vérité.
« Vous avez cru que c’était parce que Vincent Rendle m’avait aimée qu’il y avait si peu d’espoir pour vous. J’avais eu tout ce que je pouvais désirer, jusqu’à la satiété, disiez-vous, n’est-ce pas ? C’est précisément quand un homme commence à s’imaginer qu’il comprend une femme, qu’il ne la comprend pas. C’est au contraire parce que Vincent Rendle ne m’a pas aimée, qu’il n’y a pas d’espoir pour vous. Je n’ai pas eu ce que je désirais, et jamais, jamais, je ne m’abaisserai jusqu’à me contenter d’autre chose.
« Commencez-vous à comprendre ? Tout était donc une duperie, direz-vous ? — Non, tout — si du moins il y a eu quelque chose — tout était vrai. Vous êtes jeune, vous n’avez pas encore appris à connaître les mille indices imperceptibles grâce auxquels on se fraye, à tâtons, un chemin à travers le labyrinthe de la nature humaine. Mais n’avez-vous pas été quelquefois frappé que je ne vous aie jamais raconté la moindre petite anecdote sur Rendle ? Le geste, par exemple, avec lequel il faisait tournoyer un coupe-papier entre son pouce et son index pendant qu’il parlait ; sa manie de garder l’envers blanc des lettres ; combien il était gourmand des fraises des bois, — celles des Alpes, — toutes petites et savoureuses ; son goût enfantin pour les acrobates et les jongleurs ; sa manière de m’appeler « Vous, chère Vous », en tête de chaque lettre… Je ne vous ai jamais, n’est-ce pas, dit un mot de tout cela ? Croyez-vous que j’eusse pu me retenir de vous en parler, s’il m’avait aimée ? Ces petites choses eussent été à moi ; elles eussent fait partie de ma vie, de notre vie ; elles m’auraient échappé, malgré moi (il n’y a que les femmes malheureuses pour rester éternellement réservées et dignes). Mais il n’y a jamais eu de notre vie, jusqu’au bout il y a eu sa vie et ma vie…
« Si vous saviez quel soulagement c’est pour moi de dire enfin tout ceci à quelqu’un, vous supporteriez que je vous fasse mal ! Je ne serai jamais plus aussi isolée, maintenant que quelqu’un d’autre sait ce qui en est.
« Laissez-moi commencer par le commencement. Quand je rencontrai Vincent Rendle pour la première fois, il y a vingt ans, je n’avais pas vingt-cinq ans. De ce jour-là, jusqu’à sa mort, nous avons été d’excellents amis l’un pour l’autre. Il m’a donné quinze années, les meilleures peut-être de sa vie. Le monde entier, vous le savez, trouve que ses plus beaux poèmes furent écrits pendant cette période-là. Je suis censée les avoir « inspirés » et, jusqu’à un certain point, c’est vrai. Dès le début, la sympathie intellectuelle entre nous fut presque complète. Il me semble que mon esprit a dû être pour lui comme un instrument parfaitement harmonieux sur lequel il n’était jamais las de jouer. Quelqu’un me répéta depuis qu’il avait dit une fois que « je comprenais toujours ». C’est le seul éloge que je sache qu’il m’ait décerné. J’ignore même s’il me trouvait jolie, quoique je ne suppose pas que ma figure lui déplût, car il avait horreur des gens laids. En tout cas il s’accoutuma bientôt à passer tout son temps avec moi. Il aimait notre maison ; notre manière de vivre lui convenait. Il était nerveux et assez irritable. Le monde l’ennuyait et cependant il n’aimait pas la solitude. Il prit donc ses habitudes chez nous. Quand nous voyagions, il nous accompagnait ; en hiver, il louait un logement près du nôtre à Rome. En Angleterre, sur le continent, il était toujours avec nous pendant une bonne partie de l’année. Je pouvais lui rendre de petits services pour son travail, je lui devins nécessaire. Lorsque nous étions séparés, il m’écrivait sans cesse ; il aimait à me faire part de tout ce qu’il faisait ou pensait, il avait hâte de connaître mon jugement sur chaque livre nouveau qui l’intéressait. Je faisais partie de sa vie intellectuelle. Mon malheur était de désirer être quelque chose de plus. J’étais jeune et je l’aimais, pas parce qu’il était Vincent Rendle, mais parce qu’il était lui-même !
« La société commença tout naturellement à jaser ; j’étais la Mrs Anerton de Vincent Rendle ! Quand parurent les Sonnets à Silvia, on dit tout bas que j’étais Silvia. Partout où il allait, j’étais invitée. Les gens me recherchaient dans l’espoir d’arriver à le connaître. Pendant mon séjour à Londres, tout le monde était pendu à ma sonnette. Pairesses, douairières, maîtresses de maison ambitieuses, jeunes filles sentimentales, auteurs intrigants, m’accablaient de leurs assiduités. Je jouissais de mon succès, car je savais ce que tout cela signifiait : l’on croyait Rendle amoureux de moi. Et par moments j’arrivais à le croire aussi. Ah ! il n’y a pas de phase de folie que je n’aie traversée. Vous n’imagineriez jamais les excuses qu’une femme peut trouver à un homme qui ne lui dit pas qu’il l’aime : arguments pitoyables qu’elle percerait à jour du premier regard, si une autre s’en servait ! Mais tout ce temps-là, et au fond, bien au fond de moi, je savais parfaitement qu’il ne m’avait jamais aimée. Je l’aurais su, même s’il avait passé sa vie à me faire des déclarations. Au contraire, je n’ai jamais pu deviner s’il savait ce qu’on disait de nous ; il écoutait si rarement, et se souciait si peu des racontars ! Il a toujours été honnête et absolument droit avec moi, me traitant comme un homme en traite un autre, et cependant il me semblait quelquefois qu’il devait savoir que je sentais autrement. Il n’en a jamais rien montré. Peut-être n’avait-il rien remarqué, car je suis bien certaine qu’il n’a aucunement voulu être cruel. Il ne m’avait jamais fait la cour. Ce n’était pas sa faute si je désirais plus qu’il ne pouvait me donner. Les Sonnets à Silvia, dites-vous ? Mais que sont-ils ? Une philosophie cosmique et pas un poème d’amour. Ils sont adressés à La Femme et non à une femme !
« Mais alors les lettres ? Ah ! les lettres ! Eh bien, je me confesserai. Vous avez certainement remarqué çà et là des interruptions, précisément lorsque ces lettres semblaient sur le point de devenir tendres ? Tous les critiques, vous vous le rappellerez, louèrent l’éditeur pour sa délicatesse et son bon goût (si rares de nos jours !), Ils le félicitèrent d’avoir omis de la correspondance toute référence personnelle, tous ces détails intimes, qui doivent être tenus sacrés, loin des yeux du public. L’on faisait naturellement allusion aux astérisques dans les lettres à Mrs A… Ces lettres, c’est moi-même qui les ai préparées, c’est-à-dire, que je les ai copiées pour l’éditeur, et que de temps à autre j’y ai glissé une ligne d’astérisques pour donner l’apparence d’une chose supprimée… Vous comprenez ? Ces astérisques étaient une supercherie. Il n’y avait rien à supprimer, entendez-vous, rien…
« Il n’y a qu’une femme qui puisse se rendre compte de ce que j’ai traversé pendant ces années ; les moments de révolte, où il me semblait que je devais me libérer de tout, jeter à Rendle la vérité au visage et ne jamais plus le revoir. Puis, l’inévitable réaction se produisait : ne pas le revoir semblait la seule chose vraiment intolérable, et je tremblais à l’idée qu’un regard, une parole de moi détruisît l’harmonie de notre amitié. Ah ! les heures absurdes où je caressais la chimère qu’il « devait » m’aimer, puisque tout le monde le croyait ! Les longues périodes d’accablement où je me figurais ne pas tenir à ce qu’il m’aimât ou non. À ces jours de misère en succédaient d’autres, où notre accord intellectuel était si parfait que j’oubliais tout le reste, dans la joie de me sentir soulevée sur les ailes de sa pensée. Parfois, alors, les cieux paraissaient s’ouvrir…
« Et à travers tout cela, il était un si bon ami ! Il avait le génie de l’amitié. Il me prodiguait les marques d’attachement. Oui, vous aviez raison de dire que j’ai eu plus qu’aucune autre femme. Il faut de l’adresse pour aimer[4], dit Pascal, et j’avais tant de sérénité, de gaieté, j’étais si franchement affectueuse avec lui, que je suis presque certaine de ne l’avoir jamais ennuyé, durant toutes ces années. Eussé-je pu en espérer autant, s’il m’avait aimée ?
« Il ne faut pas d’ailleurs que vous vous le figuriez perpétuellement attaché à mes jupes. Il allait et venait comme il voulait, et ses caprices étaient tout aussi libres. Il y eut, à un moment, une jeune fille (je vous dis tout), une ravissante créature qui appelait sa poésie « profonde ». Elle lui donna Lucile[5] pour son jour de naissance ! Il la suivit en Suisse pendant un été entier, et durant tout ce temps où il tournait autour d’elle, — un peu trop ouvertement, d’après moi, pour un grand homme, — il m’écrivait sur sa théorie de la combinaison des voyelles, ou sur ses essais de rénovation de l’hexamètre anglais ! Ses lettres étaient datées des endroits mêmes où je savais qu’ils allaient s’asseoir ensemble auprès des cascades, tandis qu’il s’ingéniait à trouver des adjectifs pour la nuance de ses cheveux. Il m’en parla plus tard en toute franchise. Elle était d’une beauté parfaite, et il avait éprouvé une joie très pure à la contempler, mais elle tenait absolument à parler, et son esprit, disait-il, était « tout en coudes ». Pourtant, l’année suivante, quand il apprit son mariage, il partit subitement tout seul… C’est précisément alors qu’il publia son Viatique d’amour… Que les hommes sont bizarres !…
« Après la mort de mon mari, — vous voyez que je formule les choses crûment, — j’eus un renouveau d’espoir. C’était parce qu’il m’aimait, me représentai-je, qu’il n’avait jamais parlé, parce qu’il avait toujours espéré faire de moi sa femme, quelque jour, parce qu’il avait voulu m’épargner « la faute ». Quelle illusion ! Je savais trop bien, dans le cœur de mon cœur, que ma seule chance était dans la force de l’habitude. Il s’était accoutumé à moi, il n’était plus jeune, il redoutait les visages nouveaux et les nouvelles manières d’être, il avait pris son pli. Ne lui serait-il pas plus commode de m’épouser ?
« Je ne crois pas maintenant qu’il y ait jamais pensé. Il m’écrivit ce qu’on appelle « une magnifique lettre ». Il fut bon, plein d’égards, avec une commisération très correcte… Puis, au bout de quelques semaines, il reprit son ancienne habitude de venir chaque jour, et nos interminables conversations se renouèrent juste où elles avaient été interrompues. J’ai su plus tard que le monde avait trouvé que j’avais fait preuve de « tant de tact », en ne l’épousant pas.
« Nous continuâmes ce petit train pendant environ cinq ans. Peut-être cette période-là fut-elle la meilleure, car j’avais abandonné tout espoir. Et il mourut.
a Après sa mort, — n’est-ce pas curieux ? — il me vint comme un mirage d’amour. Tous les livres et les articles qu’on écrivit sur lui, tous les comptes rendus, toutes les « vies », étaient remplis de discrètes allusions à Silvia. Je redevins à nouveau la Mrs Anerton des jours de gloire. Les femmes romanesques et les chers jeunes gens comme vous devenaient tout roses quand quelqu’un murmurait : « C’était à Silvia que vous parliez. » Les imbéciles me demandèrent des autographes, les éditeurs me pressaient d’écrire mes souvenirs sur lui, les critiques me consultaient sur l’interprétation des vers douteux. Et je savais que, pour tous ces gens, j’étais la femme que Vincent Rendle avait aimée.
« Au bout d’un certain temps, ce feu-là s’éteignit aussi, et je demeurai seule avec mon passé, ou même toute seule, car Vincent n’avait jamais été réellement auprès de moi. L’union intellectuelle ne comptait plus pour rien. Ç’avait toujours été l’âme dans l’âme, jamais la main dans la main, et il n’y avait pas de petits détails auxquels se rattacher.
« Alors commença une sorte d’hiver arctique. Je m’enterrai en moi-même comme dans une hutte contre la neige. Je haïssais ma solitude et je redoutais pourtant tout ce qui eût pu la troubler. Cette phase-là passa naturellement, comme les autres. Je repris à la vie. Je commençai à lire les journaux et à me préoccuper de la coupe de mes robes. Mais il y avait une question que je ne pouvais écarter et qui me hantait jour et nuit. Pourquoi ne m’avait-il jamais aimée ? Pourquoi lui avais-je tant représenté et pas davantage ? Étais-je si laide, si essentiellement peu aimable qu’un homme pût bien me chérir comme compagnon de son esprit, mais qu’il ne pût m’aimer comme femme ? Je ne puis vous exprimer à quel point cette question me tortura. Cela alla jusqu’à l’obsession…
« Commencez-vous à voir, mon pauvre ami ? Il fallait que je découvrisse ce qu’un autre homme pensait de moi ! Ne me jugez pas trop sévèrement. Écoutez d’abord, considérez bien tout. Quand je rencontrai Vincent Rendle, au début, j’étais une toute jeune femme, mariée trop tôt, et qui avait mené la plus paisible des existences. Je n’avais pas eu « d’expériences ». Depuis notre première entrevue jusqu’au jour de sa mort, je n’ai jamais regardé aucun autre homme, ni remarqué si aucun autre homme me regardait. Quand je le perdis, il y a de cela cinq ans, je ne connaissais pas plus les limites de mon pouvoir qu’un enfant. Était-il trop tard pour savoir ? Ne saurais-je jamais ce pourquoi ?
« Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Vous êtes si jeune ! Cette aventure ne deviendra que trop tôt un épisode, un simple « document », pour vous. Et d’ailleurs tout ceci n’a pas été aussi prémédité, aussi arrangé de sang-froid que ces lignes incohérentes ne le feraient croire. Je n’ai pas combiné les choses comme une femme dans un livre. La vie est tellement plus complexe que toutes ses représentations. Vous m’avez plu dès le commencement. J’ai été attirée vers vous (vous avez dû le voir), je voulais que vous m’aimiez, et ce n’était pas une simple expérience psychologique. Et pourtant, jusqu’à un certain point c’était cela aussi, je vous dois d’être honnête. Il me fallait une réponse à cette question : pourquoi Rendle ne m’a-t-il pas aimée ? Ce fantôme devait être enseveli.
« Au début, je craignais, ah ! combien je l’ai craint ! que vous m’aimiez uniquement parce que j’étais Silvia, que vous ne m’aimiez que parce que vous pensiez que Rendle m’avait aimée. Je commençai à croire qu’il m’était impossible d’échapper à ma destinée.
« Ah ! que je fus heureuse en découvrant que vous deveniez jaloux de mon passé, que vous étiez près de détester Rendle ! Mon cœur battit comme celui d’une jeune fille quand vous m’avez dit que vous vouliez me suivre à Venise.
« Après notre séparation à la Villa d’Este, mes anciens doutes reparurent à nouveau. Que savais-je vraiment de votre sentiment pour moi ? Étiez-vous seulement capable vous-même de l’analyser ? Il était probablement fait aux deux tiers de curiosité et au troisième de sentimentalisme littéraire. Vous pouviez parfaitement vous croire amoureux de Mrs Anerton, et n’être en réalité qu’épris de Silvia. Le cœur est de si mauvaise foi ! Ou même vous pouviez être plus calculateur que je ne le supposais. Peut-être était-ce vous qui aviez profité de ma vanité, avec l’espoir (bien excusable !) de faire de moi, après un intervalle décent, un joli petit essai, avec annotations.
« Quand vous êtes arrivé à Venise, et que nous nous sommes retrouvés, vous rappelez-vous la musique sur la lagune, ce soir-là, de mon balcon ? J’avais une peur affreuse que vous ne commenciez aussitôt à me parler de lui, car le livre sur lui était ma raison officielle d’être venue. Vous n’en avez jamais dit un mot, et je vis bientôt que votre seule appréhension était que j’en parlasse, moi, que je ne vous rappelasse le prétexte de votre présence auprès de moi. C’est alors que j’ai su que vous m’aimiez vraiment. Nous n’avons pas fait allusion au livre une seule fois, n’est-ce pas, durant tout ce mois à Venise ?
« Maintenant que je viens de relire ma lettre, je voudrais vous avoir dit tout ceci, au lieu de vous l’écrire. J’aurais pu chercher ma voie, en lisant sur votre visage, et en examinant si vous compreniez. Mais non. Je n’aurais pas pu retourner à Venise et je n’ai pas davantage pu vous y parler (car j’ai essayé). Je ne pouvais pas gâter ce mois, mon seul mois. Il m’était si doux, pour une fois dans ma vie, d’échapper à la littérature…
« Vous m’en voudrez au commencement, mais pas bien longtemps, hélas ! Ce que j’ai fait eût été cruel de la part d’une jeune femme. Au point où nous en sommes, l’expérience ne fera vraiment de mal qu’à moi-même. Et elle m’en fera horriblement, autant que vous le souhaiterez peut-être dans votre premier mouvement de colère, parce qu’elle m’a montré, pour la première fois, tout ce que j’ai perdu… »
Portrait of Wharton as a child by Edward Harrison May (1870)
Les Metteurs en scène (recueil)
Lendemain
Edith Wharton
Les Metteurs en scène
Traduction par Jeanne Chalençon.Plon, 1909 (p. 123-178).
LENDEMAIN
I
Au départ de Bologne, leur compartiment était complet ; mais à la première station après Milan leur dernier compagnon les quitta ; — c’était un voyageur courtois, qui avait tiré un déjeuner frugal d’un sac en tapisserie, et les avait salués en se levant du coussin jonché de miettes.
L’œil de Lydia suivit avec regret son paletot luisant jusqu’à ce qu’il eût disparu dans la foule des quémandeurs et des cochers de fiacre qui se tenaient aux abords de la gare ; puis elle regarda Gannett et saisit le même regret dans ses yeux. Tous les deux, ils étaient fâchés d’être seuls.
— Partenza ! — criait l’employé.
Le train vibrait sous la secousse des portières fermées brusquement ; un garçon de buffet courut le long du quai avec un plateau de sandwichs desséchés ; un porteur en retard jeta dans une voiture de troisième classe un paquet de châles et de cartons : l’employé répéta un Partenza ! très bref, d’où l’on pouvait conclure que le premier appel avait été purement de parade, — et le train roula hors de la gare.
La direction de la voie avait changé : un rayon de soleil, par-dessus les poussiéreux coussins de velours rouge, atteignit le coin de Lydia. Gannett n’y prit point garde. Il s’était replongé dans sa Revue de Paris, et Lydia dut se lever pour baisser le store. Sur le vaste horizon de leur existence inoccupée, de tels incidents se dessinaient nettement.
Après avoir baissé le store, Lydia se rassit, laissant toute la longueur du compartiment entre elle et Gannett. À la fin, il s’aperçut qu’elle n’était plus en face de lui et leva la tête.
— J’ai fui le soleil, expliqua-t-elle.
Il la regarda curieusement : à travers le store, le soleil frappait encore son visage.
— Très bien, dit-il tranquillement.
Et, tirant de sa poche un étui à cigarettes, il reprit :
— Vous permettez ?…
Ce fut pour elle un repos, un relâche à la tension de son esprit, cette idée qu’après tout, il pouvait fumer !… Mais ce relâche ne fut que d’un moment. Elle n’avait pas grande expérience des fumeurs, — son mari ayant réprouvé l’usage du tabac, — mais elle croyait savoir que dans certains cas les hommes fumaient pour s’étourdir…
Gannett, après une ou deux bouffées, reprit sa lecture.
C’était bien ce qu’elle avait prévu : il craignait de parler tout autant qu’elle. C’était une des misères de leur situation qu’ils ne fussent jamais assez occupés pour que cela nécessitât ou même excusât l’ajournement des discussions pénibles. S’ils évitaient un sujet, c’était évidemment parce que le sujet était désagréable. Ils avaient des loisirs illimités, et toute une accumulation d’énergie mentale à consacrer à la première question qui se présentait ; pour eux, tout ce qui était nouveau faisait prime. Lydia avait parfois comme des pressentiments qu’ils en arriveraient à une période de disette où il ne resterait plus rien de quoi parler, et elle s’était plus d’une fois surprise à distiller goutte à goutte ce que, dans la prodigalité de leurs premières confidences, elle aurait débité d’une haleine. Leur silence pouvait donc s’expliquer par le fait qu’ils n’avaient rien à se dire ; mais un autre désavantage de leur position, c’était les occasions multiples qui s’offraient à eux de classer les moindres nuances. Lydia avait appris à distinguer entre les silences réels et les silences factices ; et à cet instant, sous celui de Gannett, elle découvrait un bourdonnement de paroles auquel ses propres pensées répondaient non moins impétueusement.
Pouvait-il en être autrement, avec cette chose entre eux ?… Lydia leva les yeux vers le filet au-dessus d’elle : oui, la chose était là, dans son sac de voyage, symboliquement suspendue sur leurs deux têtes. Il y pensait, à ce moment, tout comme elle ; ils y avaient pensé, à l’unisson, depuis qu’ils étaient montés dans le train. Tant que le compartiment avait contenu d’autres voyageurs, ceux-ci avaient mis entre elle et lui comme un écran ; maintenant qu’ils étaient seuls, Lydia savait exactement ce qui se passait dans l’esprit de Gannett ; elle l’entendait se demander ce qu’il devait lui dire…
C’était ce matin même, à Bologne, lorsqu’ils se préparaient à quitter l’hôtel, que la chose était parvenue à Lydia sous l’aspect innocent d’une enveloppe banale, avec le reste de leur courrier. En décachetant la lettre, elle avait continué à rire avec Gannett de quelque ineptie du guide local : — ils en étaient réduits, depuis quelque temps, à tirer le meilleur parti possible des incidents humoristiques du voyage. — Même lorsqu’elle eut déplié la feuille, elle s’imagina que c’était un papier d’affaires insignifiant qu’on lui envoyait à signer ; ses yeux parcoururent distraitement les « attendu » tourbillonnants du préambule, jusqu’à ce mot qui l’arrêta : « divorce ». Oui, il était bien là, ce mot, dressant une barrière infranchissable entre le nom de son mari et le sien.
Elle y avait été préparée, bien entendu, comme les gens bien portants sont préparés à la mort : ils savent qu’elle doit venir, sans s’attendre le moins du monde à ce qu’elle vienne. Elle avait su dès le début que Tillotson comptait demander le divorce contre elle ; mais que lui importait ? Rien ne lui importait, dans ces premiers jours de suprême délivrance, hormis le fait qu’elle était libre ; et pas tant — elle commençait à s’en apercevoir — le fait d’être ainsi délivrée de Tillotson que celui d’appartenir maintenant à Gannett. Cette découverte l’avait choquée dans l’estime qu’elle avait d’elle-même. Elle aurait mieux aimé croire que Tillotson incarnait à lui seul toutes les raisons qu’elle avait eues de le quitter ; et ces raisons lui avaient paru assez puissantes pour n’avoir pas besoin de renfort. Et pourtant elle ne l’avait quitté qu’après avoir rencontré Gannett. C’était son amour pour Gannett qui avait fait de la vie avec Tillotson une si pauvre et médiocre affaire. Si, dès le principe, elle n’avait pas regardé son mariage comme un plein abandon de ses droits sur la vie, elle l’avait tout au moins accepté, pour un certain nombre d’années, comme une compensation provisoire ; elle en avait pris son parti.
L’existence, chez les Tillotson, dans leur spacieuse maison de la Cinquième Avenue, — avec Mrs Tillotson mère commandant les abords par ses fenêtres du second étage, — l’existence avait été réduite à une série d’actes purement automatiques. Le moral de l’intérieur Tillotson était aussi soigneusement protégé, aussi pourvu de paravents et de rideaux que la maison elle-même : Mrs. Tillotson mère craignait tout autant les idées que les courants d’air. Ces gens prudents aimaient une température égale ; pour eux, faire quelque chose d’inattendu était aussi absurde que de sortir sous la pluie. Un des principaux avantages de la richesse était de supprimer les éventualités imprévues : avec une fermeté ordinaire et un peu de bon sens, on pouvait être sûr de faire exactement la même chose tous les jours, à la même heure. Ces doctrines, révérencieusement sucées avec le lait de sa mère, Tillotson, le fils modèle qui n’avait jamais donné à ses parents une heure de souci, les exposait complaisamment à sa femme, et citait comme preuves de l’importance qu’il y attachait la régularité avec laquelle il mettait ses caoutchoucs les jours de pluie, sa ponctualité aux repas et ses précautions compliquées contre les cambrioleurs et les maladies contagieuses. Lydia, élevée dans une ville de province et entrant dans le monde de New-York par le portail de la maison Tillotson, avait accepté machinalement cette manière d’envisager les choses comme inséparable du banc qu’on avait dans les premiers rangs au temple et de la baignoire qu’on avait à l’Opéra. Tous les gens qui venaient chez eux évoluaient dans ce même cercle étroit de préjugés. C’était la société où, après dîner, les femmes comparent les prix exorbitants que leur coûte l’éducation de leurs enfants, et conviennent que, malgré les nouveaux droits sur les vêtements importés de France, au bout du compte, il est meilleur marché de tout prendre chez Worth, — tandis que les maris, en fumant leurs cigares, se lamentent sur la corruption municipale et décident que, pour faire des réformes, il faut des hommes qui n’aient pas d’intérêts personnels en jeu.
Cette façon de considérer la vie était devenue pour Lydia une chose toute naturelle, de même que le majestueux landau de sa belle-mère lui semblait le seul moyen de locomotion possible et que le sermon d’un pasteur à la mode, chaque dimanche, était l’inévitable expiation à subir pour s’être ennuyée pendant les six jours de la semaine. Avant qu’elle eût fait la connaissance de Gannett, cette vie lui avait paru simplement monotone ; mais, depuis lors, elle ressemblait, cette vie, à une de ces tristes gravures de Cruikshank où tout le monde est laid et se livre à des occupations vulgaires ou stupides.
Il était naturel que Tillotson fût le premier à pâtir de cette optique nouvelle. Le voisinage de Gannett avait rendu Tillotson ridicule ; une part de ce ridicule retombait sur sa femme. Qu’elle y parût indifférente, et Gannett soupçonnerait chez elle un manque de sensibilité dont elle devait, coûte que coûte, se justifier à ses yeux.
Mais cela, elle ne le comprit que plus tard. Sur le moment, elle s’imagina tout simplement avoir atteint les limites de l’endurance. Dans la magnifique liberté que semblait lui conférer le seul acte de quitter Tillotson, la petite question de divorcer ou de ne pas divorcer ne comptait pas. Mais quand elle s’aperçut qu’elle n’avait quitté son mari que pour vivre avec Gannett, elle vit clairement le sens de tout ce qui touchait à leurs relations. Son mari, en la rejetant, l’avait pour ainsi dire poussée dans les bras de Gannett : c’était ainsi que le monde envisageait la chose. Le degré d’empressement avec lequel Gannett la recevrait allait devenir le sujet d’intéressantes controverses autour des tables à thé et dans les cercles. Elle savait ce qu’on dirait d’elle : elle l’avait entendu si souvent à propos d’autres ! Ce souvenir la consterna. Les hommes parieraient probablement que Gannett ferait « ce qu’il était convenable de faire » ; mais les sourcils des femmes indiqueraient à quel point cette fidélité forcée leur paraîtrait sans valeur ; et, après tout, elles auraient raison. Lydia s’était placée dans une situation où Gannett lui « devait » quelque chose, où, en galant homme, il était tenu de « réparer ». L’idée d’accepter une telle compensation ne lui avait jamais traversé l’esprit ; la prétendue réhabilitation que serait un tel mariage, voilà, pour elle, la seule véritable honte. Ce qu’elle redoutait surtout, c’était d’avoir à s’expliquer avec Gannett, d’avoir à combattre ses arguments, à calculer, malgré elle, l’exacte mesure d’insistance par laquelle il chercherait à les lui imposer. Elle ne savait pas ce qui lui faisait plus horreur : qu’il insistât trop ou trop peu. Dans un cas pareil le sens des proportions même le plus fin pouvait se trouver en défaut : combien facilement il pouvait commettre cette erreur de prendre sa résistance, à elle, pour une épreuve de sa sincérité, à lui ! De quelque côté qu’elle se tournât, elle se heurtait à l’ironie des circonstances : elle avait le sentiment exaspéré de s’être prise au piège de quelque mauvaise plaisanterie.
Au fond de toutes ces préoccupations, il y avait la crainte de ce que Gannett pouvait penser. Tôt ou tard, naturellement, il faudrait qu’il parlât ; mais qu’il pût penser, un moment, que ses paroles auraient le moindre effet, Lydia, en attendant, trouvait cela simplement insupportable. Sa sensibilité, à ce propos, s’aggravait d’une autre crainte à peine consciente jusque-là : celle d’entraver involontairement la liberté de Gannett. Le regarder comme l’instrument de sa libération, résister en elle-même à toute velléité de mainmise conjugale sur son avenir, à lui, — elle avait jugé que tel était le seul moyen de maintenir la dignité de leurs relations. Ses idées n’avaient pas changé ; mais elle se sentait de plus en plus incapable de fixer son esprit sur le point essentiel : la rupture avec Gannett. Sans doute, il était facile de l’admettre, tant qu’elle en reculait assez l’échéance ; mais par le fait même qu’elle l’ajournait ainsi mentalement, est-ce qu’elle n’empiétait pas un peu sur l’avenir de Gannett ? Il faudrait qu’elle eût le courage de discerner le moment où, par un mot ou un regard, leur association volontaire se transformerait en un esclavage d’autant plus dur qu’il ne serait fondé sur aucune de ces obligations communes qui assurent l’équilibre du mariage le plus défectueux.
Lorsqu’à la station suivante un facteur ouvrit la portière, Lydia se recula, pour faire place à l’intrus qu’elle espérait ; mais personne ne monta, et le train continua de rouler paresseusement à travers les blés printaniers et les taillis en bourgeons. Elle commençait à espérer que Gannett parlerait avant le prochain arrêt : elle le guettait furtivement, songeant à revenir s’asseoir en face de lui. Mais la manière dont Gannett s’absorbait dans sa lecture était vraiment trop voulue : Lydia ne bougea pas. Elle ne l’avait jamais vu lire avec un air si évident de repousser toute interruption. À quoi pouvait-il bien penser ? Pourquoi avait-il peur de parler ? Ou bien redoutait-il la réponse qu’elle lui ferait ?
Le train s’arrêta pour laisser passer un express : Gannett posa son livre et regarda par la fenêtre. Tout à coup il se tourna vers Lydia en souriant :
— Voici une charmante vieille villa, fit-il.
Ce ton aisé fut un soulagement pour elle : elle répondit à son sourire, en changeant de place pour se mettre auprès de lui.
Au delà du talus, par la brèche ouverte dans un mur couvert de mousse, elle aperçut la villa, avec ses balustrades effritées, ses fontaines endormies et le satyre de pierre achevant la perspective du tapis vert.
— Vous plairiez-vous là ? demanda-t-il, au moment où le train se remettait en marche.
— Là ?
— Dans un endroit de ce genre, enfin… Il y a au moins deux siècles de solitude sous ces ifs. Cela ne vous plairait pas ?
— Je… je ne sais pas, balbutia-t-elle.
Elle comprenait maintenant qu’il voulait parler.
Il alluma une autre cigarette.
— Il faudra bien pourtant nous établir quelque part ! dit-il en se penchant sur l’allumette.
Lydia répondit, en s’efforçant à l’insouciance :
— Je n’en vois pas la nécessité ! Pourquoi ne pas vivre un peu partout, comme nous l’avons fait jusqu’ici ?
— Mais nous ne pouvons pas voyager toujours, n’est-ce pas ?
— Oh ! « toujours » est un bien grand mot ! répliqua-t-elle en ramassant la revue qu’il avait jetée de côté.
— Je veux dire : tout le reste de notre vie ! fit-il en se rapprochant.
Mais Lydia, par un léger mouvement, esquiva la main qu’il étendait vers la sienne.
— Pourquoi donc faire des plans ? Ne trouvez-vous pas, comme moi, plus agréable de se laisser aller au fil de l’eau ?
Il la regarda avec hésitation.
— Agréable, oui, pour un temps, c’est certain ; mais ne faudra-t-il pas que je me remette au travail, un de ces jours ? Vous savez que je n’ai pas écrit une ligne depuis… tous ces temps-ci, — corrigea-t-il vivement.
Elle tourna vers lui un visage rayonnant de sympathie et de remords :
— Oh ! si c’est là ce que vous voulez dire, si vous désirez écrire, il faut, bien entendu, que nous nous arrêtions quelque part. Comme je suis sotte de n’y avoir pas pensé plus tôt ! Où irons-nous ? Où pensez-vous pouvoir le mieux travailler ? Il ne faut plus perdre de temps.
Il hésita encore.
— J’avais pensé à une villa dans ces parages ; personne ne nous ennuierait. On s’arrangerait une vie calme et paisible. Cela vous irait-il ?
— Mais oui… (Elle se tut et regarda d’un autre côté.) Cependant je croyais… ne m’avez-vous pas dit, une fois, que votre meilleur travail, vous l’aviez fait au milieu de la foule, dans les grandes villes ?… Pourquoi nous enfermer dans un désert ?
Gannett ne répondit pas tout de suite. À la fin, tout en évitant son regard aussi soigneusement qu’elle évitait le sien :
— Ce ne serait peut-être plus la même chose, à présent, fit-il ; je ne peux rien dire, naturellement, avant d’avoir essayé. Un écrivain ne devrait pas être dépendant de son « milieu » ; c’est une erreur de se laisser aller à de telles complaisances envers soi-même, et je pensais que, pour les premiers temps au moins, vous préféreriez être…
Elle le regarda en face :
— Être quoi ?
— Eh bien, mais… être tranquille. Je veux dire…
— Que voulez-vous dire par « les premiers temps » ? — interrompit-elle.
Il se tut de nouveau. Puis :
— Je veux dire après notre mariage.
Elle eut un haut-le-corps et se tourna vers la fenêtre :
— Merci, répliqua-t-elle sèchement.
— Lydia ! s’écria-t-il, décontenancé.
Et Lydia eut jusqu’au plus profond de son être la sensation qu’il avait commis l’inconcevable, l’impardonnable erreur d’anticiper son consentement.
Le train continuait son vacarme tandis que Gannett prenait à tâtons une troisième cigarette. Lydia se taisait toujours.
— Je ne vous ai pas fâchée ? risqua-t-il enfin, sur le ton hésitant d’un homme qui cherche sa voie.
Elle secoua la tête avec un soupir :
— Je croyais que vous compreniez, gémit-elle.
Leurs yeux se rencontrèrent, et elle revint se blottir auprès de lui.
— Voulez-vous savoir comment ne pas me fâcher ?… En tenant pour acquis, une fois pour toutes, que vous m’avez dit ce que vous aviez à me dire sur cette odieuse question ; que j’ai fait de même, et qu’ainsi nous nous retrouvons juste au point où nous en étions, ce matin, avant que… que cet exécrable papier vînt tout gâter entre nous !
— Tout gâter entre nous ? Que diable voulez-vous dire ? N’êtes-vous pas heureuse d’être libre ?
— J’étais libre avant.
— Pas de m’épouser.
— Mais je ne veux pas vous épouser ! s’écria-t-elle.
Elle le vit pâlir.
— Pardonnez mon manque de perspicacité, dit-il lentement. J’avoue que je ne vois pas où vous voulez en venir. En avez-vous assez ? Ou bien ai-je été simplement un… un prétexte à votre départ ? Peut-être aviez-vous peur de voyager seule ? Est-ce cela ? Et maintenant vous voulez me lâcher ? (Sa voix était devenue rauque.) Vous me devez une réponse franche, vous savez. Pas de pitié, je vous en prie !
Les yeux de Lydia se remplirent de larmes tandis qu’elle s’inclinait vers lui :
— Ne voyez-vous pas, dit-elle, que c’est parce que je vous aime ?… parce que je vous aime tant !… Oh ! Ralph ! ne comprenez-vous donc pas combien cela m’humilierait ? Tâchez de vous mettre à ma place. Voyez quelle misère, de devenir votre femme dans de pareilles conditions ! Si je vous avais connu quand j’étais jeune fille… c’eût été un vrai mariage ! Mais maintenant… cette fraude vulgaire à l’égard de la société… d’une société que nous méprisions et dont nous nous moquions… pour rentrer subrepticement dans une situation que nous avons volontairement quittée… ne voyez-vous pas que c’est un compromis indigne de nous ? Ni vous ni moi ne croyons à l’abstraite « sainteté » du mariage ; nous savons tous les deux que point n’est besoin d’une cérémonie pour consacrer notre mutuel amour : quel serait donc notre raison de nous marier, sinon la crainte secrète de chacun que l’autre n’échappe, ou bien le secret désir de regagner tout doucement, oh ! tout doucement, l’estime des gens dont nous avons toujours haï et bafoué la moralité conventionnelle ? Le seul fait que ces gens-là pourraient, après un intervalle convenable, venir dîner avec nous… oui, ces femmes qui pérorent sur l’indissolubilité du mariage et qui me laisseraient aujourd’hui mourir dans le ruisseau parce que je vis « dans le péché… » est-ce que cela ne vous dégoûte pas plus que de les voir nous tourner le dos maintenant ?
Elle s’arrêta. Gannett gardait un silence perplexe.
— Vous jugez des choses trop théoriquement, dit-il enfin d’une voix lente. La vie n’est faite que de compromis.
— La vie d’où nous nous sommes évadés… oui ! Si nous avions consenti à les accepter, ces compromis (elle rougit), nous aurions pu continuer de nous rencontrer aux dîners de Mrs Tillotson.
Il sourit légèrement :
— Je ne pensais pas que nous étions partis pour fonder un nouveau système de morale. Je croyais que c’était parce que nous nous aimions.
— La vie est complexe, oui, sûrement, et n’est-ce pas le fait même de la voir ainsi qui nous sépare des gens qui la voient tout d’une pièce ? S’ils ont raison, eux, si le mariage en lui-même est sacré, et s’il faut que l’individu soit toujours sacrifié à la famille, alors il ne peut y avoir de vrai mariage entre vous et moi, puisque notre vie commune est une protestation contre le sacrifice de l’individu à la famille.
Elle s’interrompit en riant :
— Vous allez dire maintenant que je vous fais une conférence de sociologie. Chacun agit, bien entendu, comme il peut, tiraillé par toute espèce de fils invisibles ; mais au moins rien ne nous force à faire semblant, pour des avantages mondains, de souscrire à un credo qui méconnaît la complexité des motifs humains, classe les gens par des signes arbitraires, et met à la portée de tous l’honneur de figurer sur la liste de Mrs Tillotson. Il peut être nécessaire que le monde soit régi par des conventions ; mais si nous y croyions, pourquoi nous en sommes-nous affranchis ? Et si nous n’y croyons pas, est-il honnête de profiter de la protection qu’elles assurent ?
Gannett hésita.
— On peut y croire ou n’y pas croire, dit-il ; mais, tant qu’elles gouvernent le monde, ce n’est qu’en profitant de leur protection que l’on peut trouver un modus vivendi.
— Est-ce que les gens hors la loi ont besoin de modus vivendi ?
Il la regarda, découragé. Il n’y a, en effet, rien de plus déconcertant pour un homme que le procédé mental d’une femme qui raisonne ses émotions.
Lydia crut avoir marqué un point et poursuivit passionnément son avantage :
— Vous comprenez, n’est-ce pas ? vous voyez à quel point une telle idée m’humilie ? Si nous sommes ensemble aujourd’hui, c’est parce que nous l’avons voulu : ne cherchons pas plus loin !
Elle lui prit les mains :
— Promettez-moi que vous ne me parlerez jamais plus de cela ; promettez-moi que vous n’y penserez même plus ! implora-t-elle, en accentuant les mots avec émotion.
À travers tout ce qui suivit, — les protestations, les arguments de Gannett, et sa soumission finale, mais sans conviction, — Lydia eut le sentiment qu’il ne discernait qu’à moitié tout ce qui, pour elle, avait rendu ce moment si pénible. Ils avaient atteint ce point mémorable dans toutes les histoires de cœur où, pour la première fois, l’homme paraît inintelligent et la femme déraisonnable. À la réflexion, ce fut l’empressement un peu maladroit de Gannett qui consola Lydia de son manque de finesse. Après tout, n’eût-ce pas été pire, incalculablement pire, s’il s’était montré trop prompt à la comprendre ?
II
Quand, à la tombée de la nuit, le train les déposa enfin au bord d’un des lacs, Lydia fut bien aise de n’avoir pas, comme d’habitude, à passer d’une solitude dans une autre. Leur perpétuel voyage, depuis un an, avait ressemblé à une fuite de proscrits : à travers la Sicile, la Dalmatie, la Transylvanie et l’Italie méridionale, ils avaient tacitement persisté à éviter leur prochain. L’isolement, d’abord, avait donné une saveur plus profonde à leur bonheur, comme la nuit donne plus d’intensité au parfum de certaines fleurs ; mais, dans la nouvelle phase où ils entraient, le plus vif désir de Lydia était qu’ils ne fussent plus exposés de cette façon anormale à l’action mutuelle de leurs pensées.
Elle frémit pourtant lorsque la masse illuminée de l’élégant hôtel anglo-américain dressa sur la rive, devant le bateau qui avançait, tout ce qu’il représentait d’ordre social, — liste des voyageurs, services religieux, et douce inquisition de la table d’hôte. Le fait seul que dans quelques minutes, elle figurerait sur le registre de l’hôtel sous le nom de Mrs Gannett semblait affaiblir le ressort de sa résistance.