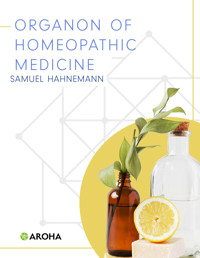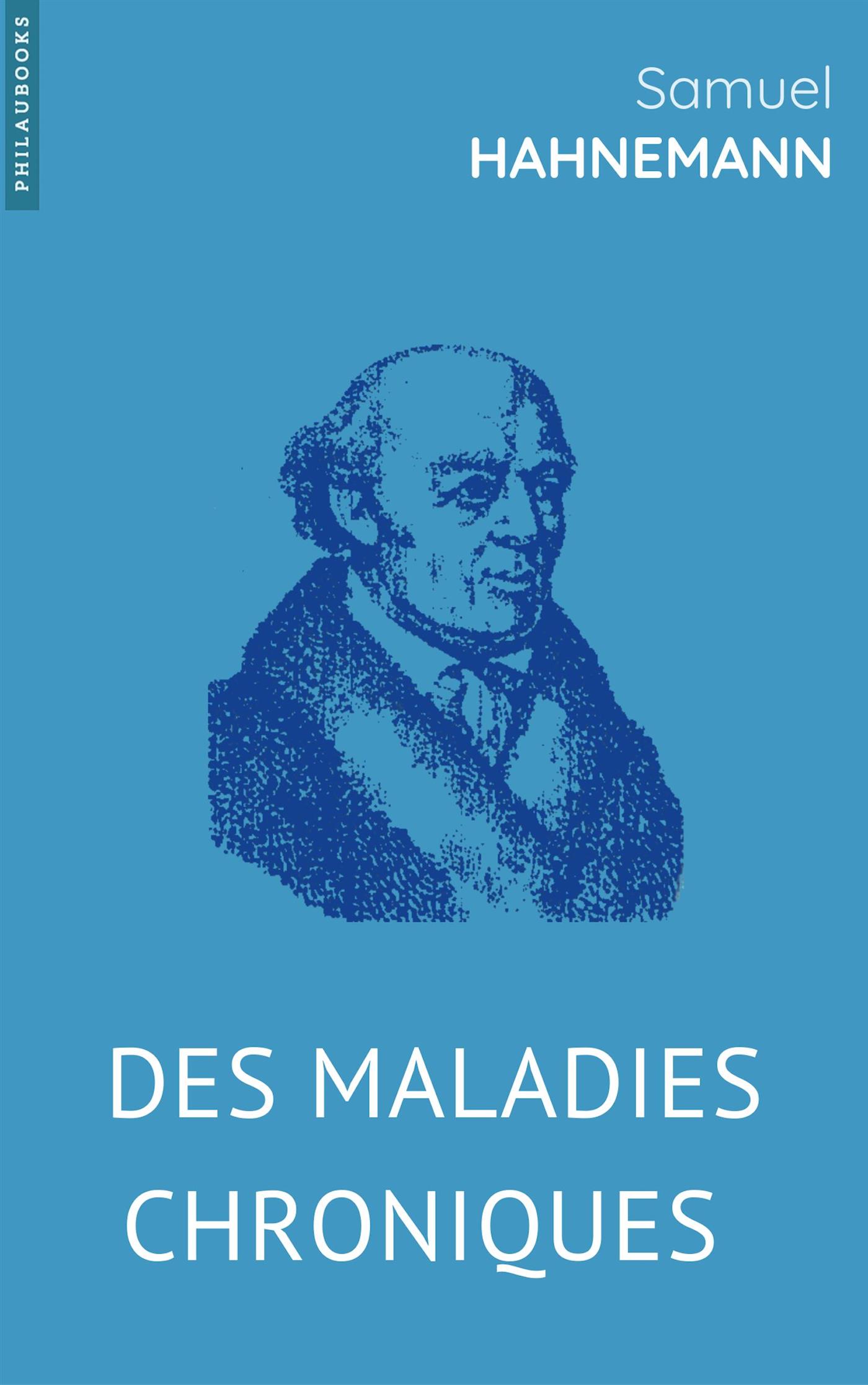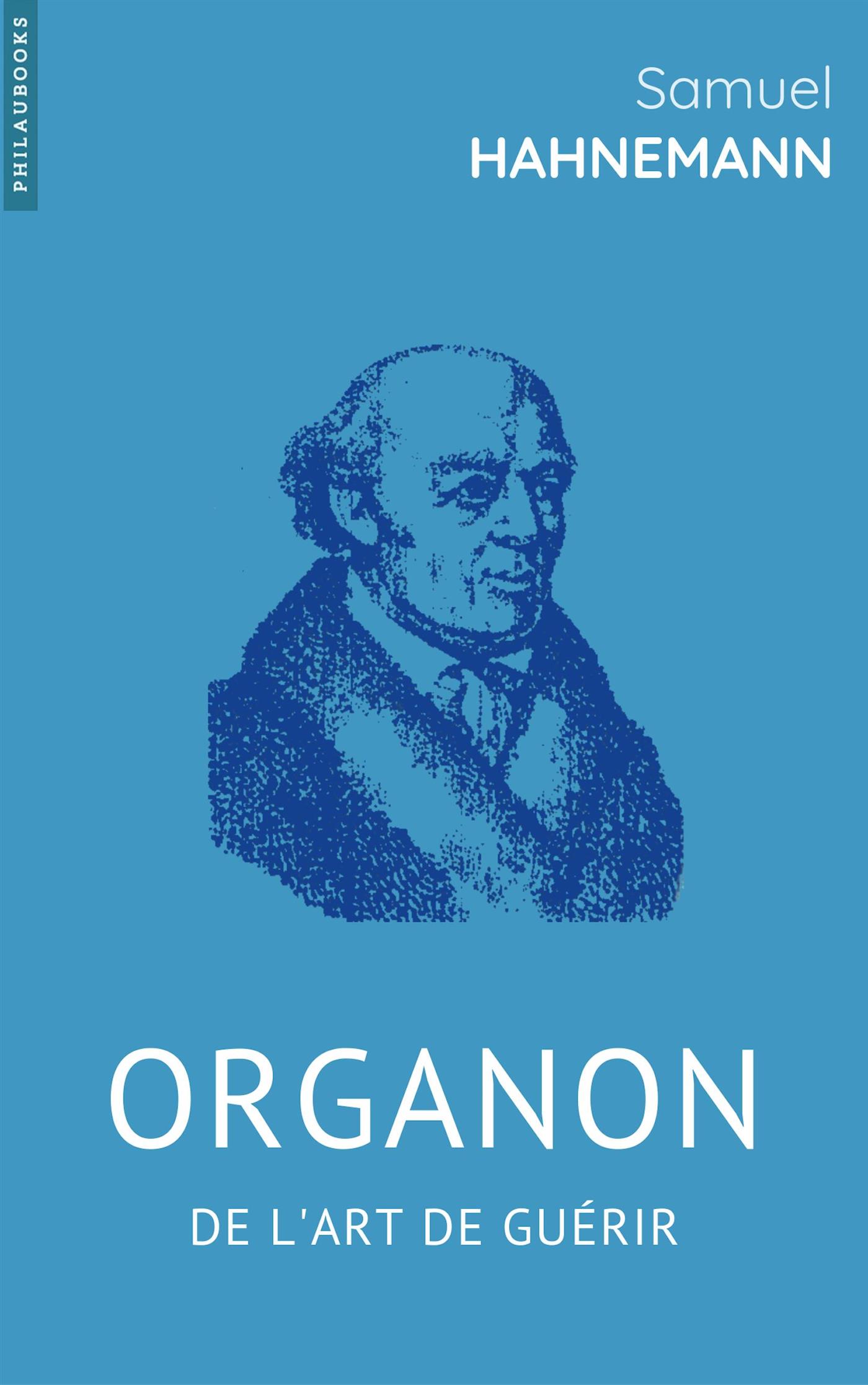
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
- Texte révisé suivi de repères chronologiques.
Important : Les critiques qu'il formule contre la médecine s'adresse à la médecine de l'époque et à ses méthodes (Claude Bernard publiera Introduction à l’étude de la médecine expérimentale en 1864).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Organon de l’art de guérir
Samuel Hahnemann
Traduction parAntoine-Jacques-Louis Jourdan
Table des matières
Édition numérique du 2/06/2020.
Préface de l’auteur.
Introduction
Organon de la médecine
Notes
Repères chronologiques
Édition numérique du 2/06/2020.
Texte révisé suivit de Repères chronologiques.
Cette édition reprend les écrits de Samuel Hahnemann publiés dans :
S. Hahnemann, Exposition de la doctrine médicale homœopathique ou Organon de l’art de guérir, Traduit de l’allemand sur la dernière édition, par le docteur A.J.L. Jourdan, Paris, J.B. Baillière1, 1856.
Traduit de l’allemand sur la cinquième édition (1833).
Copyright © 2020 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.
ISBN : 979-10-372-0178-2
Préface de l’auteur.
L’ancienne médecine, ou l’allopathie, pour dire quelque chose d’elle en général, suppose, dans le traitement des maladies, tantôt une surabondance de sang (pléthore), qui n’a jamais lieu, tantôt des principes et des âcretés morbifiques. En conséquence, elle enlève le sang nécessaire à la vie, et cherche soit à balayer la prétendue matière morbifique, soit à l’attirer ailleurs, au moyen des vomitifs, des purgatifs, des sudorifiques, des sialagogues. des diurétiques, des vésicatoires, des cautères, des exutoires de toute espèce, etc.
Elle s’imagine, par là, diminuer la maladie et la détruire matériellement. Mais elle ne fait qu’accroître les souffrances du malade, et prive par ce moyen et par l’emploi d’agents douloureux, l’organisme des forces et des sucs nourriciers nécessaires à la guérison. Elle attaque le corps par des doses considérables, longtemps continuées et fréquemment renouvelées, de médicaments héroïques, dont les effets prolongés et assez souvent redoutables lui sont inconnus. Elle semble même prendre à tâche d’en rendre l’action méconnaissable, en accumulant plusieurs substances inconnues dans une seule formule. Enfin, par un long usage de ces médicaments, elle ajoute à la maladie déjà existante de nouvelles maladies médicinales, qu’il est parfois impossible de guérir. Elle ne manque jamais non plus, pour se maintenir en crédit auprès des malades 1, d’employer, quand elle le peut, des moyens qui, par la loi d’opposition contrariacontrariiscurantur, suppriment et pallient pendant quelque temps les symptômes, mais laissent derrière eux une plus forte disposition à les reproduire, c’est-à-dire exaspèrent la maladie elle-même.
Elle regarde à tort les maux qui occupent les parties extérieures du corps comme étant purement locaux, isolés, indépendants, et croit les avoir guéris quand elle les a fait disparaître par des topiques, qui obligent le mal interne de se jeter sur une partie plus noble et plus importante. Lorsqu’elle ne sait plus que faire contre la maladie qui refuse de céder, ou qui va toujours en s’aggravant, elle entreprend, du moins en aveugle, de la modifier par les altérants, notamment avec le calomélas, le sublimé corrosif et autres préparations mercurielles à hautes doses lesquelles minent l’existence.
Rendre au moins incurables, sinon même mortelles, les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des maladies, celles qui affectent la forme chronique, soit en débilitant et tourmentant sans cesse le faible malade accablé déjà de ses propres maux, soit en lui attirant de nouvelles et redoutables affections médicinales, tel paraît être le but des funestes efforts de l’ancienne médecine, l’allopathie, but auquel on parvient aisément lorsqu’une fois on s’est mis au courant des méthodes accréditées, et rendu sourd à la voix de la conscience.
Les arguments ne manquent point à l’allopathiste pour défendre tout ce qu’il fait de mal ; mais il ne s’étaye jamais que des préjugés de ses maîtres ou de l’autorité de ses livres. Il y trouve de quoi justifier les actions les plus opposées et les plus contraires au bon sens, quelque hautement qu’elles soient condamnées par le résultat. Ce n’est que lorsqu’une longue pratique l’ayant convaincu des tristes effets de son art prétendu, il se borne à d’insignifiantes boissons, c’est-à-dire à ne rien faire, dans les cas mêmes les plus graves, que les malades commencent à empirer et mourir moins souvent entre ses mains.
Cet art funeste, qui, depuis une longue suite de siècles, est en possession de statuer arbitrairement sur la vie et la mort des malades, qui fait périr dix fois plus d’hommes que les guerres les plus meurtrières, et qui en rend des millions d’autres infiniment plus souffrants qu’ils ne l’étaient dans l’origine, je l’examinerai tout à l’heure avec quelques détails, avant d’exposer les principes de la nouvelle médecine, qui est la seule vraie.
Il en est autrement de l’homéopathie. Elle démontre sans peine à tous ceux qui raisonnent que les maladies ne dépendent d’aucune âcreté, d’aucun principe morbifique matériel, mais qu’elles consistent uniquement en un désaccord dynamique de la force qui anime virtuellement le corps de l’homme. Elle sait que la guérison ne peut avoir lieu qu’au moyen de la réaction de la force vitale contre un médicament approprié, et qu’elle s’opère d’autant plus sûrement et promptement que cette force vitale conserve encore davantage d’énergie chez le malade.
Aussi évite-t-elle tout ce qui pourrait débiliter le moins du monde 2, se garde-t-elle, autant que possible, d’exciter la moindre douleur, parce que la douleur épuise les forces ; n’emploie-t-elle que des médicaments dont elle connaît bien les effets, c’est-à-dire la manière de modifier dynamiquement l’état de l’homme ; cherche-t-elle parmi eux celui dont la faculté modifiante (la maladie médicinale) est capable de faire cesser la maladie par son analogie avec elle (similia similibus), et donne-t-elle celui-là seul, à doses rares et faibles, qui, sans causer de douleur ni débiliter, excitent néanmoins une réaction suffisante. Il résulte de là qu’elle éteint la maladie naturelle sans affaiblir, tourmenter ou torturer le malade ; et que les forces reviennent d’elles-mêmes à mesure que l’amélioration se dessine. Cette œuvre, qui aboutit à rétablir la santé des malades en peu de temps, sans inconvénients et d’une manière complète, semble facile, mais elle est pénible et exige beaucoup de méditations.
L’homéopathie s’offre donc à nous comme une médecine très simple, toujours la même dans ses principes et dans ses procédés, laquelle semble, quand elle est bien comprise, faire un tout complet comme la doctrine d’où elle découle. La clarté de ses principes et la précision de ses moyens sont telles que l’esprit les saisit aisément ; et comme l’homéopathie offre seule des agents curatifs, il n’est pas permis à ses adeptes de revenir aux pratiques routinières de l’ancienne école, dont les principes sont aussi différents des nôtres que le jour l’est de la nuit, sans renoncer par cela même au titre d’homéopathes3.
Lorsque des homéopathes se laissant entraîner à de semblables erreurs, essayent de mêler les pratiques fautives de l’allopathie à leurs prétendus traitements homéopathiques, ils montrent par là qu’ils n’ont pas une connaissance complète de notre doctrine. Ils font preuve en même temps de paresse, d’un mépris impardonnable des souffrances des hommes, d’une présomption ridicule et d’une négligence inexplicable qui les empêchent de rechercher le meilleur spécifique homéopathique pour chaque cas de maladie. Ils agissent souvent ainsi par cupidité et par d’autres motifs moins nobles encore. Et pourquoi résultat ? Pour se trouver impuissants devant les maladies chroniques graves que l’homéopathie peut cependant guérir, quand on l’applique seule et avec soin ; ou pour vouer à la mort un grand nombre de leurs malades. Il est vrai que ces praticiens offrent une consolation aux parents, en leur disant qu’ils ont tout fait pour ravir le malade à la mort ; tout, même les pernicieuses pratiques de l’allopathie !
Samuel HAHNEMANN.
Cœthen, le 28 mars 1833.
Introduction
Coup d’œil sur les méthodes allopathique et palliative des écoles qui ont dominé jusqu’à ce jour en médecine.
Depuis que les hommes existent sur la terre, ils ont été, individuellement ou en masse, exposés à l’influence de causes morbifiques, physiques ou morales. Tant qu’ils sont demeurés dans l’état de pure nature, des remèdes en petit nombre leur ont suffi, parce que la simplicité de leur genre de vie ne les rendait accessibles qu’à peu de maladies. Mais les causes d’altération de la santé et le besoin de secours ont crû proportionnellement aux progrès de la civilisation.
Dès lors, c’est-à-dire depuis les temps qui ont suivi de près Hippocrate, ou depuis deux mille cinq cents ans, il y eut des hommes qui s’adonnèrent au traitement des maladies, chaque jour de plus en plus multipliées, et que la vanité conduisit à chercher dans leur imagination des moyens de les soulager. Tant de têtes diverses firent éclore une infinité de doctrines sur la nature des maladies et de leurs remèdes, qu’on décora du nom de systèmes, et qui étaient toutes en contradiction les unes avec les autres comme avec elles-mêmes. Chacune de ces théories subtiles étonnait d’abord le monde par sa profondeur inintelligible, et attirait à son auteur une foule d’enthousiastes prosélytes, dont aucun ne pouvait cependant rien tirer d’elle qui lui fut utile dans la pratique, jusqu’à ce qu’un nouveau système, souvent tout à fait opposé au précédent, fit oublier celui-ci, et à son tour s’emparât pendant quelque temps de la renommée. Mais nul de ces systèmes ne s’accordait avec la nature et avec l’expérience. Tous étaient des tissus de subtilités, conduisant à des conséquences illusoires, qui ne pouvaient servir à rien au lit du malade, et qui n’étaient propres qu’à alimenter de vaines disputes.
À côté de ces théories, et sans nulle dépendance d’elles, se forma une méthode qui consiste à diriger des mélanges de médicaments inconnus contre des formes de maladies arbitrairement admises, le tout d’après des vues matérielles en contradiction avec la nature et l’expérience, et par conséquent sans résultat avantageux. C’est là l’ancienne médecine, qu’on appelle allopathie.
Sans méconnaître les services qu’un grand nombre de médecins ont rendus aux sciences accessoires de l’art de guérir, à la physique, à la chimie, à l’histoire naturelle, dans ses différentes branches, et à celle de l’homme en particulier, à l’anthropologie, à la physiologie, à l’anatomie, etc., je ne m’occupe ici que de la partie pratique de la médecine, pour montrer combien est imparfaite la manière dont les maladies ont été traitées jusqu’à ce jour.
Mes vues s’élèvent bien au-dessus de cette routine mécanique qui se joue de la vie si précieuse des hommes, en prenant pour guide des recueils de recettes, dont le nombre chaque jour croissant prouve à quel point est malheureusement encore répandu l’usage qu’on en fait. Je laisse ce scandale à la lie du peuple médical, et je m’occupe seulement de la médecine régnante, qui s’imagine que son ancienneté lui donne réellement le caractère d’une science.
Cette vieille médecine se vante d’être la seule qui mérite le titre de rationnelle, parce qu’elle est la seule, dit-elle, qui s’attache à rechercher et à écarter la cause des maladies, la seule aussi qui suive les traces de la nature dans le traitement des maladies.
Tolle causam ! s’écrie-t-elle sans cesse ; mais elle s’en tient à cette vaine clameur. Elle se figure pouvoir trouver la cause de la maladie, mais ne la trouve point en réalité, parce qu’on ne peut ni la connaître, ni par conséquent la rencontrer. En effet, la plupart, l’immense majorité même, des maladies étant d’origine et de nature dynamiques, leur cause ne saurait tomber sous les sens. On était donc réduit à en imaginer une. En comparant, d’un côté, l’état normal des parties internes du corps humain après la mort (anatomie) avec les altérations visibles que ces parties présentent chez les sujets morts de maladies (anatomie pathologique), de l’autre, les fonctions du corps vivant (physiologie) avec les aberrations infinies qu’elles subissent dans les innombrables états morbides (pathologie, séméiotique), et tirant de là des conclusions par rapport à la manière invisible dont les changements s’effectuent dans l’intérieur de l’homme malade, on arrivait à se former une image vague et fantastique, que la médecine théorique regardait comme la cause première de la maladie 1, dont on faisait ensuite la cause prochaine et en même temps l’essence intime de cette maladie, la maladie même, quoique le bon sens dise que la cause d’une chose ne saurait être cette chose elle-même. Maintenant, comment pouvait-on, sans vouloir s’en imposer à soi-même, faire de cette essence insaisissable un objet de guérison, prescrire contre elle des médicaments dont la tendance curative était également inconnue, du moins pour la majeure partie d’entre eux, et surtout accumuler plusieurs de ces substances inconnues dans ce qu’on appelait des formules ?
Cependant le sublime projet de trouver a priori une cause interne et invisible de la maladie se réduisait, du moins chez les médecins réputés les plus raisonnables de l’ancienne école, à rechercher, en prenant, il est vrai, aussi pour base les symptômes, ce que l’on pouvait présumer être le caractère générique de la maladie présente2. On voulait savoir si c’était le spasme, la faiblesse ou la paralysie, la fièvre ou l’inflammation, l’induration ou l’obstruction de telle ou telle partie, la pléthore sanguine, l’excès ou le défaut d’oxygène, de carbone, d’hydrogène ou d’azote dans les humeurs ; l’exaltation ou l’affaissement de la vitalité du système artériel, ou veineux, ou capillaire ; un défaut dans les proportions relatives des facteurs de la sensibilité, de l’irritabilité ou de la nutrition. Ces conjectures, honorées par l’école du nom d’indications procédant de la cause, et regardées comme la seule rationalité possible en médecine, étaient trop hypothétiques et trop fallacieuses pour pouvoir jouir de la moindre utilité dans la pratique. Incapables même, quand elles eussent été fondées, de faire connaître le meilleur remède à employer dans tel ou tel cas donné, elles flattaient bien l’amour-propre de celui qui les avait laborieusement enfantées ; mais elles l’induisaient la plupart du temps en erreur, quand il prétendait agir d’après elles. C’était plutôt par ostentation qu’on s’y livrait que dans l’espoir sérieux de pouvoir en profiter pour parvenir à la véritable indication curative.
Combien n’arrivait-il pas souvent que le spasme ou la paralysie semblait exister dans une partie de l’organisme, tandis que l’inflammation paraissait avoir lieu dans une autre ?
D’une autre part, d’où pouvait-il sortir des remèdes assurés contre chacun de ces prétendus caractères généraux ? Ceux qui auraient guéri sûrement n’auraient pu être que les spécifiques, c’est-à-dire les médicaments dont l’action était homogène à l’irritation morbifique 3 ; mais l’ancienne école les proscrivait comme très dangereux4, parce qu’en effet l’expérience avait démontré qu’avec les fortes doses consacrées par l’usage, ils compromettaient la vie dans les maladies où l’aptitude à ressentir des irritations homogènes est portée à un si haut degré. Or l’ancienne école ne soupçonnait pas qu’on put administrer les médicaments à des doses très faibles et même extrêmement petites. Ainsi on ne devait et on ne pouvait pas guérir par la voie directe et la plus naturelle, c’est-à-dire par des remèdes homogènes et spécifiques, puisque la plupart des effets que les médicaments produisent étaient et demeuraient inconnus, et que, quand bien même on les eût connus, on n’aurait jamais pu, avec des habitudes semblables de généralisation, deviner la substance qu’il était le plus à propos d’employer.
Cependant, l’ancienne école, qui sentait fort bien qu’il est plus rationnel de suivre le droit chemin que de s’engager dans les voies détournées, croyait encore guérir directement les maladies en éliminant leur prétendue cause matérielle. Car il lui était presque impossible de renoncer à ces idées grossières, en cherchant, soit à se faire une image de la maladie, soit à découvrir les indications curatives ; il n’était pas non plus en son pouvoir de reconnaître la nature, à la fois spirituelle et matérielle de l’organisme pour un être si élevé que les altérations de ses sensations et actions vitales, qu’on nomme maladies, résultent principalement, presque uniquement même, d’impressions dynamiques, et ne pourraient être déterminées par nulle autre cause.
L’école considérait donc toute matière altérée par la maladie, qu’elle fût ou seulement turgescente, ou rejetée au dehors, comme la cause excitatrice de cette maladie, ou du moins, en raison de sa prétendue réaction, comme celle qui l’entretient ; et cette dernière opinion, elle l’admet encore aujourd’hui.
Voilà pourquoi elle croyait opérer des cures portant sur les causes, en faisant tous ses efforts pour expulser du corps les causes matérielles qu’elle supposait à la maladie. De là, son attention à faire vomir, pour évacuer la bile dans les fièvres bilieuses 5, sa méthode de prescrire des vomitifs dans les affections de l’estomac6, son empressement à expulser la pituite et les vers dans la pâleur de la face, la boulimie, les tranchées et enflure du ventre chez les enfants7, sa coutume de saigner dans les hémorragies 8, et principalement l’importance quelle attache aux émissions sanguines de toute espèce 9, comme indication principale à remplir dans les inflammations ; comme un célèbre praticien de l’école de Paris recommande de la faire, croyant pouvoir guérir une maladie avec un nombre considérable de sangsues, quel que soit le lieu qu’elle occupe. Une foule de praticiens suivent cette routine comme des moutons.
En agissant ainsi, elle croit obéir à des indications véritablement déduites de la cause et traiter les malades d’une manière rationnelle. Elle s’imagine également, en liant un polype, extirpant une glande tuméfiée, ou la faisant détruire par la suppuration déterminée au moyen d’irritants locaux, disséquant un kyste stéatomateux ou mélicéritique, opérant un anévrysme, une fistule lacrymale ou une fistule à l’anus, amputant un sein cancéreux ou un membre dont les os sont frappes de carie, etc., avoir guéri les maladies d’une manière radicale, en avoir détruit les causes. Elle a la même croyance quand elle fait usage de ses répercussifs, et dessèche de vieux ulcères aux jambes par l’emploi des astringents, des oxydes de plomb, de cuivre et de zinc, associés, il est vrai, à des purgatifs, qui ne diminuent point le mal fondamental, et ne font qu’affaiblir ; quand elle cautérise les chancres, détruit localement les fics et les verrues, et repousse la gale de la peau par les onguents de soufre, de plomb, de mercure ou de zinc ; enfin quand elle fait disparaître une ophtalmie par des dissolutions de plomb et de zinc, et qu’elle chasse les douleurs des membres au moyen du baume Opodeldoch, des pommades ammoniacées ou des fumigations de cinabre et d’ambre. Dans tous ces cas, elle s’imagine avoir anéanti le mal et opéré un traitement rationnel dirigé contre la cause. Mais quelles sont les suites ? Des formes nouvelles de maladies, qui se manifestent infailliblement, soit plus tôt, soit plus tard, qu’on donne, quand elles paraissent, pour des maladies nouvelles, et qui sont toujours plus fâcheuses que l’affection primitive, réfutent assez hautement les théories de l’école. Elles devraient lui ouvrir les yeux, en prouvant que le mal a une nature immatérielle plus profondément cachée, que son origine est dynamique, et qu’il ne peut être détruit que par une puissance dynamique.
L’hypothèse que l’école a généralement préférée jusque dans les temps modernes, je pourrais même dire jusqu’à ce jour, est celle des principes morbifiques et des âcretés, qu’à la vérité elle subtilisait beaucoup. De ces principes, il fallait débarrasser les vaisseaux sanguins et lymphatiques, par les organes urinaires ou les glandes salivaires ; la poitrine, par les glandes trachéales et bronchiales ; l’estomac et le canal intestinal, par le vomissement et les déjections alvines ; sans quoi on ne se croyait point en droit de dire que le corps avait été nettoyé de la cause matérielle excitant la maladie, et qu’on avait opéré une cure radicale d’après le principe tolle causam.
En pratiquant à la peau des ouvertures que la présence habituelle d’un corps étranger convertissait en ulcères chroniques (cautères, sétons), elle s’imaginait soutirer la matière peccante du corps, qui n’est jamais malade que dynamiquement, comme on fait sortir la lie d’un tonneau en le perçant avec un foret. Elle croyait aussi attirer les mauvaises humeurs au-dehors par des vésicatoires entretenus à perpétuité. Mais tous ces procédés, absurdes et contraires à la nature, ne faisaient qu’affaiblir les malades et les rendre enfin incurables.
Je conviens qu’il était plus commode pour la faiblesse humaine de supposer, dans les maladies qui se présentaient à guérir, un principe morbifique dont l’esprit pouvait concevoir la matérialité, d’autant mieux que les malades eux-mêmes se prêtaient volontiers à une telle hypothèse. Effectivement, en l’admettant, on n’avait qu’à s’occuper de faire prendre une quantité de médicaments suffisante pour purifier le sang et les humeurs, provoquer la sueur, faciliter l’expectoration, balayer l’estomac et l’intestin. Voilà pourquoi toutes les matières médicales qui ont paru depuis Dioscoride gardent un silence presque absolu sur l’action propre et spéciale de chaque médicament, et se bornent à dire, après avoir énuméré ses vertus prétendues contre telle ou telle maladie nominale de la pathologie, qu’il sollicite les urines, la sueur, l’expectoration ou le flux menstruel, et surtout qu’il a la propriété de chasser par haut ou par bas le contenu du canal alimentaire, parce qu’en tout temps les efforts des praticiens ont eu pour tendance principale l’expulsion d’un principe morbifique matériel et de plusieurs âcretés qu’ils se figuraient être la cause des maladies.
C’étaient là de vains rêves, des suppositions gratuites, des hypothèses dénuées de base, habilement imaginées pour la commodité de la thérapeutique, qui se flattait d’avoir une tâche plus facile à remplir quand il s’agirait pour elle de combattre des principes morbifiques matériels (si modo essent).
Mais l’essence des maladies et leur guérison ne se plient point à nos rêves et aux désirs de notre paresse. Les maladies ne peuvent pas, pour complaire à nos folles hypothèses, cesser d’être des aberrations dynamiques que notre vie spirituelle éprouve dans sa manière de sentir et d’agir ; c’est-à-dire des changements immatériels dans notre manière d’être.
Les causes de nos maladies ne sauraient être matérielles, puisque la moindre substance matérielle étrangère 10, quelque douce qu’elle nous paraisse, qu’on introduit dans les vaisseaux sanguins, est repoussée tout à coup comme un poison par la force vitale, ou, si elle né peut l’être, occasionne la mort. Que le plus petit corps étranger vienne à s’insinuer dans nos parties sensibles, le principe de la vie qui est répandu partout dans notre intérieur n’a pas de repos jusqu’à ce qu’il ait procuré l’expulsion de ce corps par la douleur, la fièvre, la suppuration ou la gangrène. Et dans une maladie de peau datant d’une vingtaine d’années, ce principe vital, dont l’activité est infatigable, souffrirait avec patience pendant vingt ans, dans nos humeurs, un principe exanthématique matériel, un virus dartreux, scrofuleux ou goutteux ! Quel nosologiste a jamais vu aucun de ces principes morbifiques, dont il parle avec tant d’assurance, et sur lesquels il prétend construire un plan de conduite médicale ? Qui jamais mettra sous les yeux de personne un principe goutteux, un virus scrofuleux ?
Lors même que l’application d’une substance matérielle à la peau, ou son introduction dans une plaie, a propagé des maladies par infection, qui pourrait prouver que, comme on l’affirme si souvent dans nos pathogénésies, la moindre parcelle matérielle de cette substance pénètre dans nos humeurs ou se trouve absorbée 11 ? On a beau se laver les parties génitales avec le plus grand soin et le plus promptement possible, cette précaution ne garantit pas de la maladie chancreuse vénérienne. II suffit d’un faible souffle qui s’échappe d’un homme atteint de la variole pour produire cette redoutable maladie chez l’enfant bien portant.
Combien en poids doit-il pénétrer ainsi de ce principe matériel dans les humeurs pour produire, dans le premier cas, une maladie (la syphilis) qui, à défaut de traitement, durera jusqu’au terme le plus reculé de la vie, ne s’éteindra qu’à la mort, et, dans le second, une affection (la variole) qui fait souvent périr avec rapidité au milieu d’une suppuration presque générale 12. Est-il possible d’admettre, dans ces deux circonstances et autres analogues, un principe morbifique matériel qui ait passé dans le sang ? On a vu souvent des lettres écrites dans la chambre d’un malade communiquer la même maladie miasmatique à celui qui les lisait. Peut-on songer alors à quelque chose de matériel qui pénètre dans les humeurs ? Mais à quoi bon toutes ces preuves ? Combien de fois n’a-t-on pas vu des propos offensants occasionner une fièvre bilieuse qui mettait la vie en danger, une indiscrète prophétie causer la mort à l’époque prédite, et une surprise agréable ou désagréable suspendre subitement le cours de la vie ? Où est alors le principe morbifique matériel qui s’est glissé en substance dans le corps, qui a produit la maladie, qui l’entretient, et sans l’expulsion matérielle duquel, par des médicaments, toute cure radicale serait impossible ?
Les partisans d’une hypothèse aussi grossière que celle des principes morbifiques devraient rougir de méconnaître à ce point la nature immatérielle de notre vie et le pouvoir dynamique des causes qui font naître des maladies, et de se rabaisser ainsi au rôle ignoble de gens qui, dans leurs vains, efforts pour balayer des matières peccantes dont l’existence est une chimère, tuent les malades au lieu de les guérir.
Les crachats, souvent si dégoûtants, qu’on observe dans les maladies, seraient-ils donc précisément la matière qui les engendre et les entretient 13 ? Ne sont-ils pas plutôt toujours des produits de la maladie, c’est-à- dire du trouble purement dynamique que la vie a éprouvé ?
Avec ces fausses idées matérielles sur l’origine et l’essence des maladies, il n’est pas surprenant que, dans tous les temps, les petits comme les grands praticiens, et même les inventeurs des systèmes les plus sublimes, n’aient eu pour but principal que l’élimination et l’expulsion d’une prétendue matière morbifique, et que l’indication le plus fréquemment établie ait été celle d’inciser cette matière, de la rendre mobile, de procurer sa sortie par la salive, les crachats, la sueur et l’urine, de purifier le sang par faction intelligente des tisanes, de le débarrasser ainsi d’âcretés et d’impuretés qui n’y existèrent jamais, de soutirer mécaniquement le principe imaginaire de la maladie par des sétons, des cautères, des vésicatoires permanents, mais principalement de faire sortir la matière peccante, comme on la nomme, par le canal intestinal, au moyen de laxatifs et de purgatifs, décorés du titre d’apéritifs et de dissolvants, afin de leur donner plus d’importance et des dehors plus imposants. Ces efforts d’expulsion d’une matière morbifique capable d’engendrer et d’entretenir les maladie, devaient nécessairement échouer ; l’organisme vivant étant sous la dépendance d’un principe vital immatériel, et la maladie n’étant qu’un désaccord dynamique de cette puissance sous le rapport de ses sensations et de ses actes.
Maintenant si nous admettons, ce dont il n’est pas permis de douter, qu’à l’exception des maladies provoquées par l’introduction de substances tout à fait indigestes ou nuisibles dans les organes digestifs ou autres viscères creux, par la pénétration de corps étrangers à travers la peau, etc., il n’en existe aucune qui ait pour cause un principe matériel, que toutes, au contraire, elles sont uniquement et toujours le résultat spécial d’une altération virtuelle et dynamique de la santé, combien les méthodes de traitement qui ont pour base l’expulsion 14 de ce principe imaginaire doivent-elles paraître mauvaises à l’homme sensé, puisqu’il n’en peut rien résulter de bon dans les principales maladies de l’homme, les chroniques, et qu’au contraire elles nuisent toujours énormément ?
Les matières dégénérées et les impuretés qui deviennent visibles dans les maladies, ne sont autre chose, personne n’en disconviendra, que des produits de la maladie, dont l’organisme sait se débarrasser, d’une manière parfois trop violente, sans le secours de la médecine évacuante, et qui renaissent aussi longtemps que dure la maladie. Ces matières s’offrent souvent au vrai médecin comme des symptômes morbides, et l’aident à tracer le tableau de la maladie, dont il se sert ensuite pour chercher un agent médicinal homéopathique propre à guérir celle-ci.
Mais les partisans actuels de l’ancienne école ne veulent plus être regardés comme ayant pour but, dans leurs traitements, d’expulser des principes morbifiques matériels. Ils donnent aux évacuations nombreuses et variées qu’ils emploient le nom de méthode dérivative, et prétendent ne faire en cela qu’imiter la nature de l’organisme malade, qui, dans ses efforts pour rétablir la santé, juge la fièvre par la sueur et l’urine ; la pleurésie par le saignement de nez, des sueurs et des crachats muqueux ; d’autres maladies par le vomissement, la diarrhée et le flux de sang ; les douleurs articulaires par des ulcérations aux jambes ; l’angine par la salivation ou par des métastases et des abcès qu’elle fait naître dans des parties éloignées du siège du mal.
D’après cela, ils croient n’avoir rien de mieux à faire qu’à imiter la nature, et prennent des voies détournées dans le traitement de la plupart des maladies. Aussi, marchant sur les traces de la force vitale malade abandonnée à elle-même, procèdent-ils d’une manière indirecte 15 en appliquant des irritations hétérogènes plus fortes sur des parties éloignées du siège de la maladie, et provoquant, ordinairement même, entretenant des évacuations par les organes qui diffèrent le plus des tissus affectés, afin de détourner en quelque sorte le mal vers cette nouvelle localité.
Cette dérivation a été et est encore une des principales méthodes curatives de l’école régnante jusqu’à ce jour.
En imitant ainsi la nature médicatrice, suivant l’expression employée par d’autres, ils cherchent à exciter violemment, dans les parties qui sont les moins malades et qui peuvent le mieux supporter la maladie médicamenteuse, des symptômes nouveaux qui, sous l’apparence de crises et la forme d’évacuations, doivent, suivant eux, dériver la maladie primitive16, afin qu’il soit permis aux forces médicatrices de la nature d’opérer peu à peu la résolution17.
Les moyens dont ils se servent pour parvenir à ce but sont l’emploi de substances qui poussent à la sueur et aux urines, les émissions sanguines, les sétons et cautères, mais de préférence les irritants du canal alimentaire propres à déterminer des évacuations, soit par le haut, soit par le bas, irritants dont les derniers ont aussi reçu les noms d’apéritifs et de dissolvants18.
Au secours de cette méthode dérivative on en appelle une autre qui a beaucoup d’affinité avec elle, et qui consiste à mettre en usage des irritants antagonistes : les tissus de laine sur la peau, les bains de pieds, les nauséabonds, les tourments de la faim imposés à l’estomac et au canal intestinal, les moyens qui excitent de la douleur, de l’inflammation et de la suppuration dans des parties voisines ou éloignées, comme les sinapismes, les vésicatoires, le garou, les sétons, les cautères, la pommade d’Autenrieth, le moxa, le fer rouge, l’acupuncture, etc. En cela, on suit encore les traces de la grossière nature, qui, livrée à elle-même, cherche à se débarrasser de la maladie dynamique par des douleurs qu’elle fait naître dans des régions éloignées du corps, par des métastases et des abcès, par des éruptions cutanées ou des ulcères suppurants, et dont tous les efforts à cet égard sont inutiles quand il s’agit d’une affection chronique.
Ce n’est donc point un calcul raisonné, mais seulement une indolente imitation qui a mis l’ancienne école sur la voie de ces méthodes indirectes, tant dérivative qu’antagoniste, et l’a conduite à des procédés si peu efficaces, si affaiblissants et si nuisibles, dans le but d’apaiser ou d’écarter les maladies pendant quelque temps, mais en substituant un mal plus fâcheux à l’ancien. Un pareil résultat peut-il donc être appelé guérison ?
La médecine ordinaire regardait les moyens que la nature de l’organisme emploie pour se soulager, chez les malades qui ne font usage d’aucun médicament, comme des modèles parfaits à imiter. Mais elle se trompait beaucoup. Les efforts misérables et extrêmement incomplets que la force vitale fait pour se porter secours à soi-même dans les maladies aiguës, sont un spectacle qui doit exciter l’homme à ne pas se contenter d’une stérile compassion et à déployer toutes les ressources de son intelligence, afin de mettre un terme, par une guérison réelle, à ces tourments que s’impose elle-même la nature. Si la force vitale ne peut point guérir homéopathiquement une maladie déjà existante dans l’organisme par la provocation d’une autre maladie nouvelle et semblable a celle-ci (§§ 43-46), ce qui en effet est bien rarement à sa disposition (§ 30), et si l’organisme, privé de tous les secours du dehors, reste seul chargé de triompher d’une maladie qui vient d’éclater (sa résistance est tout à fait impuissante dans les affections chroniques), nous ne voyons qu’efforts douloureux et souvent dangereux pour sauver le malade à quelque prix que ce soit, efforts dont il n’est par rare que la mort soit le résultat.
N’apercevant point ce qui se passe dans l’économie, chez l’homme bien portant, le créateur de toutes choses ayant soustrait une semblable notion à ses créatures, nous ne pouvons pas voir davantage ce qui s’y opère quand la vie est troublée. Les opérations qui ont lieu dans les maladies ne s’annoncent que par les changements perceptibles, par les symptômes, au moyen desquels seuls notre organisme peut exprimer les troubles survenus dans son intérieur, de sorte que, dans chaque cas donné, nous n’apprenons même pas quels sont, parmi les symptômes, ceux qui sont dus à l’action primitive de la maladie et ceux qui ont pour origine les réactions au moyen desquelles la force vitale cherche à se tirer du danger. Les uns et les autres se confondent ensemble sous nos yeux, et ne nous offrent qu’une image réfléchie au dehors de tout l’ensemble du mal intérieur, puisque les efforts infructueux par lesquels la vie abandonnée à elle-même cherche à faire cesser la maladie sont aussi des souffrances de l’organisme tout entier. Voilà pourquoi les évacuations que la nature excite ordinairement à la fin des maladies dont l’invasion a été brusque, et que l’on appelle crises, font souvent plus de mal que de bien.
Ce que la force vitale fait dans ces prétendues crises et la manière dont elle l’accomplit, sont des mystères pour nous, aussi bien que tous les actes intérieurs qui ont lieu dans l’économie organique de la vie. Ce qui est certain, cependant, c’est que, dans le cours de ces efforts, il y a plus ou moins des parties souffrantes qui se trouve sacrifié pour sauver le reste. Ces opérations de la force vitale combattant une maladie aiguë uniquement d’après les lois de la constitution organique du corps, et non d’après les inspirations d’une pensée réfléchie, ne sont, la plupart du temps, qu’une sorte d’allopathie. Afin de débarrasser, par une crise, les organes primitivement affectés, elle augmente l’activité des organes sécrétoires, vers lesquels dérive ainsi l’affection des premiers ; il survient des vomissements, des diarrhées, des flux, d’urine, des sueurs, des abcès, etc., et la force nerveuse, attaquée dynamiquement, cherche en quelque sorte â se décharger par des produits matériels.
La nature de l’homme, abandonnée à elle-même, ne peut se sauver des maladies aiguës que par la destruction et le sacrifice d’une partie de l’organisme même, et si la mort ne s’ensuit pas, l’harmonie de la vie et de la santé ne peut se rétablir que d’une manière lente et incomplète.
La grande faiblesse dont les organes qui ont été exposés aux atteintes du mal et même le corps entier restent atteints après cette guérison spontanée, la maigreur, etc., prouvent assez l’exactitude de ce qui vient d’être avancé.
En un mot, toute la marche des opérations par lesquelles l’organisme cherche à se débarrasser seul des maladies dont il est atteint, ne fait voir à l’observateur, qu’un tissu de souffrances et ne lui montre rien qu’il puisse ou qu’il doive imiter, s’il veut exercer réellement l’art de guérir.
On s’est borné à suivre la marche de l’instinctive nature dans les efforts qu’elle tente, efforts couronnés d’un succès faible, seulement dans les maladies aiguës peu intenses. On n’a fait qu’imiter la puissance vitale conservatrice abandonnée à elle-même, qui, reposant uniquement sur les lois organiques du corps, n’agit non plus qu’en vertu de ces lois, sans raisonner et réfléchir ses actes. On a copié la grossière nature, qui ne peut pas, comme un chirurgien intelligent, rapprocher les lèvres béantes d’une plaie et les réunir par première intention ; qui, dans une fracture, est impuissante, quelque quantité de matière osseuse qu’elle fasse épancher, pour redresser et affronter les deux bouts de l’os ; qui, ne sachant pas lier une artère blessée, laisse un homme plein de vie et de force succomber à la perte de tout son sang ; qui ignore l’art de ramener à sa situation normale la tête d’un os déplacée par l’effet d’une luxation, et rend même en très peu de temps la réduction impossible à la chirurgie par le gonflement qu’elle excite dans les alentours ; qui, pour se débarrasser d’un corps étranger violemment introduit dans la cornée transparente, détruit l’œil entier par la suppuration ; qui, dans une hernie étranglée, ne sait briser l’obstacle que par la gangrène et la mort ; qui, enfin, dans les maladies dynamiques, rend souvent par les changements de forme qu’elle leur imprime, la position du malade beaucoup plus fâcheuse qu’elle ne l’était auparavant. Il y a plus encore : cette force vitale non intelligente admet sans hésitation dans le corps les plus grands fléaux de notre existence terrestre, les sources d’innombrables maladies qui affligent l’espèce humaine depuis des siècles, c’est-à-dire les miasmes chroniques, la psore, la syphilis et la sycose. Bien loin de pouvoir débarrasser l’organisme d’un seul de ces miasmes, elle n’a pas même la puissance de l’adoucir ; elle le laisse au contraire exercer tranquillement ses ravages jusqu’à ce que la mort vienne fermer les yeux du malade, souvent après de longues et tristes années de souffrances.
Comment l’ancienne école, qui se dit rationnelle, a-t-elle pu, dans une chose aussi importante que la guérison, dans une œuvre qui exige tant de méditation et de jugement, prendre cette aveugle force vitale pour son institutrice, pour son guide unique, imiter sans réflexion les actes indirects et révolutionnaires qu’elle accomplit dans les maladies, la suivre enfin comme le meilleur et le plus parfait des modèles, tandis que la raison, ce don magnifique de la Divinité, nous a été accordée pour pouvoir surpasser la force vitale dans les secours à porter à nos semblables ?
Lorsque la médecine dominante, appliquant ainsi, comme elle a coutume de le faire, ses méthodes antagoniste et dérivative, qui reposent uniquement sur une imitation irréfléchie de l’énergie grossière, automatique et sans intelligence qu’elle voit déployer à la vie, attaque des organes innocents, et leur inflige des douleurs plus aiguës que celles de la maladie contre laquelle elles sont dirigées, ou, ce qui arrive la plupart du temps, les oblige à des évacuations qui dissipent en pure perte les forces et les humeurs, son but est de détourner, vers la partie qu’elle irrite, l’activité morbide que la vie déployait dans les organes primitivement affectés, et ainsi de déraciner violemment la maladie naturelle, en provoquant une maladie plus forte, d’une autre espèce, sur un point qui avait été ménagé jusqu’alors, c’est-à-dire en se servant de moyens indirects et détournés qui épuisent les forces et entraînent la plupart du temps de la douleur19.
Il est vrai que, par ces fausses attaques, la maladie, quand elle est aiguë, et que par conséquent son cours ne peut être de longue durée, se transporte sur des parties éloignées et non semblables à celles quelle occupait d’abord ; mais elle n’est point guérie. Il n’y a rien dans ce traitement révolutionnaire qui se rapporte d’une manière directe et immédiate aux organes primitivement malades, et qui mérite le titre de guérison. Si l’on s’était abstenu de ces atteintes fâcheuses portées à la vie du reste de l’organisme, on aurait souvent vu la maladie aiguë se dissiper seule, d’une manière même plus rapide, en laissant moins de souffrances après elle, en causant un moindre épuisement des forces. On ne peut d’ailleurs mettre ni le procédé suivi par la grossière nature, ni sa copie allopathique, en parallèle avec le traitement homéopathique, direct et dynamique, qui, ménageant les forces, éteint la maladie d’une manière immédiate et rapide.
Mais, dans l’immense majorité des maladies, dans les affections chroniques, ces traitements perturbateurs, débilitants et indirects de l’ancienne école ne produisent presque jamais aucun bien. Leur effet se borne à suspendre pour un petit nombre de jours tel ou tel symptôme incommode, qui revient aussitôt que la nature s’est accoutumée à l’irritation éloignée la maladie renaît plus fâcheuse ; parce que les douleurs antagonistes 20 et d’imprudentes évacuations ont affaibli l’énergie de la force vitale.
Tandis que la plupart des allopathies, imitant d’une manière générale les efforts salutaires de la grossière nature livrée à ses propres ressources, introduisaient ainsi dans la pratique ces dérivations soi-disant utiles, que chacun variait au gré des indications suggérées par ses propres idées, d’autres, visant à un but plus élevé encore, favorisaient de tout leur pouvoir la tendance que la force vitale montre, dans les maladies, à se débarrasser par des évacuations et des métastases antagonistes, cherchaient en quelque sorte à la soutenir en activant ces dérivations et ces évacuations, et s’imaginaient pouvoir d’après cette conduite s’arroger le titre de ministres de la nature.