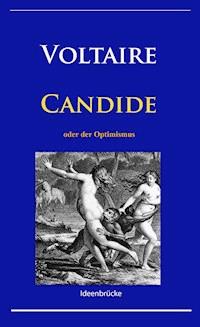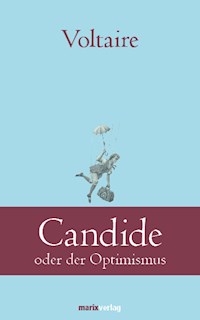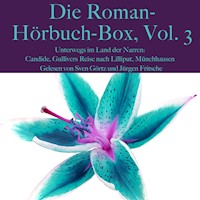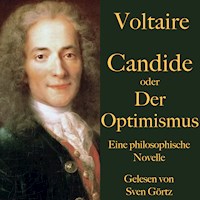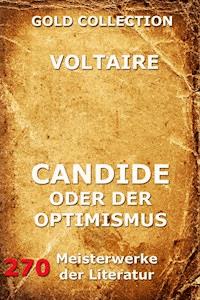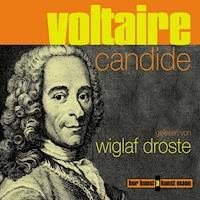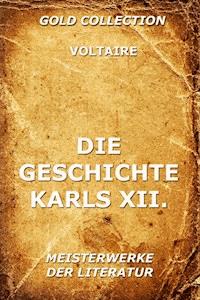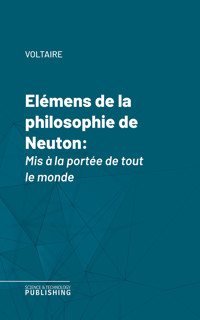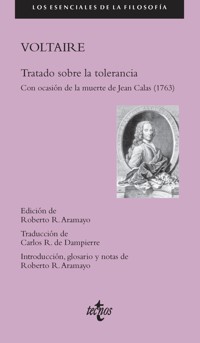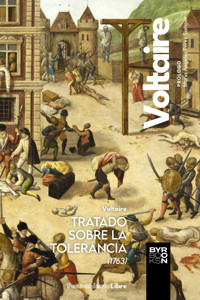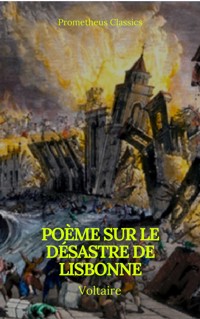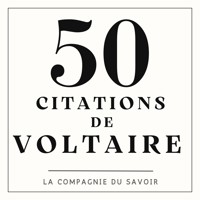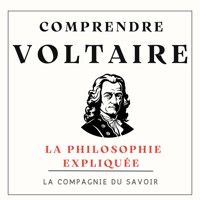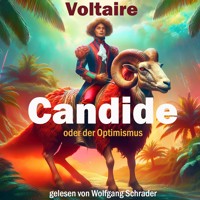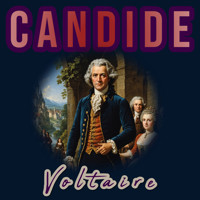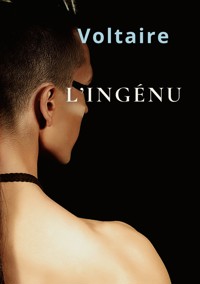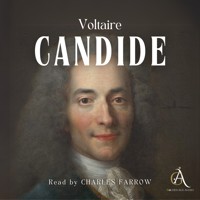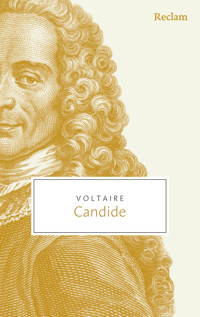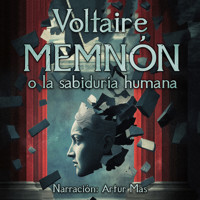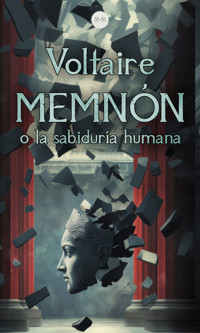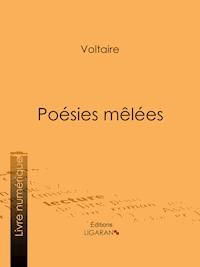
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "Dans tes vers, Duché, je te prie, Ne compare point au Messie Un pauvre diable comme moi : Je n'ai de lui que sa misère, Et suis bien éloigné, ma foi, D'avoir une vierge pour mère. Adieu, ma pauvre tabatière ; Adieu, je ne te verrai plus ; Ni soins, ni larmes, ni prière, Ne te rendront à moi ; mes efforts sont perdus. Adieu, ma pauvre tabatière ; Adieu, doux fruit de mes écus !..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335091229
©Ligaran 2015
Dans le recueil des Poésies mêlées, on a évité d’en multiplier trop le nombre, et d’en insérer qui fussent d’une autre main. Souvent ce choix a été assez difficile. Dans le cours d’un long ouvrage en vers, il eût été presque impossible d’imiter la grâce piquante, le coloris brillant, la philosophie douce et libre qui caractérisent toutes les poésies de Voltaire : son cachet ne pouvait être aussi reconnaissable dans quinze ou vingt vers presque toujours impromptus. Il était plus aisé, en s’appropriant quelques-unes de ses idées et de ses tournures, d’atteindre à une imitation presque parfaite. D’ailleurs il n’a jamais voulu ni recueillir ces pièces, ni en avouer aucune collection. Celles qu’on en a publiées de son vivant, sous ses yeux, contenaient des pièces qu’il n’avait pu faire, et dont il connaissait les auteurs. C’était un moyen qu’il se réservait pour se défendre contre la persécution que chaque édition nouvelle de ses ouvrages réveillait. Il attachait très peu de prix à ces bagatelles, qui nous paraissent si ingénieuses et si piquantes. L’à-propos du moment les faisait naître, et l’instant d’après il les avait oubliées. L’habitude de donner à tout une tournure galante, ou spirituelle, ou plaisante, était devenue si forte, qu’il lui eût été presque impossible de s’exprimer d’une manière commune. Le travail de parler en rimes avait cessé d’en être un pour lui dans tous les genres où la familiarité n’est point un défaut. Il ne faut donc pas s’étonner qu’il estimât peu ce qui ne lui coûtait rien, et que cette modestie ait été sincère.
K.
J’ai dû porter mon attention à faire disparaître des Poésies mêlées les pièces qui ne sont point de Voltaire. Voici à ce sujet quelques explications.
I. Le quatrain sur les sonneurs :
est imprimé dans la première édition du Ménagiana, qui est de 1693. Voltaire naquit l’année suivante.
II. Le madrigal :
est formellement attribué au marquis de La Faye par un homme qui n’est pas disposé à dépouiller Voltaire, d’Alembert. Cette pièce est imprimée dans le Mercure galant de 1710, page 215, avec les initiales M. D.L.F.(monsieur de La Faye).
III. J’ai le premier, en 1823, admis dans les poésies de Voltaire un autre madrigal :
parce que je l’avais trouvé dans les Amusements littéraires, à la suite du madrigal Projets flatteurs, etc., qui est de La Faye, ainsi qu’on l’a vu. Il n’y a donc plus de motif, même léger, de croire que le second madrigal soit de Voltaire.
IV. Treize vers au maréchal de Richelieu :
ont pour auteur le poète Lebrun, surnommé Pindare, et sont imprimés dans ses Œuvres.
V. Les bouts-rimés :
qu’on avait admis sur l’autorité de Grimm, avaient, il est vrai, été imprimés sous le nom de Voltaire dans l’Année littéraire, 1759, tome VIII, page 339 ; mais ils sont de Dalmas, commissaire des guerres provincial, et ordonnateur de la Lorraine, résidant à Nancy ; voyez l’Année littéraire, 1760, tome Ier, page 263. Réimprimés sous le nom de Voltaire dans le Journal encyclopédique du 1er mars 1763, ces bouts-rimés ont été désavoués par Voltaire dans une lettre dont nous donnons dans la Correspondance le fragment qui en a été publié par le Journal encyclopédique du 1er avril. Potier, gendre de Dalmas, fit insérer dans le même journal du 15 mai une lettre où il réclame la pièce pour son beau-père.
VI. L’inscription pour un cadran solaire :
est rapportée par Villette pour avoir été récitée par Voltaire comme une vieillerie. En effet, dans le Mercure de 1722, second volume de novembre, page 100, on lit ces vers :
Ils font partie de la Suite du journal du voyage du roi à Reims (et Relation des fêtes de Villers-Cotterets). L’auteur est l’abbé de Vayrac.
VII. L’énigme sur la tête à perruque :
est du chevalier de La Touraille, à qui Voltaire écrivit quelques lettres, et qui la réclame en la reproduisant page 161 de la première partie du Nouveau Recueil de gaieté et de philosophie, 1785, deux parties in-12.
VIII. Le prétendu Impromptu fait à Cirey sur la beauté du ciel dans une nuit d’été :
est du P. Lemoine, auteur du poème de Saint Louis ; voyez les Œuvres poétiques du P. Lemoine, 1671, in-folio, épître XI du livre Ier.
IX. Un autre impromptu, supposé fait à Auteuil dans la maison de Gendron, qui avait appartenu à Boileau :
a été imprimé dans la Notice sur cet oculiste, en tête du catalogue de sa bibliothèque. Des éloges donnés par Voltaire ne sont pas sans importance ; et les héritiers Gendron, pour la gloire de leur parent, ne pouvaient mieux faire que d’attribuer à Voltaire le quatrain dont il s’agit. Fréron, en le réimprimant dans l’Année littéraire, 1770, tome IV, page 347, souligna les mots vrai et vrais, dont la répétition n’est pas une élégance. Voltaire désavoue ces vers dans une note de son Dialogue de Pégase et du Vieillard.
X. Les vers sur l’envoi d’une branche de laurier cueillie au tombeau de Virgile par la margrave de Bareith, pour le roi de Prusse son frère :
imprimés sans nom d’auteur, en 1756, dans le Mercure, tome II de janvier, page 20, réimprimés dans le même journal en septembre 1768, page 5, comme attribués à Voltaire, ont été réclamés par La Condamine par une lettre insérée dans le tome II d’octobre 1768, page 60-62.
XI. Dans le Journal de Paris du 12 janvier 1779, parut, sous le nom de Voltaire, une pièce de dix-huit vers, adressés à Mme la comtesse de Boufflers. Ils furent, dans le Journal du 7 février, réclamés par M. Pons de Verdun, qui les a compris pages 48-49 de son Recueil de contes et poésies en vers, 1783, in-12 ; mais non dans les Loisirs, ou Contes et Poésies diverses, 1807, in-8°.
XII. Le madrigal :
est de M. Leroy, qui le composa pour une dame de Brest.
XIII. Le quatrain à Mme de Prie :
est de Desalleurs ; voyez la Vie de Voltaire, par du Vernet, chapitre VI des premières éditions, ou chapitre VII de la dernière.
Il est d’autres pièces que j’ai cru pouvoir et même devoir exclure des poésies mêlées, où quelques éditeurs les ont conservées ; mais je dois compter des raisons qui m’ont déterminé.
Le quatrain commençant par :
fait partie de la lettre à d’Argental, du 12 février 1764.
Le quatrain à l’abbé de Sade :
n’est qu’une variante de six vers de la lettre du 29 août 1733.
Les vers adressés au comte de Sade :
sont rapportés dans la lettre à l’abbé de Sade, du 3 novembre 1733.
Les huit vers à Mme d’Aiguillon :
sont un fragment d’une lettre à cette dame, à la date de 1734.
Cinq vers au marquis de Valory :
n’étaient qu’un passage de la lettre du 1er mai 1743.
C’est dans la même lettre que se trouve le quatrain :
Cinq vers sur le jésuite qu’on disait roi du Paraguay :
sont dans la lettre à Bertrand, du 10 novembre 1739.
Un huitain sur Ovide, Catulle et Tibulte :
fait partie d’une épître qui est page 294.
Le quatrain à Mme du Barry :
est un des trois qui sont dans la lettre du 20 juin 1773.
Le huitain :
est dans une lettre à Mme de Champbonin, de 1734.
Les deux quatrains :
et
font partie de la Lettre sur un écrit anonyme, qui est dans les Mélanges.
Les quinze vers :
dont les éditeurs de Kehl ne donnaient pas l’adresse, sont dans la lettre à Bertrand, du 28 auguste 1764.
Les vers sur le baiser donné par Marguerite d’Écosse à Alain Chartier font partie de la Fête de Bélébat.
La Prophétie de la Sorbonne :
est dans les Mélanges ; je n’ai pu me décider à mettre ce morceau au nombre des poésies.
C’est dans le Dictionnaire philosophique que sont : au mot CALEBASSE, le quatrain sur la vanité de l’homme :
au mot ADULTÈRE, celui sur Bayle :
Le matin rigoriste et le soir libertin, etc ;
au mot BOUC, celui sur les filles de Mendès :
Je n’énumérerai point les autres pièces de vers disséminées dans le Dictionnaire philosophique, et qui feraient ici double emploi. Ces petites pièces de vers font, pour ainsi parler, partie intégrante des articles où elles se trouvent.
B.
Voulant éviter les répétitions, qui grossissent inutilement une édition des Œuvres complètes, nous nous sommes abstenu, comme nous venons de le faire pour les Épîtres, de reproduire ici les morceaux qui feraient double emploi, pourvu qu’il n’y ait aucune variante, ni aucune autre raison qui justifie ce double emploi. Nous éliminons, par conséquent, un certain nombre de pièces qui ont leur place marquée, soit dans le Commentaire historique, soit dans la Correspondance, soit ailleurs. Nous avons soin, toutefois, de mentionner chacune de ces pièces supprimées à l’endroit où quelques précédents éditeurs les ont mises, et d’indiquer où on les trouvera dans notre édition.
L.M.