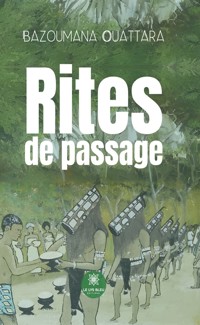
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Rites de Passage" explore les enjeux cruciaux de l’Afrique contemporaine : l'effritement des structures traditionnelles, l'influence croissante des leaders religieux modernes et la domination des marabouts, nouveaux symboles de pouvoir. Peu importe leur forme ou leur nom, ces figures représentent des fétiches porteurs de croyances profondes. Croyez en Dieu, en vos convictions et surtout en vous-même ! Cependant, gardez votre foi sans renoncer à votre esprit critique.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Bazoumana Ouattara est enseignant-chercheur à l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo en Côte d’Ivoire. "Rites de Passage" est son premier roman, faisant suite à un recueil de nouvelles qu’il a publié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bazoumana Ouattara
Rites de passage
Roman
© Lys Bleu Éditions – Bazoumana Ouattara
ISBN : 979-10-422-4584-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L. 122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivante du Code de la propriété intellectuelle.
Ceci est une fiction, toute ressemblance n’est que pure coïncidence.
Préface
À ceux-là qui s’intéressent à l’espace-temps et qui poursuivent le rêve d’immortaliser les moindres moments de la vie, ce livre, riche en description, vous donne les détails d’un environnement qu’il fige. Le roman de Bazoumana Ouattara pose la préoccupation de l’avenir des traditions africaines face au modernisme. Il est d’actualité quand il aborde les périples du migrant, les mésaventures des couples et les fables du destin. Dans sa forme comme dans son fond, ce roman exprime l’Afrique. Même quand il est défendu au chasseur de parler de ce qui s’est passé dans la brousse, ce roman ouvre des pistes de réflexion sur les rites de l’initiation au bois sacré. Il théâtralise la dislocation des cultures africaines face à l’école, l’islam et le christianisme. C’est à travers la vie, ses mystères, ses goûts et dégoûts que l’auteur expose Têh Yinh et ses compagnons.
Dr Guy Roland Amoikon
Chapitre 1
Nous sommes en juillet, dans la seconde moitié du mois. Cela correspond à la mort de Kariwaga1 et la naissance annoncée de Tougoutangan2. En cette période, à Sokala, c’est l’effervescence. C’est la sortie certaine de la disette. La récolte de la nouvelle igname approche. Certains cultivateurs ont terminé leur deuxième tour de sarclage ou sont à la veille de le faire. On peut creuser quelques buttes pour vérifier l’état de maturité des tubercules. Dans les champs, la consommation clandestine de la nouvelle igname a même déjà lieu. Clandestine ! Oui, c’est de cela qu’il s’agit. À Sokala, il n’est pas convenable de rentrer au village avec la nouvelle igname tant que les rites officiels consacrant sa consommation n’auront pas été faits. Autrement, c’est de la clandestinité. Ainsi, pour contourner le sort, toute consommation de la nouvelle igname peut se faire discrètement dans les champs. Pour ça, les mânes sont peu regardants. C’est le moment où l’hivernage consacrant les pluies drues caractéristiques des tropiques déverse ses derniers torrents par intervalles réguliers. Au réveil, un regard autour de soi, on dévisage une nature qui vous met du baume au cœur, on la découvre, sourire à pleines dents. Ici, un poulet gazouille frénétiquement. Il le sait, ni le ver, ni la fourmi, ni même le termite ne fera défaut. Là, un chien est couché au seuil de la maison de son maître ; sauf cas de force majeure, il ne sortira pas avant les premiers rayons du soleil. Il profite encore de la chaleur de la fosse qu’il s’est faite pour passer les nuits froides de la saison. Dans la cour, l’arbre ornemental, l’espèce Manihot glaziovii, laisse tomber les gouttes d’eau retenues durant la nuit pluvieuse. La place publique du village est encore infestée des fientes des tisserins gendarmes, des mésanges et des rouges-gorges, d’éclats d’œufs, de plumes, d’oisillons à becs larges et à corps parsemés de duvets, de débris de nids mêlés aux cacas de chiens et de porcs. Les femmes s’attellent à faire le grand ménage.
Les nuages se dissipent subrepticement. Les rayons du soleil se faufilent les uns après les autres. Le village prend vie inexorablement. Les habitants passent de cour en cour, se saluant, se donnant des nouvelles de leur nuit, se dépassent, retrouvent leur domicile et s’apprêtent pour vaquer à leurs corvées.
Hors du village, la végétation est toute luxuriante. Sur les pistes menant aux champs, les hautes herbes ploient sous le poids de l’humidité et se penchent sur le chemin en attendant que le premier passant enlève la rosée pour qu’elles se redressent. Le sol gorgé d’eau moule les pieds, la boue sort entre les orteils. Les pistes sont très glissantes aux abords des termitières latéritiques. De loin, les coassements des grenouilles répondant les unes aux autres, en chœur, harmonieusement, comme obéissant à un chef d’orchestre, parviennent aux oreilles, avertissant que par ces temps de fortes crues, le cours d’eau que jadis l’on traversait à sec pour se rendre au champ, est sorti de son lit, a remonté la piste sur les deux rives et a inondé les terres avoisinantes.
Au champ, les feuilles d’ignames sont d’un vert foncé rassurant au point qu’en admirant cette sérénité que dégagent les plantes, on ne peut s’empêcher de répondre par un sourire béat. Oui, les récoltes s’annoncent très bonnes. Il ne peut en être autrement lorsque les pluies coïncident bien avec le moment où les cultures en ont le plus besoin. On ne peut qu’exulter et exalter les dieux pour avoir exaucé les sacrifices propitiatoires. On se prend même à se moquer de la science. Les prédictions des courbes d’indices pluviométriques de l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM), qui a une station à Sokala depuis longtemps, semblent tombées dans les oubliettes. Pourtant, les résultats scientifiques sont sans équivoque. À en croire l’ORSTOM, nous sommes dans une période où les fluctuations des isohyètes sont très favorables. À cette période, la saison des pluies peut s’étendre jusqu’à la mi-juillet. Mais il peut se produire un arrêt brusque, prolongé et dramatique des précipitations en raison d’une descente rapide du front intertropical. Ainsi, la seconde moitié de juillet et même le mois d’août peuvent être moins arrosés et réduire à néant les cultures. Du fait de cette répartition saisonnière anormale des pluies, il arrive qu’en fin d’hivernage, on assiste localement à des averses fortes et intenses qui créent des pointes de crues brèves et violentes qui, subitement, peuvent remplir les mares, et aussi détruire les ressources et les habitations. Probablement, nous sommes en plein dans ce scénario.
À Sokala, l’igname est l’aliment de base. Des réserves de maïs, de mil, de fonio, d’arachide, de pistache, de sorgho et autres récoltes des années précédentes sont conservées dans les greniers pour prévenir les catastrophes. Pourtant, quand l’igname vient à manquer, à Sokala, on parle de famine. Eh oui ! même si le manioc, qui est planté sous forme de haie pour délimiter les parcelles, reste encore disponible dans les champs. Cette année, les champs de l’igname précoce ont bien donné. Cela se voit, les tubercules forment une montagne insurmontable. On ne voit pas l’adulte arrêté de l’autre côté du tas d’ignames. L’igname, nous la consommons en bouillie pelée, en robe de champ, en friture et en foutou. Nous la consommons le matin, le midi et le soir. Il ne nous vient jamais à l’idée de la changer par moments avec autre chose. À la rigueur, seule la sauce peut varier : arachide avec ou sans feuilles, aubergines, pistache, gombo frais ou sec, feuilles sèches de baobab, huile et piment écrasé… on n’en finit guère. Ma foi, tout est à l’appréciation de nos mamans et va de l’ingéniosité et de l’imagination de celles-ci.
Après la récolte de l’igname précoce, ses rhizomes sont renfermés sous terre pour que ceux-ci se développent adéquatement et servent pour la plantation de l’année suivante. La récolte de l’igname tardive ne se fait que lorsque la plante de cette autre variété perd toutes ses feuilles. Ceci, au même moment où l’on déterre les rhizomes de la précoce, en saison sèche. La variété tardive et les rhizomes de l’igname précoce sont exposés dans des hangars faits de bois et de branchages secs. Selon un système de rotation de cultures, les parcelles sont en ce moment-là pourvues en pois sucré, mil, sorgho et autres cultures pouvant résister à la rareté des précipitations. Mais le point de tolérance reste tout de même fragile selon la plante cultivée en cette saison. Pour peu que la saison pluvieuse s’allonge, ces cultures sont perdues ; une saison sèche trop hâtive et bonjour les dégâts.
Elle commence tranquillement en début septembre. Avec le temps, le débit des cours d’eau s’annule. Peu à peu, elle atteint son paroxysme. Elle s’installe confortablement en décembre. Alors, les cours d’eau s’arrêtent de couler. En cette période d’étiage, il faut creuser, creuser et creuser, d’endroit à endroit, dans le bassin pour voir de l’eau suinter de la terre, en quantité suffisante pour la consommation domestique. Tôt le matin, les femmes sont sur la piste du marigot à la recherche du précieux liquide. La veille, à la tombée de la nuit, les hommes sortent les branchages, les feuilles mortes et les grenouilles de la mare. Ils sacrifient un poussin à l’honneur des divinités de l’eau du marigot desséché. Ainsi, au petit matin, c’est la cohue et le ballet incessant des femmes pour se procurer l’eau avant que le soleil ne l’évapore. La sévérité et la persistance des déficits pluviométriques entraînent un appauvrissement catastrophique des nappes phréatiques alimentant les cours d’eau pendant le tarissement. Le lit des cours d’eau sèche, durcit et craque. Cette année, il y a un mauvais présage. Lagboho, une rivière réputée pérenne qui, malgré l’acuité de la saison kariwaga, persiste à abreuver la communauté, est morte. C’est la saison sèche.
Dans notre zone, la saison sèche coïncide avec l’harmattan ; sous d’autres cieux, il semblerait que cela corresponde à l’hiver. La particularité est que chez nous, les nuits et les matins sont froids, et le midi il fait extrêmement chaud. Le sol est littéralement une fournaise ardente, le vent violent soulève la poussière et les tourbillons témoignent du passage des mauvais génies.
La saison sèche à Sokala, c’est aussi la saison de la chasse au petit gibier, donc des feux de brousse. Les hommes ont décidé de la dernière chasse de l’année, celle qu’ils font avant les fêtes de fin d’année. Elle débute dans le Kataga et prend fin dans les environs du village. Le Kataga, c’est l’ancien emplacement du village. Là où le guerrier anticolonialiste Cha Mory, un authentique Africain, a déniché nos ancêtres. Cha Mory et ses sofas les y avaient trouvés faisant copain-copain avec le gouverneur Louis-Gustave Binger, un Strasbourgeois, gardien de colonies. Un Français sur le passage de lui, Cha Mory, l’Almamy, le Chef du Ouassoulou, lui qui bout sans être mis sur un feu ! À son nez et à sa barbe, un peuple noir ami d’un gibier de potence ! Ajouter l’insulte à l’injure ! Inacceptable ! Pour laver l’affront, un bon matin, avant le premier chant du coq, Cha Mory et ses sofas envahirent le vaste territoire de nos ancêtres. Seuls pouvaient échapper, ceux qui étaient en voyage ou qui, divinement avertis, pouvaient sortir du village avant son arrivée. Ce fut d’ailleurs le cas de mon aïeul Lah Têh qui détala tel un lapin pour se planquer dans une grotte. Les silures de cette cachette l’adoptèrent et le protégèrent. Cette planque est un lieu d’adoration pour ma famille : Latêhlarassaga. Ainsi, hommes, femmes, enfants et animaux, Cha Mory passa absolument tout, à une exception près, les femmes enceintes, au fil de son sabre. Après ce désastre, il mit le cap sur Ladaba, contrée voisine où il érigea son camp à Gbanan. La terre de nos aïeux a donc été brûlée dans toute son immensité. Les rescapés de cette folie meurtrière s’éparpillèrent sur environ une vingtaine de campements. En fait, en autant de campements qu’il y avait de rescapés de sexe masculin. Tous ces campements évolués en villages vivent dans un esprit de communauté les uns par rapport aux autres. C’est l’ancien emplacement abandonné que les vieux avaient nommé Kataga, lieu où le malheur nous a frappés de plein fouet. Là, dans ces ruines, résident les esprits de nos aïeux. Les animaux y abondent. Mais nul ne s’y hasarde pour une partie de chasse solitaire. La communauté consulte les géomanciens pour connaître la date idéale pour la grande chasse. Alors, les habitants des autres campements se rencontrent à Sokala pour la partie de chasse de l’année. Ne sont restés au village que les malades, les estropiés, les femmes, les filles et les bébés. Cela fait déjà un moment que la battue a lieu. Les aboiements des chiens et la fureur du feu de brousse traquent les animaux. On ne compte plus les gibiers abattus, tant on en a tué. Pourtant, la chasse continue. Elle ne doit cesser qu’aux abords du village. La canicule doublée par la rage du feu assèche les gorges. Les enfants affaiblis, tant bien que mal, tentent de retrouver le village avant la fin de la partie. Des hommes s’éloignent momentanément des lieux de la chasse aux animaux pour trouver de l’eau. Il faut se désaltérer à n’importe quel prix. Là un cours d’eau tari, et une mare boueuse à l’ombre de quelques arbres millénaires sous lesquels se trouvent quelques palmiers. Les chiens, langues pendantes, devancent les hommes, boivent tout ce qu’il y a encore d’eau et se vautrent dans la boue pour se rafraîchir le corps. Les hommes arrivent enfin. Ils délogent les canidés, sortent les grenouilles pourries, creusent et attendent patiemment que de l’eau remonte en surface. L’eau a la couleur de morve, d’une odeur de putréfaction ; on se pince le nez pour la boire.
Du côté du feu de brousse, le vent change constamment de direction. Cela perturbe la quiétude des hommes. Le feu échappe à leur contrôle. La chasse continue quand même. Un rongeur ! c’est un agouti ! il fonce droit sur un groupe de chasseurs. Un homme, mon père, qui d’un coup de gourdin, le foudroie et se jette sur l’animal. On ne sait trop comment, ni même de quel endroit, un coup de feu part et mon père est atteint à la hanche. Il gît dans du sang, le sien et celui de l’animal. C’est la panique. Le blessé est couché sur des feuilles de palmier, attaché et transporté en direction du village. Il saigne énormément. L’atmosphère empeste le brûlé. À l’horizon, on distingue une épaisse fumée noirâtre montée dans le ciel. Plus on s’approche du village, plus l’inquiétude grandit. Les cris d’affolement des femmes confirment les craintes. Non conhooooo-non-con ! Un tel cri signifie qu’il y a un incendie. Les porteurs abandonnent le blessé attaché dans son brancard de fortune le long du chemin. Ils se précipitent au village, trop tard, tout est en feu. Les hommes, dans leur grande majorité, sont encore à la chasse, loin du village. Le feu, il y a le feu partout. Des langues de feu tourbillonnent comme portées par des mains invisibles et tombent sur les toits de chaume. Les cases, les greniers, les animaux domestiques et les malades alités, il consume tout. Franchement, si l’on pouvait voir la mort, jamais elle ne pourrait avoir de victimes. On voit des handicapés s’extirper d’eux-mêmes des flammes. Devant ce spectacle de désolation, les femmes, anéanties et harassées, ont beau pleurer, maintenant, plus aucune goutte de larme ne leur coule des yeux. Chacune se tient débout, les deux mains sur la tête, moment de désarroi ! Les hommes aux visages noircis, stupéfaits, fixent les décombres, les uns le poing sur le menton, les autres assis tête basse face à l’impuissance. D’autres, face contre terre, font des imprécations.
C’est à la belle étoile que se passe la nuit. Le lendemain matin, tous hagards, les gens se regardent, regardent les cendres sans mot dire. Qui pour expliquer l’inexplicable, comprendre l’incompréhensible, qui ? Si non, on fait le dénombrement des villages qui ont subi ce triste sort, un, deux puis trois et ça continue… On fait le bilan des dégâts. On sait le désastre humain lourd. De nombreux champs ont brûlé avec tout ce qu’il y a de nouveau et d’anciens, les nouvelles cultures et les réserves. Les ignames des hangars brûlés sont cuites. On les prend et on les mange directement, sans autre forme de procédure.
Tout est à refaire. Toute une vie à reconstruire.
Si le sort croit avoir tout pris à mon peuple, il s’est bien fourvoyé. Il a omis de lui enlever l’essentiel, sa foi, son courage et sa solidarité. Quoiqu’éparpillés après la razzia de Cha Mory, les ex-habitants du Kataga forment une communauté tricotée serrée. Les anciens qui font partie des rescapés se sont réunis en urgence. Le village est confié aux génies protecteurs des trois points encadrant le village. Grâce au jeu d’alliance et de solidarité, tous les villages sinistrés sont reconstruits. C’est clair qu’on ne sort pas indemne d’une telle situation. La santé de mon père allait clopin-clopant après un long séjour chez le guérisseur d’une contrée voisine. Longtemps encore après l’événement, il arrive à des gens de hurler pendant leur sommeil. D’autres, ayant perdu la raison, sont enchaînés. Mais ici à Sokala, le syndrome post-traumatique est pris en charge par les dieux, et la vie continue. Les saisons succèdent aux saisons ; les unes bonnes et les autres beaucoup moins comme le cours normal d’une vie.
Chapitre 2
Il fait jour. Mon grand-père vient me prendre pour les champs. Il vit avec une de ces maladies pulmonaires obstructives chroniques qui fait qu’il ne passe jamais inaperçu. Ce matin, alors qu’il s’approche de la maison de mes parents, je l’entends tousser. En cette période d’harmattan où le vent est sec et froid le matin, aller en brousse ne m’enchante guère. La sécheresse, avec pour corollaire la famine, balaie à nouveau la région. Tout ceci me démotive à me rendre dans la brousse, où de toute évidence, il manque l’eau potable et la nourriture. Pendant cette période de vaches maigres, les champs ne servent plus que de lieux de méditation, lieux d’espérance, lieux où l’on se rend pour trahir l’envie incompressible de voir le ciel à nouveau dégouliner sur la terre. Mais mon grand-père, lui, a besoin de moi pour l’aider à surveiller ses volailles contre les assauts répétés de l’épervier. L’ayant donc entendu dans les parages, je me suis caché sous le panier de ma maman avant même que pépé ne franchisse le seuil de notre porte. Je le vois à travers les interstices du panier artisanal au moment où il demande : où est mon petit-fils Têh Yinh ? Personne ne sait où je suis. Cette fois, pépé ira au champ sans moi. Il a les plantes de pieds kératinisées. Il ne ressent plus les piqûres des chiendents ni même les morsures et les serres des ronces qui jonchent le sentier. Je l’imagine en route, sous le joug des cages de poulets qui pendent et se balancent de gauche à droite.
Chemin faisant, il entre par moments dans la brousse sèche visiter ses pièges. Je sais, oui, que mon grand-père ne revient jamais bredouille de la chasse. Je suis persuadé qu’il va tuer un petit rongeur. À l’idée de la tête d’agouti que je mangerai si je suis avec lui au champ, j’ai vraiment l’envie de le suivre. Déchirant ! Pour un enfant, c’est comme choisir entre morves et larmes. Ce jour, je choisis de rester au village aux côtés des femmes. Au village, je mangerai certes peu, mais bien. Les femmes ne vont dans les champs par ces temps austères que pour casser le bois de chauffe. Autrement, elles restent au village commerçant et troquant le menu fretin pour acheter un grain de céréale : riz, fonio, mil ou maïs ; mais aussi quelques épices ou tout autre chose qui permettra d’assaisonner le repas du soir pour supporter le moral et l’humeur exécrable de leurs hommes en période de dèche. Nos mamans ont ce don de nous faire apprécier le goût de la nourriture que nous détestons le plus au monde. Je suis donc plus que certain de manger à midi un petit morceau de manioc cuit à l’huile de palme ou au beurre de karité quoique ce soit le tubercule que je répugne le plus.
Le soir venu, un voile léger et gris de fumée enveloppe le village. Peu après, l’écho du pilon contre le mortier, comme émis par un seul individu, le déchire. Les femmes préparent les repas du soir. Quelque temps après, un son discordant se fait entendre à l’autre bout. Une femme est en retard sur ses congénères et il ne lui est pas permis, à moins de se retirer du village à une distance équivalente à celle de la moitié d’un jet de pierre, de piler ses légumes secs. La nuit, à l’heure du souper, comme d’habitude, nous nous rendons, mon père et moi, chez grand-papa où tous les hommes du quartier, accompagnés de leurs descendances mâles, se réunissent pour prendre le repas communautaire.
Les plats, déposés à même le sol, sont placés de façon circulaire. Nos parents, de même que les jeunes adultes, forment un grand cercle extérieur tandis que nous, les plus jeunes, formons un cercle interne mettant en sandwich les repas entre les deux cercles concentriques, celui de nos parents et le nôtre. Les parents sont assis sur des tabourets et les enfants accroupis. Je suis très attaché à mon grand-père, et en temps normal, je me positionne toujours devant lui. Cette nuit-là, mon papa remarque quelque chose d’inhabituel : « Que se passe-t-il ? Tu ne vas pas chez ton pépé ? » me demande-t-il. Mon grand-père se met à rire. Mon attitude parle d’elle-même ; pépé en décode le message « je n’étais pas bien loin quand il me cherchait pour les champs ». Il ne m’en tient pas rigueur.
Cette nuit-là, il se peut que nous ayons soupé plus tôt, soit aux environs de vingt heures. La lune partage généreusement avec le village sa luminosité témoin de la gratitude du soleil. Les enfants commencent à s’amuser sous le gros baobab. Les filles font trois cercles selon leurs générations. Le bogo3 est lancé : « bogo ho, yawélé aié ya bogo yawélé… ». Les garçonnets se roulent dans la poussière. Les téméraires se faufilent entre les cercles des jeunes filles d’où ils ne ressortent guère sans égratignure, car ils reçoivent toujours des coups. Ha, comme c’est bon ! si bon de se faire taper par la fille qu’on désire, qu’on recommence ce jeu de provocation. À côté, c’est un autre groupe de gars qui s’adonnent à la lutte traditionnelle. Non loin de là, d’autres jouent aux chasseurs. Les plus grands attendent dans la pénombre et envoient des plus jeunes leur appeler des filles. Plus loin, certains jeunes gens de sexes opposés sont déjà en conciliabule dans une passerelle entre deux maisons. Après quelque deux heures d’ambiance, la clameur s’éteint. Le chant de clôture, tout comme le chant d’ouverture, est le même tous les jours : « Aié tolonguè dougou déni wéé tolo yé dougou dia ». Alors que le premier est une invitation à l’amusement, le dernier chant vante le mérite qu’il y a à animer le village. Dès son entonnement, on se retire un à un ou par groupes générationnels. Chacun retrouve sa couchette pour une courte nuit de sommeil. On est pressé que le jour se lève, que la nuit tombe, et qu’on revienne jouer encore sur la place publique. On le sait, le clair de lune ne dure pas tout le mois alors, on en profite autant que faire se peut. Ainsi va la vie à Sokala.
Ce matin, de bonne heure, la voix terrible du tam-tam parleur se fait entendre. C’est une convocation. Tous les villageois se rassemblent le temps du battement des paupières comme s’ils s’y attendaient. La nouvelle est très simple : le garde de sous-préfecture, envoyé au village, débout à côté du Chef Canton, lit dans un français approximatif la liste des enfants qui doivent prendre le chemin de l’école, la rentrée prochaine. Des parents sont très mécontents parce que leurs enfants ont été cités. Ces parents ont pourtant bûché comme des fous dans le champ du Chef pour que celui-ci leur épargne les dépenses engendrées par la scolarisation d’un enfant.
Yonton Wédjori, le propriétaire de la cour attenante à la nôtre, a deux garçons. Les deux ont été sélectionnés pour l’école. Mais finalement, un seul part à l’école avec moi. Paradoxalement, c’est celui-là même qui éprouve des troubles du langage. Il se prénomme Yonton Djinmin. Nous sommes dans la même classe. Il a une cicatrice sur la tête et les amis l’agacent en y déposant des pièces de monnaie. Chamonri Peh, un autre élève de ma classe, vit au village avec ses grands-parents. Tous les matins, il suit sa grand-mère qui, de concession en concession, vend du tabac en poudre. La grand-mère, chaque jour, lui remet le premier sou obtenu pour son petit-déjeuner à la récréation. Mon ami Tafoh Panh est le fils d’un influent notable du village. C’est sans doute ce qui explique que tous ses frères et sœurs soient à l’école. Monsieur Panh, le père de Tafoh est beau, grand et intelligent. Ses points de vue ne souffrent d’aucune impureté, mais vraiment un homme sage ! Sur la question de l’école, son avis est tranché. Pour lui, les autres notables se doivent de donner le bon exemple aux villageois en acceptant l’école pour tous leurs enfants, filles et garçons.
Notre école est isolée du village. Elle tient sur deux bâtiments. Le premier, pur produit de la cravache coloniale, est construit en granite. Il abrite les deux cours préparatoires (CP1 et CP2) et le cours élémentaire première année (CE1). Le second, fait en briques, a été construit sous le soleil des indépendances. Il est celui du cours élémentaire deuxième année (CE2) et des deux cours moyens (CM1 et CM2). Entre les deux bâtisses se trouve un gros arbre sur lequel est accrochée la cloche. La cour de l’école s’étend jusqu’à la lisière du village. Au beau milieu se trouve le mât sur lequel flotte le drapeau du pays. Les habitations des instituteurs, avec leurs toits de tôle, sont les seules maisons de type moderne à Sokala. Elles sont situées à bonne distance des salles de classe. Dans les alentours se trouve un rocher. Ce lieu est la demeure d’un des génies protecteurs du village, Gnangangolo-gbocho ; probablement le garant de la réussite des élèves. Ce génie réclame sans cesse des sacrifices de moutons pour nous protéger des envoûtements lancés par les ennemis de l’école. Il semble que Djompégué-gbocho et Fouin-gbocho les deux autres génies protecteurs du village, portent souvent secours au génie de l’école. Aussi, à chacune de ses sorties, Toudouan le masque pisteur, grimpe d’abord la montagne, fait le tour de l’établissement, va à Fouin puis à Djompégué avant de terminer sa course folle par un autre tour de l’école. La viande des animaux, immolés pour la circonstance, est cuite dans l’enceinte de l’établissement. Nous sommes aux aguets, et le sacrificateur après avoir fini ses préceptes, crie «





























