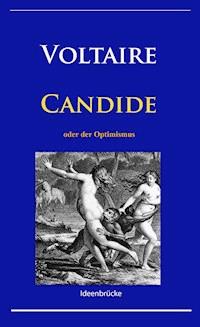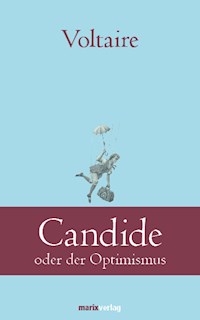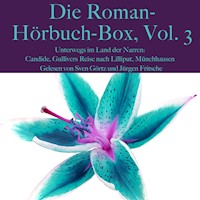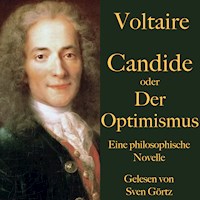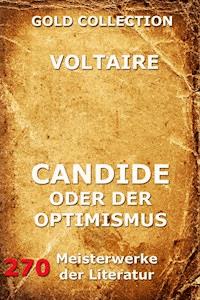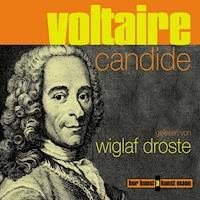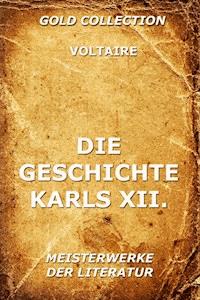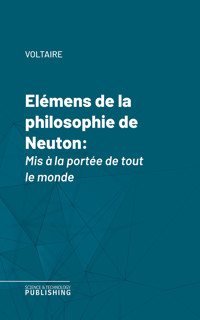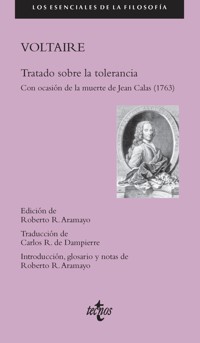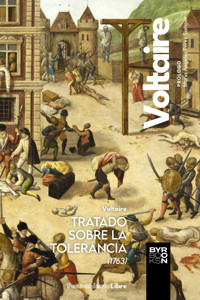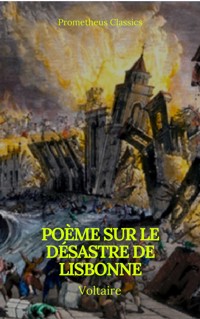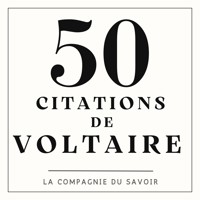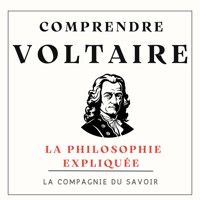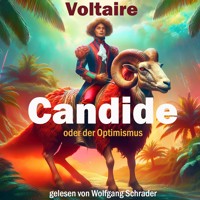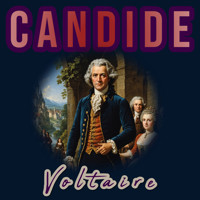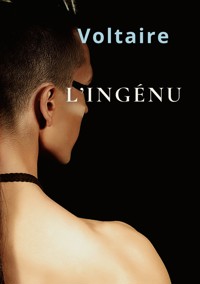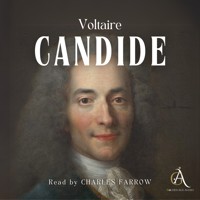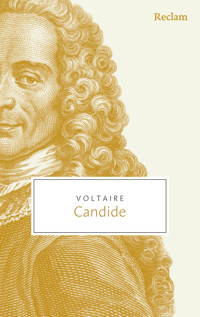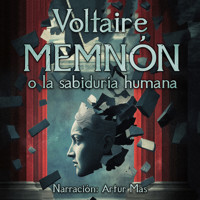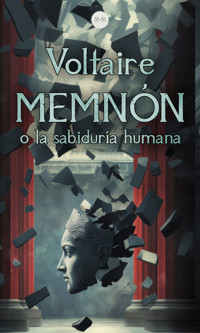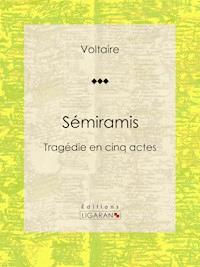
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "ARZACE : Oui, Mitrane, en secret l'ordre émané du trône, Remet entre tes bras Arzace à Babylone. Que la reine en ces lieux, brillants de sa splendeur, De son puissant génie imprime la grandeur ! Quel art a pu former ces enceintes profondes, Où l'Euphrate égaré porte en tribut ses ondes ; Ce temple, ces jardins dans les airs soutenus ; Ce vaste mausolée où repose Ninus ? Éternels monuments, moins admirables qu'elle ! C'est ici qu'à ses pieds Sémiramis m'appelle."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335067378
©Ligaran 2015
« Voltaire, irrité d’entendre appeler l’auteur d’Atrée et Thyeste le Sophocle du siècle, sachant d’ailleurs que certaines gens, et parmi eux Marivaux, disaient que tout son bel esprit devait pâlir et s’éclipser devant le génie de Crébillon, avait juré de ne pas laisser debout une de ses pièces, et de démontrer jusqu’à l’évidence la plus brutale la distance qui les séparait l’un de l’autre, en refaisant successivement toutes les tragédies du vieux poète… Le refus d’approbation de Mahomet est son grand grief contre Crébillon, qui déclara, en qualité de censeur, la pièce inacceptable ; et il ne le lui pardonna pas. Ce qu’il ne lui pardonna pas davantage, ce fut d’avoir à partager avec lui les faveurs de Mme de Pompadour, qui bientôt même inclinera du côté de l’auteur de Catilina, plus par politique peut-être que par entraînement. On lui opposait ce poète rocailleux, incorrect, barbare, que l’on affectait de considérer comme notre troisième tragique ; il saurait démasquer l’envie et prouver qu’entre l’auteur d’Électre et lui il y avait des abîmes ! »
C’est ainsi que M. G. Desnoiresterres explique l’origine de cette tragédie, et il n’y en a point d’autre explication, malgré le singulier roman que M. Michelet a imaginé à ce propos. Crébillon avait fait représenter sa Sémiramis le 10 avril 1717. Ce n’était pas la première fois que ce sujet avait été traité. Il y avait eu deux tragédies de Sémiramis assez remarquables au siècle précédent, l’une de Gilbert, représentée en 1647, l’autre par Desfontaines, qui ne paraît pas avoir été représentée, et qui fut imprimée la même année 1647 sous le titre de la Véritable Sémiramis. Un peu plus d’une année avant de jouer l’œuvre de Crébillon, les mêmes comédiens avaient donné une Sémiramis romanesque et très faible, de Mme de Gomez, tragédie qui n’avait eu que trois représentations.
La Sémiramis de Crébillon n’en eut que sept dans sa nouveauté. Sémiramis n’est pas la meilleure pièce de Crébillon ; Rhadamiste, Électre, Atrée et Thyeste, sont bien supérieures. Il était certainement permis à un écrivain de traiter le même sujet après un intervalle de trente et un ans.
Continuons de citer M. Desnoiresterres : Encore fallait-il être joué. Voltaire prendra d’abord ses sûretés contre l’auteur de la première Sémiramis, qui n’avait que trop de facilités pour empêcher la représentation de la seconde. Au-dessus de l’approbation des censeurs, il y avait celle du lieutenant de police ; Voltaire adresse à celui-ci une belle lettre où il manifeste confidentiellement ses appréhensions. Il peut s’alarmer à tort ; mais, à tout évènement, il en appelle à l’équité, à la haute bienveillance du magistrat. « Permettez, lui écrivait-il, qu’en partant pour Commercy, je remette la tragédie de Sémiramis entre vos mains et que je vous demande votre protection pour elle. On la représentera pendant mon absence (il ignorait alors qu’il assisterait à la première soirée). Je commence par la soumettre à votre décision, non seulement comme à celle du magistrat de la police, mais comme aux lumières d’un juge très éclairé. M. Crébillon, commis par vous à l’examen des ouvrages de théâtre, a fait autrefois une tragédie de Sémiramis, et peut-être ai-je le malheur qu’il soit mécontent que j’ai travaillé sur le même sujet. Je lui en ai pourtant demandé la permission, et je vous demande à vous, monsieur, votre protection, m’en remettant à vos bontés et à votre prudence. M. Berrier répondit le plus obligeamment du monde, et l’action de Crébillon se borna à la suppression de quelques vers. Voltaire estima que c’était encore trop, et n’eut de repos qu’après avoir fait restituer les passages retranchés. »
Les comédiens firent pour cette pièce des changements de décors qui n’étaient pas dans leurs habitudes. C’est que Louis XV s’était chargé de la dépense du spectacle, en considération de feu Mme la Dauphine pour qui la nouvelle tragédie avait été faite. – Cette dépense fut réglée à cinq mille francs selon les uns, à huit ou dix mille selon les autres, ce qui ne serait pas encore un chiffre très élevé, si nous le comparions à ce qu’il en coûte aujourd’hui pour monter une pièce avec quelque luxe.
Le grand obstacle à l’effet de la représentation, c’était l’encombrement du théâtre par les spectateurs. Le premier soir, il y eut une telle foule que les comédiens ne pouvaient se mouvoir. À la scène du tombeau de Ninus, la sentinelle postée sur le théâtre, ne voyant pas de passage suffisant même pour un fantôme, cria tout haut : « Place à l’Ombre ! » L’Ombre s’embarrassa dans les jambes des jeunes seigneurs, et faillit tomber. On n’a pas de peine à comprendre combien, dans de telles conditions, toute illusion devenait impossible. Aux soirées suivantes, on prit les précautions nécessaires pour ne pas laisser pénétrer sur le théâtre plus de monde qu’il ne fallait.
Le succès ne fut pas décisif à la première représentation. Il y avait deux camps dans la salle, celui des ennemis de Voltaire et celui de ses partisans. Dans le premier étaient les « soldats de Corbulon », comme Voltaire appelait les partisans de Crébillon, les jaloux et les rivaux. Piron était à leur tête. L’autre camp, celui des amis, était nombreux et composé avec soin. Voltaire avait distribué quatre cents billets, et les avait placés en de bonnes mains, c’est-à-dire, « capables de bien claquer, et à propos », comme dit Longchamp. Ces troupes amies étaient conduites par Thiériot, Dumolard, Lambert, de Lamara, de Mouhy, et le chevalier de la Morlière dont l’influence dans le parterre était presque souveraine.
Les trois premiers actes, malgré ces précautions, furent accueillis froidement. Le quatrième échoua à cause de l’intervention naïve du grenadier que nous venons de rappeler et de la gaucherie de l’acteur Legrand chargé du personnage de l’Ombre. Le cinquième acte fut applaudi ; il y avait loin, toutefois, de ces applaudissements a l’enthousiasme excité par Zaïre et par Mérope.
Les représentations suivantes furent courues, mais l’ouvrage demeurait très contesté. Piron lançait épigramme sur épigramme. Il fit une sorte de compte rendu en chanson, qu’il intitula l’Inventaire, et qui se chantait sur l’air de l’opéra de Pyrame et Thisbé,
Les Ana ont reproduit ce petit dialogue entre Piron et Voltaire à propos de Sémiramis : « Vous voudriez bien que je l’eusse faite, aurait dit Piron. – Je vous aime assez pour cela, » eût répondu Voltaire. D’autres placent le trait à propos de Nanine, et tournent autrement la réponse de Voltaire : « Mais, lui fait-on répliquer, on n’a pas sifflé. – Eh ! repart Piron, peut-on siffler quand on bâille. » Tout cela est évidemment de pure invention.
Dans sa nouveauté, Sémiramis eut vingt et une représentations. Elle fut représentée, le jeudi 24 octobre, sur le théâtre de Fontainebleau, et y fut assez bien reçue. Le 10 mars 1749, Voltaire fit reprendre cette pièce avec des corrections qu’il y avait faites, et elle réunit tous les suffrages. C’était dans le cinquième acte qu’il avait introduit le plus de changements.
« La Sémiramis de M. de Voltaire, lisons-nous dans les Anecdotes dramatiques (1775), est une des pièces de cet homme célèbre qui attire aujourd’hui le plus nombreux concours de spectateurs, et que l’on donne le plus souvent… On n’oubliera jamais le jeu terrible et animé du sieur Lekain, chargé du rôle d’Arzace, sortant du tombeau de Ninus, le bras nu et ensanglanté, les cheveux épars, au bruit du tonnerre, à la lueur des éclairs ; arrêté par la terreur à la porte ; luttant pour ainsi dire contre la foudre. Ce tableau, qui dure quelques minutes et qui est de l’invention de l’acteur fait toujours le plus grand effet. »
Si de grands défauts ne permettent pas que cette tragédie soit comptée parmi les pièces du premier ordre, ses beautés poétiques et théâtrales la rangent au moins parmi les premières du second. C’est la conclusion de Laharpe.
Cette tragédie, d’une espèce particulière, et qui demande un appareil peu commun sur le théâtre de Paris, avait été demandée par l’infante d’Espagne, dauphine de France, qui, remplie de la lecture des anciens, aimait les ouvrages de ce caractère. Si elle eût vécu, elle eût protégé les arts, et donné au théâtre plus de pompe et de dignité.
À S.ÉM. Mgr le cardinal Quirini, noble vénitien évêque de Brescia, bibliothécaire du Vatican
MONSEIGNEUR,
Il était digne d’un génie tel que le vôtre, et d’un homme qui est à la tête de la plus ancienne bibliothèque du monde, de vous donner tout entier aux lettres. On doit voir de tels princes de l’Église sous un pontife qui a éclairé le monde chrétien avant de le gouverner. Mais si tous les lettrés vous doivent de la reconnaissance, je vous en dois plus que personne, après l’honneur que vous m’avez fait de traduire en si beaux vers la Henriade et le Poème de Fontenoy. Les deux héros vertueux que j’ai célébrés sont devenus les vôtres. Vous avez daigné m’embellir, pour rendre encore plus respectables aux nations les noms de Henri IV et de Louis XV, et pour étendre de plus en plus dans l’Europe le goût des arts.
Parmi les obligations que toutes les nations modernes ont aux Italiens, et surtout aux premiers pontifes et à leurs ministres, il faut compter la culture des belles-lettres, par qui furent adoucies peu à peu les mœurs féroces et grossières de nos peuples septentrionaux, et auxquelles nous devons aujourd’hui notre politesse, nos délices et notre gloire.
C’est sous le grand Léon X que le théâtre grec renaquit, ainsi que l’éloquence. La Sophonisbe du célèbre prélat Trissino, nonce du pape, est la première tragédie régulière que l’Europe ait vue après tant de siècles de barbarie, comme la Calandra du cardinal Bibiena avait été auparavant la première comédie dans l’Italie moderne.
Vous fûtes les premiers qui élevâtes de grands théâtres, et qui donnâtes au monde quelque idée de cette splendeur de l’ancienne Grèce, qui attirait les nations étrangères à ses solennités, et qui fut le modèle des peuples en tous les genres.
Si votre nation n’a pas toujours égalé les anciens dans le tragique, ce n’est pas que votre langue, harmonieuse, féconde, et flexible, ne soit propre à tous les sujets ; mais il y a grande apparence que les progrès que vous avez faits dans la musique ont nui enfin à ceux de la véritable tragédie. C’est un talent qui a fait tort à un autre.
Permettez que j’entre avec Votre Éminence dans une discussion littéraire. Quelques personnes, accoutumées au style des épîtres dédicatoires, s’étonneront que je me borne ici à comparer les modernes, au lieu de comparer les grands hommes de l’antiquité avec ceux de votre maison ; mais je parle à un savant, à un sage, à celui dont les lumières doivent m’éclairer, et dont j’ai l’honneur d’être le confrère dans la plus ancienne académie de l’Europe, dont les membres s’occupent souvent de semblables recherches ; je parle enfin à celui qui aime mieux me donner des instructions que de recevoir des éloges.
Un célèbre auteur de votre nation dit que, depuis les beaux jours d’Athènes, la tragédie, errante et abandonnée, cherche de contrée en contrée quelqu’un qui lui donne la main et qui lui rende ses premiers honneurs, mais qu’elle n’a pu le trouver.
S’il entend qu’aucune nation n’a de théâtres où des chœurs occupent presque toujours la scène et chantent des strophes, des épodes, et des antistrophes, accompagnées d’une danse grave ; qu’aucune nation ne fait paraître ses acteurs sur des espèces d’échasses, le visage couvert d’un masque qui exprime la douleur d’un côté et la joie de l’autre ; que la déclamation de nos tragédies n’est point notée et soutenue par des flûtes, il a sans doute raison : je ne sais si c’est à notre désavantage. J’ignore si la forme de nos tragédies, plus rapprochée de la nature, ne vaut pas celle des Grecs, qui avait un appareil plus imposant.
Si cet auteur veut dire qu’en général ce grand art n’est pas aussi considéré depuis la renaissance des lettres qu’il l’était autrefois ; qu’il y a en Europe des nations qui ont quelquefois usé d’ingratitude envers les successeurs des Sophocle et des Euripide ; que nos théâtres ne sont point de ces édifices superbes dans lesquels les Athéniens mettaient leur gloire ; que nous ne prenons pas les mêmes soins qu’eux de ces spectacles devenus si nécessaires dans nos villes immenses, on doit être entièrement de son opinion :
HORACE, II, ép. I, 68.