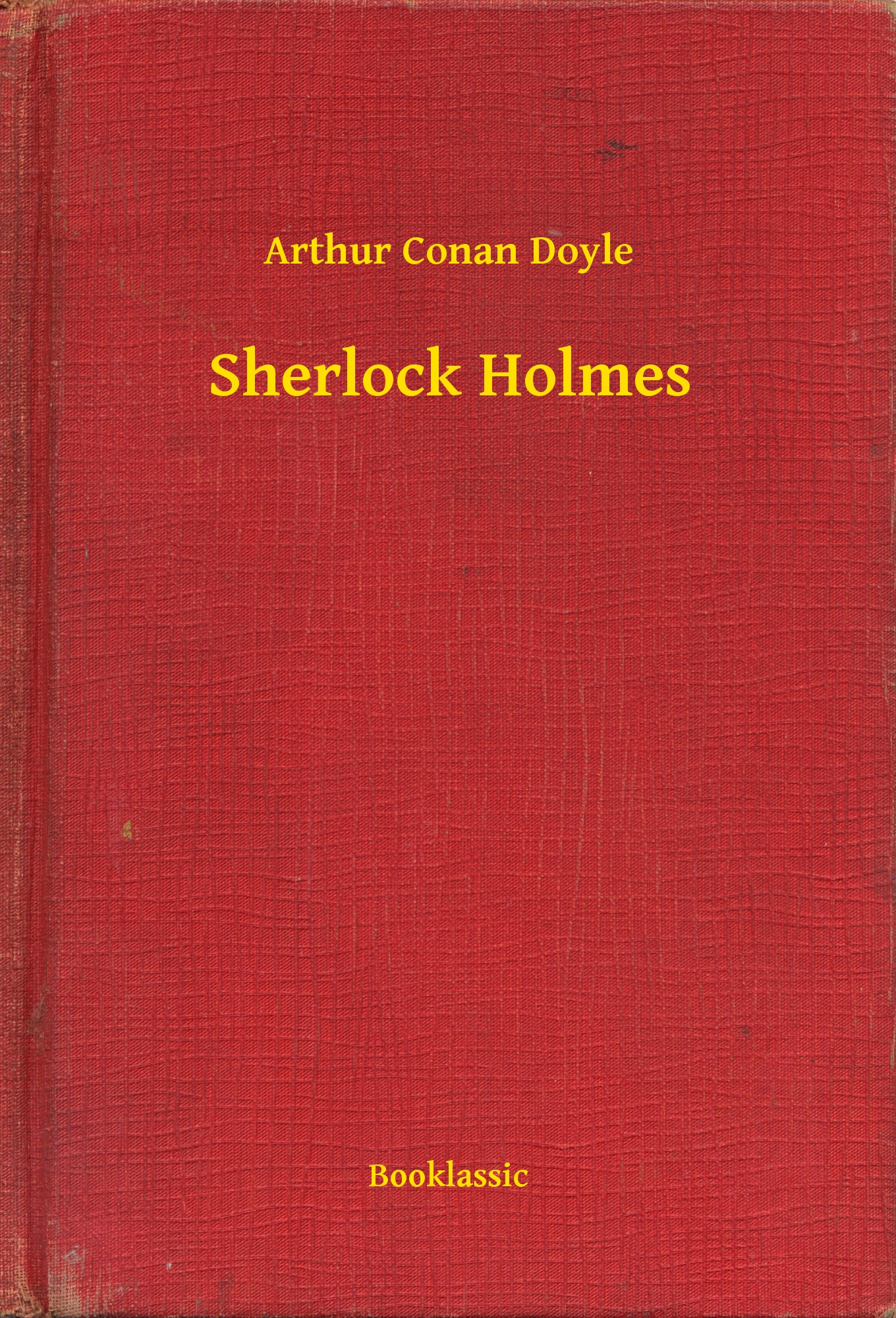
0,88 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: WS
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Sherlock Holmes was written in the year 1899 by Arthur Conan Doyle. This book is one of the most popular novels of Arthur Conan Doyle, and has been translated into several other languages around the world.
This book is published by Booklassic which brings young readers closer to classic literature globally.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sherlock Holmes
Arthur Conan Doyle
ACTE PREMIER
DÉCOR : Un salon dans la maison des Murray, vieille demeure triste et en mauvais état, dans un lointain quartier de Londres. Cependant, la pièce est vaste et conserve un certain aspect de grandeur. Un escalier au fond de la pièce conduit au premier étage, dont on entrevoit le palier. À droite, une porte donnant dans le vestibule. Une large fenêtre occupe la plus grande partie du côté droit.
Le mobilier, qui a été riche, est d'ancienne mode et fané; un piano. À gauche du spectateur, un meuble, genre secrétaire, ou armoire à une porte, dans le compartiment inférieur duquel se trouve un coffre-fort avec des combinaisons de lettres. Lampes allumées.
SCÈNE I
MADGE MURRAY, BENJAMIN
Mme Murray est une belle personne brune d'une trentaine d'années, au visage et aux yeux durs. Elle est habillée avec recherche.
Benjamin entre, portant un plateau sur lequel est un journal. C'est un maître d'hôtel, tenue irréprochable.
BENJAMIN. – C'est à la troisième page, madame, en haut de la deuxième colonne.
MADGE. – Merci !
BENJAMIN,pendant que Madge prend le journal. – Je demande pardon à Madame, mais la femme de chambre voudrait lui dire quelques mots.
Madge a pris le journal et s'est assise sur un fauteuil, puis a commencé à lire.
MADGE,les yeux fixés sur le journal. – Je n'ai pas le temps pour le moment.
BENJAMIN. – Bien, madame.
MADGE,sans lever les yeux du journal. – Laquelle des deux femmes de chambre est-ce ?
BENJAMIN,s'arrêtant. – Thérèse, madame.
MADGE,paraissant surprise. – Thérèse ?
BENJAMIN. – Oui, madame.
MADGE. – Avez-vous idée de ce qu'elle veut me dire ?
BENJAMIN. – Pas du tout, madame.
MADGE. – Eh bien ! qu'elle vous le communique. Je ne la verrai que quand je saurai ce qu'elle désire.
BENJAMIN. – Je ferai la commission, madame. Il sort, en fermant soigneusement la porte derrière lui.
Madge, une fois seule, examine avec attention le journal. Elle s'approche d'une des lampes pour pouvoir lire plus facilement.
Benjamin rentre doucement. Il reste un moment à la porte et observe Madge occupée à sa lecture. Celle-ci l'a terminée et se lève avec irritation. Jetant violemment son journal sur le piano, elle se dirige vers le meuble qui contient le coffre-fort. Après avoir ouvert la porte de bois, elle fixe ardemment les yeux sur les rouleaux des lettres, puis elle referme brusquement la porte. À ce moment, elle voit Benjamin et se calme immédiatement. Celui-ci prend la mine d'un homme qui vient seulement d'entrer dans la pièce.
BENJAMIN. – Je ne peux pas faire entendre raison à Thérèse. Elle insiste pour parler à madame.
MADGE. – Eh bien ! qu'elle attende à demain.
BENJAMIN. – C'est ce que je lui ai dit, mais elle m'a répondu qu'elle ne sera plus ici demain.
MADGE,étonnée. – Qu'est-ce que cela signifie ?
BENJAMIN. – Je demande pardon à madame; mais il me semble qu'elle a l'air un peu étrange depuis quelque temps.
MADGE. – C'est bon ! Dites-lui de venir.
Benjamin s'incline et va pour sortir.
MADGE,le rappelant. – Ah ! Benjamin ! Le maître d'hôtel s'arrête. Qu'est-ce qui vous a donc fait croire en m'apportant ce journal, que je prenais un intérêt quelconque à cette annonce de mariage qu'il contient ?
BENJAMIN,avec déférence. – J'avais entendu madame causer avec monsieur des personnes que ce mariage concerne. C'est ce qui m'avait fait croire que cela pouvait l'intéresser.
MADGE. – Benjamin, vous êtes intelligent, et j'aime cette qualité chez mes serviteurs… Souvenez-vous cependant que s'il est bon, pour un maître d'hôtel, d'avoir de l'esprit, il peut être mauvais d'en avoir trop.
BENJAMIN. – Je me le tiendrai pour dit, madame.
MADGE. – Maintenant envoyez-moi Thérèse !
BENJAMIN. – Bien, madame.
Il sort.
SCÈNE II
Madge reste un moment songeuse. Puis elle reprend le journal et relit le passage qui l'avait intéressée. On entend la porte extérieure de la maison se fermer violemment. Madge lève la tête et se dirige vers la porte du vestibule.
Entre Murray. C'est un homme grand, solidement bâti, au visage résolu. Sa mine est soignée et son extérieur serait séduisant si son regard, à de certains moments, ne prenait un aspect encore plus dur que celui de sa femme.
MADGE,vivement. – Eh bien ? As-tu trouvé notre homme ?
MURRAY. – Non. Il va au meuble dont il ouvre nerveusement la porte; il donne un tour ou deux aux lettres tout en parlant. Il n'était pas chez lui… Ah ! Il va falloir appeler un serrurier !
MADGE,vivement. – Non ! non ! à aucun prix ! ce serait une imprudence !
MURRAY. – Pourtant, il faut croire quelque chose. Revenant au coffre-fort. Je ne connais rien à ces satanés engins. Et nous n'avons plus un instant à perdre ! Il y a du nouveau.
MADGE. – Quelque chose de grave ?
MURRAY. – Et d'inquiétant !… Les hauts personnages que vise notre opération viennent de mettre dans leur jeu Sherlock Holmes…
MADGE,tressautant. – Sherlock Holmes ? Le détective amateur ?
MURRAY. – Parbleu !… Comme s'il y en avait un autre !
MADGE. – Comment sais-tu cela ?
MURRAY. – Je l'ai appris par des gens qui sont intéressés à savoir exactement tout ce qui concerne Sherlock Holmes… Toutes les fois qu’il s'attelle à une nouvelle affaire, ils sont renseignés.
MADGE. – Eh bien ! Tout Sherlock Holmes qu'il est, que fera-t-il ?
MURRAY. – Je n'en sais rien, mais sûrement il fera quelque chose… Il a beau n'être qu'un détective privé, un amateur, il voit autrement clair et loin que la vraie police. La preuve, c'est que dès qu'il y a quelque part, sur toute la surface du monde civilisé, un problème à résoudre, un écheveau difficile à débrouiller, c'est à lui qu'on s'adresse. Et quand une fois il a pris une affaire en main, il n'est pas long à agir.
MADGE. – Alors, il n'y a pas à tergiverser, et puisque tu n'as pu dénicher Bribb, il faut sur-le-champ trouver quelqu'un qui s'acquitte de la besogne à sa place.
MURRAY. – Bribb peut encore venir. J'ai laissé un mot à son bar habituel et j'ai lancé sur sa piste quelques camarades. Avec un grondement de mauvaise humeur. Quelle déveine ! Dire que voici dix-huit mois que nous trimballons avec nous ces deux femmes, que nous les amadouons, que nous les dorlotons, et que juste au moment où nous croyons enfin les avoir amenées au point que nous désirions, cette mâtine de fille nous joue un tour pareil ! Regardant l'escalier. Si je montais la voir et causer un instant avec elle… peut-être arriverais-je à la convaincre.
MADGE. – Vas-y, si tu veux, mais tu n'obtiendras rien par la violence.
MURRAY. – Eh bien ! J'essaierai de la douceur, quoique ce ne soit guère dans mes cordes.
À ce moment Thérèse entre.
MADGE. – Ah ! c'est vous, Thérèse ! … Attendez une seconde, je vais vous parler. Remontant vers l'escalier. Surtout, Jim, garde ton sang-froid.
MURRAY. – Sois tranquille !
SCÈNE III
MADGE, THÉRÈSE, puis MISTRESS BRENT
THÉRÈSE. – Benjamin, le maître d'hôtel, m'a dit que madame avait à me parler.
MADGE. – C'est plutôt vous, paraît-il, qui désiriez me voir… Est-ce vrai, ce qu'on me dit : Vous voulez quitter la maison ?
THÉRÈSE. – Oui, madame.
MADGE. – Et pour quel motif, s'il vous plaît ?
THÉRÈSE. – Je désire retourner à Paris. Je ne m'accommode décidément pas de l'Angleterre. J'ai comme qui dirait le mal du pays.
MADGE. – Pourtant, voilà deux ans que vous êtes à mon service, et vous ne vous plaigniez pas ?
THÉRÈSE. – C'est possible, madame, mais aujourd'hui n'est pas hier ! Et puis, s'il faut tout dire, il se passe ici depuis quelque temps des choses qui ne me plaisent pas.
MADGE,vivement. – Vraiment ? À quelles choses faites-vous allusion, s'il vous plaît ?
THÉRÈSE. – Que madame ne me force pas à dire tout ce que je pense ! … Ce qui se trame dans cette maison ! … La façon qu'a monsieur de traiter la jeune dame qui est là-haut ! … Tout ça ne me va pas… Je préfère m'en aller.
MADGE. – Vous ne savez pas ce que vous dites ! La personne dont vous parlez est souffrante ! Sa maladie est, pour nous, un grave sujet e préoccupation… et nous avons, au contraire, pour sa santé, tous les soins, tous les ménagements possibles.
À ce moment, un gémissement prolongé part de l'étage supérieur. Les deux femmes s'arrêtent immobiles. Au même instant, entre en scène, descendant par l'escalier, mistress Brent, une femme âgée, à l'air distingué, aux cheveux blancs, vêtue d'une robe d'intérieur.
MISTRESS BRENT,gémissant. – Mon enfant !
MADGE,allant à elle, entre ses dents. – Qu'est-ce que vous venez faire ici ?
MISTRESS BRENT. – On maltraite encore mon enfant !
MADGE. – Ne vous ai-je pas défendu de quitter votre chambre ?
La vieille dame a un geste de frayeur devant le visage courroucé de Madge. Celle-ci continue d'un ton menaçant. Allons ! venez ! accompagnez-moi. Elle prend mistress Brent par le bras et l'attire, malgré ses efforts, vers la porte. Le même gémissement que précédemment, se fait entendre, mais plus assourdi. Venez, je vous dis !
THÉRÈSE. – Madame…
MADGE,changeant de ton subitement et parlant à mistress Brent d'une voix presque affectueuse. – N'ayez pas peur, ma bonne amie, votre pauvre chère fille n'est pas très bien aujourd'hui… Son cerveau est encore malade, mais elle ne tardera pas à se rétablir. Impérieusement à Thérèse. Thérèse, je causerai avec vous demain matin. Àmistress Brent. Accompagnez-moi, je vous en prie ! À voix basse, d'un ton menaçant. M'entendez-vous ?
Elle prend violemment mistress Brent par le bras et l'entraîne vers l'escalier. Thérèse suit des yeux ce jeu de scène.
Juste au moment où Madge et la vieille dame disparaissent, Benjamin entre. Il va à Thérèse et, l'un et l'autre se regardent un instant sans mot dire.
SCÈNE IV
BENJAMIN, THÉRÈSE
BENJAMIN. – Eh bien ? Je pense que vous êtes tombée d'accord avec la patronne. Et que vous n'avez plus envie de nous quitter ?
THÉRÈSE. – J'en ai, au contraire, plus envie que jamais ! … Avez-vous entendu crier cette malheureuse ? Qu'est-ce qu'ils lui font ?
BENJAMIN. – Elle est peut-être plus souffrante.
THÉRÈSE. – Ce sont eux qui la rendent malade à force de mauvais traitements ! Non ! non ! Je ne veux pas assister à cela. Je trouverai une autre place.
BENJAMIN,à mi-voix. – J'en ai peut-être une pour vous. THÉRÈSE. – Vrai ? Où cela ?
BENJAMIN,avec mystère. -Tenez, voici l'adresse. Il écrit quelques mots sur une carte.
THÉRÈSE. – Mais est-ce une place sérieuse, une place chez des gens convenables ?
BENJAMIN. – Soyez tranquille ! mais, surtout, ne laissez voir cette carte à personne.
THÉRÈSE,lisant tandis que Benjamin regarde au dehors. – « Sherlock… Holmes ».
BENJAMIN,se tournant vers Thérèse. – Chut donc ! … Pas si haut ! On pourrait vous entendre ! … Allez à cette adresse demain matin… Vous ne vous en repentirez pas.
La sonnette de la porte d'entrée se fait entendre.
THÉRÈSE. – On sonne à la porte d'entrée.
BENJAMIN. – Oui… Je vais ouvrir.
Thérèse sort d'un côté, Benjamin va à la porte du fond qui donne dans le vestibule. On le voit ouvrir la porte à Bribb.
SCÈNE V
BENJAMIN, BRIBB
Bribb est un garçon court, gros, leste et éveillé. Il porte à la main un petit sac de cuir. Il est vêtu assez élégamment, chapeau haut de forme, gants comme un employé de bureau, coquet de sa personne, bague, épingle de cravate, chaîne de montre.
BENJAMIN. – Monsieur veut-il me dire qui je dois annoncer.
BRIBB. – En voilà des cérémonies ! … Vous me parlez comme si je n’étais pas un ami de la maison ! … Enfin, puisque vous y tenez. Avec importance. Annoncez à vos maîtres M. John Alfred Napoléon Bribb.
BENJAMIN. – Monsieur peut compter sur moi… Il sort par l'escalier.
Bribb ôte son chapeau et ses gants qu'il pose sur son sac. Il jette un regard investigateur autour de lui et, avisant le gros meuble d'en face, il y va tout droit, ouvre la porte et examine attentivement le coffre-fort.
BRIBB. – Voilà probablement l'objet. Il s'agenouille et donne un tour aux rouleaux des lettres. Puis il se lève et va à son sac dans lequel il fouille.
SCÈNE VI
BRIBB, MADGE, MURRAY
MADGE,à Bribb qui continue ses recherches. – Enfin, c'est vous Bribb ?
MURRAY. – Nous t'attendions avec impatience. Tu as reçu mon mot ?
BRIBB,continuant à chercher quelque chose clans son sac. – Naturellement, puisque me voici. Désignant de la tête le meuble. C'est pour ce gros papa-là, hein, que vous avez besoin de moi ?
MADGE. – En ne vous voyant pas venir, nous craignions d'être obligés de recourir à un étranger.
BRIBB,important. – Inutile !… Bribb est là. Bribb est d'attaque. Bribb se charge de tout !… Et vous croyez que le jeu en vaut la chandelle ?
MURRAY. – Je t'en réponds !
BRIBB. – All right, alors ! … Il va au coffre-fort tenant à la main des outils qu’il a retirés de son sac. Dis donc, Orlebar !
MADGE. – Chut !
MURRAY. – Pas ce nom-là, donc ! Ici, je m'appelle Murray.
BRIBB. – Je te demande pardon ! C'est une vieille habitude du temps où nous apprenions le métier ensemble.
MURRAY. – Il y a longtemps !
BRIBB. – Pour sûr ! … Ah ! tu ne t'attendais pas plus que moi, à mener la grande vie à cette époque-là, quand nous travaillions sur la ligne des steamers de Liverpool à New York.
MURRAY. – Ne parle donc pas de ça !
MADGE. – Ce qui importe, Bribb, c'est d'ouvrir au plus vite ce coffre-fort. Nous n'avons pas de temps à perdre.
BRIBB,choisissant parmi ses outils. – Soyez tranquille ma chère ! Cette antique carcasse ne résistera pas longtemps aux instruments perfectionnés et à l'habileté de John Alfred Napoléon Bribb. Un temps. Par exemple, je me demande où vous avez pu dénicher un modèle comme celui-là !… Je dirais qu'il est certainement venu au monde avant mon grand-père, si j'avais jamais connu ce respectable gentleman… Au moment d'essayer un outil dans la serrure. On peut travailler sans crainte, n'est-ce pas ? Pas de gêneurs aux environs ?
MURRAY. – Sois tranquille.
Tous les deux le regardent travailler avec anxiété.
BRIBB,Il travaillant, puis changeant de ton, il retourne chercher dans son sac un vilebrequin qu'il commence à ajuster. – Alors, c'est de la galette qu'il y a là dedans, une grosse galette ?
MURRAY. – Tu n'y es pas.
BRIBB. – Bah ! quoi donc, alors ?
MADGE. – Une liasse de papiers, tout simplement.
BRIBB. – J’y suis !… Des titres, des valeurs ?
MADGE, – Vous pouvez être tranquille… Ils nous en rapporteront…
BRIBB. – Un moment !… Puisque c'est une affaire, j'en suis, n'est-ce pas ?
MADGE. – Comme de juste, Bribb ! La peine que vous prenez mérite salaire.
BRIBB. – À la bonne heure… Ça va ronfler, vous allez voir ! Pendant que je travaille, expliquez-moi donc en deux mots l’opération.
MURRAY. – À quoi bon des bavardages inutiles.
BRIBB. – Mon cher, si j'en suis, j'en suis, et j'aime à savoir sur quel terrain je travaille.
MADGE. – Pourquoi ne pas lui dire la chose carrément ?
BRIBB. – S'il arrive une complication, je suis capable de donner un bon conseil.
MURRAY. – Eh bien, soit ! mais à la condition que je ne te nommerai pas les personnes mêlées à la combinaison.
BRIBB. – Oh ! les noms, je m'en fiche pas mal.
MURRAY,se rapprochant de Bribb et parlant à mi-voix. – Tu sais que ces dernières années, Madge et moi, nous avons travaillé sur le continent en France, en Allemagne, en Italie…
BRIBB. – Je l'ai entendu dire…
MURRAY. – C'est à Ostende que le chopin s'est présenté… Nous avions fait la connaissance d'une jeune fille, une jeune fille charmante, de la meilleure société, malheureusement attristée par des chagrins de famille. Sa sœur venait de mourir et sa mère, à la suite de la catastrophe, était tombée gravement malade.
BRIBB. – Et vous avez pris soin d'elle ? Je reconnais votre bon cœur.
MURRAY. – Madge, qui avait gagné sa confiance, ne tarda pas à apprendre que la sœur en question…
BRIBB. – La morte ?
MADGE. – Précisément…
MURRAY. – Que la sœur donc avait eu une intrigue avec… s’arrêtant avec une sorte d'hésitation, avec un grand seigneur étranger… Mais un grand seigneur, dans la plus haute acception du terme.
BRIBB. – Un homme huppé, quoi ! un numéro un…
MADGE,insistant. – Et appartenant à une famille d'un rang particulièrement élevé.
BRIBB. – Quoi, c'est tout de même pas des empereurs ?
MURRAY,hésitant. – Pas… tout à fait ! Mais on peut dire cependant que leur situation n'a guère de rivale en Europe.
BRIBB,avec une grimace. – Alors, qu'est-ce qu'il est advenu entre la petite et son amoureux rupin ?
MURRAY. – Il lui avait promis de l'épouser.
BRIBB. – Et, naturellement, il n'a pas tenu parole ?
MURRAY. – Comme tu dis ! Il l'a même abandonnée.
BRIBB,avec un soupir. – Je connais ça ! … Le désespoir s'est emparé de l'infortunée, comme on dit dans les faits divers des journaux.
MURRAY. – Tellement qu'elle en est morte, et son enfant avec elle.
BRIBB. – Bah ! Il y avait un lardon ? … Mais dans tout ça je ne vois pas notre opération.
MURRAY. – Attends… L'infidèle, au beau temps de sa passion, avait naturellement écrit, fait des cadeaux, envoyé des photographies avec des dédicaces enflammées.
BRIBB. – Oui… on fait toujours ça. Sommes-nous bêtes, hein ?
MURRAY. – Portraits et correspondances constituaient un ensemble de documents des plus intéressants, documents restés entre les mains de la sœur dont nous avions assumé la garde.
BRIBB. – Je comprends ! Elle sait que cela vaut de l'argent ? Et elle en veut ?…
MURRAY. – Non. Elle rêve autre chose : une vengeance !
BRIBB. – Oh ! que c'est mesquin ! Je pense que votre combinaison est plus pratique.
MURRAY. – Tu l'as deviné !
BRIBB. – Cette collection d'autographes, entre les mains de gens malins, c'est une mine d'or.
MURRAY. – Pardieu ! Un personnage dans la position de… celui qui a écrit ces lettres ne peut pas se marier sans être rentré d'abord en leur possession… Le jeune homme sait cela et, ce qui est plus intéressant, sa famille en est également persuadée.
BRIBB. – Riche la famille, hein ?
MURRAY. – Plus que riche.
BRIBB,ouvrant de grands yeux. – Plus que riche ?… Alors, ce que je n'osais pas supposer… Voyons ! vous pouvez bien lâcher le morceau à un vieux camarade comme moi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ?
MADGE. – Ah ! ah ! Maître Bribb, leur nom ne sous est plus si indifférent que tout à l'heure !
Murray se rapproche de Bribb et lui murmure un nom à l'oreille.
BRIBB,il siffle avec admiration. – Non ?… Eh bien ! sous en avez des relations ! … un temps. Mais la demoiselle, la sœur de l'amoureuse… Comment êtes-vous parvenus à l'amener à Londres ?
MADGE. – J'avais fini par m'insinuer tout à fait dans ses bonnes grâces. Je lui avais donné tant de marques de sympathie, tant de consolations ! … J'ai fait saloir l'intérêt qu'il y aurait pour la santé de sa mère à changer de pays… et je l'ai invitée à venir passer quelque temps chez nous. Jim, pendant ce temps, est venu louer cette maison, l'a meublée, et quand, huit jours plus tard je suis arrivée avec la demoiselle, tout était prêt, jusqu'à ce coffre-fort acheté exprès pour qu'elle pût y enfermer les lettres, les portraits et les bijoux.
MURRAY. – Tout marcha à merveille jusqu'au mois dernier où nous reçûmes la visite de deux diplomates : le comte Shtalberg et le baron d'Altenhien, qui, sans faire de proposition directe, venaient tâter le terrain, indice certain que la poire était mûre.
MADGE. – La famille, disaient-ils, désirait rentrer en possession des fameuses lettres.
MURRAY. – Je ne répondis ni oui, ni non, lorsque tout à coups les négociations s'arrêtèrent. Éclipse totale des deux émissaires. Il me parut alors nécessaire, à notre tour, de montrer les dents… Mais lorsque je voulus parcourir la correspondance, je m'aperçus que les lettres de la combinaison avaient été changées à notre insu… C'était cette coquine de fille qui avait fait le coup !… Et aucune menace ne parvint à lui arracher le mot nouveau par lequel elle avait remplacé l’autre !
BRIBB. – De sorte que tout le pot aux roses est là dedans ?
MURRAY. – Sans qu'il nous soit possible de mettre la main dessus.
BRIBB. – Sois tranquille ! Cette serrure-là ne résistera pas longtemps à mon expérience. Il continue à travailler. Mais ce qui me taquine, c'est le motif pour lequel ces deux diplomates ont cessé si brusquement leurs relations avec toi.
MURRAY. – Je l'ai appris cet après-midi… Regard interrogateur de Bribb. C'est qu'ils ne sont plus pour rien eux-mêmes dans l'affaire, dont ils ont placé la direction entre les mains de Sherlock Holmes.





























