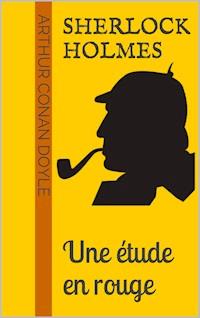
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Une étude en rouge", aussi traduit "Un crime étrange" ou encore "Écrit dans le sang" ("A Study in Scarlet" en anglais), est un roman policier d'Arthur Conan Doyle paru en 1887 dans le "Beeton's Christmas Annual" avant d'être publié en volume en 1888. Le roman raconte une enquête menée par le détective Sherlock Holmes, narrée par son nouveau compagnon, le docteur Watson.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre I – Sherlock Holmes
Chapitre II – Où l’on voit que la déduction peut devenir une vraie science
Chapitre III – Le mystère du Jardin Lauriston
Chapitre IV – Les renseignements fournis par John Rance
Chapitre V – L’annonce amène un visiteur
Chapitre VI – Gregson montre de quoi il est capable
Chapitre VII – Une lueur dans les ténèbres
Chapitre VIII – Dans le désert de sel
Chapitre IX – La fleur d’Utah
Chapitre X – Le prophète chez John Ferrier
Chapitre XI – La fuite
Chapitre XII – Les anges de la vengeance
Chapitre XIII – Continuation des souvenirs de John H. Watson, ex-médecin-major
Chapitre XIV – Épilogue
Notes
Page de copyright
Chapitre I – Sherlock Holmes
Ce fut en 1878 que je subis devant l’Université de Londres ma thèse de docteur en médecine. Après avoir complété mes études à Netley – pour me conformer aux prescriptions imposées aux médecins qui veulent faire leur carrière dans l’armée, – je fus définitivement attaché, en qualité d’aide-major, au 5efusiliers de Northumberland. Ce corps était alors aux Indes, et, avant que j’aie pu le rejoindre, la seconde campagne contre l’Afghanistan était entamée.
En débarquant a Bombay, j’appris que mon régiment avait déjà traversé les défilés de la frontière et se trouvait au cœur même du pays ennemi. Je me joignis à plusieurs officiers dont la situation était analogue à la mienne, et nous parvînmes à atteindre sans encombre la ville de Candahar ; j’y retrouvai mon régiment et le jour même j’entrai dans mes nouvelles fonctions.
Des distinctions, des grades, tel fut pour un grand nombre le bilan de la campagne qui s’ouvrait alors ; pour moi je n’en recueillis que déboires et malheurs.
Une permutation d’office m’ayant fait passer aux Berkshires, ce fut avec ce corps que je pris part à la fatale bataille de Maiwand ; j’y fus blessé à l’épaule par un de ces petits boulets que lancent les tromblons Jezaïl. L’os de la clavicule était brisé, l’artère voisine froissée et j’allais tomber entre les mains des féroces Ghazis quand le dévouement et le courage de mon ordonnance Murray me sauvèrent la vie ; il réussit à me jeter en travers d’un cheval de bât et me ramena ainsi sain et sauf dans les lignes anglaises.
Brisé par la souffrance, affaibli par les fatigues et les privations de toutes sortes, je fis partie d’un long convoi de blessés et fus dirigé sur l’hôpital central de Peshawur. Là, mes forces commencèrent bientôt à renaître et j’allais déjà assez bien pour me promener à travers les salles et même pour m’étendre au soleil sous une véranda, lorsque je fus terrassé par la fièvre typhoïde, ce terrible fléau de nos possessions indiennes. Après avoir passé plusieurs mois entre la vie et la mort, j’entrai enfin en convalescence ; mais j’étais si amaigri et si faible qu’à la suite d’une consultation les médecins décidèrent de me renvoyer en Angleterre, sans perdre un instant. En conséquence, je pris passage à bord du transport l’Orontes, et un mois plus tard je débarquais à Portsmouth, avec, il est vrai, une santé à tout jamais ruinée, mais muni, en revanche, d’un congé octroyé par notre bon et paternel gouvernement pour me permettre de travailler pendant neuf mois consécutifs à récupérer mes forces disparues.
Sans feu ni lieu, libre comme l’air — ou plutôt aussi libre qu’on peut l’être lorsqu’on possède pour toute fortune 14 fr. 35 de rente par jour, — je n’eus naturellement qu’une idée, celle de gagner Londres, ce vaste réceptacle vers lequel converge, irrésistiblement entraînée par tous les déversoirs de l’Empire Britannique, la foule des gens qui n’ont dans la vie ni emploi fixe, ni but déterminé.
Je plantai d’abord mes pénates dans un petit hôtel du Strand et pendant quelque temps j’y menai une vie aussi désœuvrée que monotone ; tout en entamant notablement mes pauvres économies. Bientôt même l’état de mes finances devint si inquiétant qu’il me parut indispensable de choisir entre les deux partis suivants : ou quitter la capitale et chercher à la campagne quelque trou pour y végéter tristement, ou changer totalement mon genre d’existence. Ce fut à cette dernière alternative que je m’arrêtai ; pour commencer je résolus de quitter l’hôtel et de m’établir dans un domicile moins brillant comme apparence, mais plus économique.
Le jour même où j’avais pris cette décision, je me trouvais au Criterion bar lorsque je sentis quelqu’un me frapper sur l’épaule, et en me retournant, je reconnus le jeune Stamford que j’avais eu comme assistant à l’hôpital de Barts. La vue d’une figure de connaissance, pour tout homme qui se sent profondément isolé au milieu de l’infernal brouhaha de Londres, est certainement la chose du monde la plus réconfortante. Jamais cependant Stamford n’avait été pour moi ce qu’on appelle un véritable copain, mais à ce moment je fraternisai avec lui de la façon la plus enthousiaste, et lui-même de son côté sembla ravi de la rencontre. Dans l’exubérance de ma joie, je l’invitai à déjeuner chez Holborn et un instant après nous montions en fiacre pour nous y rendre.
Pendant que la voiture roulait dans les rues tumultueuses de Londres : « Quelle diable de vie avez-vous bien pu mener, Watson ? » me demanda mon compagnon en me dévisageant avec un étonnement non déguisé. « Vous êtes maigre comme un coucou et noir comme une taupe. »
En quelques mots, je le mis au courant de mes aventures et j’en avais à peine terminé le récit quand nous arrivâmes à la porte du restaurant.
« Pauvre garçon, me dit Stamford sur un ton de commisération, et maintenant où en êtes-vous ?
— Pour le moment je suis à la recherche d’un logement et par là même d’un problème, le problème consistant à dénicher pour un prix raisonnable un appartement suffisamment confortable.
— Étrange, murmura-t-il, vous êtes la seconde personne aujourd’hui qui me tienne identiquement le même langage.
— Et quelle est la première ?
— Un garçon qui vient à l’hôpital travailler dans le laboratoire de chimie. Il se plaignait ce matin devant moi de ne pouvoir trouver un ami pour partager avec lui un charmant appartement qu’il avait été visiter, mais dont le loyer dépassait ses moyens.
— Bon Dieu ! m’écriai-je, s’il désire vraiment trouver quelqu’un qui partage avec lui et l’appartement et le loyer, je suis son homme. Je préfère de beaucoup loger avec un camarade que vivre tout seul. »
Le jeune Stamford me regarda par-dessus son verre d’une façon singulière. « Vous ne connaissez pas encore Sherlock Holmes, me dit-il ; peut-être ne tiendrez-vous pas à l’avoir toujours pour compagnon.
— Pourquoi ? A-t-on quelque chose à lui reprocher ?
— Oh ! ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. Seulement il est quelque peu original, un véritable fanatique par rapport à certains genres de sciences. Cependant par ce que j’en connais, il paraît être un très brave garçon.
— Un étudiant en médecine, sans doute ?
— Non, et même je n’ai aucune idée de ce qu’il a l’intention de faire. Il est, dit-on, très fort en anatomie et tout à fait de premier ordre en chimie ; mais jamais, que je sache, il n’a suivi régulièrement les cours de médecine. Il étudie d’une façon très décousue, excentrique même ; et, sans s’astreindre aux connaissances que tout le monde cherche à acquérir, il en a amassé une foule d’autres, de quoi certainement étonner tous ses professeurs.
— Ne lui avez-vous jamais demandé à quelle carrière il se destinait ?
— Non certes, car ce n’est pas un homme qu’on puisse faire causer facilement, quoiqu’à l’occasion, et si la fantaisie lui en prend, il sache être assez communicatif.
— Je serais bien aise de le rencontrer, dis-je. Si je dois habiter avec quelqu’un, je préférerais que ce fût avec un homme studieux et d’habitudes tranquilles. Je ne suis pas encore assez fort, voyez-vous, pour supporter beaucoup de bruit ou d’agitation, et d’ailleurs j’ai eu assez de tout cela en Afghanistan pour en être rassasié jusqu’à la fin de mes jours. Comment faire pour rencontrer votre ami ?
— Il est bien probablement au laboratoire, répliqua Stamford ; ou bien il n’y met pas les pieds pendant des semaines entières, ou bien il y travaille du matin jusqu’au soir. Si vous voulez, nous prendrons une voiture après déjeuner et nous irons jusque-là.
— Parfaitement », répondis-je, et là-dessus nous nous mîmes à parler d’autre chose.
En nous rendant à l’hôpital, Stamford me donna encore quelques détails sur mon futur compagnon.
« Il ne faut pas m’en vouloir, commença-t-il, si vous ne vous entendez pas avec l’individu en question ; je ne le connais guère que pour l’avoir rencontré de temps à autre au laboratoire. C’est vous qui avez eu l’idée de cet arrangement, ne m’en rendez donc pas responsable.
— Si nous ne nous entendons pas, repris-je, il sera facile de nous séparer. Cependant, Stamford, ajoutai-je, en le regardant fixement, il me semble, que vous ayez des raisons spéciales pour vous laver les mains de tout ce qui pourrait advenir. Y a-t-il vraiment quelque chose à craindre du caractère de cet homme ? Allons, parlez franchement et ne soyez pas aussi cachottier. »
Stamford se mit a rire, « C’est qu’il n’est pas facile d’exprimer ce qui est inexprimable, dit-il. Ce Holmes s’est, pour mon goût, un peu trop identifié avec la science elle-même, et je crois que cela doit amener fatalement à l’insensibilité la plus complète. Ainsi, je m’imagine qu’il serait parfaitement capable d’administrer à un ami une petite pincée de la substance toxique la plus récemment découverte, non par méchanceté, vous m’entendez bien, mais simplement, étant donné son esprit chercheur, pour se rendre exactement compte de la façon dont ce poison opère. Cependant, je dois dire pour être juste, et cela avec la conviction la plus entière, qu’il tenterait tout aussi bien l’expérience sur lui-même. Il semble avoir la rage d’approfondir ce qu’il étudie de façon à tout résumer dans des formules d’une exactitude mathématique.
— Et je trouve qu’il a bien raison.
— D’accord, mais on peut pousser cette qualité jusqu’à l’exagération ; ainsi quand on en arrive à prendre un bâton pour en battre les sujets anatomiques déposés sur la table de dissection, cela peut paraître au moins étrange.
— Que me racontez-vous là ?
— La pure vérité ; il a fait cela un jour ; c’était, paraît-il, pour se rendre compte des effets ainsi produits sur les cadavres, et cela je l’ai vu, de mes yeux vu.
— Cependant, vous dites que ce n’est pas un étudiant en médecine ?
— Non, — Dieu seul sait quel est le but de ses études…. Mais nous voici arrivés et vous allez pouvoir vous former vous-même une opinion à son sujet. »
Tout en parlant, nous tournions dans une petite ruelle et nous franchissions une porte bâtarde percée dans une aile du grand hôpital. C’était pour moi un terrain familier et je n’avais pas besoin de guide pour gravir les degrés de pierre du vaste escalier à l’aspect si glacial, et pour trouver mon chemin dans ces longs corridors, aux murs blanchis à la chaux, où s’ouvraient ça et là des portes peintes en brun foncé.
Vers l’extrémité du bâtiment s’embranchait un passage bas et voûté qui conduisait au laboratoire de chimie. Qu’on se figure une énorme pièce, fort élevée, tapissée du haut en bas d’innombrables flacons. Partout de larges tables, très basses, semées comme au hasard, et sur ces tables, au milieu des cornues et des éprouvettes, de petites lampes Bunsen, à la flamme bleuâtre, jetant des lueurs vacillantes.
Dans cette salle, et tout au fond, un seul étudiant, penché sur une table, complètement absorbé par son travail. Au bruit de nos pas, il leva vivement la tête, bondit vers nous en poussant un cri de triomphe et en agitant sous le nez de mon compagnon l’éprouvette qu’il tenait à la main. « Le voilà, le voilà, s’écria-t-il, il est trouvé le réactif qui arrive à précipiter l’hémoglobine, le seul, l’unique ! »
Vraiment il aurait découvert une mine d’or qu’il n’aurait pas pu manifester une joie plus exubérante.
« Docteur Watson, Monsieur Sherlock Holmes », prononça Stamford en nous présentant l’un à l’autre.
« Comment vous portez-vous ? » me dit aussitôt Holmes, avec rondeur et en me donnant une poignée de main dont l’énergie me révéla une force musculaire que je n’aurais pu soupçonner à première vue. « Ah ! ah ! je vois que vous revenez d’Afghanistan.
— Comment diable pouvez-vous le savoir ? demandai-je abasourdi.
— Peu importe, répliqua-t-il en se souriant à lui-même. L’hémoglobine et son réactif, voilà pour le moment la grande affaire. Je ne doute pas que vous ne saisissiez toute l’importance de ma découverte ?
— Évidemment, répondis-je, elle présente un certain intérêt au point de vue chimique, mais au point de vue pratique….
— Comment, monsieur, mais, sous le rapport médico-légal, c’est précisément la découverte la plus pratique qui ait été faite depuis des années. Ne voyez-vous pas que cela nous donne une méthode infaillible pour reconnaître les taches faites par le sang humain. Venez par ici — et, dans son empressement, il me saisit par la manche et m’entraîna vers la table où il venait de travailler. — D’abord procurons-nous du sang frais, dit-il ; — et, se donnant un léger coup de bistouri au milieu du doigt, il recueillit dans un petit tube une goutte de son sang. — Maintenant, je verse cette simple goutte dans un litre d’eau. Vous voyez que l’eau conserve absolument l’apparence qu’elle avait auparavant. La proportion de sang ne doit guère excéder un millionième, et cependant je ne doute pas que nous n’obtenions la réaction caractéristique. »
Tout en parlant, il jeta d’abord dans le récipient quelques cristaux blancs, puis y versa quelques gouttes d’un liquide transparent. En un instant, le tout prit une teinte acajou foncé et un précipité de couleur brunâtre se forma au fond du bocal.
« Ha ! ha ! » s’écria-t-il en battant des mains avec l’air transporté d’un enfant auquel on présente un joujou nouveau. « Qu’est-ce que vous en pensez ?
— Il me semble que voilà un réactif d’une rare sensibilité, remarquai-je.
— Merveilleux ! c’est merveilleux ! Autrefois, avec le gaïac, on n’obtenait que difficilement quelques résultats et encore bien incertains. Il en était de même lorsqu’on soumettait les globules de sang à l’analyse microscopique ; celle-ci perdait toute valeur pour peu que le sang fût vieux de quelques heures. Mon réactif, au contraire, se comporte aussi bien avec du sang vieux qu’avec du sang frais ; ah ! s’il avait été connu plus tôt, des centaines d’hommes qui se promènent tranquillement sur la surface du globe, auraient depuis longtemps subi le châtiment dû à leurs crimes.
— Vraiment, murmurai-je.
— Mais oui ; nous touchons là au point capital d’un grand nombre de causes judiciaires. Un homme n’est souvent soupçonné d’un crime que plusieurs mois après l’avoir commis ; on examine son linge ou ses vêtements, on y découvre des taches rougeâtres ; d’où proviennent-elles ? de sang, de boue, de rouille ou simplement du jus d’un fruit ? Voilà où plus d’un expert a perdu son latin, et pourquoi ? Parce qu’on ne possédait pas de réactif infaillible. Mais maintenant nous avons le réactif de Sherlock Holmes et l’incertitude ne sera plus possible. »
Pendant qu’il parlait, ses yeux étincelaient ; lorsqu’il eut fini, mettant la main sur son cœur, il s’inclina profondément, comme pour remercier une foule imaginaire de ses applaudissements.
« Recevez tous mes compliments, lui dis-je, confondu de cet enthousiasme extraordinaire.
— N’avons-nous pas eu l’année dernière encore le cas de von Rischoff de Francfort ? Il aurait certainement été pendu, si mon réactif avait existé. Et Mason de Bradford, et le célèbre Müller, et Lefèvre de Montpellier, et Samson de la Nouvelle-Orléans…. Je pourrais citer plus de vingt cas analogues.
— Mais vous êtes un répertoire vivant de tous les crimes, s’écria Stamford en riant ; publiez donc là-dessus un mémoire et intitulez-le : Nouvelles annalesjudiciaires du temps passé.
— Cela pourrait être bien intéressant », murmura Sherlock Holmes, tout en collant un petit morceau de taffetas à l’endroit où il s’était piqué le doigt, puis me montrant sa main avec un sourire : « Je suis obligé d’être prudent, dit-il, je manipule tant de poisons…. » Je vis alors que cette main était déjà couturée d’autres morceaux de taffetas et toute brûlée par de violents acides.
« Mais ce n’est pas tout cela, interrompit Stamford en s’asseyant sur un escabeau et en m’en poussant un autre avec son pied, nous sommes venus ici pour parler d’affaires sérieuses. Mon ami que voici cherche une installation, et, comme je vous ai entendu vous plaindre de ne pas trouver de camarade pour cohabiter avec vous, j’ai cru bien faire en vous réunissant. »
Sherlock Holmes parut ravi à l’idée de partager son logement avec moi : « J’ai un appartement en vue, me dit-il, il est situé Baker Street, et nous iraitcomme un gant…. Mais j’espère que vous ne craignez pas l’odeur d’un tabac très fort ?
— Je ne fume moi-même que du tabac de matelot, répondis-je.
— Bon, dit-il. Maintenant, je vous préviens que je suis toujours entouré d’ingrédients chimiques et que je me livre quelquefois à des expériences ; cela vous contrarierait-il ?
— En aucune façon.
— Voyons, laissez-moi chercher quels sont mes autres vices rédhibitoires…. Ah ! j’ai de temps en temps des humeurs noires qui durent plusieurs jours et pendant lesquelles je n’ouvre pas la bouche. Il ne faudra pas croire pour cela que je boude ; vous n’aurez qu’à me laisser tranquille et je reviendrai bien vite à mon état normal. Maintenant, à votre tour ; qu’avez-vous à confesser ? Voyez-vous, il vaut mieux que deux individus connaissent mutuellement tous leurs défauts avant de se mettre à vivre en commun. »
Cet interrogatoire contradictoire me fit sourire : « Je possède un petit chien bull, dis-je, puis mes nerfs ont été récemment si ébranlés que je ne puis supporter le bruit et le tapage ; enfin je me lève aux heures les plus invraisemblables et je suis affreusement paresseux. Je possède, il est vrai, un autre jeu de défauts quand je suis bien portant, mais, pour le quart d’heure, voilà quels sont chez moi les principaux.
— Par tapage, voulez-vous parler aussi du violon ? demanda Holmes avec inquiétude.
— Cela dépend de l’exécutant, répondis-je ; entendre bien jouer du violon, est un plaisir des dieux, mais si on en racle….
— Parfait alors, s’écria-t-il gaiement ; en ce cas l’affaire me semble conclue, à condition, bien entendu, que l’appartement vous plaise.
— Quand le visiterons-nous ?
— Venez me prendre ici demain à midi, nous irons le voir ensemble.
— Convenu, dis-je en lui serrant la main ; à demain, à midi précis. »
Nous le laissâmes, Stamford et moi, en train de continuer ses expériences chimiques et nous reprîmes ensemble le chemin de mon hôtel.
« À propos, fis-je tout à coup en m’arrêtant et en me retournant vers mon compagnon, comment diable a-t-il pu savoir que j’avais été en Afghanistan ? »
Stamford sourit d’un air énigmatique. « C’est précisément là une de ses bizarreries ; bien des gens se demandent comment il arrive à découvrir du premier coup les choses les mieux cachées.
— Oh ! du mystère alors, m’écriai-je, en me frottant les mains, cela devient palpitant. Je vous suis vraiment bien reconnaissant de m’avoir fait faire connaissance avec un pareil personnage. La véritable manière d’étudier l’humanité consiste, vous le savez, à étudier successivement les différentes individualités.
— Eh bien, étudiez celle-ci, répliqua Stamford en me disant adieu. Seulement je vous avertis que vous vous heurtez à un problème qui n’est pas facile à déchiffrer, et je parierais bien que le bonhomme en apprendra vite plus long sur vous que vous n’en saurez sur lui. Sur ce, bonsoir.
— Au revoir », répondis-je, et je continuai mon chemin tout en flânant, réellement intrigué par ma nouvelle connaissance.
Chapitre II – Où l’on voit que la déduction peut devenir une vraie science
Le lendemain, après nous être retrouvés au rendez-vous convenu, nous nous rendîmes, Sherlock Holmes et moi, au numéro 221 de Baker Street, pour visiter le logement dont il avait été question. Il se composait de deux chambres à coucher très confortables et d’un grand salon bien aéré, élégamment meublé et éclairé par deux larges fenêtres. L’ensemble était si séduisant et le prix si modique — du moment où nous en payions chacun la moitié — que l’affaire fut conclue sur-le-champ. Comme nous pouvions entrer immédiatement en jouissance, je transportai le soir même toutes mes affaires dans notre nouvel appartement et le lendemain matin je vis, arriver Sherlock Holmes avec un assez grand nombre de malles et de caisses. Pendant deux ou trois jours nous fûmes uniquement occupés à déballer tous nos bibelots et à les disposer de manière à les mettre le mieux possible en valeur. Ces arrangements préliminaires terminés, nous commençâmes à nous sentir installés et à nous familiariser avec notre nouveau domicile,
Holmes n’était certainement pas un homme difficile à vivre ; calme d’allures, régulier dans ses habitudes, il se couchait rarement après dix heures du soir et chaque matin, en me levant, je constatais invariablement qu’il avait déjà décampé après avoir pris son déjeuner. Parfois il passait la journée dans le laboratoire de chimie, parfois dans la salle de dissection, ou bien encore il faisait de longues promenades dont l’objectif semblait toujours être les quartiers les plus misérables de la ville. Rien ne peut donner une idée de son activité lorsqu’il était dans une période agissante ; mais, au bout de quelque temps, la réaction se produisait et pendant des jours entiers il restait depuis le matin jusqu’au soir étendu sur un canapé du salon, sans, pour ainsi dire, prononcer une parole ou remuer un membre. Dans ces moments-là, ses yeux prenaient une expression si rêveuse et si vague que je l’aurais certainement soupçonné de se livrer à l’usage d’un stupéfiant quelconque, si sa sobriété exemplaire et la moralité parfaite de sa vie n’eussent protesté contre une semblable supposition.
Les semaines se succédaient et je sentais ma curiosité devenir de jour en jour plus vive à l’endroit du but qu’il pouvait bien donner à son existence. Tout son extérieur, d’ailleurs, était fait pour impressionner à première vue l’individu le moins observateur. D’une taille élevée — il avait plus de cinq pieds et demi, — sa maigreur le faisait paraître bien plus grand encore. Ses yeux étaient vifs et perçants — excepté pendant ces périodes de torpeur dont j’ai parlé plus haut, — et son nez, mince et recourbé comme le bec d’un oiseau de proie, donnait à son visage une expression décidée, jointe à un air de pénétration remarquable. La forme carrée et proéminente de son menton contribuait aussi à dénoter chez lui une puissance de volonté peu commune. Ses mains étaient constamment couvertes de taches d’encre et de brûlures produites par les acides chimiques ; et cependant il avait une adresse extraordinaire dans les doigts, ainsi que j’ai pu m’en convaincre souvent en le voyant manier ses fragiles instruments de physique.
Quand bien même le lecteur devrait m’accuser d’avoir les instincts de curiosité d’une vieille portière, j’avouerai que cet homme, m’intriguait terriblement et que bien des fois j’ai essayé de percer le mystère dont il semblait vouloir s’entourer. Cependant avant de me juger trop sévèrement qu’on veuille bien se rappeler combien ma vie sans but était dépourvue de tout intérêt. Ma santé ne me permettait de sortir que par des temps exceptionnellement favorables et je ne possédais pas un ami à qui la pensée ait pu venir de passer quelques instants avec moi et de rompre ainsi la monotonie d’une existence qui me pesait tous les jours davantage. Aussi je saisis avidement cette occasion d’occuper la majeure partie de mon temps en cherchant à soulever les voiles mystérieux dont s’enveloppait mon compagnon.
Décidément il n’étudiait pas la médecine. Lui-même, en réponse à une question posée par moi, avait confirmé les dires de Stamford à ce sujet. Il ne semblait pas non plus subordonner ses lectures à une méthode quelconque lui permettant, soit de faire des progrès dans une science déterminée, soit de s’ouvrir un chemin particulier dans le domaine de l’érudition. Et cependant son zèle pour certaines études était vraiment remarquable ; ses connaissances, qui sortaient de toutes les limites convenues, étaient si vastes et si approfondies que plus d’une fois les remarques faites par lui m’ont causé une réelle stupéfaction. « Sûrement, pensais-je, pas un homme n’est capable de travailler autant et d’acquérir sur certains points une instruction aussi précise s’il ne se propose à lui-même un but bien défini. Car les gens qui lisent sans apporter à leurs lectures un véritable esprit de suite ne peuvent que bien rarement arriver à coordonner ce qu’ils ont appris. Personne enfin ne consentirait à se surcharger le cerveau d’une foule de connaissances secondaires sans avoir, pour agir ainsi, les raisons les plus fortes. »
À côté de tout cela son ignorance en certaines choses était aussi remarquable que son savoir. En fait de littérature contemporaine, aussi bien qu’en philosophie ou en politique, il était nul, ou à peu près. Je me souviens qu’ayant cité un jour Thomas Carlyle devant lui, il me demanda de la façon la plus naïve quel nom je venais de prononcer là et ce que ce personnage avait bien pu faire. Mais le jour où ma surprise fut portée à son comble, ce fut celui où je découvris, par hasard, qu’il était parfaitement ignorant de la théorie de Copernic et qu’il ne connaissait même pas l’explication du système solaire. Qu’il y eût en plein xixe siècle, un être civilisé ne sachant pas que la terre tourne autour du soleil, cela me parut si extraordinaire que je ne pouvais y croire.
« Vous semblez étonné, me dit-il en souriant de mon air stupéfait. Mais soyez tranquille, maintenant que je le sais, je ferai tous mes efforts pour l’oublier.
— Pour l’oublier !
— Vous allez le comprendre. Dans le premier âge, le cerveau humain me représente un grenier vide, le devoir de chacun est de le meubler à son gré. S’agit-il d’un imbécile ? Il emmagasinera toutes les matières les plus encombrantes de telle façon que les connaissances qui lui seraient le plus utiles s’entasseront à la porte sans pouvoir entrer ; ou bien, en mettant tout au mieux, une fois entrées, elles se trouveront tellement enchevêtrées au milieu d’une foule d’autres qu’elles ne seront plus à la portée de sa main, lorsque l’occasion viendra pour lui de s’en servir. Tout au contraire, l’artisan industrieux apporte le plus grand soin à la manière dont il meuble son grenier. Il ne veut y loger que les instruments qui peuvent lui être utiles dans son travail ; seulement de ceux-ci a-t-il au moins un vaste assortiment toujours rangé dans l’ordre le plus parfait. C’est une erreur de penser que ce petit grenier ait des murs élastiques qui puissent se dilater à volonté. Croyez-le bien, il vient un temps où pour chaque chose nouvelle que vous apprenez, vous en oubliez une que vous saviez précédemment. Il est donc de toute importance de ne pas emmagasiner un bagage inutile qui vienne gêner celui qui doit réellement vous servir.
— Mais le système solaire…, commençai-je en manière de protestation.
— Que diable cela peut-il bien me faire ! interrompit-il avec impatience ; vous dites que la terre tourne autour du soleil ; qu’elle tourne autour de la lune si cela lui fait plaisir, mais, pour mon compte, je m’en moque, et mes travaux ne s’en ressentiront guère ! »
J’étais sur le point de lui demander en quoi pouvaient bien consister ses travaux, lorsque je compris en le regardant que ma question serait parfaitement intempestive. Cependant je me pris à méditer sur cette conversation et je cherchai à en tirer quelques conclusions. N’avait-il pas dit qu’il se refusait à acquérir toute connaissance qui ne serait pas en relation directe avec son but ? En conséquence, celles qu’il possédait ne pouvaient que lui être utiles. J’énumérai donc en moi-même les différents sujets sur lesquels il m’avait paru exceptionnellement ferré et je pris même un crayon pour en dresser une liste exacte.
Je ne pus m’empêcher de sourire en relisant le document que j’étais arrivé à rédiger ainsi.
Le voici :
Résumé du savoir de Sherlock Holmes.
1° En littérature. Connaissances nulles.
2° En philosophie. —
3° En astronomie. —
4° En politique. Connaissances très médiocres.
5° En botanique. Connaissances variables. Très ferré sur tout ce qui concerne la belladone, l’opium et les poisons en général, complètement ignorant en horticulture pratique.
6° En géologie. Connaissances renfermées dans certaines limites bien définies ; discerne à première vue les différents terrains les uns des autres : me montre après ses promenades les taches de boue de son pantalon et m’explique comment leur couleur et leur consistance lui permettent de reconnaître dans quelle partie de Londres chacune a été faite.
7° En chimie. Connaissance approfondie.
8° En anatomie. Connaissances très grandes, mais acquises sans aucune méthode.





























