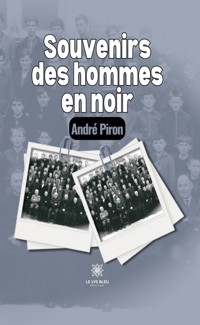
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Dans les années 1963-64, les internes du collège Saint-Grégoire sont soumis à l’autorité implacable du Frère Anastase, chargé de la discipline. Punitions sévères, brutalités et climat de violence règnent sans la moindre tolérance. Quatre collégiens, dont Jacquelin-Dubuisson, se lancent dans une quête de vengeance contre ce nervi en soutane. Cela déclenche une série d’événements intrigants : un vol mystérieux, des représailles et la mort suspecte du Frère malveillant. Qui sont réellement les coupables ? Ainsi débute une enquête policière captivante.
À PROPOS DE L'AUTEUR
André Piron, auteur de biographies familiales, de récits de voyages, de poésie et d’un roman, revient avec "Souvenirs des hommes en noir". Ce thriller, retraçant la vie d’un interne dans un collège privé au début des années soixante, offre une escapade captivante, fidèle à la vocation de divertissement de ses précédents ouvrages.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
André Piron
Souvenirs des hommes en noir
Roman
© Lys Bleu Éditions – André Piron
ISBN : 979-10-422-3538-3
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Du même auteur
Autoédition
Édition
Les faits, lieux et protagonistes de cette histoire sont pour partie imaginaires, et pour partie inspirés de faits réels. Toute ressemblance ou homonymie avec des noms de personnes existantes ou ayant existé seraient, pour certaines, purement fortuites, pour d’autres, empruntées à la réalité.
Photos : un collège catholique au début des années 1960
(© photos droits réservés)
À Jocelyne
À mes enfants et petits-enfants
Principaux personnages
Baudet Jacques, pensionnaire ;
Baudouin Christian et Jean-François, pensionnaires ;
Boisnard Philippe, ouvrier en bijouterie-joaillerie-gravure ;
Boisroux Charles, technicien d’entretien au collège Saint-Grégoire ;
Bruneau Pierre, pensionnaire, « Pierrot » ;
Claude-Forget Serge Noël, dit SNCF, pensionnaire ;
Decaen Guy, pensionnaire ;
Duché Jean-Claude, pensionnaire ;
Frelon Alain, pensionnaire ;
Frère Alfred, acolyte d’Anastase, chargé de discipline ;
Frère Anastase, dit Tatase ou Nikitanastase, responsable de discipline ;
Frère Bernard, dit Sent du bec, professeur de Sciences naturelles ;
Frère Dominique, homme en noir, professeur d’histoire-géographie ;
Frère Guy, professeur de maths ;
Frère Hilaire, premier directeur de l’institution Saint-Grégoire ;
Frère Hubert, dit Bébert, homme en noir, professeur d’anglais ;
Frère Jean-Baptiste Manchard, dit Don Quijote de la Manchard, professeur d’espagnol ;
Frère Mathieu, dit Scrogneugneu, second directeur de l’Institution ;
Frère Pierre, homme en noir, professeur de français ;
Hamard Gilbert, pensionnaire ;
Heuvin Pierre, pensionnaire ;
Jacquelin Dubuisson Jean-Baptiste, J.B.J.D., pensionnaire ;
Jourden Roger, commissaire de police ;
Loriot Alain, pensionnaire ;
Pouchard Jean, abbé de l’Institution Saint-Grégoire ;
Prevost, surveillant civil ;
Quentin-Richard Serge Paul, dit S.P.Q.R, technicien d’entretien ;
Quinton Maurice, pensionnaire ;
Réaux d’Inville d’Isseaux Eve, mère de Frère Anastase.
I
Le pensionnat
Mardi 29 octobre 1963
« Que sonne dans le vent l’hallali de la bête ! Que l’éternité se souvienne de nos douleurs ! »
La dernière trouvaille littéraire de Jean-Baptiste Jacquelin-Dubuisson pour parfaire sa rédac honorait irrémédiablement ses dispositions pour l’écriture, mais fut jugée mal à propos par Frère Pierre, impétueux homme en noir, et corrigée de trois coups de règle sur les doigts afin de lui rappeler la bienséance et le respect auxquels tout élève devait se conformer vis-à-vis de ses maîtres.
On avait beau toucher au terme du premier demi-trimestre scolaire de l’année 1963-64, y voir la source possible d’une tolérance légère à la veille des congés : conclure un texte par une salve mortifère contre un membre de l’équipe pédagogique du collège était du plus mauvais effet.
— Un sujet pourtant très simple, J.B.J.D. – comme on l’appelait parfois – aboya Frère Pierre, cheveux dans un désordre beethovénien, un sujet de fin d’année pour honorer ceux qui par leur dévouement vous dirigent vers le progrès intellectuel et moral : on ne vous demandait rien d’autre que quoi ? Je le répète, « dresser le portrait de votre frère préféré ! » C’est ce que tout le monde a compris, sauf vous. Alors on est en droit de s’interroger, qui visez-vous en écrivant les insanités qui s’enchaînent ligne après ligne, mon vieux ? Ne connais pas de Frère Jacques au collège ! dit-il en circuit court, c’est-à-dire en construisant certaines phrases sans articles, un tic rescapé du service militaire. Avez dû confondre avec la comptine que vous chantait votre mère il n’y a pas si longtemps…
La classe éclata de rire, mais le croissant de lune dentaire dura peu.
— Silence, bande de bougres ! Vais vous faire passer la manie de vous esclaffer à tout propos ! Bertrand Cocatrix, vous me copierez quatre pages, prenez l’Évangile, y choisirez une parabole du Christ ! Et vous, Pierre Heuvin, montez sur l’estrade et collez-vous à genoux sur votre règle, observez bien la carte du monde, euh… vous interrogerai à la sortie de votre peine, et si répondez à côté vous vous torcherez aussi quatre pages.
L’homme en noir hurlait en s’emparant de Heuvin par le col pour l’amener au lieu du supplice. Un silence de mort s’installa dans la classe. Dehors, à travers les vitres inondées par la luminosité solaire, la vue s’ouvrait belle, sur les grands chênes du château, sur l’étang, sur le château lui-même.
— Jacquelin, pour la dernière fois : de qui avez-vous dressé ce portrait autant dégoûtant qu’inexact ? Qui désignez-vous comme « la brute assoiffée du sang des élèves », ou encore « le kapo de l’Institution Saint-Grégoire », ou enfin « le bouledogue mangeur de crottes de nez » ?
Frère Pierre patienta une minute synonyme d’éternité, un peu comme « le noir illimité » de Baudelaire, marchant de long en large dans « sa » classe, avalant une allée bordée de rangées d’élèves, puis une autre, puis la dernière. Il tourna les talons à petits pas vers Jacquelin-Dubuisson, se raclant la gorge, fouillant la poche de sa soutane, à cet instant on entendit vaguement le voisin de l’élève Claude Dupuy murmurer « il se gratte les couilles », ce qui ralluma les rires d’un escadron de la première rangée. Mais curieusement, Frère Pierre n’identifia pas un traître mot de l’allusion, car son mental en proie à la colère envers Jacquelin-Dubuisson le rendait sourd à tout bruit extérieur, claquemurait son idée fixe : foutre une trempe à ce petit vaurien qui osait salir l’un de ses confrères ensoutanés. Il fonça sur lui d’un coup, lui colla cinq à six claques bien nourries sur la tête en l’insultant avec sa drôle de manie de bouffer les articles : « Petit crétin ! Sale garnement, crois qu’tu vas t’en tirer comme cela ? Iras t’expliquer chez l’directeur, l’est déjà au courant, faudra bien qu’tu craches le morceau. »
À voir l’ensoutané céder aux voix diaboliques de sa bipolarité, Jacquelin s’attendait au déluge qui lui tomba soudainement sur le lard. Sa sixième et ultime année au collège Saint-Grégoire venait de commencer, il en connaissait par cœur les acteurs, les coutumes, le théâtre. Il avait acquis l’habitude de cette violence à laquelle recouraient volontiers quelques hommes en noir pour passer leurs messages, ou leurs nerfs… Pour « rééduquer », comme ils disaient, les cancres incapables et les vauriens déniant tout respect à la soutane.
Malgré ses quinze ans, un corps musclé, son mètre soixante-dix, il craignait les Frères et ne se rebiffait pas. Ces mentors en imposaient par leur statut, leur pleine force de l’âge, et le respect des maîtres et des Institutions n’était pas un vain mot en mille-neuf-cent-soixante-trois. Il en aurait fallu beaucoup plus pour que ses parents soutinssent un mauvais geste de réplique porté à un professeur, au maître de discipline, fussent-ils coupables d’une violence excessive. L’homme qu’il avait dépeint dans son texte n’était autre que Frère Anastase, surnommé classiquement Tatase, affublé parfois d’un baroque Nikitanastase depuis qu’en son cours d’Histoire, en 1962, le Frère Dominique, très savant sur l’Union soviétique grâce à un parent détaché par les Affaires diplomatiques françaises à Moscou, avait expliqué en classe le rôle d’assassin endossé par Nikita Khroutchev contre Beria après la mort de Staline. À cette brute épaisse d’Anastase, cynique, perverse, tout le monde ou presque vouait la plus grande haine. On ne peut pas être éternellement le souffre-douleur d’une bête humaine sans que monte en soi, un jour, une forme de pus qui s’installe peu à peu dans le cœur, et qu’il faudra un jour éjecter pour ne pas étouffer.
— Feras l’objet d’une sanction sévère, reprit Frère Pierre, attends-toi au châtiment que mérite ton acte, le manque de respect envers ses maîtres, l’absence de loyauté à l’égard de ton Institution justifient une punition royale, estime-toi heureux que je ne t’administre pas une correction plus sévère.
J.B.J.D. s’attendait désormais au pire et redoutait l’instant où il se retrouverait face à Anastase, car nul doute que la corporation en habit noir devinait l’identité du tortionnaire brossé dans son œuvre notée 0/20, et l’informerait du pamphlet sanglant écrit sur sa personne.
La sonnerie de fin de cours interrompit le réquisitoire de Frère Pierre, celui-ci regarda une dernière fois Jacquelin-Dubuisson dans les yeux, et leva sa main en la secouant menaçante d’avant en arrière pour lui signifier « je te servirais bien une autre tournée de baffes. » Mais il s’abstint, tourna les talons, retrouva son bureau, cabra son cartable bourré de livres et de documents, et sortit en criant aux élèves :
— Préparez-vous pour le cours d’anglais.
Sur le pas de la porte, presque dans le couloir, il se ravisa cependant, et héla les deux énergumènes qu’il avait punis :
— Heuvin, regagnez votre place. En avez fini d’observer la carte de géographie, devez être capable de me dire où se trouve la ville de Brest-Litovsk, vous écoute !
Heuvin réfléchit, hésita et lâcha enfin sa réponse :
— En Bretagne, Frère Pierre !
Des rires fusèrent, vite contenus par l’homme en noir :
— Me copieras quatre pages, les mêmes que Cocatrix. Au fait Cocatrix, je veux les quatre pages pour demain, toi et Pierre Heuvin avez tout le temps de l’Étude pour les écrire…
Et Frère Pierre s’échappa dans le couloir, vers une autre classe.
Avant l’entrée du professeur suivant, les élèves se retrouvèrent seuls quelques deux minutes, un brouhaha prudent mais soutenu monta en cadence, à l’intention de Jacquelin-Dubuisson, chacun allait de son commentaire :
— Il t’en a collé une sévère, ce gros porc !
— T’as la tête dure, avec tout ce qu’il t’a mis !
— C’est de vraies peaux de vaches !
Soudain Frère Hubert entra dans la classe, un silence de plomb s’imposa immédiatement. Un homme mince, maigre, presque décharné, le visage creusé et les yeux enfoncés dans deux cavernes bordées de sourcils épais, tel il apparaissait, marchant prestement, tournant vivement sur lui-même, avec un éternel rictus à la bouche qu’il arrondissait légèrement en cul de poule. Il flottait dans sa soutane et portait toujours un gilet de laine noire, victime sans doute de frilosité depuis son retour des Antilles où il avait enseigné dix ans. Cheveux noirs, très brun de teint, tellement brun que même rasé il semblait avoir une barbe naissante. Les élèves le surnommaient Bébert, tout simplement, presque affectueusement. Ils l’appréciaient, sentant qu’il donnait beaucoup de sa personne pour les faire progresser, mais par asymétrie ils le redoutaient, le sachant capable d’être explosif, de piquer des colères dantesques lorsque quelque chose le rebutait.
De tous les Frères du collège Saint-Grégoire, membres de la Congrégation chrétienne de Plourmel créée et missionnée pour enseigner partout dans le monde, Frère Hubert s’illustrait comme le plus compétent, le moins violent, le plus ouvert, cartésien jusqu’au bout des ongles : « Je doute car je pense, je pense donc je suis » revenait souvent dans ses propos liminaires. Il expliquait sans cesse aux élèves le bien qu’ils pourraient tirer dans leur vie de la constante application de la pensée cartésienne ; semblait souvent ailleurs, doutant peut-être de sa vocation religieuse, les yeux de courts instants dans le vague, pensif, se remémorant des souvenirs de son passage à New York puis à Haïti où il avait longtemps vécu et dont il évoquait ses heures d’enseignant avec une touchante nostalgie.
Réputé comme prof d’Anglais de très bon niveau, efficace, pas un de ces médiocres enseignants prétendant transmettre les mots, l’accent et l’âme de la langue de Shakespeare sans l’avoir jamais pratiquée sérieusement dans un pays anglophone, type de recrues dont les Écoles Chrétiennes privées, soucieuses de leurs deniers, étaient coutumières, son métier le passionnait, il désirait de toutes ses forces que les élèves, y compris les plus médiocres, quittassent la classe de troisième pourvus d’un niveau représentatif.
— Je vais vous rendre les Compositions que j’ai toutes notées. C’est une catastrophe ! Enfin, soyons honnêtes, pas pour tout le monde, il y a quelques bonnes notes : Alain Loquin, vous êtes le plus mauvais avec 4/20. Prenez votre livre immédiatement et ouvrez-le à la leçon 10 deux fois cinq. Travaillez à voix basse, dans cinq minutes je vous ferai lire.
L’enseignement de l’anglais, comme celui de l’espagnol dans la classe d’à-côté, reposait pour l’essentiel sur une méthode de l’écrit, et infiniment peu sur l’oral. Bébert lisait leçon après leçon, puis passait à l’explication grammaticale et au vocabulaire. Enfin, pour couronner le tout, les exercices se traitaient par écrit.
L’unique entrave à son talent d’enseignant ? La méthode officielle limitait le travail oral à la lecture individuelle de quelques phrases, mais n’embrayait jamais sur des conversations intenses, trop peu d’échanges parlés entre le maître et l’élève. La capacité des élèves à s’exprimer correctement en souffrait, et que dire du piteux accent avec lequel ils prononçaient les mots ! Plus d’une fois, la lecture d’une ligne déclenchait l’hilarité générale, que Frère Hubert balayait à la volée en criant une locution rapportée d’Haïti : « Paix bouche ! » Ce qui signifiait en langage bien compris : « Fermez-la ! »
— Chatel Dominique, lisez-moi la phrase 1 ! demanda-t-il à son élève qui avait un peu plus de trois ans d’anglais derrière lui.
Au lieu de lire « He is a boy and she is a girl », Chatel annonça :
— Zis is a boi (comme le son de « il boit ») and she is a gueule.
— Une vraie vache espagnole ! Reprenez, triple buse, ce n’est pas correct.
— Hi is a bohi and…
— A boy, Chatel, a boy, prononcé comme si vous disiez « auille ». On l’a déjà répété mille fois, Chatel, vous en faites exprès ou quoi ?
Coup de froid puis coup de bol pour Chatel : la classe fut interrompue par l’arrivée du directeur de l’Institution, Frère Hilaire. « Il a du pot, ce con ! », murmura Gilbert Hamard à son voisin Jacquelin-Dubuisson, tandis que tous les élèves se levèrent comme d’un seul, dans une harmonie de mouvement incroyable. « Debout ! » avait crié Bébert, mais c’était un réflexe inutile, dès que le Dirlo pointait sa tête à la vitre de l’entrée, le mouvement sur pied s’imprimait dans les cerveaux, par respect, par crainte.
Ce n’était pas pour un « standing ovation » à l’égard de l’homme qui se présentait devant eux, loin de là. Ils lui vouaient rancune et haine en tonnage équivalent à celui d’Anastase, même s’il ne s’abaissait jamais à frapper, mais voilà un être vil, sournois, menteur : nourri au lait de jésuite ! Il fut un temps pendant lequel le collège Saint-Grégoire lui décerna deux appellations : HILARE, par l’ablation du « I », la cause étant qu’il ne souriait jamais sauf sur la photo annuelle du pensionnat, et HITLAIRE par l’ajout d’un « T » parce qu’on le savait très sévère et politique. Les élèves ont une réserve d’humour et d’imagination en eux qui est très surprenante. Et puis cette mode passa, il finit par devenir pour tout le monde le « DIRLO », tout simplement, raccourci plus facile, et moins risqué que de se faire prendre sur le fait par les garde-chiourmes en train de prononcer l’un des deux surnoms.
Si Hubert était maigre, Hilaire apparaissait squelettique, visage trop pâle, cheveux ondulés, un profil froid avec des yeux rapetissés derrière ses lunettes par la méfiance permanente, motorisé par un esprit calculateur, un ton inflexible, des idées figées, le tout nappé d’un coup d’œil trahissant une intelligence redoutable. Sa corpulence était celle d’un porte-manteau étroit surmontant un serviteur des plus creux. Des plus bons marchés !
Toutes les lettres écrites par les pensionnaires à leurs parents passaient avant envoi au tamis du regard acéré de Frère Hilaire, puis à la censure de sa plume. Si quelques-unes survivent longtemps dans un quelconque grenier de famille, on en lira portant le sceau de son écriture de mouche, biffées de certaines de leurs phrases, annotées à l’encre rouge d’un coup de griffe sorti de l’esprit tordu du froid Directeur : « Ne pas tenir compte de ces observations ! Elles ne reflètent pas la vérité » ou bien « Je crois que Pierre exagère un peu » ou bien encore « Jacques va beaucoup mieux, il ne pleure plus, dès que vous avez le dos tourné, il va vers ses petits camarades et la joie plutôt que la tristesse se lit sur son visage… »
Frère Hilaire ne supportait aucune critique de son Institution, aucune remarque désobligeante à l’endroit d’un de ses professeurs ou de ses deux sbires chargés de l’ordre – Tatase et son adjoint Frère Alfred surnommé aussi par les pensionnaires « Freddy la pédale » en raison, aux dires d’un ancien, de sa nationalité belge et fors du principe énoncé mais non prouvé que la plupart des coureurs cyclistes belges se prénommaient Freddy –, il couvrait toutes les pratiques perverses et actes de violence auxquels ils se livraient, comme si c’était une bonne politique de les tolérer.
Il surveillait la vaste cour où jouaient, défilaient, priaient tous les écoliers, à travers la fenêtre de son large bureau située au premier étage de l’immeuble du pensionnat, comme un directeur de prison surveille ses forçats, d’un œil attentif, scrutant coin par coin, après un panoramique d’échauffement, et chaque matin à la récréation des dix heures, puis l’après-midi à seize heures, il faisait son tour dans la cour, malgré son handicap au pied droit qui le rendait boiteux. Les potaches se moquaient de son pied bot, mais jamais devant lui, ô grands dieux, c’eût été, outre irrespectueux, gravement suicidaire.
On était en fin de mois, Hilaire faisait le tour de l’ensemble des classes pour présenter les carnets de notes. Il se réservait ce plaisir, le vivait comme un acte de domination sur les élèves et les Frères enseignants.
— Asseyez-vous ! dit-il de sa voix de fausset. Sur sa soutane satinée, brillante sous l’éclat des néons, une croix de bronze, pesante et froide, accrochée au grappin d’une chaîne à maille dorée, sautillait au moindre de ses mouvements. « Je ne vous dérangerai pas longtemps. »
Il monta sur l’estrade pour mieux dominer ses agneaux, tandis que Bébert regagna son bureau et se tint debout la main appuyée sur l’angle du meuble. Tout ouïe.
Son intervention bien huilée, et chaque fois la même, ruisselait dans un langage précis et parfois précieux. Il commençait par un avis général sur le collège, présentait ensuite les résultats globaux de la classe, puis déclinait le classement des élèves dans un ordre inverse à la loi des nombres : depuis le dernier jusqu’au premier.
Nous étions à la fin du mois d’octobre 1963, le premier mois complet depuis la rentrée, veille de la grande sortie mensuelle de Toussaint fixée au lendemain mercredi 30 octobre à midi, celle où quoi qu’il advînt des résultats du mois, les élèves rentraient chez eux, ce qui n’était pas le cas pour les semaines ordinaires, où le droit au week-end se gagnait à la sueur de ses efforts et par l’obtention de notes supérieures à la moyenne aux examens officiels appelés « Compositions ». Les meilleurs s’adjugeaient un droit à trois sorties dans le mois, autant dire un retour à la maison tous les dimanches, les plus mauvais avaient zéro sortie, encore fallait-il une note de discipline irréprochable et ne pas être tombé sous le coup d’une verbalisation de Tatase ou d’Alfred, insatiables distributeurs de prunes.
— Il faut malheureusement le répéter. Les résultats des Troisièmes du collège sont dans leur ensemble très décevants, y compris ceux de la Troisième Rouge, votre classe, ouvrit-il en jetant un regard furtif à Bébert qui, conscient de son talent personnel, n’était pas du genre à prendre la remarque pour lui, et se tint coi.
Le collège avait ouvert cinq classes de Troisième pour cette année 1963-64, chacune d’elles recevait entre vingt-huit et trente élèves, se trouvait répertoriée sous une couleur spécifique (noire, blanche, rouge, verte, bleue), et répartie dans le même couloir du bâtiment scolaire selon l’ordre du poème d’Arthur Rimbaud « Voyelles ». Une idée qui avait traversé l’esprit de Frère Pierre, il croyait ainsi inciter les élèves à connaître par cœur le célèbre sonnet.
— Vingt-huitième et dernier : Alain Frelon, moyenne piteuse, seulement 47 sur 100 en notes d’excellence et des notes inférieures à 7 sur 20 dans chaque épreuve de Composition. Appréciation du professeur principal : « pas bien haut, mais peut encore baisser ! » Heureusement que la Grande Sortie de Toussaint arrive demain, Frelon, pour le mois suivant vous n’aurez aucune sortie, profitez bien de ces quelques jours chez vos parents ! insista sadiquement Frère Hilaire, puisque les notes désastreuses dans les Compositions condamnaient théoriquement Frelon au mitard sur tout le mois de novembre. Vous avez la place la moins enviable, on en parlera avec vos parents.
Derrière ses verres de lunettes en culs de bouteilles, Frelon regarda le Frère directeur sans manifester le moindre regret ou la moindre gêne, cet enfant ne songeait qu’au dessin et n’avait qu’une hâte : en finir avec les robes noires. Il attendait la fin juin, l’adieu à ce collège détesté, il demandait à vieillir pour tourner la page au plus vite, et puis voilà tout ; et pendant ce temps composait de superbes dessins.
Cette indifférence au classement était loin d’être partagée par tous les autres élèves. Pour une immense majorité, se situer en bonne place revêtait au contraire une importance capitale. Pour eux-mêmes, à titre personnel, vis-à-vis des copains et enfin et surtout vis-à-vis de leurs parents. Occuper le dernier rang, voilà une honteuse carte de visite propre à baisser la tête, déclencher les moqueries des autres élèves sur la cour, générer une « convoc » des parents chez le Frère directeur.
Le paradigme les stimulait, les poussait aux efforts pour remonter d’un mois sur l’autre dans les meilleurs rangs. En compétition, on se bat contre les autres, mais d’abord et surtout contre soi-même.
L’appel se poursuivit : vingt-septième, vingt-sixième… vingtième… quinzième… dixième… Certains parmi ces mal-classés, tout à l’inverse de l’élève Frelon, versaient des larmes de dépit, de regrets, de tristesse, car derrière le rang occupé se dressaient les notes, en général mauvaises, et la maudite perspective de passer les dimanches au pensionnat faute de droits acquis pour la sortie de fin de semaine.
— C’est seulement au dixième que nous trouvons enfin la moyenne ! Vous vous rendez compte ! Et c’est monsieur Ho que je suis heureux de féliciter pour ses 53 sur 100 et 10 sur 20 en moyenne de compositions. Trois sorties pour le mois de novembre ! Bravo ! Mes chers enfants, vous savez que monsieur Ho a moins de facilités que vous pour le français ; donc il n’en a que plus de mérite d’avoir obtenu ces notes, et je vous encourage à prendre exemple sur lui.
François Ho, d’origine chinoise, était arrivé en France avec ses parents en 1960, via le Vietnam. Sa famille fuyait le « bonheur » maoïste, tant vénéré pourtant par ceux de la gauche française qu’il y aurait presque lieu de s’interroger sur les réelles raisons de cette fuite… Ses parents habitaient Paris, et lui était pensionnaire dans ce collège de province pour trouver les meilleures conditions d’étude. Très souriant, il était aimé de tous, et plus âgé de deux ans que l’âge moyen des Troisièmes.
— Quatrième sur vingt-huit, Gilbert Hamard, 70 sur 100 et 12, 50 sur 20 à la moyenne des compositions. Hamard, je vous félicite, vous démarrez mieux l’année que vous n’avez fini la précédente, les coups de règle de Frère Anastase vous ont visiblement réussi.
Gilbert était un adolescent en pleine croissance, en six mois sa morphologie avait changé : charpenté des épaules, muscles en voie de devenir saillants, visage moins poupon, cheveux bien coiffés, à quatorze ans et demi passés tout indiquait qu’il serait bientôt un homme. Cet élève gai, souvent dissipé, plein d’humour, était le voisin et grand ami de J.B J. D., et même son confident intime, avec réciprocité, au même titre que son autre ami Claude-Forget.
— Troisième sur vingt-huit, Victor Podard, 72 sur 100 et 12,75 sur 20, avec notamment deux belles compositions françaises, que Frère Pierre a lues en Conseil des professeurs, et qui me remplissent de joie, continuez ainsi, deux sorties seulement le mois prochain pour quelques écarts de discipline. Ne vous laissez pas égarer par des esprits que je n’irai pas jusqu’à qualifier de diaboliques, mais où le Malin se laisse aller à de mauvaises influences. Eh bien justement, parlons-en, Jean-Baptiste Jacquelin-Dubuisson, deuxième sur vingt-huit, 75 sur 100 et 13 sur 20, très bon classement et du bon travail dans l’ensemble, hélas tout cela gâché par votre composition de français dont la note vous a été rendue ce matin, 0/20. Vous nous avez écrit des horreurs, mon ami, seul un esprit sous influence de mauvaises pensées a pu nous sortir un texte aussi vilain, le corps des professeurs n’en revient toujours pas. Mais ne pénalisons pas vos petits camarades avec votre cas personnel, vous viendrez me voir demain matin à 9 heures, nous en rediscuterons. Et maintenant, mes enfants, place et honneur au premier de la classe, sur vingt-huit élèves, et qui plus est la meilleure moyenne de toutes les Troisièmes réunies, à la fois en excellence et en compositions : 77 sur 100 et 14 sur 20. Levez-vous, Serge-Noël Claude-Forget, je vous félicite au nom de tous les professeurs et en mon nom, vous êtes un exemple d’intelligence et de travail, comme Jacquelin d’ailleurs, alors résistez, ne tombez surtout pas sous l’influence d’êtres faibles qui se laissent emporter par des idées maladroites et malsaines contre lesquelles je réagirai avec la plus grande fermeté. Sur ce, Frère Hubert, mes enfants, je vous abandonne, il me reste deux autres classes à voir cet après-midi, pour ceux que je ne reverrai pas d’ici demain, je vous souhaite un bon congé de Toussaint et vous incite à ne pas délaisser vos prières pendant cet intermède où les religieux vous manqueront, j’en suis persuadé. Rendez-vous le lundi 4 novembre pour la rentrée.
Le Frère directeur s’éclipsa. Tout le monde se leva pour saluer son départ. Hubert mit à profit la liberté retrouvée et l’horloge qui sonnait dix heures pour achever son cours, puis envoyer ses élèves en récréation après la piqûre de rappel pour le rendez-vous du lendemain : « Attention, et notamment les internes, le Frère directeur a omis de rappeler que demain sera faite la photo de pensionnat dans la Cour d’Honneur à dix heures. Soyez à l’heure. Les externes ne sont pas concernés. »
La récré était le moment où les pensionnaires se libéraient du carcan représenté par les sept heures de cours infusées chaque jour : quatre le matin, trois l’après-midi. Les externes aussi, bien sûr, mais le sort d’un externe n’est en aucun point comparable à celui d’un pensionnaire.
La cour assez vaste se divisait en deux sections d’accueil : le Grand Jeu et le Petit Jeu. Réservé aux grands comme son nom l’indique, le Grand Jeu accueillait les élèves des classes de cinquième, quatrième et troisième, en moyenne, la tranche d’âge de douze à quinze ans. À l’inverse, et en toute logique, le Petit Jeu réunissait les classes des moins âgés, Huitième, Septième, Sixième, on trouvait dans ce Petit Jeu des enfants pensionnaires à partir de l’âge de huit ans, et la présence de ces gamins au visage souvent triste rendait ce lieu improbable, aucun cœur n’y pouvait rester indifférent.
Les élèves se répartissaient en deux récréations, afin d’éviter le surnombre, la première de 10,00 à 10,20, la seconde de 10,20 à 10,40. Le temps imparti ne permettait guère d’organiser des jeux ; aussi les élèves consacraient-ils leur temps à se réunir par groupes de copains, à discuter, à se chamailler. Avec deux ballons de football à leur disposition, des farouches amateurs de ballon rond s’entraînaient à marquer des buts, dans un rectangle édifié sobrement avec une barre transversale fixée aux deux poteaux centraux du préau qui fermait la cour.
Depuis la rentrée de septembre, Jean-Baptiste Jacquelin-Dubuisson ne manquait jamais une récré sans aller dans le Petit Jeu remonter le moral à un gamin de dix ans à peine, dont l’intégration au Pensionnat s’éternisait laborieuse. Engagé dans sa deuxième année de classe de Septième, la première l’an passé s’était révélée des plus difficiles, tant l’envahissait de chagrin la séparation avec sa famille, le rendant incapable d’un travail scolaire régulier et efficace. Ses carnets de notes des deux premiers trimestres avaient pris l’allure de graphiques de températures contraires aux normes : toujours en dessous des moyennes saisonnières. Pourtant, se réveillant au dernier trimestre et alignant de belles notations au-dessus du fatal dix sur vingt, Frère Guy, son professeur principal, l’avait assuré qu’il passerait en sixième à la rentrée. Mais c’est là que l’esprit pervers d’Hilaire avait frappé. L’inscription de Pierrot en sixième privant le collège de celle d’un élève venant de l’extérieur, donc d’une source de recettes supplémentaires car il se trouvait moins d’inscrits en septième, Hilaire était allé voir Pierrot, sur la cour, l’avant-dernier jour de juin 1963 et malgré l’insistance de Frère Guy lui avait tenu ces propos : « Pierre Bruneau, c’est bien, vous avez réussi un bon dernier trimestre qui vous autorise à passer en sixième. Mais je ne vous le conseille pas. Ce sera très dur pour vous, souvenez-vous des deux premiers trimestres de cette année. Vous n’avez pas vu beaucoup votre maman à cause de vos mauvaises notes. Si vous redoublez votre septième, ce que moi je vous conseille, vos notes s’amélioreront, ainsi que les droits de sortie qui vont avec. Vous rentrerez chez votre mère chaque semaine, au contraire si vous choisissez d’aller en classe de Sixième, ce sera difficile et vous la verrez moins ou pas du trimestre. Alors finalement, que préférez-vous ? » Et le petit Pierrot, bien entendu, affolé à l’idée de ne plus voir sa maman, avait dit : « Je préfère redoubler, Frère directeur. »
Frère Guy, professeur de maths, en voilà un brave homme en noir ! Physiquement un visage bizarre, raté, avec une bouche trop large et pulpeuse taillée pour choper les moustiques au vol, mais un cœur d’or, à coup sûr Frère « Joyeux » s’il eût été nain. À fond dans son sacerdoce et sa religion ! Quelques mois auparavant, vers la fin juin 1963, il courait dans tous les recoins des cours du collège en criant « Nous avons un Pape, nous avons un Pape ! » pour saluer l’élection du nouveau Souverain Pontife Paul VI. Dubuisson, sortant des WC et ayant mal entendu, avait demandé à son copain Frelon pourquoi Guy criait autant et courait à toute vitesse d’un groupe de collégiens à un autre. Et Frelon, en train de rêvasser avec son crayon sur une feuille, avait simplement répondu : « J’sais pas ! Problèmes de soupapes… J’crois ! J’ai cru entendre quelque chose comme ça ! »
Jacquelin avait pris Pierrot en amitié parce que ce gosse c’était lui six ans plus tôt, à son entrée à Saint-Grégoire, un sinistre jour de septembre, le cœur serré, meurtri, l’âme dévastée, et les yeux embués de larmes. J.B.J.D avait tellement ressenti ce sentiment d’abandon et cette souffrance paralysante qu’il avait décidé d’aider ce gamin, même si les résultats tardaient toujours à embellir le bulletin de notes.
— Bonjour Pierrot, alors ça va bien aujourd’hui ? Tu n’es pas triste, la sortie approche !
Le gosse souriait à pleines dents, un reflet de soleil dorait son visage, et rendait ses yeux pétillants de bonheur.
— Mes parents viennent me chercher demain midi.
— Tu dois être heureux ?
— Ah oui ! Je vais revoir maman, enfin, depuis trois semaines.
Il souffrait d’un tel abattement, d’un vague à l’âme tellement puissant qu’il était dépossédé de la force mentale suffisante pour bien travailler, et malgré son redoublement les mauvaises notes s’égrenaient en chapelet. Son taux de concentration tombé trop bas le rendait incapable de fournir les efforts qu’attendent les professeurs de tout élève pour marcher vers le savoir et le progrès.
Ce gosse lui faisait pitié aussi parce que les monstrueux surveillants en soutane Alfred et Tatase le punissaient sévèrement pour les larmes qu’il versait. Le voyant rêvasser pendant les heures d’étude, Alfred, chargé des petites classes, le rabrouait au lieu de l’aider, et Tatase en remettait une couche à la moindre occasion :
— Pierre Bruneau, vous êtes ici pour travailler, pas pour rêver à je ne sais quoi. Vous me copierez quatre pages.
Et l’autre, en passant par-derrière, lui collait une tarte sur le haut de la tête.
Il était petit, faible, alors eux profitaient de leur force et de leur pouvoir pour le sacquer un peu plus.
— À demain, Pierrot, le cours reprend.
— À demain, Jean-Baptiste, et merci.
Le cours de sciences naturelles attendait désormais les élèves de Troisième Rouge. Frère Bernard, enseignant déjà ancien dans la fonction et plutôt qualifié, attendait stoïquement à son bureau le lent retour de tous ses élèves. Ils arrivaient en se payant carrément sa tête, car Frère Bernard souffrait de son manque de caractère, résultat d’une bonté chrétienne excessive, et ne répliquait que trop rarement. En cela résidait sa grande faiblesse, et les élèves en groupe profitent toujours de la largesse de patience d’un maître. Ils chantaient un pastiche de la chanson « un Canard, moi j’aime bien les canards… » dans lequel les paroles devenaient « un Bernard, moi j’aime pas les Bernard ». Tout cela évidemment n’était possible qu’en l’absence de Nikitanastase parti s’occuper de l’Économat, car en situation contraire nul ne se serait risqué à entonner cette marche ridicule.
Frère Bernard avait tout du brave homme, mais sale. Sous la soutane l’oxygène semblait interdit de séjour car le drôle sentait mauvais. Sa bouche fermentait grave le saucisson du réfectoire, ce qui lui valait un surnom éculé comme le mystère de l’existence de Dieu : « Sent du bec ! »
John Atkinson, seul élève anglais de Troisième, placé pour la deuxième année consécutive en pension au collège afin d’apprendre à parler couramment français, disait de lui « c’est un looser », à quoi Frelon, mauvaises notes mais plein d’humour, avait collé l’angliche en répliquant : « J’ajouterai même un perlouzeur ! »
— C’est quoi un perlouzeur ? Je ne veux pas savoir.
Et Frelon, en se pinçant le nez, lui avait expliqué avec ses mots bien à lui :
— Un lâcheur de perlouzes, espèce d’incendiaire de Jeanne d’Arc ! C’est le même parcours que le suppositoire, mais dans le sens inverse !
— Oh, my God ! avait conclu Atkinson, un grand maigrichon mal sapé qui mâchait sans arrêt des chewing-gums en cachette lors de la promenade du jeudi, et détestait que l’infirmière du collège le contraignît au suppositoire pour soigner sa grippe :
« Le siuppo, c’est dégueulasse ! » affirmait-il. À la première prise, ignorant tout des rites gaulois, il l’avait mangée.
Outre ses fonctions d’enseignant, Frère Bernard officiait comme fondateur et animateur d’un groupe de prières baptisé « Les Chevaliers du Christ. » Un vécu un peu extrême de la pratique religieuse, consistant pour ses jeunes fidèles à écouter ses messages chrétiens, puis à prier en groupe avec les bras écartés du corps, à la manière d’un curé qui lit sa messe devant l’autel. Quand les tout nouveaux pensionnaires des petites classes interrogeaient les anciens sur les activités et les avantages de s’inscrire au mouvement de Frère Bernard, ceux-ci leur racontaient des bobards du style « Tu es un vrai chevalier, avec une épée, et même parfois tu montes à cheval avec l’habit de chevalier, et tu vas combattre pour Jésus. » Les jeunes naïfs s’y voyaient déjà mais déchantaient vite, et l’on restait généralement très peu de temps chevalier du Christ.
La dernière heure de cours de la matinée du mardi revenait au long et noble Frère Jean-Baptiste Manchard, le plus âgé des soutanes du collège, quatre-vingt-deux ans, professeur d’espagnol. Un personnage incroyable, parlant anglais, espagnol et allemand couramment, ancien interprète en Allemagne à l’Ambassade de France sous la République de Weimar, avant de devenir prêtre, puis Frère de Plourmel.
Les élèves le surnommaient Don Quijote de la Manchard car il en avait le profil, avec ses joues émaciées, son corps ténu, son nez allongé et affûté comme un fil d’épée, son béret basque qu’il transportait partout même en cours, même à la chapelle, et sa manière de tenir un livre comme Don Quichotte tient sa rapière.
Sa gravissime surdité créait des situations hautement cocasses, puisque d’un coin à l’autre de la classe, à son insu visuel et auditif quand il se tenait debout occupé à interroger un élève, voletaient des boulettes de papier, des bavardages à haute voix et des histoires un peu cochonnes, ordonnançant un joli chahut.
Dès qu’il s’en apercevait, il fondait sur le premier perturbateur repéré dans son champ de vision et lui assénait un coup de livre sur la tête, en agrémentant son geste d’un commentaire fleuri qui rajoutait à l’effet comique de sa silhouette :
— Voyez-vous, monsieur le bâilleur ! Voyez-vous la sale bête ! Mon pied au cul, et oust, en route pour la pêche à Terre-Neuve ! On ne fait rien d’autre que s’amuser ! Récitez-moi le verbe « Tener » à tous les temps. À la moindre erreur, vous resterez ce midi à me le copier.
Son mode d’enseignement était simple mais efficace : à chaque début de cours de conjugaison orale par un élève de trois verbes espagnols, puis trois verbes différents par un second, présent, passé, imparfait, futur. Et le processus s’avérait payant : les élèves connaissaient leurs verbes espagnols, réguliers et irréguliers. Beaucoup apprirent le castillan grâce à lui.
Il détestait l’élève Podard. En dépit de ses notes globalement bonnes et de sa troisième place, Victor Podard, baptisé « peau d’hareng » par les pensionnaires, se cantonnait dans une nullité rare en espagnol. Pire encore que Chatel en anglais. Mais surtout il se montrait très négligent avec sa personne et sentait mauvais. Tellement puant que tout le monde en profitait, y compris Don Quijote de la Manchard, homme en noir semblant glissé dans une soutane fourreau tant il était maigre, comme un pauvre moine franciscain du temps de la conversion de la Californie, mais toujours propre et sur ce point de la plus grande exigence.
— Podard, huele raro aqui, Podard apesta a pescado. Traduisez ce que je viens de dire ! demanda le Frère.
— Euh ! L’huile est rare ici…
— Non Podard, on parle de toi, « ça sent drôle, Podard pue le poisson », c’est ça que ça veut dire, peau d’hareng ! lui souffla son voisin du banc de derrière, l’empathique Alain Frelon, nul en anglais et guère meilleur en espagnol, un de ceux que Manchard avait surnommés « monsieur le bâilleur » parce qu’il faisait selon lui du gras en classe. Pendant les contrôles improvisés du cours, beaucoup d’élèves profitaient de la surdité du professeur pour souffler les bonnes réponses à Frelon, lui ouvrant la porte à des notes correctes, mais dès qu’il s’agissait d’une composition, retrouvant sa solitude, il cessait de faire illusion et accrochait des zéros à sa boutonnière. Intrigué Manchard s’étonnait publiquement de la différence : « C’est bizarre, monsieur le bâilleur, il a de bonnes notes en cours, et des mauvaises en compositions… »
II
Nikitanastase
Mardi 29 octobre 1963
Ce mardi veille de sortie s’acheva comme tous les autres jours. À dix-sept heures cessèrent les classes, l’envol des potaches dans la cour, et surtout le départ des externes plongeant les pensionnaires dans la mélancolie, pire encore, dans la crainte : le temps des sbires chargés de la discipline était venu. On entendit tout de même le chant du départ, celui que les pensionnaires entonnaient en général les vendredis, veilles de grande sortie du samedi, sur l’air du Noël américain Jingle Bell : « Viv’ le ven viv’ le ven, viv’ le vendredi, car demain c’est samedi on fout l’camp d’ici. » Un chant du départ cette fois-ci adapté à la circonstance d’une sortie le mercredi, que les potaches surent improviser : « Viv’ le mer, viv’ le mer, viv’ le mercredi, car demain on s’ra loin, on fout l’camp d’ici. »
Ils se dirigèrent au réfectoire prendre leur goûter, se rangèrent en ordre parfait devant la porte d’entrée, cent dix élèves alignés par rang de trois se tenaient impeccablement et sans bruit dans l’attente de l’arrivée du tyran de leur existence : Nikitanastase ou, plus sobre au palais, Tatase. L’homme en noir le plus détesté du collège déboucha sans bruit derrière le dernier rang de la file, mains croisées en bas du dos, marchant avec lenteur, pieds glissés dans une paire de chaussures souples dont la semelle amortissait tout bruit d’approche, mais pas la vigueur des coups de pied au cul. Visage de marbre, dur, la peau pourprée comme si dans sa marmite ventrale bouillait une mauvaise colère, des lunettes teintées dissimulaient ses yeux, lui donnant un air de sale homme de main.
Sous sa soutane noire, il portait toujours une sorte de jabot blanc montant jusqu’au col, dont les plis se terminaient par un feston de dentelles. Nul ne connaissait son âge, les grands lui donnaient entre quarante-cinq et cinquante ans, estimation vraisemblable, les petits sans opinion. Quoiqu’il fût, il paraissait costaud, les muscles saillaient sous l’habit noir, ses bras se terminaient par deux grosses mains avec des doigts longs, épais, deux paluches qui ressemblaient à des marteaux et faisaient très mal quand il s’en servait. Depuis son arrivée au pensionnat, J.B.J.D. ne perdait jamais de vue la lourde chevalière étirée sur la moitié de son annulaire droit, l’une des premières choses notables, gravée dans sa mémoire de collégien car Tatase l’avait claqué avec, le lendemain même. Fils d’un père qui travaillait les métaux destinés aux bijoutiers, il en voyait assez dans l’atelier depuis sa petite enfance pour reconnaître que l’anneau était probablement en or, quant à la bague elle-même, sertie d’une croix et d’une tête de Christ magnifique, tout inclinait de prime abord à l’homologuer comme accessoire trempé dans du métal jaune au carat de haut degré.
Les copains et camarades de pensionnat ne s’attachaient pas à ces détails, tous cependant avaient une fois au moins goûté d’un aller-retour flanqué par Tatase et se souvenaient de la douleur du revers causé par la chevalière. La brutalité de ses gifles se trouvait avivée par l’impact métallique du bijou.
Tatase la portait du matin au soir,il en était fou, ne l’ôtant que rarement pour l’enfiler aussitôt, s’amusant à la faire glisser sur son doigt pour tuer le temps en Étude, ou dès que l’énervement le gagnait. La rumeur du collège – car les collèges sont eux aussi très sujets à rumeur – attribuait son origine à quelque héritage paternel ou familial, mais il y a bien des années déjà qu’aucun pensionnaire ne savait plus reconstituer la genèse de la légende. Peut-être une indiscrétion d’un Frère, surprise par une oreille de collégien traînant par là, ou une confidence de l’intéressé à un parent d’élève incapable de mutisme.
On ne connaissait ni le nom ni l’origine familiale et régionale de Tatase. Tout cela restait secret. Comme il la portait à l’annulaire droit, on pouvait le supposer second ou troisième d’une fratrie, puisque selon la coutume l’aîné porte la chevalière à l’annulaire gauche accolé à son alliance s’il est marié. Mais la vérité se trouvait ailleurs, bien plus simple, et se nommait « dextérité » : balancées du bras droit, les calottes partaient plus vite, en plein dans la cible, sans gaucherie, avec la puissance désirée.
Il ne la quittait pas davantage en promenade ou à la Messe. On verra dans cette fidélité à l’objet la marque d’un grand respect pour le généreux donateur familial auteur du présent, ou le pur attachement à la classe de l’objet. Quelle que soit la raison, on sentait sa profonde affection pour cet accessoire dont il ne se défaisait jamais sinon peut-être la nuit dans l’intimité de son alcôve solitaire, pour se reposer du frottement et du poids sur son doigt.
Frelon fut le premier à découvrir au plus près la chevalière de Tatase, puis à la décortiquer. Le moment datait de la Retraite religieuse annuelle de début juin 1963. On s’acheminait alors vers la fin de l’année scolaire, tous les ans à la même époque l’Institution pilotait à moindres frais un grand rassemblement mis sur pied à l’extérieur de Saint-Grégoire. Cette année-là la troupe envahit les moyenâgeuses cellules de moines au monastère franciscain distant de deux cents kilomètres. Le voyage se fit dans les cars Lebossu, organisateur officiel des déplacements de l’Institution. Les pensionnaires et les Frères se répartirent dans deux véhicules, Tatase dans l’un Freddy dans l’autre pour veiller à l’exacte application des mesures KGB. Les Frères s’efforçaient de créer l’enthousiasme en reprenant des chants scouts et même quelques chansons à succès d’Hugues Aufray comme Santiano. Frère Hilaire quant à lui restait dans la chanson de catéchèse et barbait les pensionnaires de Quatrième et Troisième, les plus grands, sous les accents de « plus près de toi, mon Dieu. »
— On se croirait sur le Titanic, voilà ce qu’en disait Frelon, en grande forme. Terriblement rafraîchissant, en un mot « Hilarant » !
Derrière ses grosses lunettes épaisses comme les hublots du France récemment lancé à Saint-Nazaire, Frelon avec ses yeux rieurs, son humour pince-sans-rire, amusait son monde. Il était comme ça, très gai ou alors terriblement triste. Comme les vieilles montres en or d’autrefois, qu’il fallait ouvrir et scruter avec une loupe pour en percer les secrets – lieu de fabrication, réparée ou pas, nom de l’horloger – il aurait fallu ouvrir son âme pour le bien connaître, il ne se livrait jamais vraiment.
Cette Retraite, une grande leçon de catéchisme longue de trois jours, s’adressait à tous les pensionnaires, y compris ceux ayant prononcé depuis longtemps leurs vœux de Communion solennelle et reçu la confirmation.
La confession était obligatoire, et la communion tout autant. Chaque jour se tenaient les rites de prière et d’hommage à Dieu et ses Saints. Au petit matin, la prière en groupe faisait monter vers le ciel la centaine de voix des pensionnaires dans un unisson presque parfait, à onze heures l’abbé Pouchard disait sa messe. Entre les deux, les collégiens répartis par groupe de huit recevaient la bonne parole chrétienne des Frères sur des thèmes choisis par la direction centrale de la Congrégation.
Après le repas du midi, les groupes reprenaient leurs travaux puis à quatre heures s’entonnait une nouvelle prière, enfin les collégiens bénéficiaient d’une heure de détente sous forme de jeux ou football au choix. À 18 heures 30, tout ce petit monde se rassemblait pour participer à l’épreuve du chapelet, consistant à répéter dix fois le Notre Père et tout autant le « Je vous salue Marie ».
Les Frères de l’Institution étaient rejoints par d’autres pour diriger tous ces groupes, et si l’ennui atteignait son paroxysme avec cette indigestion de prières, il régnait une ambiance assez « bon enfant » pour faire oublier les sombres instants de la vie quotidienne au pensionnat.
La discipline néanmoins ne baissait pas la garde et Tatase et Alfred ne se privaient pas de sanctionner le moindre écart aux règles fixées par le gouvernement de Saint-Grégoire.
Un jour donc que l’élève Frelon participait au même Groupe de travail que l’anglais Atkinson, ce dernier nommé, voulant prouver ses progrès en français et sa capacité à construire de l’humour dans la langue de Molière, se risqua à jeter aux membres du groupe, au moment où Frelon arrivait pour les rejoindre :
— Attention ! Voilà Frelon et le frelon ça pique !
Tout cela dit avec un bel accent britannique.
Agacé par ce british qu’il n’aimait guère, Frelon répondit du tac au tac :
— Viens ici, rosbif ! Je vais te faire sucer mon dard.
Éclat de rire général de l’assemblée au moment hélas où Freddy la Pédale passait dans le coin. Ayant tout entendu il s’en prit à Frelon, qualifia son propos de « mauvaises pensées avec circonstance aggravante puisqu’exprimées en public pendant une Retraite. » Frelon, l’autiste très intelligent et dessinateur talentueux, encore plus agacé de ce manque d’humour, perdit les pédales, traitant Freddy de vieux rabat-joie.
Freddy alerta Tatase qui, soucieux de ne pas aggraver l’affaire, se garda bien de le frapper, ce qui eût été du plus mauvais effet dans une Retraite organisée devant un parterre d’autres Frères venus d’ailleurs. Mais il convoqua Frelon pour lui parler en tête à tête :
— Je vais passer l’éponge à une condition : vous allez me faire le dessin de ma chevalière.
— Le dessin de votre chevalière ? Mais pourquoi ?





























