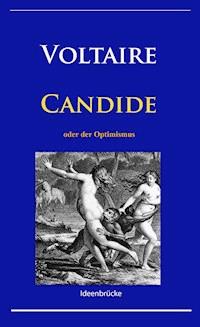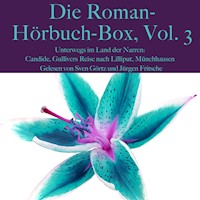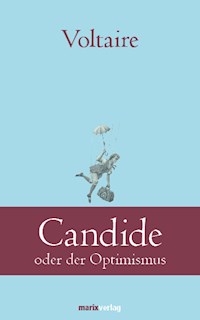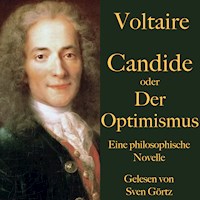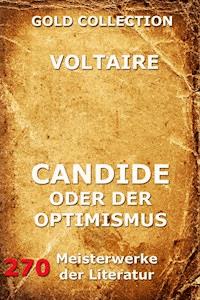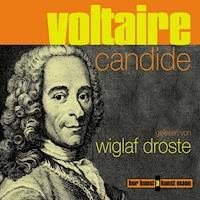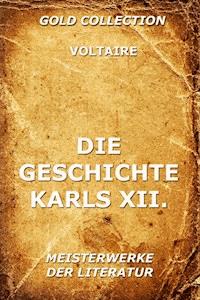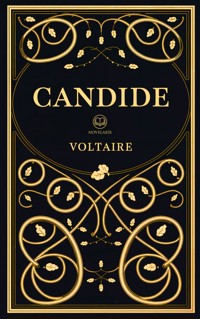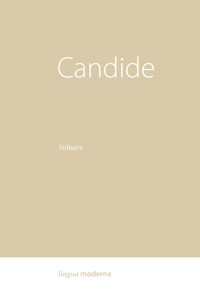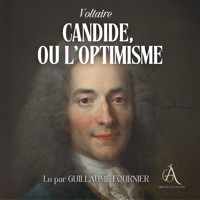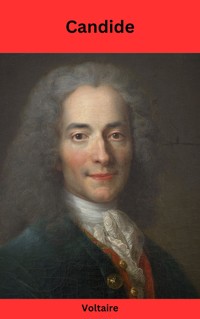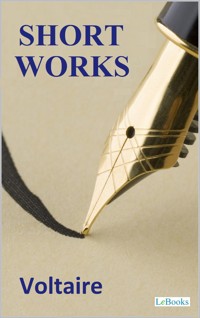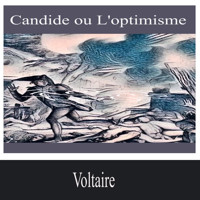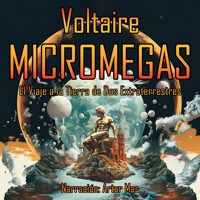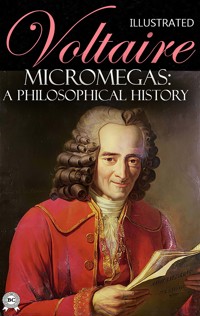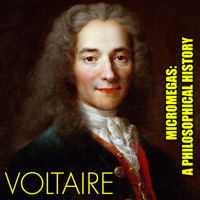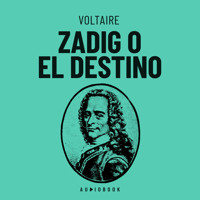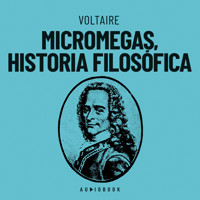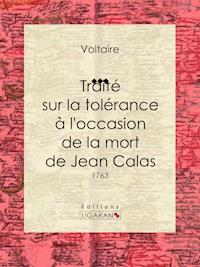
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le Traité sur la tolérance, écrit par le célèbre philosophe des Lumières, Voltaire, est une œuvre majeure qui aborde avec finesse et perspicacité la question de la tolérance religieuse. Publié en 1763, ce court texte incisif et engagé est une véritable plaidoirie en faveur de la liberté de conscience et de la coexistence pacifique entre les différentes croyances.
Voltaire y expose avec clarté et éloquence les conséquences néfastes de l'intolérance religieuse, dénonçant les persécutions, les guerres de religion et les injustices commises au nom de la foi. À travers des exemples historiques et des arguments philosophiques, il démontre que la diversité des croyances est une richesse pour la société et que la tolérance est le fondement d'une véritable civilisation.
Ce traité, bien que court, est d'une grande portée intellectuelle et morale. Voltaire y exprime sa conviction profonde que la raison et la tolérance doivent prévaloir sur les dogmes et les préjugés. Il appelle à la réflexion et à l'action, invitant les lecteurs à remettre en question les idées reçues et à lutter contre l'intolérance sous toutes ses formes.
Le Traité sur la tolérance est un ouvrage intemporel qui résonne encore aujourd'hui, rappelant l'importance de respecter les différences et de promouvoir un dialogue ouvert et respectueux entre les individus. Il est une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un monde plus juste et plus tolérant.
Extrait : "Nous osons croire, à l'honneur du siècle où nous vivons, qu'il n'y a point dans toute l'Europe un seul homme éclairé qui ne regarde la tolérance comme un droit de justice, un devoir proscrit par l'humanité, la conscience, la religion ; une loi nécessaire à la paix et à la prospérité des États."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335048124
©Ligaran 2015
Nous osons croire, à l’honneur du siècle où nous vivons, qu’il n’y a point dans toute l’Europe un seul homme éclairé qui ne regarde la tolérance comme un droit de justice, un devoir prescrit par l’humanité, la conscience, la religion ; une loi nécessaire à la paix et à la prospérité des États.
Si, dans cette classe d’hommes qui déshonorent les lettres par leur vie comme par leurs ouvrages, quelques-uns osent encore s’élever contre cette opinion, on peut leur opposer avec trop d’avantage les maximes et la conduite des États-Unis de l’Amérique septentrionale, des deux parlements de la Grande-Bretagne, des États-Généraux, de l’empereur des Romains, de l’impératrice des Russes, du roi de Prusse, du roi de Suède, de la république de Pologne. Du cercle polaire au 50e degré de latitude, du Kamtschatka aux rives du Mississippi, la tolérance s’est établie sans trouble. À la vérité, les confédérés polonais mêlèrent quelques pratiques de dévotion au projet d’assassiner leur roi, et à leur alliance avec les Turcs ; mais cet abus de la religion est une preuve de plus de la nécessité d’être tolérant si l’on veut être paisible.
Tout législateur qui professe une religion, qui connaît les droits de la conscience, doit être tolérant ; il doit sentir combien il est injuste et barbare de placer un homme entre le supplice et des actions qu’il regarde comme des crimes. Il voit que toutes les religions s’appuient sur des faits, sont établies sur le même genre de preuves, sur l’interprétation de certains livres, sur la même idée de l’insuffisance de la raison humaine ; que toutes ont été suivies par des hommes éclairés et vertueux ; que les opinions contradictoires ont été soutenues par des gens de bonne foi, qui avaient médité toute leur vie sur ces objets.
Comment se croira-t-il donc assez sûr de sa croyance pour traiter comme ennemis de Dieu ceux qui pensent autrement que lui ? Regardera-t-il le sentiment intérieur qui le détermine comme une preuve juridique qui lui donne des droits sur la vie ou sur la liberté de ceux qui ont d’autres opinions ? Comment ne sentirait-il pas que ceux qui professent une autre doctrine ont contre lui un droit aussi légitime que celui qu’il exerce contre eux ?
Supposons maintenant un homme qui, n’ayant aucune religion, les regarde toutes comme des fables absurdes ; cet homme sera-t-il intolérant ? Non sans doute. À la vérité, comme ses preuves sont d’un autre genre, comme les fondements de ses opinions sont appuyés sur des principes d’une autre nature, le devoir d’être tolérant est fondé, pour lui, sur d’autres motifs. S’il regarde comme des insensés les sectateurs des différentes religions, se croira-t-il en droit de traiter comme un crime une folie qui ne trouble pas l’ordre de la société, de priver de leurs droits des hommes que l’espèce de démence dont ils sont atteints ne met pas hors d’état de les exercer ? Peut-il ne pas les supposer de bonne foi ? car l’existence même des fourbes qui professent une croyance qu’ils n’ont pas supposé celle des dupes aux dépens de qui ces fourbes vivent et s’enrichissent. Il faudrait qu’il y eût un moyen de prouver juridiquement que tel homme qui professe une opinion absurde ne la croit pas ; et l’on sent que ce moyen ne peut exister. L’idée même qu’une telle opinion particulière peut être dangereuse par ses conséquences n’autoriserait pas une loi d’intolérance. Une opinion qui prescrirait directement la sédition ou l’assassinat comme un devoir pourrait seule être traitée comme un délit ; mais, dans ce cas, ce n’est plus d’intolérance religieuse qu’il s’agit, mais de l’ordre et du repos de la société.
Si maintenant nous considérons la justice et le maintien des droits des hommes, nous trouverons que la liberté des opinions, celle de les professer publiquement, et de s’y conformer dans sa conduite en tout ce qui ne donne point atteinte aux droits d’un autre homme, est un droit aussi réel que la liberté personnelle ou la propriété des biens. Ainsi toute limitation apportée à l’exercice de ce droit est contraire à la justice, et toute loi d’intolérance est une loi injuste.
À la vérité, il ne faut ici entendre par loi qu’une loi permanente, parce qu’il est possible que l’espèce de fièvre que cause le zèle religieux exige pour un temps, dans un certain pays, un autre régime que l’état de santé ; mais alors la sûreté et le repos de ceux que l’on prive de leurs droits sont le seul motif légitime que puissent avoir des lois de cette espèce.
L’intérêt général de l’humanité, ce premier objet de tous les cœurs vertueux, demande la liberté d’opinions, de conscience, de culte : d’abord, parce qu’elle est le seul moyen d’établir entre les hommes une véritable fraternité ; car puisqu’il est impossible de les réunir dans les mêmes opinions religieuses, il faut leur apprendre à regarder, à traiter comme leurs frères ceux qui ont des opinions contraires aux leurs. Cette liberté est encore le moyen le plus sûr de donner aux esprits toute l’activité que comporte la nature humaine, de parvenir à connaître la vérité sur tous ces objets liés intimement avec la morale, et de la faire adopter à tous les esprits ; or l’on ne peut nier que la connaissance de la vérité ne soit pour les hommes le premier des biens. En effet, il est impossible qu’il s’établisse dans un pays ou qu’il y subsiste une loi permanente contraire à ce que l’opinion générale des hommes qui ont reçu une éducation libérale regardera comme opposé ou aux droits des citoyens ou à l’intérêt général. Il est impossible qu’une vérité aussi reconnue s’efface jamais de la mémoire, ou que l’erreur puisse l’emporter sur elle. C’est là, dans toutes les constitutions politiques, la seule barrière solide qu’on puisse opposer à l’oppression arbitraire, à l’abus de la force.
La politique pourrait-elle avoir d’autres vues ? La force réelle, la richesse, et surtout la félicité d’un pays, ne dépendent-elles pas de la paix qui règne dans l’intérieur de ce pays. Tous ces objets, liés entre eux, le sont avec la tolérance des opinions, et surtout des opinions religieuses, les seules qui puissent agiter le peuple.
La tolérance, dans les grands États, est nécessaire à la stabilité du gouvernement : en effet le gouvernement, disposant de la force publique, n’a rien à craindre tant que les particuliers qui chercheraient à le troubler ne pourront réunir assez d’hommes pour former une résistance capable de balancer cette force publique, ou tant qu’ils ne pourront enlever au gouvernement la force dont il dispose. Or il est aisé de voir que les opinions religieuses, que l’intolérance oblige de se réunir en un plus petit nombre de classes, peuvent seules donner à des particuliers ce pouvoir dangereux. La tolérance, au contraire, ne peut produire aucun trouble, et enlève tout prétexte ; son effet nécessaire est de désunir les opinions : dans un pays partagé entre un grand nombre de sectes, aucune ne peut prétendre à dominer, et par conséquent toutes sont tranquilles.
Les partisans de l’intolérance politique ont dit, dans les pays protestants, qu’il ne fallait pas tolérer le papisme, parce qu’il tend à établir la puissance ecclésiastique sur les ruines de l’autorité du monarque ; et dans les pays catholiques, qu’il ne faut pas tolérer les communions protestantes, parce qu’elles sont ennemies du pouvoir absolu. Cette contradiction ne suffit-elle pas à un homme de bon sens pour en conclure qu’il faut les tolérer toutes, afin qu’aucune n’ayant de pouvoir, aucune ne puisse être dangereuse ?
Quelques personnes prétendent que la liberté de penser étant une suite naturelle de la tolérance, et la liberté de penser conduisant à la destruction de la morale, l’intolérance est nécessaire au bonheur des hommes : c’est calomnier la nature humaine. Quoi ! du moment où les hommes se mêlent de raisonner, ils deviennent des scélérats ! Quoi ! la vertu, la probité, ne peuvent s’appuyer que sur des sophismes qui disparaîtront dès qu’on sera libre de les attaquer ! Cette opinion est contredite par les faits. Parmi les hommes qui commettent des crimes, il y a beaucoup plus de gens crédules que de libres penseurs ; et il faut se garder de confondre la liberté de penser, produite par l’usage de la raison, avec ces maximes immorales qui sont depuis tous les temps à la bouche de la canaille de tous les pays : elles sont le fruit d’un instinct grossier, et non celui de la raison ; elles ne peuvent être attaquées et détruites que par elle.
Vous voulez, dites-vous, que les hommes aiment et pratiquent la vertu : préférez ceux qui veulent les rendre raisonnables à ceux qui s’occupent d’ajouter des erreurs étrangères aux erreurs où l’instinct peut entraîner.
Les hommes qui croient vraie la religion qu’ils professent doivent désirer la tolérance : d’abord, pour avoir le droit d’être tolérés eux-mêmes dans le pays où leur religion ne domine pas ; ensuite, pour que leur religion puisse subjuguer tous les esprits. Toutes les fois que les hommes ont la liberté de discuter, la vérité finit par triompher seule. Voyez comme, depuis le peu de temps où il a été permis de parler raison sur la magie, cette erreur si générale et si ancienne a disparu presque absolument. Croyez-vous donc qu’il faille des bourreaux et des assassins pour dégoûter les hommes de croire au dieu Fô, à Sammonocodom, etc. ?
Tandis que la nature, la raison, la politique, la vraie piété, prêchent la tolérance, quelques hommes voudraient bien persécuter : et si les gouvernements, plus éclairés, plus humains, ne leur immolent plus de victimes, on leur abandonne les livres ; on défend, sous des peines graves, d’écrire avec liberté. Qu’en arrive-t-il ? On porte dans les livres clandestins la liberté jusqu’à la licence ; et si l’on avance dans ces livres des principes dangereux, aucun homme qui a de la morale ou de l’honneur ne veut les réfuter, pour peu que le nom de l’auteur soit soupçonné, et que sa personne puisse être compromise. Cette persécution sert donc seulement à ne laisser pour défenseurs à la cause de ceux qui les suscitent que des hommes méprisés.
D’autres fois, des corps très respectables demandent hautement qu’on empêche de laisser entrer dans un royaume les livres où l’on combat leurs opinions. Ils ignorent apparemment que ces deux phrases : « Je vous prie d’employer votre crédit pour empêcher mon adversaire de combattre mes raisons, » ou bien : « Je ne crois pas aux opinions que je professe, » sont rigoureusement synonymes.
Que dirait-on d’un homme qui ne voudrait pas que son juge entendit les raisons de chaque partie ? Or, de quelque religion que vous soyez prêtres, quand il s’agit de vérité vous n’êtes que parties. La raison, la conscience de chaque homme est votre juge. Quel droit auriez-vous de l’empêcher de s’instruire ? Quel droit auriez-vous de l’empêcher d’instruire ses semblables ? Si votre croyance est susceptible de preuves, pourquoi craignez-vous qu’on l’examine ? Si elle ne l’est pas, si une grâce particulière d’un Dieu peut seule la persuader, pourquoi voulez-vous joindre une tyrannie humaine à cette force bienfaisante ?
Il existe en France un livre qui contient l’objection la plus terrible qu’on puisse faire contre la religion : c’est le tableau des revenus du clergé ; tableau trop bien connu, quoique les évêques aient refusé au roi de lui en donner un exemplaire. C’est la une de ces objections qui frappent le peuple comme le philosophe, et à laquelle il n’y a qu’une réponse : rendre à l’État ce que le clergé en a reçu, et rétablir la religion en vivant comme on prétend qu’ont vécu ceux qui l’ont établie. Écouteriez-vous un professeur de physique qui serait payé pour enseigner un système, et qui perdrait sa fortune s’il en enseignait un autre ? Écouteriez-vous un homme qui prêche l’humanité en se faisant appeler monseigneur, et la pauvreté volontaire en accumulant les bénéfices ?
On demande encore pourquoi le clergé, qui jouit d’environ un cinquième des biens de l’État, veut faire la guerre aux dépens du peuple ? S’il trouve certains livres dangereux pour lui, qu’il les fasse réfuter, et qu’il paye un peu plus cher ses écrivains. D’ailleurs, il n’en coûterait pas plus d’un ou deux millions par an pour retirer tous les exemplaires des livres irréligieux qui s’impriment en Europe ; cette dépense ne ferait pas un impôt d’un cinquantième sur les biens ecclésiastiques : aucune nation ne fait la guerre à si bon marché.
On a dit dans quelques brochures que les libres penseurs étaient intolérants : ce qui est absurde, puisque liberté de penser et tolérance sont synonymes. La preuve en était plaisante : c’est qu’ils se moquaient, disait-on, de leurs adversaires, et qu’ils se plaignaient des prérogatives odieuses ou nuisibles usurpées par le clergé. Il n’y a point d’intolérance à tourner en ridicule de mauvais raisonneurs. Si ces mauvais raisonneurs étaient tolérants et honnêtes, cela serait dur ; s’ils sont insolents et persécuteurs, c’est un acte de justice, c’est un service rendu au genre humain, mais ce n’est jamais intolérance : se moquer d’un homme, ou le persécuter, sont deux choses bien distinctes.
Si les prérogatives qu’on attaque sont mal fondées, celui qui s’élève contre elles ne fait que réclamer des droits usurpés sur lui. Est-ce donc être intolérant que de faire un procès à celui qui a usurpé nos biens ? Le procès peut être injuste, mais il n’y a point là d’intolérance.
On a dit aussi que les libres penseurs étaient dangereux parce qu’ils formaient une secte : cela est encore absurde. Ils ne peuvent former de secte, puisque leur premier principe est que chacun doit être libre de penser et de professer ce qu’il veut ; mais ils se réunissent contre les persécuteurs, et ce n’est point faire secte que de s’accorder à défendre le droit le plus noble et le plus sacre que l’homme ait reçu de la nature.
Le meurtre de Calas, commis dans Toulouse avec le glaive de la justice, le 9 mars 1762, est un des plus singuliers évènements qui méritent l’attention de notre âge et de la postérité. On oublie bientôt cette foule de morts qui a péri dans des batailles sans nombre, non seulement parce que c’est la fatalité inévitable de la guerre, mais parce que ceux qui meurent par le sort des armes pouvaient aussi donner la mort à leurs ennemis, et n’ont point péri sans se défendre. Là où le danger et l’avantage sont égaux, l’étonnement cesse, et la pitié même s’affaiblit ; mais si un père de famille innocent est livré aux mains de l’erreur, ou de la passion, ou du fanatisme ; si l’accusé n’a de défense que sa vertu ; si les arbitres de sa vie n’ont à risquer en l’égorgeant que de se tromper ; s’ils peuvent tuer impunément par un arrêt, alors le cri public s’élève, chacun craint pour soi-même, on voit que personne n’est en sûreté de sa vie devant un tribunal érigé pour veiller sur la vie des citoyens, et toutes les voix se réunissent pour demander vengeance.
Il s’agissait, dans cette étrange affaire, de religion, de suicide, de parricide ; il s’agissait de savoir si un père et une mère avaient étranglé leur fils pour plaire à Dieu, si un frère avait étranglé son frère, si un ami avait étranglé son ami, et si les juges avaient à se reprocher d’avoir fait mourir sur la roue un père innocent, ou d’avoir épargné une mère, un frère, un ami coupables.
Jean Calas, âgé de soixante et huit ans, exerçait la profession de négociant à Toulouse depuis plus de quarante années, et était reconnu de tous ceux qui ont vécu avec lui pour un bon père. Il était protestant, ainsi que sa femme et tous ses enfants, excepté un, qui avait abjuré l’hérésie, et à qui le père faisait une petite pension. Il paraissait si éloigné de cet absurde fanatisme qui rompt tous les liens de la société qu’il approuva la conversion de son fils Louis Calas, et qu’il avait depuis trente ans chez lui une servante zélée catholique, laquelle avait élevé tous ses enfants.
Un des fils de Jean Calas, nommé Marc-Antoine, était un homme de lettres : il passait pour un esprit inquiet, sombre, et violent. Ce jeune homme, ne pouvant réussir ni à entrer dans le négoce, auquel il n’était pas propre, ni à être reçu avocat, parce qu’il fallait des certificats de catholicité qu’il ne put obtenir, résolut de finir sa vie, et fit pressentir ce dessein à un de ses amis ; il se confirma dans sa résolution par la lecture de tout ce qu’on a jamais écrit sur le suicide.
Enfin, un jour, ayant perdu son argent au jeu, il choisit ce jour-là même pour exécuter son dessein. Un ami de sa famille et le sien, nommé Lavaisse, jeune homme de dix-neuf ans, connu par la candeur et la douceur de ses mœurs, fils d’un avocat célèbre de Toulouse, était arrivé de Bordeaux la veille ; il soupa par hasard chez les Calas. Le père, la mère, Marc-Antoine leur fils aîné, Pierre leur second fils, mangèrent ensemble. Après le souper on se retira dans un petit salon : Marc-Antoine disparut ; enfin, lorsque le jeune Lavaisse voulut partir, Pierre Calas et lui, étant descendus, trouvèrent en bas, auprès du magasin, Marc-Antoine en chemise, pendu à une porte, et son habit plié sur le comptoir ; sa chemise n’était pas seulement dérangée ; ses cheveux étaient bien peignés : il n’avait sur son corps aucune plaie, aucune meurtrissure.
On passe ici tous les détails dont les avocats ont rendu compte : on ne décrira point la douleur et le désespoir du père et de la mère ; leurs cris furent entendus des voisins. Lavaisse et Pierre Calas, hors d’eux-mêmes, coururent chercher des chirurgiens et la justice.
Pendant qu’ils s’acquittaient de ce devoir, pendant que le père et la mère étaient dans les sanglots et dans les larmes, le peuple de Toulouse s’attroupe autour de la maison. Ce peuple est superstitieux et emporté ; il regarde comme des monstres ses frères qui ne sont pas de la même religion que lui. C’est à Toulouse qu’on remercia Dieu solennellement de la mort de Henri III, et qu’on fit serment d’égorger le premier qui parlerait de reconnaître le grand, le bon Henri IV. Cette ville solennise encore tous les ans, par une procession et par des feux de joie, le jour où elle massacra quatre mille citoyens hérétiques, il y a deux siècles. En vain six arrêts du conseil ont défendu cette odieuse fête, les Toulousains l’ont toujours célébrée comme les jeux floraux.
Quelque fanatique de la populace s’écria que Jean Calas avait pendu son propre fils Marc-Antoine. Ce cri, répété, fut unanime en un moment ; d’autres ajoutèrent que le mort devait le lendemain faire abjuration ; que sa famille et le jeune Lavaisse l’avaient étranglé par haine contre la religion catholique : le moment d’après on n’en douta plus ; toute la ville fut persuadée que c’est un point de religion chez les protestants qu’un père et une mère doivent assassiner leur fils dès qu’il veut se convertir.
Les esprits une fois émus ne s’arrêtent point. On imagina que les protestants du Languedoc s’étaient assemblés la veille ; qu’ils avaient choisi, à la pluralité des voix, un bourreau de la secte ; que le choix était tombé sur le jeune Lavaisse ; que ce jeune homme, en vingt-quatre heures, avait reçu la nouvelle de son élection, et était arrivé de Bordeaux pour aider Jean Calas, sa femme, et leur fils Pierre, à étrangler un ami, un fils, un frère.
Le sieur David, capitoul de Toulouse, excité par ces rumeurs et voulant se faire valoir par une prompte exécution, fit une procédure contre les règles et les ordonnances. La famille Calas, la servante catholique, Lavaisse, furent mis aux fers.
On publia un monitoire non moins vicieux que la procédure. On alla plus loin : Marc-Antoine Calas était mort calviniste, et s’il avait attenté sur lui-même, il devait être traîné sur la claie ; on l’inhuma avec la plus grande pompe dans l’église Saint-Étienne, malgré le curé, qui protestait contre cette profanation.