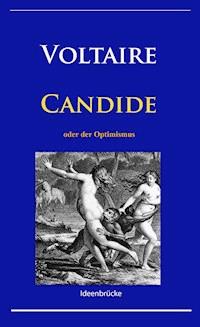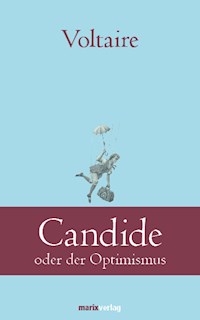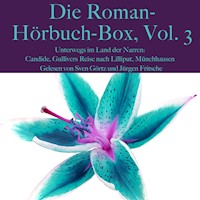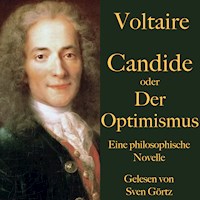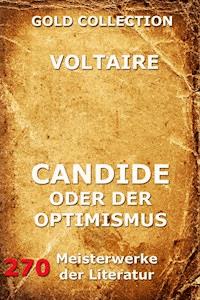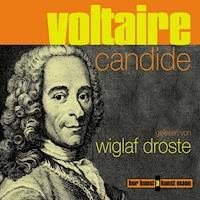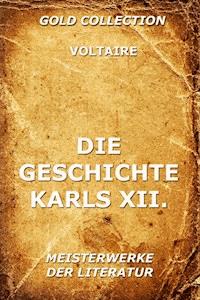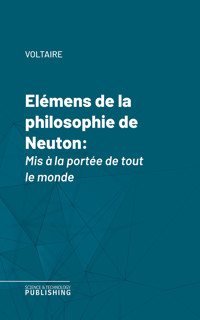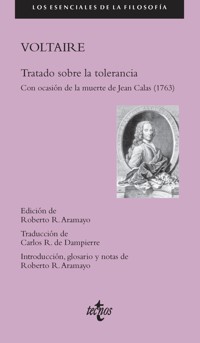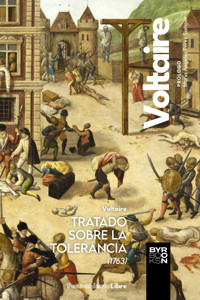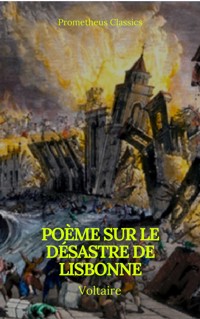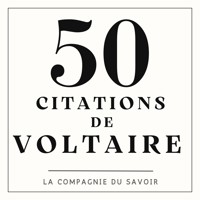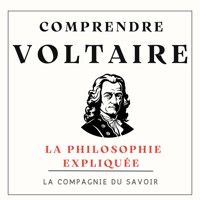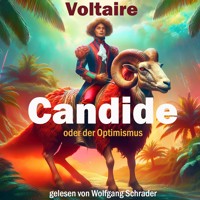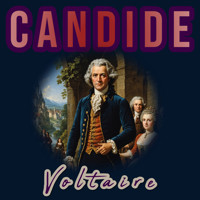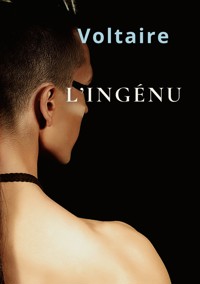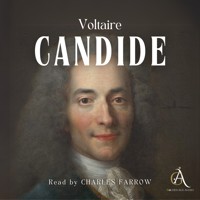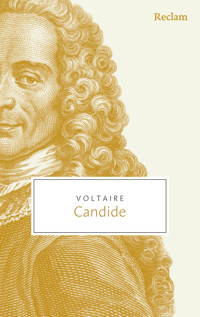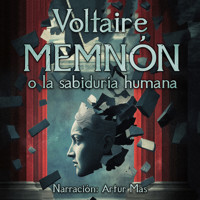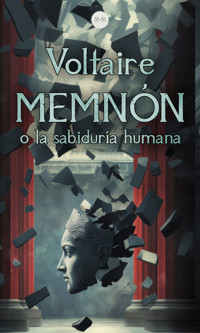Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UPblisher
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Deux essais philosophiques fondateurs et essentiels pour comprendre notre société actuelle.
Le Traité sur la tolérance est une œuvre polémique de Voltaire publiée en 1763. Destinée à stigmatiser le fanatisme religieux, c’est un texte majeur de la philosophie des Lumières. Au départ, un fait divers de 1762 : Jean Calas est protestant, comme toute sa famille sauf un de ses fils. Le fils est retrouvé pendu. La foule gronde. Calas est accusé de meurtre, arrêté. Les juges cèdent à la pression populaire. Calas est exécuté. Fin de l’histoire ? Dès 1762, Voltaire s’en empare et en fait l’introduction de son
Traité sur la tolérance ; l’affaire Calas est née et symbolise encore aujourd’hui les ravages de l’intolérance.
Loin d’être fondée sur un principe noble, elle trouve sa source dans ce que la société produit de plus vil, le fanatisme, lui-même engendré par la superstition. Voltaire écrit que cette dernière est « à la religion ce que l’astrologie est à l’astronomie : la fille très folle d’une mère très sage. » Pour Voltaire, la philosophie en chassant les démons de l’obscurantisme et du fanatisme offre aux Hommes un moyen de rechercher, ensemble, le bien commun. Facteur de paix sociale, de respect et d’amour réciproques, la tolérance est une des exigences suprêmes de la civilisation et de la société.
Avec le
Traité sur la tolérance, Voltaire réhabilite la mémoire de Calas, mais surtout il ouvre la voie à l’affirmation de la liberté religieuse telle que nous la concevons aujourd’hui. C’est un chef d’œuvre littéraire et philosophique inestimable qui a fait écrire à Diderot, non sans ironie « Quand il y aurait un Christ, je vous assure que Voltaire serait sauvé ». À la suite du
Traité, UPblisher vous offre de découvrir la remarquable
Lettre sur la tolérance (1689) à laquelle Voltaire fait référence. Œuvre de John Locke, philosophe anglais, elle pose les bases de la tolérance religieuse (traduction de Jean Le Cler, 1710).
Une œuvre classique qui pousse habilement à la réflexion, quelle que soit l’époque à laquelle on la lit.
EXTRAIT
Le meurtre de Calas, commis dans Toulouse avec le glaive de la justice, le 9 mars 1762, est un des plus singuliers événements qui méritent l'attention de notre âge et de la postérité. On oublie bientôt cette foule de morts qui a péri dans des batailles sans nombre, non seulement parce que c'est la fatalité inévitable de la guerre, mais parce que ceux qui meurent par le sort des armes pouvaient aussi donner la mort à leurs ennemis, et n'ont point péri sans se défendre.
À PROPOS DES AUTEURS
François-Marie Arouet, dit
Voltaire, né le 21 novembre 1694 à Paris, ville où il est mort le 30 mai 1778(à 83 ans), est un écrivain et philosophe français qui a marqué le xviiie siècle.Représentant le plus connu de la philosophie des Lumières, anglomane, il est à son époque le chef de file du parti philosophique, et sera avant la Révolution française et pendant le début du xixe siècle le philosophe préféré de la bourgeoisie libérale.
John Locke (Wrington, Somerset, 29 août 1632 - Oates, High Laver, Essex, 28 octobre 1704) est un philosophe anglais. Il a vécu à une époque charnière qui voit la fin des guerres de religion, les débuts du rationalisme et une forte opposition à l'absolutisme en Angleterre.
Ses écrit sur la tolérance ne peuvent être disjoints d'une période où s'opère un profond réajustement des champs politiques et religieux. Dans l'optique qui s'ouvre en partie grâce à lui, le politique s'occupe du monde présent et la religion s'occupe du monde de l'au-delà, les deux ne devant pas interférer. Sa théorie politique s'oppose à l'absolutisme qui se met alors en place en France et qui échoue à s'imposer en Angleterre, en partie grâce à lui. Il est aussi un des fondateurs de la notion d'« État de droit ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHAPITRE 1 Histoire abrégée de la mort de Jean Calas
Le meurtre de Calas, commis dans Toulouse avec le glaive de la justice, le 9 mars 1762, est un des plus singuliers événements qui méritent l'attention de notre âge et de la postérité. On oublie bientôt cette foule de morts qui a péri dans des batailles sans nombre, non seulement parce que c'est la fatalité inévitable de la guerre, mais parce que ceux qui meurent par le sort des armes pouvaient aussi donner la mort à leurs ennemis, et n'ont point péri sans se défendre. Là où le danger et l'avantage sont égaux, l'étonnement cesse, et la pitié même s'affaiblit ; mais si un père de famille innocent est livré aux mains de l'erreur, ou de la passion, ou du fanatisme ; si l'accusé n'a de défense que sa vertu : si les arbitres de sa vie n'ont à risquer en l'égorgeant que de se tromper ; s'ils peuvent tuer impunément par un arrêt, alors le cri public s'élève, chacun craint pour soi-même, on voit que personne n'est en sûreté de sa vie devant un tribunal érigé pour veiller sur la vie des citoyens, et toutes les voix se réunissent pour demander vengeance.
Il s'agissait, dans cette étrange affaire, de religion, de suicide, de parricide ; il s'agissait de savoir si un père et une mère avaient étranglé leur fils pour plaire à Dieu, si un frère avait étranglé son frère, si un ami avait étranglé son ami, et si les juges avaient à se reprocher d'avoir fait mourir sur la roue un père innocent, ou d'avoir épargné une mère, un frère, un ami coupables.
Jean Calas, âgé de soixante-huit ans, exerçait la profession de négociant à Toulouse depuis plus de quarante années, et était reconnu de tous ceux qui ont vécu avec lui pour un bon père. Il était protestant, ainsi que sa femme et tous ses enfants, excepté un, qui avait abjuré l'hérésie, et à qui le père faisait une petite pension. Il paraissait si éloigné de cet absurde fanatisme qui rompt tous les liens de la société qu'il approuva la conversion de son fils Louis Calas, et qu'il avait depuis trente ans chez lui une servante zélée catholique, laquelle avait élevé tous ses enfants.
Un des fils de Jean Calas, nommé Marc-Antoine, était un homme de lettres : il passait pour un esprit inquiet, sombre, et violent. Ce jeune homme, ne pouvant réussir ni à entrer dans le négoce, auquel il n'était pas propre, ni à être reçu avocat, parce qu'il fallait des certificats de catholicité qu'il ne put obtenir, résolut de finir sa vie, et fit pressentir ce dessein à un de ses amis ; il se confirma dans sa résolution par la lecture de tout ce qu'on a jamais écrit sur le suicide.
Enfin, un jour, ayant perdu son argent au jeu, il choisit ce jour-là même pour exécuter son dessein. Un ami de sa famille et le sien, nommé Lavaisse, jeune homme de dix-neuf ans, connu par la candeur et la douceur de ses mœurs, fils d'un avocat célèbre de Toulouse, était arrivé de Bordeaux la veille [1] ; il soupa par hasard chez les Calas. Le père, la mère, Marc-Antoine leur fils aîné, Pierre leur second fils, mangèrent ensemble. Après le souper on se retira dans un petit salon : Marc-Antoine disparut ; enfin, lorsque le jeune Lavaisse voulut partir, Pierre Calas et lui, étant descendus, trouvèrent en bas, auprès du magasin, Marc-Antoine en chemise, pendu à une porte, et son habit plié sur le comptoir ; sa chemise n'était pas seulement dérangée ; ses cheveux étaient bien peignés : il n'avait sur son corps aucune plaie, aucune [2].
On passe ici tous les détails dont les avocats ont rendu compte : on ne décrira point la douleur et le désespoir du père et de la mère ; leurs cris furent entendus des voisins. Lavaisse et Pierre Calas, hors d'eux-mêmes, coururent chercher des chirurgiens et la justice.
Pendant qu'ils s'acquittaient de ce devoir, pendant que le père et la mère étaient dans les sanglots et dans les larmes, le peuple de Toulouse s'attroupe autour de la maison. Ce peuple est superstitieux et emporté ; il regarde comme des monstres ses frères qui ne sont pas de la même religion que lui. C'est à Toulouse qu'on remercia Dieu solennellement de la mort de Henri III, et qu'on fit serment d'égorger le premier qui parlerait de reconnaître le grand, le bon Henri IV. Cette ville solennise encore tous les ans, par une procession et par des feux de joie, le jour où elle massacra quatre mille citoyens hérétiques, il y a deux siècles. En vain six arrêts du conseil ont défendu cette odieuse fête, les Toulousains l'ont toujours célébrée comme les jeux floraux.
Quelque fanatique de la populace s'écria que Jean Calas avait pendu son propre fils Marc-Antoine. Ce cri, répété, fut unanime en un moment ; d'autres ajoutèrent que le mort devait le lendemain faire abjuration ; que sa famille et le jeune Lavaisse l'avaient étranglé par haine contre la religion catholique : le moment d'après on n'en douta plus ; toute la ville fut persuadée que c'est un point de religion chez les protestants qu'un père et une mère doivent assassiner leur fils dès qu'il veut se convertir.
Les esprits une fois émus ne s'arrêtent point. On imagina que les protestants du Languedoc s'étaient assemblés la veille ; qu'ils avaient choisi, à la pluralité des voix, un bourreau de la secte ; que le choix était tombé sur le jeune Lavaisse ; que ce jeune homme, en vingt-quatre heures, avait reçu la nouvelle de son élection, et était arrivé de Bordeaux pour aider Jean Calas, sa femme, et leur fils Pierre, à étrangler un ami, un fils, un frère.
Le sieur David, capitoul de Toulouse, excité par ces rumeurs et voulant se faire valoir par une prompte exécution, fit une procédure contre les règles et les ordonnances. La famille Calas, la servante catholique, Lavaisse, furent mis aux fers.
On publia un monitoire non moins vicieux que la procédure. On alla plus loin : Marc-Antoine Calas était mort calviniste, et s'il avait attenté sur lui-même, il devait être traîné sur la claie ; on l'inhuma avec la plus grande pompe dans l'église Saint-Étienne, malgré le curé, qui protestait contre cette profanation.
Il y a, dans le Languedoc, quatre confréries de pénitents, la blanche, la bleue, la grise, et la noire. Les confrères portent un long capuce, avec un masque de drap percé de deux trous pour laisser la vue libre : ils ont voulu engager M. le duc de Fitz-James, commandant de la province, à entrer dans leurs corps, et il les a refusés. Les confrères blancs firent à Marc-Antoine Calas un service solennel, comme à un martyr. Jamais aucune Église ne célébra la fête d'un martyr véritable avec plus de pompe ; mais cette pompe fut terrible. On avait élevé au-dessus d'un magnifique catafalque un squelette qu'on faisait mouvoir, et qui représentait Marc-Antoine Calas, tenant d'une main une palme, et de l'autre la plume dont il devait signer l'abjuration de l'hérésie, et qui écrivait en effet l'arrêt de mort de son père.
Alors il ne manqua plus au malheureux qui avait attenté sur soi-même que la canonisation : tout le peuple le regardait comme un saint ; quelques-uns l'invoquaient, d'autres allaient prier sur sa tombe, d'autres lui demandaient des miracles, d'autres racontaient ceux qu'il avait faits. Un moine lui arracha quelques dents pour avoir des reliques durables. Une dévote, un peu sourde, dit qu'elle avait entendu le son des cloches. Un prêtre apoplectique fut guéri après avoir pris de l'émétique. On dressa des verbaux de ces prodiges. Celui qui écrit cette relation possède une attestation qu'un jeune homme de Toulouse est devenu fou pour avoir prié plusieurs nuits sur le tombeau du nouveau saint, et pour n'avoir pu obtenir un miracle qu'il implorait.
Quelques magistrats étaient de la confrérie des pénitents blancs. Dès ce moment la mort de Jean Calas parut infaillible.
Ce qui surtout prépara son supplice, ce fut l'approche de cette fête singulière que les Toulousains célèbrent tous les ans en mémoire d'un massacre de quatre mille huguenots ; l'année 1762 était l'année séculaire. On dressait dans la ville l'appareil de cette solennité : cela même allumait encore l'imagination échauffée du peuple ; on disait publiquement que l'échafaud sur lequel on rouerait les Calas serait le plus grand ornement de la fête ; on disait que la Providence amenait elle-même ces victimes pour être sacrifiées à notre sainte religion. Vingt personnes ont entendu ces discours, et de plus violents encore. Et c'est de nos jours ! Et c'est dans un temps où la philosophie a fait tant de progrès ! Et c'est lorsque cent académies écrivent pour inspirer la douceur des mœurs ! Il semble que le fanatisme, indigné depuis peu des succès de la raison, se débatte sous elle avec plus de rage.
Treize juges s'assemblèrent tous les jours pour terminer le procès. On n'avait, on ne pouvait avoir aucune preuve contre la famille ; mais la religion trompée tenait lieu de preuve. Six juges persistèrent longtemps à condamner Jean Calas, son fils, et Lavaisse, à la roue, et la femme de Jean Calas au bûcher. Sept autres plus modérés voulaient au moins qu'on examinât. Les débats furent réitérés et longs. Un des juges, convaincu de l'innocence des accusés et de l'impossibilité du crime, parla vivement en leur faveur : il opposa le zèle de l'humanité au zèle de la sévérité ; il devint l'avocat public des Calas dans toutes les maisons de Toulouse, où les cris continuels de la religion abusée demandaient le sang de ces infortunés. Un autre juge, connu par sa violence, parlait dans la ville avec autant d'emportement contre les Calas que le premier montrait d'empressement à les défendre. Enfin l'éclat fut si grand qu'ils furent obligés de se récuser l'un et l'autre ; ils se retirèrent à la campagne.
Mais, par un malheur étrange, le juge favorable aux Calas eut la délicatesse de persister dans sa récusation, et l'autre revint donner sa voix contre ceux qu'il ne devait point juger : ce fut cette voix qui forma la condamnation à la roue, car il n'y eut que huit voix contre cinq, un des six juges opposés ayant à la fin, après bien des contestations, passé au parti le plus sévère.
Il semble que quand il s'agit d'un parricide et de livrer un père de famille au plus affreux supplice, le jugement devrait être unanime, parce que les preuves d'un crime si inouï [3] devraient être d'une évidence sensible à tout le monde : le moindre doute dans un cas pareil doit suffire pour faire trembler un juge qui va signer un arrêt de mort. La faiblesse de notre raison et l'insuffisance de nos lois se font sentir tous les jours ; mais dans quelle occasion en découvre-t-on mieux la misère que quand la prépondérance d'une seule voix fait rouer un citoyen ? Il fallait, dans Athènes, cinquante voix au-delà de la moitié pour oser prononcer un jugement de mort. Qu'en résulte-t-il ? Ce que nous savons très inutilement, que les Grecs étaient plus sages et plus humains que nous.
Il paraissait impossible que Jean Calas, vieillard de soixante-huit ans, qui avait depuis longtemps les jambes enflées et faibles, eût seul étranglé et pendu un fils âgé de vingt-huit ans, qui était d'une force au-dessus de l'ordinaire ; il fallait absolument qu'il eût été assisté dans cette exécution par sa femme, par son fils Pierre Calas, par Lavaisse, et par la servante. Ils ne s'étaient pas quittés un seul moment le soir de cette fatale aventure. Mais cette supposition était encore aussi absurde que l'autre : car comment une servante zélée catholique aurait-elle pu souffrir que des huguenots assassinassent un jeune homme élevé par elle pour le punir d'aimer la religion de cette servante ? Comment Lavaisse serait-il venu exprès de Bordeaux pour étrangler son ami dont il ignorait la conversion prétendue ? Comment une mère tendre aurait-elle mis les mains sur son fils ? Comment tous ensemble auraient-ils pu étrangler un jeune homme aussi robuste qu'eux tous, sans un combat long et violent, sans des cris affreux qui auraient appelé tout le voisinage, sans des coups réitérés, sans des meurtrissures, sans des habits déchirés.
Il était évident que, si le parricide avait pu être commis, tous les accusés étaient également coupables, parce qu'ils ne s'étaient pas quittés d'un moment ; il était évident qu'ils ne l'étaient pas ; il était évident que le père seul ne pouvait l'être ; et cependant l'arrêt condamna ce père seul à expirer sur la roue.
Le motif de l'arrêt était aussi inconcevable que tout le reste. Les juges qui étaient décidés pour le supplice de Jean Calas persuadèrent aux autres que ce vieillard faible ne pourrait résister aux tourments, et qu'il avouerait sous les coups des bourreaux son crime et celui de ses complices. Ils furent confondus, quand ce vieillard, en mourant sur la roue, prit Dieu à témoin de son innocence, et le conjura de pardonner à ses juges.
Ils furent obligés de rendre un second arrêt contradictoire avec le premier, d'élargir la mère, son fils Pierre, le jeune Lavaisse, et la servante ; mais un des conseillers leur ayant fait sentir que cet arrêt démentait l'autre, qu'ils se condamnaient eux-mêmes, que tous les accusés ayant toujours été ensemble dans le temps qu'on supposait le parricide, l'élargissement de tous les survivants prouvait invinciblement l'innocence du père de famille exécuté, ils prirent alors le parti de bannir Pierre Calas son fils. Ce bannissement semblait aussi inconséquent, aussi absurde que tout le reste : car Pierre Calas était coupable ou innocent du parricide ; s'il était coupable, il fallait le rouer comme son père ; s'il était innocent, il ne fallait pas le bannir. Mais les juges, effrayés du supplice du père et de la piété attendrissante avec laquelle il était mort, imaginèrent de sauver leur honneur en laissant croire qu'ils faisaient grâce au fils, comme si ce n'eût pas été une prévarication nouvelle de faire grâce ; et ils crurent que le bannissement de ce jeune homme pauvre et sans appui, étant sans conséquence, n'était pas une grande injustice, après celle qu'ils avaient eu le malheur de commettre.
On commença par menacer Pierre Calas, dans son cachot, de le traiter comme son père s'il n'abjurait pas sa religion. C'est ce que ce jeune homme [4] atteste par serment.
Pierre Calas, en sortant de la ville, rencontra un abbé convertisseur qui le fit rentrer dans Toulouse ; on l'enferma dans un couvent de dominicains, et là on le contraignit à remplir toutes les fonctions de la catholicité : c'était en partie ce qu'on voulait, c'était le prix du sang de son père ; et la religion, qu'on avait cru venger, semblait satisfaite.
On enleva les filles à la mère ; elles furent enfermées dans un couvent. Cette femme, presque arrosée du sang de son mari, ayant tenu son fils aîné mort entre ses bras, voyant l'autre banni, privée de ses filles, dépouillée de tout son bien, était seule dans le monde, sans pain, sans espérance, et mourante de l'excès de son malheur. Quelques personnes, ayant examiné mûrement toutes les circonstances de cette aventure horrible, en furent si frappées qu'elles firent presser la dame Calas, retirée dans une solitude, d'oser venir demander justice au pied du trône. Elle ne pouvait pas alors se soutenir, elle s'éteignait ; et d'ailleurs, étant née Anglaise, transplantée dans une province de France dès son jeune âge, le nom seul de la ville de Paris l'effrayait. Elle s'imaginait que la capitale du royaume devait être encore plus barbare que celle du Languedoc. Enfin le devoir de venger la mémoire de son mari l'emporta sur sa faiblesse. Elle arriva à Paris prête d'expirer. Elle fut étonnée d'y trouver de l'accueil, des secours, et des larmes.
La raison l'emporte à Paris sur le fanatisme, quelque grand qu'il puisse être, au lieu qu'en province le fanatisme l'emporte presque toujours sur la raison.
M. de Beaumont, célèbre avocat du parlement de Paris, prit d'abord sa défense, et dressa une consultation qui fut signée de quinze avocats. M. Loiseau, non moins éloquent, composa un mémoire en faveur de la famille. M. Mariette, avocat au conseil, dressa une requête juridique qui portait la conviction dans tous les esprits.
Ces trois généreux défenseurs des lois et de l'innocence abandonnèrent à la veuve le profit des éditions de leurs plaidoyers[5]. Paris et l'Europe entière s'émurent de pitié, et demandèrent justice avec cette femme infortunée. L'arrêt fut prononcé par tout le public longtemps avant qu'il pût être signé par le conseil.
La pitié pénétra jusqu'au ministère, malgré le torrent continuel des affaires, qui souvent exclut la pitié, et malgré l'habitude de voir des malheureux, qui peut endurcir le cœur encore davantage. On rendit les filles à la mère. On les vit toutes les trois, couvertes d'un crêpe et baignées de larmes, en faire répandre à leurs juges.
Cependant cette famille eut encore quelques ennemis, car il s'agissait de religion. Plusieurs personnes, qu'on appelle en France dévotes[6], dirent hautement qu'il valait mieux laisser rouer un vieux calviniste innocent que d'exposer huit conseillers de Languedoc à convenir qu'ils s'étaient trompés : on se servit même de cette expression : « Il y a plus de magistrats que de Calas » ; et on inférait de là que la famille Calas devait être immolée à l'honneur de la magistrature. On ne songeait pas que l'honneur des juges consiste, comme celui des autres hommes, à réparer leurs fautes. On ne croit pas en France que le pape, assisté de ses cardinaux, soit infaillible : on pourrait croire de même que huit juges de Toulouse ne le sont pas. Tout le reste des gens sensés et désintéressés disaient que l'arrêt de Toulouse sera cassé dans toute l'Europe, quand même des considérations particulières empêcheraient qu'il fût cassé dans le conseil.
Tel était l'état de cette étonnante aventure, lorsqu'elle a fait naître à des personnes impartiales, mais sensibles, le dessein de présenter au public quelques réflexions sur la tolérance, sur l'indulgence, sur la commisération, que l'abbé Houtteville appelle dogmemonstrueux, dans sa déclamation ampoulée et erronée sur des faits, et que la raison appelle l'apanage de la nature.
Ou les juges de Toulouse, entraînés par le fanatisme de la populace, ont fait rouer un père de famille innocent, ce qui est sans exemple ; ou ce père de famille et sa femme ont étranglé leur fils aîné, aidés dans ce parricide par un autre fils et par un ami, ce qui n'est pas dans la nature. Dans l'un ou dans l'autre cas, l'abus de la religion la plus sainte a produit un grand crime. Il est donc de l'intérêt du genre humain d'examiner si la religion doit être charitable ou barbare.
CHAPITRE II Conséquences du supplice de Jean Calas
Si les pénitents blancs furent la cause du supplice d'un innocent, de la ruine totale d'une famille, de sa dispersion et de l'opprobre qui ne devrait être attaché qu'à l'injustice, mais qui l'est au supplice ; si cette précipitation des pénitents blancs à célébrer comme un saint celui qu'on aurait dû traîner sur la claie, suivant nos barbares usages, a fait rouer un père de famille vertueux ; ce malheur doit sans doute les rendre pénitents en effet pour le reste de leur vie ; eux et les juges doivent pleurer, mais non pas avec un long habit blanc et un masque sur le visage qui cacherait leurs larmes.
On respecte toutes les confréries : elles sont édifiantes ; mais quelque grand bien qu'elles puissent faire à l'État, égale-t-il ce mal affreux qu'elles ont causé ? Elles semblent instituées par le zèle qui anime en Languedoc les catholiques contre ceux que nous nommons huguenots. On dirait qu'on a fait vœu de haïr ses frères, car nous avons assez de religion pour haïr et persécuter, et nous n'en avons pas assez pour aimer et pour secourir. Et que serait-ce si ces confréries étaient gouvernées par des enthousiastes, comme l'ont été autrefois quelques congrégations des artisans et des messieurs, chez lesquels on réduisait en art et en système l'habitude d'avoir des visions, comme le dit un de nos plus éloquents et savants magistrats ? Que serait-ce si on établissait dans les confréries ces chambres obscures, appelées chambres de méditation, où l'on faisait peindre des diables armés de cornes et de griffes, des gouffres de flammes, des croix et des poignards, avec le saint nom de Jésus au-dessus du tableau ? Quel spectacle dans des yeux déjà fascinés, et pour des imaginations aussi enflammées que soumises à leurs directeurs !
Il y a eu des temps, on ne le sait que trop, où des confréries ont été dangereuses. Les frérots, les flagellants, ont causé des troubles. La Ligue commença par de telles associations. Pourquoi se distinguer ainsi des autres citoyens ? S'en croyait-on plus parfait ? Cela même est une insulte au reste de la nation. Voulait-on que tous les chrétiens entrassent dans la confrérie ? Ce serait un beau spectacle que l'Europe en capuchon et en masque, avec deux petits trous ronds au-devant des yeux ! Pense-t-on de bonne foi que Dieu préfère cet accoutrement à un justaucorps ? Il y a bien plus : cet habit est un uniforme de controversistes, qui avertit les adversaires de se mettre sous les armes ; il peut exciter une espèce de guerre civile dans les esprits, et elle finirait peut-être par de funestes excès si le roi et ses ministres n'étaient aussi sages que les fanatiques sont insensés.
On sait assez ce qu'il en a coûté depuis que les chrétiens disputent sur le dogme : le sang a coulé, soit sur les échafauds, soit dans les batailles, dès le IVe siècle jusqu'à nos jours. Bornons-nous ici aux guerres et aux horreurs que les querelles de la Réforme ont excitées, et voyons quelle en a été la source en France. Peut-être un tableau raccourci et fidèle de tant de calamités ouvrira les yeux de quelques personnes peu instruites, et touchera des cœurs bien faits.
CHAPITRE III Idée de la réforme du XVIe siècle
Lorsqu'à la renaissance des lettres les esprits commencèrent à s'éclairer, on se plaignit généralement des abus ; tout le monde avoue que cette plainte était légitime.
Le pape Alexandre VI avait acheté publiquement la tiare, et ses cinq bâtards en partageaient les avantages. Son fils, le cardinal duc de Borgia, fit périr, de concert avec le pape son père, les Vitelli, les Urbino, les Gravina, les Oliveretto, et cent autres seigneurs, pour ravir leurs domaines. Jules II, animé du même esprit, excommunia Louis XII, donna son royaume au premier occupant ; et lui-même, le casque en tête et la cuirasse sur le dos, mit à feu et à sang une partie de l'Italie. Léon X, pour payer ses plaisirs, trafiqua des indulgences comme on vend des denrées dans un marché public. Ceux qui s'élevèrent contre tant de brigandages n'avaient du moins aucun tort dans la morale. Voyons s'ils en avaient contre nous dans la politique.
Ils disaient que Jésus-Christ n'ayant jamais exigé d'annates ni de réserves, ni vendu des dispenses pour ce monde et des indulgences pour l'autre, on pouvait se dispenser de payer à un prince étranger le prix de toutes ces choses. Quand les annates, les procès en cour de Rome, et les dispenses qui subsistent encore aujourd'hui, ne nous coûteraient que cinq cent mille francs par an, il est clair que nous avons payé depuis François Ier, en deux cent cinquante années, cent vingt-cinq millions ; et en évaluant les différents prix du marc d'argent, cette somme en compose une d'environ deux cent cinquante millions d'aujourd'hui. On peut donc convenir sans blasphème que les hérétiques, en proposant l'abolition de ces impôts singuliers dont la postérité s'étonnera, ne faisaient pas en cela un grand mal au royaume, et qu'ils étaient plutôt bons calculateurs que mauvais sujets. Ajoutons qu'ils étaient les seuls qui sussent la langue grecque, et qui connussent l'Antiquité. Ne dissimulons point que, malgré leurs erreurs, nous leur devons le développement de l'esprit humain, longtemps enseveli dans la plus épaisse barbarie.
Mais comme ils niaient le purgatoire, dont on ne doit pas douter, et qui d'ailleurs rapportait beaucoup aux moines ; comme ils ne révéraient pas des reliques qu'on doit révérer, mais qui rapportaient encore davantage ; enfin comme ils attaquaient des dogmes très respectés [7], on ne leur répondit d'abord qu'en les faisant brûler. Le roi, qui les protégeait et les soudoyait en Allemagne, marcha dans Paris à la tête d'une procession après laquelle on exécuta plusieurs de ces malheureux ; et voici quelle fut cette exécution. On les suspendait au bout d'une longue poutre qui jouait en bascule sur un arbre debout ; un grand feu était allumé sous eux, on les y plongeait, et on les relevait alternativement : ils éprouvaient les tourments de la mort par degrés, jusqu'à ce qu'ils expirassent par le plus long et le plus affreux supplice que jamais ait inventé la barbarie.
Peu de temps avant la mort de François Ier, quelques membres du parlement de Provence, animés par des ecclésiastiques contre les habitants de Mérindol et de Cabrières, demandèrent au roi des troupes pour appuyer l'exécution de dix-neuf personnes de ce pays condamnées par eux ; ils en firent égorger six mille, sans pardonner ni au sexe, ni à la vieillesse, ni à l'enfance ; ils réduisirent trente bourgs en cendres. Ces peuples, jusqu'alors inconnus, avaient tort, sans doute, d'être nés Vaudois ; c'était leur seule iniquité. Ils étaient établis depuis trois cents ans dans des déserts et sur des montagnes qu'ils avaient rendus fertiles par un travail incroyable. Leur vie pastorale et tranquille retraçait l'innocence attribuée aux premiers âges du monde. Les villes voisines n'étaient connues d'eux que par le trafic des fruits qu'ils allaient vendre, ils ignoraient les procès et la guerre ; ils ne se défendirent pas : on les égorgea comme des animaux fugitifs qu'on tue dans une enceinte[8].
Après la mort de François Ier, prince plus connu cependant par ses galanteries et par ses malheurs que par ses cruautés, le supplice de mille hérétiques, surtout celui du conseiller au parlement Dubourg, et enfin le massacre de Vassy, armèrent les persécutés, dont la secte s'était multipliée à la lueur des bûchers et sous le fer des bourreaux ; la rage succéda à la patience ; ils imitèrent les cruautés de leurs ennemis : neuf guerres civiles remplirent la France de carnage ; une paix plus funeste que la guerre produisit la Saint-Barthélemy, dont il n'y avait aucun exemple dans les annales des crimes.
La Ligue assassina Henri III et Henri IV, par les mains d'un frère jacobin et d'un monstre qui avait été frère feuillant. Il y a des gens qui prétendent que l'humanité, l'indulgence, et la liberté de conscience, sont des choses horribles ; mais, en bonne foi, auraient-elles produit des calamités comparables ?
CHAPITRE IV Si la tolérance est dangereuse, et chez quels peuples elle est permise
Quelques-uns ont dit que si l'on usait d'une indulgence paternelle envers nos frères errants qui prient Dieu en mauvais français, ce serait leur mettre les armes à la main ; qu'on verrait de nouvelles batailles de Jarnac, de Moncontour, de Coutras, de Dreux, de Saint-Denis, etc. : c'est ce que j'ignore, parce que je ne suis pas un prophète ; mais il me semble que ce n'est pas raisonner conséquemment que de dire : « Ces hommes se sont soulevés quand je leur ai fait du mal : donc ils se soulèveront quand je leur ferai du bien. »
J'oserais prendre la liberté d'inviter ceux qui sont à la tête du gouvernement, et ceux qui sont destinés aux grandes places, à vouloir bien examiner mûrement si l'on doit craindre en effet que la douceur produise les mêmes révoltes que la cruauté a fait naître ; si ce qui est arrivé dans certaines circonstances doit arriver dans d'autres ; si les temps, l'opinion, les mœurs, sont toujours les mêmes.
Les huguenots, sans doute, ont été enivrés de fanatisme et souillés de sang comme nous ; mais la génération présente est-elle aussi barbare que leurs pères ? Le temps, la raison qui fait tant de progrès, les bons livres, la douceur de la société, n'ont-ils point pénétré chez ceux qui conduisent l'esprit de ces peuples ? Et ne nous apercevons-nous pas que presque toute l'Europe a changé de face depuis environ cinquante années ?
Le gouvernement s'est fortifié partout, tandis que les mœurs se sont adoucies. La police générale, soutenue d'armées nombreuses toujours existantes, ne permet pas d'ailleurs de craindre le retour de ces temps anarchiques, où des paysans calvinistes combattaient des paysans catholiques enrégimentés à la hâte entre les semailles et les moissons.
D'autres temps, d'autres soins. Il serait absurde de décimer aujourd'hui la Sorbonne parce qu'elle présenta requête autrefois pour faire brûler la Pucelle d'Orléans ; parce qu'elle déclara Henri III déchu du droit de régner, qu'elle l'excommunia, qu'elle proscrivit le grand Henri IV. On ne recherchera pas sans doute les autres corps du royaume, qui commirent les mêmes excès dans ces temps de frénésie : cela serait non seulement injuste ; mais il y aurait autant de folie qu'à purger tous les habitants de Marseille parce qu'ils ont eu la peste en 1720.
Irons-nous saccager Rome, comme firent les troupes de Charles Quint, parce que Sixte Quint, en 1585, accorda neuf ans d'indulgence à tous les Français qui prendraient les armes contre leur souverain ? Et n'est-ce pas assez d'empêcher Rome de se porter jamais à des excès semblables ?
La fureur qu'inspirent l'esprit dogmatique et l'abus de la religion chrétienne mal entendue a répandu autant de sang, a produit autant de désastres, en Allemagne, en Angleterre, et même en Hollande, qu'en France : cependant aujourd'hui la différence des religions ne cause aucun trouble dans ces États ; le juif, le catholique, le grec, le luthérien, le calviniste, l'anabaptiste, le socinien, le mennonite, le morave, et tant d'autres, vivent en frères dans ces contrées, et contribuent également au bien de la société.
On ne craint plus en Hollande que les disputes d'un Gomar[9] sur la prédestination fassent trancher la tête au grand pensionnaire. On ne craint plus à Londres que les querelles des presbytériens et des épiscopaux, pour une liturgie et pour un surplis, répandent le sang d'un roi sur un échafaud[10]. L'Irlande peuplée et enrichie ne verra plus ses citoyens catholiques sacrifier à Dieu pendant deux mois ses citoyens protestants, les enterrer vivants, suspendre les mères à des gibets, attacher les filles au cou de leurs mères, et les voir expirer ensemble ; ouvrir le ventre des femmes enceintes, en tirer les enfants à demi formés, et les donner à manger aux porcs et aux chiens ; mettre un poignard dans la main de leurs prisonniers garrottés, et conduire leurs bras dans le sein de leurs femmes, de leurs pères, de leurs mères, de leurs filles, s'imaginant en faire mutuellement des parricides, et les damner tous en les exterminant tous. C'est ce que rapporte Rapin-Thoiras, officier en Irlande, presque contemporain ; c'est ce que rapportent toutes les annales, toutes les histoires d'Angleterre, et ce qui sans doute ne sera jamais imité. La philosophie, la seule philosophie, cette sœur de la religion, a désarmé des mains que la superstition avait si longtemps ensanglantées ; et l'esprit humain, au réveil de son ivresse, s'est étonné des excès où l'avait emporté le fanatisme.
Nous-mêmes, nous avons en France une province opulente où le luthéranisme l'emporte sur le catholicisme. L'université d'Alsace est entre les mains des luthériens ; ils occupent une partie des charges municipales : jamais la moindre querelle religieuse n'a dérangé le repos de cette province depuis qu'elle appartient à nos rois. Pourquoi ? C'est qu'on n'y a persécuté personne. Ne cherchez point à gêner les cœurs, et tous les cœurs seront à vous.
Je ne dis pas que tous ceux qui ne sont point de la religion du prince doivent partager les places et les honneurs de ceux qui sont de la religion dominante. En Angleterre, les catholiques, regardés comme attachés au parti du prétendant, ne peuvent parvenir aux emplois : ils payent même double taxe ; mais ils jouissent d'ailleurs de tous les droits des citoyens.
On a soupçonné quelques évêques français de penser qu'il n'est ni de leur honneur ni de leur intérêt d'avoir dans leur diocèse des calvinistes, et que c'est là le plus grand obstacle à la tolérance ; je ne le puis croire. Le corps des évêques, en France, est composé de gens de qualité qui pensent et qui agissent avec une noblesse digne de leur naissance ; ils sont charitables et généreux, c'est une justice qu'on doit leur rendre ; ils doivent penser que certainement leurs diocésains fugitifs ne se convertiront pas dans les pays étrangers, et que, retournés auprès de leurs pasteurs, ils pourraient être éclairés par leurs instructions et touchés par leurs exemples : il y aurait de l'honneur à les convertir, le temporel n'y perdrait pas, et plus il y aurait de citoyens, plus les terres des prélats rapporteraient.
Un évêque de Varmie, en Pologne, avait un anabaptiste pour fermier, et un socinien pour receveur ; on lui proposa de chasser et de poursuivre l'un, parce qu'il ne croyait pas la consubstantialité, et l'autre, parce qu'il ne baptisait son fils qu'à quinze ans : il répondit qu'ils seraient éternellement damnés dans l'autre monde, mais que, dans ce monde-ci, ils lui étaient très nécessaires.
Sortons de notre petite sphère, et examinons le reste de notre globe. Le Grand Seigneur gouverne en paix vingt peuples de différentes religions ; deux cent mille Grecs vivent avec sécurité dans Constantinople ; le muphti même nomme et présente à l'empereur le patriarche grec ; on y souffre un patriarche latin. Le sultan nomme des évêques latins pour quelques îles de la Grèce[11], et voici la formule dont il se sert : « Je lui commande d'aller résider évêque dans l'île de Chio, selon leur ancienne coutume et leurs vaines cérémonies. » Cet empire est rempli de jacobites, de nestoriens, de monothélites ; il y a des cophtes, des chrétiens de Saint-Jean, des juifs, des guèbres, des banians. Les annales turques ne font mention d'aucune révolte excitée par aucune de ces religions.
Allez dans l'Inde, dans la Perse, dans la Tartarie, vous y verrez la même tolérance et la même tranquillité. Pierre le Grand a favorisé tous les cultes dans son vaste empire ; le commerce et l'agriculture y ont gagné, et le corps politique n'en a jamais souffert.
Le gouvernement de la Chine n'a jamais adopté, depuis plus de quatre mille ans qu'il est connu, que le culte des noachides, l'adoration simple d'un seul Dieu : cependant il tolère les superstitions de Fô et une multitude de bonzes qui serait dangereuse si la sagesse des tribunaux ne les avait pas toujours contenus.
Il est vrai que le grand empereur Young-Tching, le plus sage et le plus magnanime peut-être qu'ait eu la Chine, a chassé les jésuites ; mais ce n'était pas parce qu'il était intolérant, c'était, au contraire, parce que les jésuites l'étaient. Ils rapportent eux-mêmes, dans leurs Lettres curieuses, les paroles que leur dit ce bon prince : « Je sais que votre religion est intolérante ; je sais ce que vous avez fait aux Manilles et au Japon ; vous avez trompé mon père, n'espérez pas me tromper moi-même. » Qu'on lise tout le discours qu'il daigna leur tenir, on le trouvera le plus sage et le plus clément des hommes. Pouvait-il, en effet, retenir des physiciens d'Europe qui, sous le prétexte de montrer des thermomètres et des éolipyles à la cour, avaient soulevé déjà un prince du sang ? Et qu'aurait dit cet empereur, s'il avait lu nos histoires, s'il avait connu nos temps de la Ligue et de la conspiration des poudres ?
C'en était assez pour lui d'être informé des querelles indécentes des jésuites, des dominicains, des capucins, des prêtres séculiers, envoyés du bout du monde dans ses États : ils venaient prêcher la vérité, et ils s'anathématisaient les uns les autres. L'empereur ne fit donc que renvoyer des perturbateurs étrangers ; mais avec quelle bonté les renvoya-t-il ! Quels soins paternels n'eut-il pas d'eux pour leur voyage et pour empêcher qu'on ne les insultât sur la route ! Leur bannissement même fut un exemple de tolérance et d'humanité.
Les Japonais[12] étaient les plus tolérants de tous les hommes : douze religions paisibles étaient établies dans leur empire ; les jésuites vinrent faire la treizième, mais bientôt, n'en voulant pas souffrir d'autre, on sait ce qui en résulta : une guerre civile, non moins affreuse que celle de la Ligue, désola ce pays. La religion chrétienne fut noyée enfin dans des flots de sang ; les Japonais fermèrent leur empire au reste du monde, et ne nous regardèrent que comme des bêtes farouches, semblables à celles dont les Anglais ont purgé leur île. C'est en vain que le ministre Colbert, sentant le besoin que nous avions des Japonais, qui n'ont nul besoin de nous, tenta d'établir un commerce avec leur empire : il les trouva inflexibles.
Ainsi donc notre continent entier nous prouve qu'il ne faut ni annoncer ni exercer l'intolérance.
Jetez les yeux sur l'autre hémisphère ; voyez la Caroline, dont le sage Locke fut le législateur : il suffit de sept pères de famille pour établir un culte public approuvé par la loi ; cette liberté n'a fait naître aucun désordre. Dieu nous préserve de citer cet exemple pour engager la France à l'imiter ! on ne le rapporte que pour faire voir que l'excès le plus grand où puisse aller la tolérance n'a pas été suivi de la plus légère dissension ; mais ce qui est très utile et très bon dans une colonie naissante n'est pas convenable dans un ancien royaume.
Que dirons-nous des primitifs, que l'on a nommés quakers par dérision, et qui, avec des usages peut-être ridicules, ont été si vertueux et ont enseigné inutilement la paix au reste des hommes ? Ils sont en Pennsylvanie au nombre de cent mille ; la discorde. la controverse, sont ignorées dans l'heureuse patrie qu'ils se sont faite, et le nom seul de leur ville de Philadelphie, qui leur rappelle à tout moment que les hommes sont frères, est l'exemple et la honte des peuples qui ne connaissent pas encore la tolérance.
Enfin cette tolérance n'a jamais excité de guerre civile ; l'intolérance a couvert la terre de carnage. Qu'on juge maintenant entre ces deux rivales, entre la mère qui veut qu'on égorge son fils, et la mère qui le cède pourvu qu'il vive !