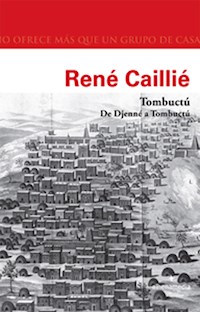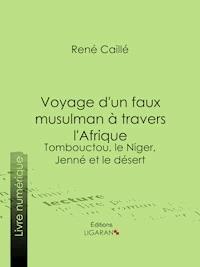
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
"Voyage d'un faux musulman à travers l'Afrique est un récit de voyage captivant écrit par René Caillié, un explorateur français du XIXe siècle. Dans ce livre, Caillié relate son incroyable périple à travers l'Afrique de l'Ouest, déguisé en musulman pour mieux s'intégrer dans les sociétés qu'il traverse.
Parti de Saint-Louis au Sénégal en 1827, Caillié traverse des territoires inconnus et hostiles, bravant les dangers et les difficultés pour atteindre Tombouctou, une ville mythique et mystérieuse à l'époque. Son récit nous plonge dans un monde fascinant, où les coutumes, les croyances et les paysages exotiques se succèdent au fil de ses aventures.
Voyage d'un faux musulman à travers l'Afrique est un témoignage précieux sur les sociétés africaines de l'époque, mais aussi sur le courage et la détermination d'un homme qui a osé défier l'inconnu. Ce livre est une véritable invitation au voyage, à la découverte et à l'émerveillement, et il nous rappelle que l'Afrique recèle encore de nombreux mystères à percer.
Extrait : ""Supposons que vous ayez sous les yeux une carte du globe ; que, sur cete carte, vous établissiez à l'un des points qui représentent Brest, Nantes, Rochefort ou Bordeaux, à la droite du petit carré qui représente la France ; que de là, votre doigt se promène au large sur cet espace blanc qui figure la grande masse d'eau de l'Atlantique, et, laissant à gauche l'Espagne, le Portugal, le détroit de Gibraltar, continue son chemin ..."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Supposons que vous ayez sous les yeux une carte du globe ; que, sur cette carte, vous vous établissiez à l’un des points qui représentent Brest, Nantes, Rochefort ou Bordeaux, à la droite du petit carré qui représente la France ; que de là, votre doigt le promène au large sur cet espace blanc qui figure la grande masse d’eau de l’Atlantique, et, laissant à gauche l’Espagne, le Portugal, le détroit de Gibraltar, continue son chemin en vue du cap Noun, du cap Boyador, du cap Blanc, du cap Vert, en vue des établissements français et anglais du Sénégal et de la Gambie ; puis, reprenne enfin terre à ce petit filet noir qui marque l’embouchure du Rio-Nunez : parvenus là, vous avez fait douze ou quinze cents lieues, et vous êtes au point de départ du voyage que nous allons entreprendre à la suite de M. Caillié.
À présent, notre ligne de route est bien facile à tracer, par à peu près s’entend. Il s’agit, en tournant le dos à la mer, de fixer sur la carte un point à deux cents lieues environ de l’embouchure du Rio-Nunez, et de joindre ce point d’une part avec cette embouchure, de l’autre avec l’empire de Maroc, avec Fez et Tanger. Entrés en Afrique par le côté qui fait face à l’Amérique, nous en sortirons par le côté qui fait face à l’Europe ; nous aurons fait sur le sol africain un coude de neuf à onze cents lieues.
Qu’y a-t-il à voir, à l’heure qu’il est, sur cette longue ligne ? Que se passe-t-il, dans ces régions sur lesquelles la carte est presque entièrement muette, ou bien qu’est-ce que représente le petit nombre d’indications qu’elle donne ? Sous quels aspects se présentent là et la terre et les hommes ? Le soleil, les nuages, les montagnes, les rivières, ont-ils là les mêmes habitudes que chez nous ? Le sol est-il pareil à celui que nous foulons ? Se pare-t-il des mêmes couleurs, porte-t-il les mêmes plantes, nourrit-il les mêmes animaux, et, creusé, laisse-t-il voir les mêmes choses ? – Enfin, s’il y a des hommes dans ces vastes contrées, qui sont ces hommes ? Quelle idée se font-ils de la vie humaine ? Quel parti tirent-ils de la terre et des choses qu’elle porte ? Quel parti tirent-ils de leurs semblables et d’eux-mêmes ? Que savent-ils ? Qu’imaginent-ils ? Ce même soleil qui, eux aussi, les réchauffe et les éclaire, leur dit-il quelque chose des autres hommes qu’il a réchauffés et éclairés avant que d’arriver à eux, de ceux qu’il réchauffe et éclaire en même temps qu’eux : de nous, par exemple, qui sommes de ceux-là ? Ces hommes s’occupent-ils de nous, comme nous nous occupons d’eux ? Songent-ils également, de leur côté, à nous rendre visite ?
Bien d’autres questions s’élèvent à la vue de ces espaces si voisins de notre Europe, et si fort négligés par elle ; de ces espaces où nos croyances et nos sciences, nos langues et nos institutions sont presque totalement inconnues. Ces hommes, en effet, ne pouvons-nous rien pour eux ? N’avons-nous à échanger avec eux que des regards indiscrets et méfiants ? Si différents qu’ils soient de nous par l’extérieur et le costume, ou même par l’organisation et les habitudes, en sont-ils moins nos pareils au nom des besoins universels de la nature humaine, au nom du travail qui répond partout à ces besoins, au nom de la sympathie par laquelle chacun de nous est associé aux plaisirs et surtout aux souffrances des autres hommes ? Qu’ils le reconnaissent ou non, ils appartiennent à la grande famille dans laquelle nous ne voyons, nous, que des frères nés pour être amis, des frères que l’erreur seule sépare.
Deux questions surtout ont attiré, de nos jours, l’attention des Européens vers cette partie de l’Afrique.
L’une de ces questions se rapportait à un vaste courant d’eau qui promettait à lui seul un puissant instrument aux recherches ultérieures. Car, vous le savez, une rivière en ces régions brûlantes, ce n’est pas seulement, comme ailleurs, un chemin qui marche, c’est un chemin qui désaltère ceux qu’il porte, un chemin qui leur prépare devant eux des vivres et un abri sur les rives que son eau fertilise. De là l’importance de la question du Niger, ce Nil des Noirs, mentionné il y a plus de deux mille ans par l’historien grec Hérodote, retrouvé en 1795 par l’Anglais Mungo Parck, et dont les sources principales furent indiquées, en 1822, par l’Anglais Laing. Plus récemment, en 1830, deux autres Anglais, Richard Lander (ci-devant domestique du célèbre voyageur Clapperton), et son frère John, se livrant hardiment au courant du fleuve, l’ont descendu jusqu’à la mer.
L’autre question, qui touchait de près à la première, était relative à la ville de Tombouctou, voisine du fleuve, et comme lui, mystérieuse. Ce nom, il faut le dire, exerçait une sorte d’enchantement sur l’imagination des géographes. Ils ne pouvaient se représenter sans enthousiasme une capitale grandie, comme par miracle, sous le souffle desséchant du Désert : véritable port de cet océan de sable qu’on appelle le Sahara, entrepôt florissant d’un commerce perpétuel entre le nord et l’occident de l’Afrique. C’était à qui lui prêterait les plus larges dimensions ; les évaluations les plus modérées ne lui donnaient pas moins de cent mille habitants. Un écrivain arabe, enchérissant sur les exagérations de ses compatriotes, allait même jusqu’à dire :
« C’est la plus grande ville que Dieu ait créée. »
Vous commencez à craindre que la réalité ne réponde pas à ces pompeuses annonces ; elles auront du moins servi à tourner l’attention de ce côté. Si l’on n’a pas le singulier plaisir que l’on se promettait de rencontrer un Paris au milieu des sables, en revanche on aura quelques pages de plus à ajouter à l’inventaire de notre planète, et du recensement général de la famille humaine.
Quant à nous, nous sommes, pour le moment du moins, condamnés à ne visiter ces contrées lointaines que par les yeux d’autrui, et, pour ainsi dire, par procuration. – Le voyageur qui se charge de les visiter pour nous se fera-t-il toutes les questions que nous nous ferions en pareil cas ? Arrivera-t-il là-bas avec nos propres préoccupations ? Par lui serons-nous là comme si nous y étions nous-mêmes ? C’est chose dont on peut douter ; toutefois, dans l’impossibilité où nous sommes, pour longtemps peut-être, de nous transporter en personne à douze cents lieues d’ici, cette ressource des récits d’emprunt (la seule qui nous reste) n’est pas à dédaigner. Elle serait plus précieuse encore, si les lecteurs de voyages avaient le bon esprit de ne demander au voyageur que ce qu’il soit, de ne pas le contraindre à parler des choses que les circonstances du trajet ou bien le défaut de connaissances préalables ne lui ont pas permis de remarquer. Loin de là, le voyageur est tenu, d’ordinaire, de tout voir, de tout entendre, de tout comprendre ; il est tenu d’entrer dans le pays avec tous les moyens d’observation que chacune de nos sciences modernes prête à ses disciples ; il est tenu d’en sortir sans oublier le nom d’une seule bicoque. Le lecteur gagne-t-il en réalité quelque chose à ces exigences ? Eh mon Dieu non ! Le voyageur fait semblant d’être en état d’y satisfaire ; il parle de tout ; il ne laisse pas en blanc une seule des stations de son itinéraire : toutes les lacunes de ses notes ou de sa mémoire, il les remplit de la meilleure grâce du monde : son honneur est sauf aux dépens de sa probité.
Tâchons d’être justes, ne fût-ce que pour n’être pas trompés ; et, prenant notre voyageur pour ce qu’il est, ne le forçons pas à se donner pour autre. Voyons ce que nous pouvons en conscience attendre de lui, et ne lui demandons rien de plus.
Dès l’ouverture de son livre, nous apprenons que c’est un jeune homme de vingt-six à vingt-sept ans. Ni dans le village de Poitou qu’il quitta, nous dit-il, à seize ans pour la côte d’Afrique, avec soixante francs pour toute fortune, et quelques lectures de voyages pour toute instruction ; ni dans ses différentes courses au Sénégal ou à la Guadeloupe, il n’eut le loisir ou le moyen d’acquérir les connaissances qu’un voyage de découverte exige. – De plus, s’il parcourt sur le globe la ligne de route que nous venons de tracer sur la carte, c’est en passant, c’est à la dérobée, à la hâte, dans des transes perpétuelles, et comme en traversant un camp ennemi : sans autre défense que celle que ses maux lui acquièrent de loin en loin dans les âmes compatissantes ; sans autre protection que la pitié ou le mépris qu’il inspire. Pauvre mendiant dévot, marchant seul et à pied au milieu de tant de populations étrangères, bien souvent, c’est à peine s’il ose lever les yeux de dessus le grand chapelet musulman qui lui sert de passeport.
Vous voyez qu’il est difficile de voyager dans des conditions plus défavorables. Nous serions mal venus à vouloir qu’il sorte de là une relation nourrie d’observations approfondies et savants. Toutefois, un pareil trajet peut nous apprendre encore bien des choses que nous ignorons, et nous en rappeler d’autres auxquelles nous ne songeons pas. En laissant même les indications que le voyageur a tâché de recueillir sur les pays qui se trouvaient à droite et à gauche de sa route ; en laissant encore la longue liste de dénominations géographiques qu’il s’est efforcé de compléter ; il reste les choses qu’il a vues de ses yeux, les choses que tout passant en Afrique pourrait apercevoir de même, les choses sur lesquelles il ne peut y avoir de doute, sans inculper, non pas les lumières, mais la bonne foi même de celui qui les raconte : il reste les évènements auxquels le voyageur a été mêlé, dans lesquels il s’est trouvé tout ensemble acteur et spectateur. Le journal de M. Caillié serait réduit au récit de ses propres aventures, qu’il n’en serait par là même sur l’Afrique qu’un témoignage plus expressif et plus authentique.
De ce que M. Caillié avoue franchement qu’il s’est mis en route sans avoir pu jamais acquérir les connaissances qui peuvent donner le plus de prix à une pareille entreprise, il ne s’ensuit pas qu’il soit parti sans préparation aucune. Rien que pour entrer sur le territoire d’Afrique, il faut se déguiser, se transformer, se composer un rôle. Ce rôle, il faut, dans une si longue traversée, qu’il s’adapte également à chacun des pays à parcourir ; qu’il convienne aux ressources particulières du voyageur, qu’il s’accommode à ses moyens d’observation. Une fois ce rôle composé, il faut l’apprendre, il ne faut pas l’oublier un seul instant : il y va de la vie. Ce rôle, quel qu’il soit, bien choisi et bien joué, est à lui seul un renseignement précieux sur les contrées dont il ouvre la porte au voyageur.
Ainsi donc, à part ses résultats, et seulement pour être mise à exécution, la traversée que nous nous proposons demande un apprentissage. Celui de M. Caillié, commencé de bonne heure, et plus long par le manque même d’encouragements et de secours, dura près de dix années. Trois voyages successifs au Sénégal, deux essais malheureux pour pénétrer dans l’intérieur à la suite des expéditions anglaises, le familiarisèrent avec toutes les difficultés de sa tâche. Dans l’une de ces tentatives, il vit par lui-même combien la foule des chameaux, la richesse du bagage, et même une troupe de soldats armés, servent de peu contre des hommes qui, s’obstinant à fermer aux Européens l’accès de leur pays, comptent au nombre de leurs armes offensives le soleil et le sable, et n’ont rien que leurs puits à défendre. Une retraite ruineuse « et plus sinistre qu’une déroute » lui apprit qu’à moins, de se frayer le chemin par la force, l’étude de ces populations défiantes ne devait pas se faire avec tant de bruit.
Ainsi, le plus grand obstacle à la traversée que nous nous proposons, ce sont les hommes. Des Arabes, en effet, de race plus ou moins mélangée, ont pénétré partout en ces parages parmi les populations noires et partout, avec le nom de Mahomet et ses lois sévères, ils ont implanté la haine et le mépris des Chrétiens : mettant, sous ce nom, tous les Européens hors la loi ; nous dévouant tous tant que nous sommes, en cette vie, au brigandage et à la filouterie des Fidèles, et dans l’autre, aux flammes éternelles de l’enfer.
Notre jeune voyageur jugea que le plus court était d’apprendre leur religion et leur langue. Il trouva tout simple d’abandonner les chances de fortune que lui offrait le commerce, pour aller faire son éducation musulmane chez les Musulmans eux-mêmes. Pour maîtres d’arabe et d’islamisme, il choisit les Arabes (ou Maures) Braknas qui errent avec leurs troupeaux entre le Sénégal et le Désert, à cinquante ou soixante lieues de la côte.
Je ne m’arrêterai pas à vous raconter le traitement que lui valut de leur part son apparente conversion aux croyances musulmanes. Ses hôtes lui montrèrent à lire l’écriture arabe, et lui firent apprendre par cœur force versets du Coran. Il fut même pourvu d’une planchette d’écolier, et, comme les enfants, soumis, le matin avant le jour et le soir à la nuit, à chanter à haute voix la gloire d’Allah et de Mohamed, à la lueur d’un petit feu.
La langue usuelle de ces Arabes lui devait être par la suite du plus grand secours. Leur société était du reste une excellente école de mœurs africaines, de vie uniforme et simple, et par-dessus tout, de sobriété. Chose étrange pour nous ! Chose bien plus étrange encore pour l’estomac du pauvre voyageur, leur principale nourriture, c’est le lait : aux chefs, le lait de chameau ; aux autres, le lait de vache, de chèvre ou de brebis ; dans la saison des pluies ils ne prennent pas autre chose. Une simple bouillie de mil pilé et assaisonnée d’herbages supplée au lait dans les temps de sécheresse. Un repas de viande séchée est le privilège des plus riches, et pour eux-mêmes, un régal. Le reste est à l’avenant.
Ces privations continues ne les dispensent pas du jeûne que la religion leur impose, jeûne auprès duquel ce que les Européens appellent aujourd’hui de ce nom n’est qu’un jeu. Ce jeûne, en dévot catéchumène, abdallahi, c’est le nom que M. Caillié s’était donné, y fut astreint sans miséricorde.
« Le soir (5 avril 1825) on aperçut la nouvelle lune. C’était celle du Ramandan : le carême allait commencer. On fit de longues prières et beaucoup de bouillie de mil… » C’était dans la saison des chaleurs, par un vent d’est étouffant. Une tasse de lait aigre avant et après le coucher du soleil ; à onze heures du soir, une simple bouillie de mil : tel était, tel est encore sur la rive droite du Sénégal le régime de la lune du jeûne.
Le sixième jour, dit le voyageur, je crus que je ne pourrais soutenir plus longtemps ces terribles mortifications. La chaleur augmentait ; ma soif était insupportable : j’avais la gorge desséchée ; ma langue, gercée, me faisait l’effet d’une râpe dans la bouche. Je crus que je succomberais ; je ne souffrais pas seul : tout le monde, autour de moi, endurait les mêmes tourments. Enfin, les Marabouts se baignèrent le visage, la tête et une partie du corps. On me permit d’en faire autant ; mais j’étais observé avec la plus grande attention. »
Une seule fois il avale avec frayeur une partie de l’eau avec laquelle il était permis de se laver la bouche.
« Je jeûnai ainsi dix-sept jours ; le dix-huitième, je fus attaqué de la fièvre ; alors on me dispensa du jeûne, si toutefois on peut appeler ne pas jeûner boire un peu d’eau dans la journée, car on ne me donna absolument rien à manger. »
Huit ou neuf mois de séjour parmi les Braknas ont mis le voyageur à même de nous raconter à loisir tous les incidents, très peu variés du reste, de leur vie ambulante, de nous introduire dans leurs maisons portatives, de nous montrer leur ameublement, leur costume ; de nous faire voir comment sont réparties chez eux, entre les diverses classes d’hommes libres ou d’esclaves, les différentes fonctions industrielles, commerciales, civiles, militaires, religieuses, etc. Ces curieux détails nous mèneraient trop loin. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de chemin à faire.
Le chrétien, dont la conversion avait toujours laissé quelque défiance, était allé aux bateaux français sur le fleuve, et, contre l’espérance de ses hôtes, il était revenu partager leur fade bouillie de mil.
Il s’agissait d’acheter un troupeau et deux Noirs pour établir chez les Braknas son point de départ sur une base solide. Par malheur, le gouverneur français, qui avait encouragé ses premiers essais, était parti. M. Caillié vit ses offres repoussées, et des espérances qui lui coûtaient déjà tant de fatigues, minées de fond en comble. Il se fit empailleur d’oiseaux, pour vivre. Le gouverneur revenu, ne répondit à son empressement que par de vagues promesses. Les Anglais de Sierra-Leone l’accueillirent mieux à tous égards. Les Français lui avaient opposé M. de Beaufort et les railleries amères sur sa prétendue conversion et sur son costume. Les Anglais, en lui opposant le major Laing, également parti pour Temboctou, lui offrirent l’hospitalité la plus généreuse. Près de deux ans s’écoulèrent ainsi dans des désappointements continuels.
M. Caillié ne se rebuta point. Il avait eu connaissance du prix proposé en 1824 par la Société de géographie