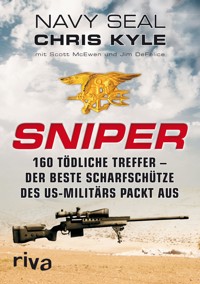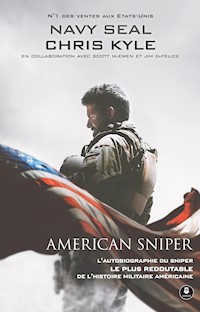
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nimrod
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Le sniper le plus redoutable d'Amérique !
Chris Kyle est le sniper le plus redoutable de toute l'histoire militaire américaine. Surnommé "Al-Shaitan" (le Diable) par ceux qu'il traquait et "la Légende" par ses frères d'armes des Navy SEALs, il est crédité de 255 ennemis tués.
Déployé à quatre reprises en Irak dans le cadre de l'opération Iraqi Freedom, il a été engagé dans les combats urbains les plus terribles du conflit : Fallouja, Ramadi ou encore Sadr City. Progressant au cœur des fournaises insurgées, investissant les maisons en tête des groupes d'assaut, protégeant ses camarades depuis son poste de tir, pris pour cible par les insurgés qui mirent sa tête à prix, Chris Kyle a été de toutes les batailles. Témoin des atrocités de la guerre et de la malveillance d'un ennemi fanatique, il livre un récit brut et dévoile au grand public son quotidien de SEAL et de sniper, mais aussi les conséquences de celui-ci sur sa vie personnelle.
Le récit brut et captivant de la vie de Chris Kyle, une légende de l'histoire militaire américaine.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Chris Kyle raconte son histoire avec le même courage que celui dont il a fait preuve au cours de sa vie et sur les champs de bataille." - Clint Eastwood
"Un formidable hommage à une vie qui n'a pas été inutile." - leaTouchBook - Babelio
"Je ne peux que vous conseiller ce livre si vous vous intéressez de près ou de loin à la guerre d'Irak, ou aux guerres en général." - Jackiedream, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Décoré de deux Silver Stars et de cinq bronze Stars, plusieurs fois cité au combat, Chris Kyle (1974-2013) a servi au sein des Navy SEALs de 1999 à 2009. Il a quitté l'armée avec le grade de maître après avoir servi comme chef instructeur Naval Special Warfare Sniper et Counter-Sniper. Il a rédigé la doctrine du Naval Special Warfare Sniper, le premier manuel de formation des snipers du Navy SEAL.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À propos de l’auteur
Le maître Chris Kyle (1974-2013), du SEAL Team 3, a été déployé à quatre reprises en Irak dans le cadre de l’opération Iraqi Freedom. Pour son courage au cours des combats, il a été décoré de deux Silver Stars, de cinq Bronze Stars avec le V pour Valor (bravoure), de deux Achievement Medals par le corps des Marines et la Navy ainsi que de deux citations décernées par le corps des Marines et la Navy. Il a également été récompensé par le Jewish Institute for National Security Affairs pour son rôle dans la guerre contre la terreur.
À la suite de ses affectations sur des théâtres d’opérations, Kyle est devenu instructeur pour la cellule Sniper du Naval Special Warfare et les équipes de contre-sniping. Il a rédigé le livre blanc intitulé Naval Special Warfare Sniper, le premier manuel d’emploi des snipers pour le Navy SEAL. Après son départ de l’armée, Kyle et sa famille sont retournés vivre au Texas, sa région natale.
American Sniper, le récit de sa vie et de son service sous les drapeaux, rédigé en collaboration avec Jim DeFelice, a été publié en janvier 2012 et est devenu un best-seller international. Le succès de ce livre a conduit Kyle à s’exprimer à la télévision et à donner des conférences. Il lui a également permis de développer des activités au profit des vétérans. Chris Kyle s’est engagé de manière active dans plusieurs groupes ou fondations dont Heroes Project, qu’il a initié avec l’aide de FITCO Fitness afin de fournir du matériel de remise en forme aux vétérans récupérant de leurs blessures ou devant affronter le stress consécutif à leur déploiement sur un théâtre d’opérations.
Le second livre de Kyle, American Gun : A History of the US in Ten Firearms, a été publié en 2013 aux États-Unis et s’est rapidement classé dans les meilleures ventes du New York Times. Alors que l’écriture du livre était en voie de finalisation, Chris Kyle a été tragiquement abattu en février 2013, deux mois seulement avant son trente-neuvième anniversaire, alors que lui-même et un ami aidaient un vétéran souffrant de stress post-traumatique.
Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie funèbre organisée dans le Cowboys Stadium d’Arlington, au Texas, et des milliers d’autres se sont alignées sur des kilomètres et des kilomètres le long d’une autoroute pour saluer le passage du cortège se rendant au cimetière d’Austin.
Après sa mort, sa veuve, Taya, a poursuivi les efforts qu’il avait initiés en faveur des vétérans, de leurs épouses et de leurs familles. Vous trouverez des informations complémentaires sur les projets qui continuent d’être menés en son nom à l’adresse suivante : www.chriskylefrog.com
Bien plus qu’un simple travailAdapter l’histoire de Chris pour le grand écran
Par Taya Kyle
Depuis le début, les gens me demandent si je suis enthousiaste à l’idée qu’American Sniper soit adapté au cinéma.
En vérité, non, cela ne m’enthousiasme pas. Cela me fait peur.
Je veux que Chris soit présenté comme l’homme qu’il était, avec les différentes facettes de sa personnalité. C’était quelqu’un de doux et de bon, bien plus que la plupart des hommes, et pourtant, il n’hésitait jamais lorsqu’il lui fallait affronter l’ennemi et sauver ses camarades. Il était capable d’accomplir ce que peu de personnes pourraient faire. Il savait faire preuve de courage, avancer en première ligne et tuer l’ennemi. Il avait pour devoir de sauver des vies, de très nombreuses vies. Il devait ensuite revenir dans son foyer et nous y retrouver, redevenir un mari et un père dont la bonté devait refaire surface dans son cœur.
Je veux que tout cela transparaisse à l’écran. Je veux que les spectateurs comprennent qui il était vraiment, comment il aidait les autres, vétérans de retour des zones de combat ou voisins du bout de la rue. Il ne sera plus là pour rétablir la vérité si le film devait trahir ce qu’il était. Alors, je suis persuadée qu’il est de notre responsabilité de faire en sorte que les spectateurs qui ne le connaissaient pas, ou qui n’ont aucune idée de ce qu’est la guerre, puissent comprendre ce qu’il était réellement sans qu’il soit nécessaire d’avoir à clarifier les choses.
Comment adapter toute la vie d’un homme et la résumer en quelques heures ? Est-ce simplement possible ?
Alors, oui, tout au long de l’élaboration du film, j’ai eu peur. Et cette peur s’est muée en terreur quand Chris est mort.
Nous étions tous deux honorés à l’idée que quelqu’un d’aussi talentueux que Bradley Cooper souhaite produire ce film. Et ce n’était pas seulement dû à son statut de star. Chris était impressionné par tous ces petits détails qui caractérisent Bradley. Son sens de l’humour et son humilité, par exemple – cela pourrait sembler étrange d’utiliser ce terme pour une star du cinéma, mais vous verriez qu’il n’a rien d’usurpé si vous aviez l’occasion de passer un peu de temps avec lui.
Je me rappelle une des premières conversations téléphoniques entre Chris et Bradley, peu après que le projet d’adaptation eut été annoncé. Chris avait un a priori plutôt favorable à l’égard de Bradley, en raison notamment de l’attention que celui-ci portait aux vétérans, mais ce fut son sens de l’humour qui finit par emporter son adhésion.
« Il faudrait que je t’attache avec une corde et que je te traîne derrière mon 4x4 pour te donner un air un peu moins joli », lui annonça Chris au cours de cette conversation. Cela fit rire Bradley et scella leur relation.
Mais les films ne se produisent pas en une nuit. Il faut d’abord réunir de nombreux collaborateurs – un réalisateur, par exemple.
Chris et moi n’étions nullement impliqués dans le choix du réalisateur, mais cela ne nous empêchait pas d’aborder le sujet. Un jour, nous étions dans la cuisine, et je demandai à Chris qui il aimerait voir réaliser le film.
« Ce ne serait pas formidable si c’était Clint Eastwood ?, suggérai-je.
– Ouais, ce serait super. »
Nous pensions tous deux que ce serait même phénoménal – et, compte tenu de son emploi du temps surchargé, impossible.
Après la mort de Chris, Steven Spielberg fut annoncé comme étant le réalisateur du film et cette idée me ravit. Spielberg travailla d’arrache-pied et s’entretint pendant des heures avec le scénariste Jason Hall afin de percer l’âme de Chris et de comprendre qui il avait été réellement. Il finit par s’imprégner de la personnalité de Chris et je ne pus être que très déçue lorsque, comme cela arrive souvent à Hollywood, les pièces du puzzle ne s’emboîtèrent pas et qu’il abandonna le projet.
C’est alors que Clint Eastwood rejoignit l’équipe de production.
« C’est encore un de tes tours de magie, Chris », songeai-je. « Nous en avions parlé ensemble et voilà que ça se réalise. »
La mort de Chris impliquait une réécriture du scénario, ce qui signifiait une nouvelle charge de travail pour le scénariste Jason Hall – et pour moi, puisque j’essayais de donner un maximum de détails à Jason sur notre vie de couple après la guerre. Le livre aborde déjà cet aspect de notre vie, mais le film avait besoin d’autres éléments. Les émotions et les situations devaient être présentées de manière plus approfondie afin qu’elles puissent avoir un impact à l’écran.
Dès le départ, ce fut autre chose qu’un simple travail. Nous pouvions rester au téléphone jusqu’à une ou deux heures du matin, nuit après nuit. Je ne sais plus combien de centaines d’heures nous passâmes ainsi. La charge émotionnelle était très forte. Jason accomplissait tout cela parce qu’il voulait appréhender la vérité, mais aussi parce que je faisais mon deuil.
Au cours d’une même conversation, il pouvait passer de l’état de scénariste à celui d’ami, puis de philosophe. Je ne m’entretenais pas avec un thérapeute, mais avec quelqu’un de bien plus précieux, avec un ami qui se trouvait être scénariste.
Je me rappelle lui avoir raconté que je m’étais assise un jour dans une église et que j’avais senti les larmes me monter aux yeux. Il avait fallu que je puise dans toutes mes forces pour retenir ce torrent de larmes qui menaçait de jaillir : si je les laissais venir, je ne ferais pas que pleurer, je me mettrais aussi à vomir. Je savais d’expérience que la situation deviendrait incontrôlable.
« Quelle est la pire chose qui aurait pu t’arriver si tu n’avais pas gardé le contrôle, me demanda-t-il lorsque je lui racontai cette histoire.
– Ç’aurait été le chaos absolu. J’aurais fait une scène. Je ne veux pas que les gens me voient dans cet état.
– C’est pourtant la réalité, l’émotion à l’état brut. Personne ne va te juger pour une telle chose, me dit-il. En revanche il ne faudrait pas que tu deviennes une vieille femme aigrie. Nous les avons tous vues, ces femmes-là, des femmes qui affichent un visage impassible, un regard glacé. Il faut que tu apprennes à libérer tes émotions. »
Je repense souvent à ce conseil. Je ne voudrais pas devenir une de ces femmes-là.
Alors que la date du tournage approchait, Clint et Bradley me demandèrent s’ils pouvaient venir me voir et rencontrer les enfants afin d’avoir une meilleure idée de ce qu’avait pu être la vie de famille avec Chris. Les assistants chargés d’organiser le déplacement me téléphonèrent pour me poser quelques questions sur les hôtels proches de chez nous. Je ne sus pas très bien quoi leur répondre.
« Il y a de très bons hôtels à Dallas ou à Fort Worth, expliquai-je. Ce n’est pas si loin.
– Non, non, répondirent-ils. Ils veulent être proches de vous et ils se fichent pas mal d’avoir un bel hôtel.
– Le plus proche est un Holiday Inn.
– Ce sera parfait. Ils n’ont pas besoin d’autre chose. »
Ils arrivèrent en avion et j’allai les accueillir dans un petit aéroport privé pour les conduire à la maison. Ils se montrèrent réellement discrets et attentionnés, sans jamais rien demander, se contentant d’absorber tout ce qu’ils pouvaient appréhender de Chris. Je leur montrai toutes les affaires de Chris, jusqu’à sa casquette de base-ball, et leur expliquai que nous étions des gens simples, sans prétention. Nous parlâmes ensemble et nous parlâmes encore. Lorsque nous eûmes besoin de faire une pause, Bradley partit dans le jardin disputer une partie de football acharnée avec mon fils, ma fille et mon amie Karen, qui était venue ce week-end-là afin de m’aider avec les enfants. Un peu plus tard, mon ami Matt nous rejoignit pour nous cuisiner de l’antilope, une bête que Chris avait abattue avant de trouver la mort. La viande d’antilope est une viande maigre et saine, et Matt n’est pas seulement un grand cuisinier, mais il a aussi un talent particulier pour préparer et assaisonner le gibier au point d’en faire un plat de gourmet.
Après le dîner, Bradley eut envie de crème glacée pour le dessert.
« Y a-t-il un endroit où je pourrais en trouver ?, demanda-t-il.
– Il y a un Dairy Queen, répondis-je tout en me disant que ce n’était sans doute pas assez chic pour lui.
– Quoi, il y a un Dairy Queen ici ! »
Bradley ressemblait soudain à un enfant découvrant que le père Noël existait également au Texas. C’était touchant.
Il emmena mon fils Colton avec lui tandis que nous continuions à discuter avec Clint. Ils n’étaient pas partis depuis très longtemps que je commençai à recevoir des SMS d’amis faisant état de photos et de rumeurs sur Facebook : Bradley Cooper ! Dans notre petite ville !
Bradley Cooper !
Nous discutâmes encore pendant des heures cette nuit-là ; il était assez tard quand je les reconduisis à leur hôtel. Ce n’est qu’à ce moment-là, alors qu’ils entraient dans l’hôtel, que l’énormité de la chose me frappa.
C’étaient Bradley Cooper et Clint Eastwood !
J’aurais donné n’importe quoi pour être une petite souris à la réception lorsqu’ils s’annoncèrent. Ils utilisaient de faux noms et il est possible que la jeune femme à l’accueil ne les ait pas reconnus car, comme Bradley me l’indiqua plus tard, elle ne laissa rien paraître à ce moment-là.
Néanmoins, lorsqu’ils quittèrent l’hôtel, elle leur présenta un DVD à dédicacer.
Le lendemain matin, j’allai les chercher à l’hôtel. Bradley fut le premier à se présenter. Quand il s’installa dans la voiture, toutes mes craintes au sujet du film se firent jour. J’éclatai en sanglots de manière incontrôlable.
« Je ne sais pas comment tout te raconter sur Chris, pleurnichai-je. Nous avons si peu de temps. Je n’y arriverai pas. »
J’avais le sentiment d’être incapable de faire tout ce que je devais faire pour Chris. Mais Bradley me réconforta.
« Non, non, non, tout va bien, m’assura-t-il. Le simple fait d’être là nous suffit. »
Il m’en dit un peu plus au sujet de son rôle. « Je ne suis pas un imposteur, me rappela-t-il. Je m’adapte au rôle. Tout ce que j’ai besoin de ressentir, c’est la présence de Chris, et c’est précisément ce qui se passe. »
Ce fut un immense soulagement pour moi. J’avais eu de bons a priori à leur sujet avant cette crise nerveuse ; je savais qu’ils faisaient le maximum pour toucher la réalité du doigt. Désormais, je comprenais qu’ils faisaient encore plus que cela. Ils voulaient s’imprégner de cette réalité.
Nous retournâmes à la maison, continuâmes à parler, puis nous allâmes bruncher. Il était déjà relativement tard. Karen avait préparé quelques plats délicieux, mais tout le monde attendait sans bouger, personne n’osant se servir en premier.
Clint devait être affamé, mais il était trop poli pour passer devant les autres. Bien sûr, tout le monde attendait qu’il se serve pour faire de même. Nous étions dans une impasse. Je l’encourageai à se servir.
« Non, non, répondit-il avec sa politesse habituelle. Je vais attendre que tout le monde se serve.
– S’il vous plaît, allez-y, insistai-je. Vous êtes notre invité. »
D’une voix traînante, sur un ton très doux, il finit par dire : « Eh bien, j’imagine que soit je me sers, soit je commence à attaquer ma main gauche. » Ce fut l’une des nombreuses fois où il m’arracha un éclat de rire.
Clint était ainsi – plein d’autodérision, drôle, toujours posé et très décontracté. Il me rappelait mon grand-père, plein d’esprit et fin observateur. Il avait une manière de regarder les choses simples avec un air de ravissement qui était contagieux. Vous pouviez vous rendre compte qu’il avait vécu une bonne et longue vie, qui l’avait rendu sage.
Plus tard ce même jour, Bradley et Clint firent la connaissance des parents de Chris, de son frère et de sa belle-sœur. Il était important pour Bradley d’obtenir leur soutien et il fut très heureux lorsqu’il l’obtint. Cette rencontre s’avéra si chaleureuse que l’on avait l’impression que Chris se trouvait avec eux dans la pièce.
Soudain, ce fut l’heure de les raccompagner à l’aéroport. Alors que nous approchions, un véhicule que je dépassais dut dévier brusquement de sa route en klaxonnant frénétiquement.
Je me demandai alors ce qui se passerait si je me garais sur le côté et que Dirty Harry giclait de mon véhicule. Cela ferait un drôle de dénouement pour une affaire d’agressivité au volant. Le simple fait d’imaginer l’expression qu’aurait pu avoir l’autre conducteur me fit rire. J’appris un peu plus tard que Clint n’avait pas une très grande confiance dans mes talents de conductrice… et qu’il avait été soulagé d’arriver vivant à l’aéroport. Une femme au volant est un stéréotype assez courant, mais combiné à une femme en deuil et un conducteur en colère… Tout ça dans une petite ville… J’imagine que cela justifia que Clint me remercie de l’avoir déposé sain et sauf à l’aéroport après cette petite balade.
M’entretenir avec Sienna Miller, l’actrice qui interprète mon personnage dans le film, fut comme parler à une amie. C’est une femme pleine d’empathie et lorsque j’évoquai mon mariage avec Chris – par exemple ce que j’avais ressenti la première fois que nous nous étions embrassés –, elle comprit tout de suite.
Le rôle de mon personnage dans le film n’étant pas très important, il fallait que Sienna parvienne à exprimer un maximum d’émotions en un temps très court. Je suis persuadée qu’elle a fait du très bon travail car elle apporte beaucoup au rôle. Au moment du casting, on m’avait demandé mon avis sur la personne qui interpréterait mon personnage. J’avais répondu que je ne voulais pas d’une actrice qui n’ait jamais eu d’enfants ni connu de peine de cœur. Je sais que les acteurs sont payés pour interpréter un rôle, mais il y a une énorme différence entre la compréhension de quelque chose que vous avez simplement lu et celle que vous éprouvez face à quelque chose que vous avez personnellement vécu. Clint et les producteurs ont pris la bonne décision en choisissant Sienna. Son existence a été remplie d’émotions, bonnes ou mauvaises. Elle sait ce qu’il en est.
En plus de cela, c’est quelqu’un d’adorable. Nous discutions à l’époque sur Skype et quand les enfants rentraient de l’école, elle leur parlait comme l’aurait fait n’importe quelle mère.
Mais il n’y a pas que les stars du cinéma qui se donnèrent à fond dans ce projet. Tout le monde y mit son âme. Même les accessoiristes en firent un défi personnel.
Un jour, je reçus l’appel d’une personne qui se mit à me poser des questions très précises sur les affaires que Chris et moi possédions – nos voitures, nos meubles… « Ma tâche ne consiste pas forcément à retrouver toutes les choses à l’identique, expliqua l’accessoiriste – dont j’ai malheureusement oublié le nom –, mais je veux que les choses soient le plus fidèles possible. Je veux que vous puissiez regarder dans le passé et voir ce film comme faisant partie intégrante de votre vie. »
Et ils ont fait les choses de la manière la plus fidèle possible, jusqu’à la vieille Yukon verte que Chris avait l’habitude de conduire. Ces petits détails contribuent à l’authenticité du film.
Plus des épisodes de ce genre se succédaient, plus je devenais confiante. Les responsables de la production n’étaient pas seulement des gens talentueux, ils mettaient aussi tout leur cœur dans le projet.
Les gens me demandent souvent si le livre American Sniper a eu un effet thérapeutique sur nous. Cela n’a pas été le cas. L’écriture nous a fait revivre des moments de grande souffrance et de grandes interrogations. Mais après sa parution et l’emballement initial, nous avons laissé cela derrière nous.
Dans nos courtes vies, Chris et moi avons traversé énormément de choses ensemble – le bon, le mauvais, la guerre, les naissances, le mariage, les réussites, les désastres, les amis décédés, de nouveaux amis. Nous avons joué toutes les gammes de la vie, mais nous sommes toujours restés amoureux l’un de l’autre. Le dernier mois de notre vie commune fut le meilleur mois de tout notre mariage. L’année qui avait précédé avait été la meilleure.
Personne ne connaîtra jamais notre histoire dans sa totalité, mais l’essentiel sera connu, grâce au livre et à ce film – et grâce à Jason, Bradley, Clint, Sienna, tous ceux et toutes celles qui ont participé à la production. Je sais qu’ils se sont tous plongés corps et âme dans ce projet et qu’ils ont fait de leur mieux. Nous n’aurions pas pu choisir des gens plus efficaces, et personne n’aurait pu mieux faire.
Il me semble qu’aujourd’hui je n’ai plus peur. En fait, je suis même impatiente de voir le résultat.
Du plus profond du deuil, une légendeComment une tragédie a transformé le scénario d’American Sniper
Par Jason Hall1
Le vendredi 1er février 2013, j’avais achevé la première mouture du scénario et je l’avais transmise aux producteurs. J’avais le sentiment qu’il s’agissait d’une bonne première ébauche. Le lendemain soir, je m’apprêtais à sortir pour aller chercher quelque chose à manger lorsque je reçus un coup de fil de Dauber, l’un des vieux amis de Chris au sein de son team SEAL. Dauber m’avait aidé à comprendre certains détails techniques pour l’écriture du scénario et nous étions devenus proches. Il m’annonça que Chris avait été tué.
D’abord, je n’en crus pas un mot.
Nous avions encore échangé des SMS quelques jours plus tôt. Je n’étais pas un de ses proches, mais j’avais eu l’impression d’apprendre à vraiment bien le connaître et je venais de passer plusieurs mois à me projeter dans sa tête pour écrire le scénario.
Je m’effondrai. J’appelai Bradley Cooper et les producteurs. Nous nous retrouvâmes tous tétanisés et en pleurs. Nous ne savions plus quoi faire.
Deux semaines plus tard, je partis assister aux funérailles de Chris et m’arrêtai à son domicile. C’était étrange de m’y retrouver sans lui. J’étais le seul à ne pas être un SEAL et à assister à une cérémonie informelle organisée en son honneur, laquelle s’acheva sur un lâcher de ballons dans la rue. Personne ne m’adressa la parole – ils estimaient, en toute logique, que je n’étais pas à ma place. Après tout, je n’étais qu’un scénariste de Hollywood m’incrustant là où je n’avais aucune raison d’être. Mais je me retrouvai plus tard dans la nuit à faire de la lutte avec l’un d’eux, démontrant ainsi, j’imagine, l’étendue de ma motivation. Ils respectèrent mon attitude et cela m’aida à me rapprocher des amis de Chris et à gagner leur confiance. Des personnes qui n’avaient pas souhaité m’adresser la parole plus tôt me donnèrent leur numéro de téléphone et se révélèrent au final d’une grande aide.
Le cortège funèbre entre Dallas et San Antonio fut quelque chose de… magique, une expérience très troublante. Je n’avais jamais rien vu de tel. C’était à la fois tragique et merveilleux. Une multitude de gens était alignée en bordure de l’autoroute, sous la pluie, pour rendre un dernier hommage à Chris. Vous pouviez comprendre que quelqu’un de très spécial venait de disparaître.
Quelques jours après les obsèques, je contactai Taya Kyle et lui demandai si nous pouvions parler. Elle se montra très courtoise et nous finîmes par passer énormément de temps au téléphone au cours des mois qui suivirent. Taya est quelqu’un de courageux, d’ouvert, et évoquer la mémoire de Chris à cette époque fut sans doute très difficile pour elle. Au fil de nos conversations, je découvris une facette de Chris que je n’avais pas encore perçue et je vis de quelle manière il allait me falloir réécrire le scénario.
Je compris à travers elle des choses que je n’avais pas comprises en discutant avec Chris. Les gens ne se rendent pas forcément compte de la manière dont les autres les voient, et Taya avait bien sûr un point de vue particulier en même temps qu’un amour débordant pour son mari. Elle m’aida à remplir de nombreuses cases restées blanches.
Mon scénario originel s’achevait sur le dernier retour de Chris d’Irak. Mais à présent, j’avais un nouvel angle de vue sur le combat – et celui de sa famille – qu’il lui avait fallu mener pour se réadapter à la vie. Le film ne s’intéressait plus seulement à la guerre qu’il avait menée en Irak et au prix qu’elle lui avait fait payer, à lui et à sa famille ; il avait évolué vers le récit de ce que Chris avait dû accomplir pour revenir mentalement chez lui. Le film était devenu plus complet ; son parcours, l’histoire de l’Irak, sa légende et son retour au pays – comment il avait combattu ses propres démons, comment il avait commencé à aider d’autres vétérans et initié des projets caritatifs. Il lui avait fallu traverser une passe très difficile, mais il avait achevé son parcours sur un succès phénoménal.
Taya me confia qu’elle avait eu une conversation avec Chris un mois avant sa mort au cours de laquelle ils avaient parlé de tout ce qu’ils avaient traversé ensemble. C’est une scène que j’ai restituée dans le film. Ils avaient discuté de tout ce qui leur semblait important et, d’une certaine manière, avaient résumé leurs vies, leurs batailles, leurs espoirs et leurs rêves. Taya avait profité de ce moment pour dire à Chris combien elle l’aimait et combien elle était heureuse de l’avoir à nouveau en tant qu’amant, en tant que père, en tant que mari. Entendre tout cela fit surgir de nombreuses émotions, de même que le retranscrire dans le scénario.
Je ne saurais dire à quel point l’aide de Taya compta pour moi, et pas seulement en tant que scénariste. Il lui avait fallu énormément de courage pour m’accorder une telle confiance. Elle m’avait ouvert la porte de son merveilleux mariage – ils avaient une très belle relation, même si ce n’était pas toujours facile. Cette relation était pétrie d’humanité et de souffrance. Cela me fit apprécier d’autant mieux ma propre épouse et notre mariage.
M’asseoir à mon bureau pour restituer tout cela fut une étape intimidante, aussi j’imagine combien cela put être difficile pour les acteurs. Je pense que les spectateurs seront réellement impressionnés par Bradley. Il montre une personnalité que nous ne lui avons encore jamais vue. Certes, sa transformation physique est impressionnante, mais, plus que cela, il a été capable d’incarner Chris d’une manière que j’aurais crue impossible pour un acteur. Le regarder jouer sur l’écran de contrôle fut exceptionnel. Il ne donnait pas l’impression d’interpréter l’histoire de Chris ; il semblait la vivre de toute son âme.
Je souhaite que la légende de Chris Kyle perdure afin de toucher toujours plus de monde. J’espère également que ce film aidera les gens à prendre la mesure des sacrifices énormes que font ces soldats quand ils partent sur un théâtre d’opérations. Il est souvent difficile d’imaginer le parcours et les difficultés qu’affrontent ces militaires et leurs familles. Il est évidemment question de patriotisme dans tout cela, mais il ne faut jamais oublier les lourds sacrifices que consentent ces SEALs et les autres militaires. Si ce film pouvait permettre de lever un coin de voile sur ce monde, alors j’en serais très heureux.
1. Le scénariste et producteur Jason Hall a écrit le scénario d’American Sniper
Note de l’auteur
Les événements rapportés dans ce livre sont authentiques, restitués le plus fidèlement possible. Ce texte a été relu par le ministère de la Défense ainsi que par plusieurs officiers supérieurs de la Navy afin d’en valider les données sensibles et la véracité. Bien qu’ils en aient autorisé la publication, cela ne signifie pas qu’ils aient apprécié tout ce qu’ils ont pu lire. Mais il s’agit de mon histoire, non pas de la leur.
Aucune information classifiée n’a été utilisée dans la rédaction de ce livre. Le Pentagone et la Navy ont demandé à ce que certains changement soient effectués pour des raisons de sécurité. Ces demandes ont été honorées.
La plupart des personnes avec lesquelles j’ai servi sont toujours des SEALs en activité. D’autres travaillent dans d’autres fonctions pour le gouvernement, afin de protéger notre pays. Toutes pourraient être considérées comme des ennemis par les ennemis de notre pays, comme je le suis moi-même. Pour cette raison, je n’ai pas divulgué leur identité réelle dans ce livre. Elles se reconnaîtront, et j’espère qu’elles sauront qu’elles ont toute ma gratitude.
Je souhaite dédier ce livre à mon épouse, Taya, et à mes enfants pour être restés à mes côtés. Merci d’avoir été là quand je rentrais à la maison.
J’aimerais également le dédier à la mémoire de mes frères SEAL, Marc et Ryan, en raison des valeureux services qu’ils ont rendus à notre pays et de l’indéfectible amitié qui nous a liés. Leur mort me tourmentera jusqu’à la fin de mes jours.
Prologue Le diable dans mon réticule
Fin mars 2003, dans la région de Nasiriya, Irak
À travers la lunette de mon fusil de précision, je scrutais la rue de cette petite ville irakienne. À une cinquantaine de mètres de moi, une femme ouvrit la porte d’une maison et sortit dans la rue.
La rue était pour ainsi dire déserte. Les habitants étaient restés cloîtrés chez eux. De temps à autre, un curieux soulevait un coin de rideau pour jeter un coup d’œil dans la rue. Tous attendaient. Ils écoutaient le grondement des véhicules de l’unité de Marines qui approchait. Les soldats américains remontaient la rue en direction du nord afin de libérer le pays de Saddam Hussein.
Ma mission consistait à les protéger. Ma section était arrivée plus tôt dans la journée afin de prendre le contrôle du bâtiment et d’assurer la couverture des hommes – d’empêcher les Marines de tomber dans une embuscade au cours de leur progression.
Cette mission n’avait rien de très compliqué, et j’étais heureux que les Marines soient de mon côté. Connaissant la puissance dévastatrice de leurs armes, je n’aurais pas aimé avoir à les combattre. L’armée irakienne n’avait pas la moindre chance face à eux. De toute manière, elle semblait avoir déjà abandonné ses positions.
La guerre avait commencé environ deux semaines plus tôt. Ma section « Charlie » (rebaptisée plus tard « Cadillac ») du SEAL Team 3 avait vécu le début des hostilités le 20 mars à l’aube. Nous avions atterri sur la péninsule d’Al-Faw pour protéger un terminal pétrolier et empêcher Saddam Hussein d’y mettre le feu comme cela s’était produit au cours de la première guerre du Golfe. Nous avions maintenant pour mission de donner un coup de main aux Marines dans le cadre de leur marche vers le nord, de Nasiriya à Bagdad.
J’étais un SEAL, un commando de la Navy entraîné aux opérations spéciales. SEAL signifie « SEa, Air, Land », ce qui donne une bonne idée des endroits où nous pouvons opérer. Dans le cas présent, nous nous trouvions bien à l’intérieur des terres, bien plus qu’il n’est d’usage pour des SEALs, une situation qui allait devenir de plus en plus fréquente à mesure que la guerre contre la terreur se prolongerait. J’avais passé près de trois ans à m’entraîner, à apprendre à devenir un guerrier ; j’étais prêt pour le combat, du moins aussi prêt qu’on peut l’être.
Le fusil que j’épaulais était un.300 WinMag, un fusil à verrou, une arme de précision que m’avait confiée mon chef de section. Comme cela faisait un moment qu’il surveillait la rue, il avait eu besoin de faire une pause. Le fait qu’il m’ait confié son arme et demandé de prendre la relève était une marque de confiance de sa part. J’étais encore un petit nouveau, un bleu, au sein du team. Je n’avais pas encore fait mes preuves.
Je n’avais pas encore été formé non plus en qualité de sniper SEAL. Je mourais d’envie de le devenir, mais la route était encore longue. En me confiant son fusil, ce matin-là, le chef avait également voulu me mettre à l’épreuve et voir ce que j’avais dans le ventre.
Nous nous trouvions sur le toit d’un vieux bâtiment défraîchi, à la lisière de la ville que les Marines allaient devoir traverser. Dans la rue en contrebas, le vent soulevait la poussière et les vieux papiers. Le patelin empestait comme une bouche d’égout – la puanteur de l’Irak était une chose à laquelle je ne m’habituerais jamais.
« Les Marines approchent », indiqua mon chef lorsque le bâtiment commença à vibrer. « Continue à surveiller. »
J’observai à travers ma lunette. Les seules personnes en mouvement étaient la mère et peut-être un enfant ou deux à proximité.
Je regardai ensuite un groupe de Marines débarquer. Dix jeunes et fiers Marines en treillis sortirent de leur véhicule et se rassemblèrent pour effectuer une patrouille à pied. Tandis qu’ils se préparaient, la mère prit quelque chose dans ses vêtements et tira dessus d’un coup sec.
Elle avait dégoupillé une grenade. Je ne le réalisai pas tout de suite.
– C’est un truc jaune, dis-je au chef en lui décrivant ce que j’avais vu et qu’il observait à son tour. Le truc est jaune, le corps est…
– Une grenade, répondit le chef. C’est une grenade chinoise.
– Merde !
– Tire !
– Mais…
– Tu dois tirer. Cette grenade ne doit pas atteindre les Marines.
J’hésitai. Quelqu’un essayait de prévenir les Marines par radio, mais la liaison était impossible à établir. Ils avançaient maintenant dans la rue, en direction de la femme et de l’enfant.
« Tire ! », ordonna le chef.
Je pressai mon doigt sur la détente. La balle fusa et toucha la femme, qui s’écroula. La grenade roula à terre. Je calai mon fusil et tirai une nouvelle fois tandis que la grenade explosait.
C’était la première fois que je tuais quelqu’un avec un fusil de précision. Et c’était aussi la première fois – et la seule – que je tuais quelqu’un en Irak qui n’était pas un homme armé.
* * *
Il était de mon devoir d’ouvrir le feu et je ne regrette pas mon geste. La femme était déjà morte avant que je tire : elle avait décidé de son propre sort en tirant sur la goupille. J’avais juste fait en sorte qu’elle n’entraîne pas des Marines avec elle dans la mort.
Il était évident qu’elle voulait les tuer, mais aussi qu’elle ne se souciait pas des passants à proximité qui auraient trouvé la mort dans l’explosion de la grenade ou dans la fusillade qui s’en serait ensuivie. Les enfants dans la rue, les gens dans leurs maisons, peut-être même son propre enfant…
Elle était trop aveuglée par la haine pour s’en embarrasser. Elle voulait simplement tuer des Américains, quoi que cela puisse entraîner.
Mes balles sauvèrent plusieurs d’entre eux dont les vies avaient sans aucun doute plus de valeur que l’âme malsaine de cette femme. Je peux me présenter devant Dieu sans avoir mauvaise conscience concernant mon travail. Pourtant, ce jour-là, je ne pus m’empêcher de haïr de toutes mes forces le mal qui habitait cette femme. Je l’abhorre aujourd’hui encore.
* * *
Un mal implacable, diabolique. Voilà ce que nous combattions en Irak. C’était la raison pour laquelle nombre de personnes, dont moi-même, qualifions l’adversaire de « bestial ». Il n’y avait vraiment aucun autre mot pour décrire l’ennemi auquel nous étions opposés.
Les gens me demandent toujours : « Combien de personnes avez-vous tuées ? » Je réponds habituellement : « Le chiffre exact fait-il de moi quelqu’un de différent ? »
Honnêtement, le nombre n’est pas important. J’aurais juste aimé pouvoir en tuer plus. Non pas pour clamer mes exploits, mais parce que je suis persuadé que le monde se porterait mieux s’il y avait moins de ces salopards qui cherchent à tuer des Américains. Chaque personne que j’ai neutralisée en Irak voulait s’en prendre à des Américains ou à des Irakiens loyaux envers le nouveau gouvernement.
En ma qualité de SEAL, j’avais un travail à accomplir. Je tuais l’ennemi – un ennemi que je pouvais voir, jour après jour, comploter pour tuer mes frères américains. Je suis aujourd’hui encore hanté par les succès qu’ils remportaient dans cette entreprise. Ils étaient rares, mais une vie américaine perdue c’était encore une de trop.
Je ne me soucie pas de ce que les gens peuvent penser de moi. C’est une des choses que j’admirais le plus chez mon père dans ma jeunesse. Il se fichait complètement de ce que les autres pensaient. Il se contentait d’être lui-même. C’est une qualité qui m’a permis de rester sain d’esprit, pour autant que je puisse honnêtement affirmer que je suis sain d’esprit.
Alors que ce livre va bientôt être mis sous presse, je reste mal à l’aise à l’idée que l’histoire de ma vie va être publiée. En premier lieu, j’ai toujours considéré que si quelqu’un voulait vraiment savoir à quoi ressemble la vie d’un SEAL, il devait décrocher son propre Trident : mériter son écusson, le symbole de ce que nous sommes. Endurer notre entraînement, accomplir les sacrifices requis, aussi bien physiques que mentaux. C’est le seul vrai moyen de le savoir.
En second lieu, et de manière plus importante, pourquoi s’intéresser à ma vie ? Je ne suis pas différent des autres.
Il se trouve que je me suis souvent retrouvé dans des situations dramatiques. Les gens m’ont affirmé que c’était intéressant, mais je ne vois pas en quoi. D’autres personnes ont envisagé d’écrire un livre sur ma vie, ou sur certaines des missions que j’avais accomplies. Je trouve cela étrange, mais je pense aussi qu’il s’agit de ma vie et de mon histoire et je suppose qu’il vaut mieux que je sois celui qui décrit la manière dont les événements se sont réellement produits.
Enfin, je ne suis pas le seul à mériter d’être mis en avant et, si je n’écris pas mon histoire, il se peut que les autres soient oubliés. Cette idée ne me séduit pas. Mes hommes méritent bien plus d’éloges que je n’en mérite moi-même.
À l’heure où j’écris ce livre, la Navy me crédite de plus d’hommes tués en ma qualité de sniper que n’importe quel autre militaire de l’armée américaine, encore en service ou non. J’imagine que c’est vrai. La Navy n’arrête pas de refaire ses calculs. Un jour, ils en arrivent au chiffre de 160 (le chiffre « officiel » pour ce que cela vaut). La semaine suivante, ce chiffre est revu à la hausse, puis il est revu à la baisse, avant d’être à nouveau réévalué entre les deux extrêmes. Si vous voulez un chiffre, demandez à la Navy – vous pourriez même obtenir la vérité si vous posiez la question le bon jour.
Les gens aiment les chiffres, mais je ne suis pas près de vous en donner un même si la Navy m’y autorisait. Je ne suis pas quelqu’un qui aime les chiffres. Les SEALs sont des guerriers silencieux, et je suis un SEAL jusqu’au plus profond de mon âme. Si vous voulez connaître toute l’histoire, libre à vous d’aller décrocher un Trident. Si vous voulez vraiment savoir ce que je vaux, allez demander à un SEAL.
Si vous pouvez vous contenter de ce que je suis prêt à partager avec vous, y compris certains faits que j’aurais préféré garder sous silence, poursuivez votre lecture.
J’ai toujours affirmé que je n’étais pas le meilleur tireur, ni même le meilleur sniper de l’Histoire. Je ne cherche pas à dénigrer mes talents. J’en ai même bavé pour les acquérir. J’ai eu la chance de bénéficier de formidables instructeurs auxquels devrait aller une grande part de mes mérites. Comme cela devrait être le cas pour mes camarades – mes camarades du SEAL, les Marines ou les fantassins avec lesquels j’ai combattu et qui m’ont aidé à faire mon boulot – ils ont joué un rôle essentiel dans mes victoires. Mais, au bout du compte, ma prétendue « légende » a beaucoup à voir avec la chance, et avec le fait que je me suis retrouvé dans la merde un grand nombre de fois.
J’ai bénéficié de plus d’opportunités que la plupart des gars. J’ai servi de manière quasi ininterrompue depuis les prémices de la seconde Guerre du Golfe jusqu’à mon départ de l’armée en 2009. J’ai été suffisamment chanceux pour servir au cœur de l’action.
Il y a une autre question que l’on me pose souvent : « Cela vous dérange-t-il d’avoir tué autant de gens en Irak ? »
Je leur réponds : « Non. »
Et je le pense vraiment. La première fois que vous tirez sur quelqu’un, vous éprouvez une certaine nervosité. Vous vous demandez : Puis-je vraiment tuer ce gars ? Est-ce vraiment ce qu’il faut faire ? Mais, après avoir tué votre ennemi, vous comprenez que c’était ce qu’il convenait de faire. Vous vous dites : Super.
Vous le refaites. Et le refaites encore. Vous le faites afin que l’ennemi ne vous tue pas ou ne tue pas vos camarades. Vous le faites jusqu’à ce qu’il n’y ait plus personne à tuer.
C’est ce en quoi consiste la guerre.
J’ai adoré tout ce que j’ai fait. Si les circonstances étaient différentes – si ma famille n’avait pas besoin de moi –, j’y retournerais aussitôt. Ce ne serait pas mentir ni exagérer que de prétendre que je me suis amusé. Être un SEAL a été la meilleure chose de ma vie.
Les gens essaient de me cataloguer comme un salaud, un réac, un enfoiré, un sniper, un SEAL et sans doute d’autres termes qu’il serait malvenu d’imprimer. Chacun de ces termes pourrait être justifié à l’occasion. Mais au final, mon histoire, que ce soit en Irak ou par la suite, ne se limite pas à tuer des gens ou à combattre pour mon pays.
C’est avant tout une histoire d’homme. C’est une histoire d’amour autant que de haine.
Chapitre 1 Dompter des chevaux sauvages et autres réjouissances
COW-BOY DANS L’ÂME
Toute histoire a un début.
La mienne commence au Texas, dans le nord de l’État. J’ai grandi dans des petites villes où j’ai été sensibilisé à l’importance de la famille et de valeurs traditionnelles comme le patriotisme, l’autonomie ou encore l’attention accordée à ses proches et à ses voisins. Je suis fier d’affirmer que je cherche toujours à mener ma vie selon ces valeurs. Je possède un sens de la justice assez prononcé. Je vois les choses en noir et en blanc, assez rarement en gris. Je pense également qu’il est important de protéger son prochain. En même temps, j’aime bien m’amuser. La vie est trop courte pour ne pas en profiter.
J’ai été élevé dans la religion chrétienne et je crois en Dieu. Si je devais établir mes priorités, ce serait Dieu, mon pays, ma famille. Le classement des deux derniers peut cependant prêter à discussion – aujourd’hui, j’aurais tendance à penser que la Famille, dans certaines circonstances, peut passer avant le Pays. Mais l’écart est serré.
J’ai toujours aimé les armes, j’ai toujours aimé la chasse, et d’une certaine manière j’imagine que vous pourriez dire que j’ai toujours eu une mentalité de cow-boy. J’ai commencé à monter à cheval en même temps que j’apprenais à marcher. Je ne me qualifierais pas moi-même de vrai cow-boy, parce que cela fait longtemps que je n’ai pas travaillé dans un ranch et que j’ai sans doute perdu une bonne partie de mes talents de cavalier. Pourtant, au plus profond de moi, si je ne suis pas un SEAL, je suis un cow-boy, ou du moins devrais-je l’être. Le problème vient de ce que c’est un moyen difficile de gagner sa vie lorsqu’on a une famille à nourrir.
Je ne me rappelle plus exactement quand j’ai commencé à chasser, mais je devais être très jeune. Ma famille possédait un droit de chasse aux cerfs à quelques kilomètres de la maison et nous allions chasser tous les hivers. (Un droit de chasse est un droit accordé par le propriétaire d’un terrain pour une certaine somme : moyennant finances, vous avez le droit d’aller chasser sur ses terres. Il existe peut-être d’autres sortes d’arrangements là où vous vivez, mais celui-ci est assez courant dans notre région.) En dehors des cerfs, nous chassions également la dinde, la colombe, la caille, selon la saison. « Nous », c’est-à-dire ma mère, mon père et mon frère, qui a quatre ans de moins que moi. Nous passions nos week-ends dans un vieux camping-car. Il n’était pas très spacieux, mais nous formions une petite famille aux liens très étroits et nous nous amusions énormément.
Mon père travaillait pour Southwestern Bell et AT&T – les deux sociétés se scindèrent puis fusionnèrent à nouveau au cours de sa carrière. Il travaillait comme cadre et nous déménagions régulièrement au gré de ses promotions. D’une certaine manière, je grandis un peu partout au Texas.
Bien que mon père connût la réussite dans son travail, il détestait ce qu’il faisait. Non pas le travail en lui-même, mais tout ce qui allait avec. La bureaucratie. Le fait de devoir travailler dans un bureau. Il ne supportait vraiment pas d’avoir à porter un costume et une cravate tous les jours.
« Je me fiche de savoir combien tu gagnes », avait-il coutume de me dire. « Ça ne vaut rien si ça ne te rend pas heureux. » C’est le conseil le plus avisé qu’il me donna jamais : Fais ce que tu veux de ta vie. Aujourd’hui encore, j’essaie de me conformer à cette philosophie.
D’une certaine manière, dans ma jeunesse mon père fut mon meilleur ami, mais il combinait cette attitude avec une bonne dose de discipline paternelle. Il y avait des limites et je ne tentais jamais de les franchir. Il ne me maltraita jamais – j’eus bien sûr droit à quelques roustes lorsque je les méritais, mais jamais de manière excessive ou sous le coup de la colère. Lorsque mon père était fou de rage, il se donnait quelques minutes pour se calmer avant de m’administrer une bonne correction – aussitôt suivie d’un câlin.
À en croire mon frère, lui et moi passions notre temps à nous battre. Je ne sais pas si c’est vrai, mais nous avions notre dose de disputes. Il était plus jeune et plus petit que moi, mais il se défendait avec tout ce qu’il avait et ne cédait jamais. Il est d’un caractère bien trempé et demeure à ce jour l’un de mes amis les plus proches. Nous nous faisions les pires crasses, mais nous nous amusions aussi beaucoup et savions que nous pouvions toujours compter l’un sur l’autre.
Une statue de panthère trônait dans l’entrée principale de notre lycée. La tradition voulait qu’à chaque rentrée scolaire les lycéens les plus âgés forcent les plus jeunes à monter sur cette panthère. Évidemment, ceux-ci résistaient. J’avais achevé ma scolarité quand mon frère débuta la sienne, mais je revins au lycée le jour de la rentrée afin de proposer cent dollars au lycéen qui parviendrait à asseoir mon frère sur la statue.
J’ai toujours ces cent dollars.
* * *
J’avais beau me bagarrer souvent, je n’étais jamais celui qui provoquait les bagarres. Mon père m’avait clairement fait savoir que je me prendrais une beigne si je devais être à l’origine d’une bagarre. Nous étions censés être au-dessus de cela.
Mais se défendre, c’était différent. Protéger mon frère, c’était encore mieux : si quelqu’un lui cherchait des noises, je me chargeais de son cas. J’étais le seul à pouvoir porter la main sur mon frère.
Adolescent, je commençai à prendre la défense des plus jeunes qui se faisaient agresser. Il me semblait que je devais les protéger. Cela devint pour moi un devoir.
Peut-être cela commença-t-il parce que je cherchais des excuses pour me battre sans en porter la responsabilité. Mais je pense qu’il y avait autre chose : les notions de justice et de fair-play de mon père m’influencèrent sans doute plus que je ne pouvais le supposer à cette époque, et plus encore à présent que je suis devenu adulte. Mais, quelles que soient les raisons, elles m’offrirent d’innombrables occasions de me battre.
* * *
Ma famille était profondément croyante. Mon père était diacre et ma mère faisait le catéchisme le dimanche. Je me rappelle une période au cours de laquelle nous allions à l’église chaque dimanche, matin et soir, ainsi que le mercredi soir. Et pourtant, nous ne nous considérions pas comme excessivement religieux, juste comme des personnes qui croyaient en Dieu et s’impliquaient dans la vie de leur église. La vérité m’oblige à dire que je n’appréciais pas particulièrement cette fréquentation assidue.
Mon père travaillait dur. J’imagine qu’il avait ça dans le sang : son père était un fermier originaire du Kansas et ces gens avaient l’habitude de se tuer à la tâche. Un seul travail ne suffisait pas à mon père – il géra une petite épicerie pendant un moment, et nous avions un ranch de taille modeste. Il a aujourd’hui pris se retraite, en tout cas officiellement, mais on peut toujours le voir travailler chez un vétérinaire du coin lorsqu’il ne s’affaire pas dans son petit ranch.
Ma mère également travaillait dur. Quand mon frère et moi fûmes assez âgés pour être autonomes, elle partit travailler comme conseillère dans un centre éducatif fermé. C’était un travail difficile, qui l’obligeait à côtoyer toute la journée des enfants en difficulté, et elle finit par passer à autre chose. Elle est aujourd’hui à la retraite, elle aussi, mais elle continue à s’occuper avec un travail à temps partiel et ses petits-enfants.
Le travail au ranch complétait mes journées d’école. Mon frère et moi avions différentes corvées à accomplir après les cours ou le week-end : nourrir et soigner les chevaux, faire paître le bétail, inspecter les clôtures.
Le bétail posait toujours un problème. Je me suis pris des coups de sabots dans la jambe, dans la poitrine, et même là où le soleil ne brille jamais. Cependant, je n’ai jamais été frappé à la tête. Cela aurait pourtant permis de me remettre les idées en place.
En grandissant, je me mis à élever des bouvillons et des génisses pour la FFA – Future Farmers of America (aujourd’hui la National FFA Organization). J’adorais la FFA et je passais énormément de temps à toiletter et à faire parader mes animaux, même si s’occuper d’eux pouvait se révéler frustrant. Je m’énervais contre eux et pensais que j’étais le roi du monde. Quand je n’arrivais plus à rien avec eux, il arrivait que je les frappe sur la tête pour essayer de les raisonner. C’est ainsi que, par deux fois, j’eus la main fracturée.
Comme je l’ai dit plus tôt, me prendre un coup de sabot en pleine tête m’aurait sans doute remis les idées en place.
J’arrivais à garder mon sang-froid lorsque je devais manipuler des armes, mais je n’en étais pas moins passionné par celles-ci. Comme bon nombre de garçonnets, ma première « arme » fut un fusil à air comprimé. Un peu plus tard, j’eus un pistolet à air comprimé qui était une copie conforme du vieux Colt modèle Peacemaker 1860. Depuis, j’ai gardé un faible pour les armes à feu de cette époque et, après avoir quitté la Navy, j’ai commencé à collectionner de belles répliques. Ma préférée est une réplique d’un Colt de la Navy année 1861 fabriquée sur une machine-outil.
Je reçus mon premier véritable fusil à l’âge de 7 ou 8 ans. C’était un fusil avec un mécanisme à verrou d’un calibre 30-06. Une arme robuste et plutôt destinée aux adultes, ce qui ne manqua pas de m’effrayer au début. Je tombai amoureux de cette arme, mais celle que je convoitais bien plus encore était celle de mon frère, un Marlin 30-30. C’était un fusil doté d’un mécanisme à levier, dans le plus pur style cow-boy.
Oui, il y avait là un thème récurrent.
DRESSER UN CHEVAL SAUVAGE
Vous ne pouvez pas prétendre être un cow-boy avant d’avoir dompté un cheval. Je commençai à apprendre la technique lorsque j’étais lycéen. Au départ, je n’y connaissais absolument rien. L’idée de base était la suivante : Tu sautes sur la bête et tu la montes jusqu’à ce qu’elle arrête de ruer. En faisant de ton mieux pour rester dessus.
J’appris beaucoup en grandissant, mais j’acquis la plupart de mes connaissances sur le terrain – ou sur le cheval, pour être précis. Le cheval se comportait d’une certaine manière, et je faisais de même. Ensemble, nous arrivions à un compromis. La leçon la plus importante à retenir était sans doute celle de la patience. Je n’étais pas très patient par nature. Je dus développer cette qualité en travaillant avec les chevaux ; elle me fut extrêmement utile lorsque je devins sniper ou qu’il me fallut courtiser ma femme.
Contrairement au bétail, je ne trouvais jamais aucun prétexte pour frapper un cheval. Le monter jusqu’à ce qu’il soit épuisé, pas de problème. Rester sur son dos pour qu’il comprenne qui était le boss, bien sûr. Mais frapper un cheval ? Je n’ai jamais trouvé une raison suffisante. Les chevaux sont bien plus malins que le bétail. Vous pouvez apprendre à un cheval à coopérer si vous êtes suffisamment patient et si vous laissez le temps travailler pour vous.
Je ne sais pas si je possédais réellement un talent pour dompter les chevaux ou non, mais le fait de traîner avec eux nourrit mon appétit pour l’univers des cow-boys. Quand j’y repense, il n’y a donc rien de très surprenant dans le fait que je me sois retrouvé à participer à des compétitions de rodéo tout en étant encore scolarisé. Je faisais du sport au lycée – base-ball et football américain – mais cela n’avait rien à voir avec l’excitation que pouvait procurer un rodéo.
Tous les lycées ont leurs clans : les athlètes, les intellos, etc. Le clan auquel j’appartenais était celui des « rois du lasso ». Nous portions des jeans et des bottes et, d’une manière générale, nous adoptions l’attitude des cow-boys et nous nous comportions comme eux. Je n’étais pas un vrai roi du lasso – j’aurais été incapable d’attraper un veau au lasso à cette époque – mais cela ne m’empêcha pas de participer à des rodéos dès l’âge de 16 ans.
Je commençai à monter des taureaux ou des chevaux dans un endroit où il suffisait de payer vingt dollars pour monter aussi longtemps que l’animal vous le permettait. Il fallait apporter son propre équipement : éperons, jambières, harnais. Il n’y a rien d’extraordinaire dans cet exercice : vous chevauchez votre monture, vous tombez, vous grimpez à nouveau dessus. Peu à peu, je parvins à rester plus longtemps en selle, jusqu’à ce que je me sente suffisamment confiant pour participer à des petits rodéos locaux.
Débourrer un taureau, ce n’est pas comme dompter un cheval. Les taureaux ruent vers l’avant, mais leur peau est si flasque que lorsqu’ils penchent, vous ne vous contentez pas de glisser vers l’avant, vous glissez aussi sur le côté. Et un taureau peut vraiment tournoyer. Laissez-moi l’expliquer d’une autre manière : rester à dos de taureau n’est vraiment pas chose facile.
Je chevauchai des taureaux pendant près d’un an, sans grand succès. Devenant plus raisonnable avec l’âge, je retournai au dressage des chevaux et finis par m’essayer au domptage en selle. Il s’agit d’un numéro assez classique au cours duquel vous ne devez pas seulement rester en selle pendant plus de huit secondes, mais faire aussi preuve de style et de finesse. Pour je ne sais quelle raison, je me débrouillais bien mieux dans ce type d’épreuve que dans les autres, aussi je m’y collai pendant un certain temps, amassant plusieurs boucles de ceinturon et quelques jolies selles en guise de trophées. Cela dit, je n’étais pas un champion, mais je me débrouillais suffisamment bien pour dépenser un peu d’argent en tournées de bar.
Cela me valut également d’attirer l’attention des bouclettes, la version rodéo des groupies féminines. Tout était donc pour le mieux. Je m’éclatais à voyager de ville en ville, à faire la fête et à monter.
Le style de vie cow-boy, en quelque sorte.
* * *
Je continuai à monter à la fin de mes années de lycée, en 1992, et entamai mes études supérieures à l’université d’État Tarleton, à Stephenville, au Texas. Pour ceux qui l’ignoreraient, l’université Tarleton a été fondée en 1899, avant de rejoindre l’université A&M du Texas en 1917. Cette université a pour réputation de former d’excellents fermiers ainsi que de très bons enseignants dans le domaine agricole.
À l’époque, je pensais devenir exploitant de ranch. Avant de m’engager dans cette voie, je m’étais cependant interrogé sur la possibilité d’une carrière militaire. Mon grand-père maternel avait été pilote dans l’Army Air Force et, un temps, j’avais caressé l’idée de devenir aviateur. Puis j’avais envisagé d’entrer dans les Marines – je voulais me trouver au cœur de l’action. J’aimais l’idée du combat. J’avais aussi vaguement entendu parler des opérations spéciales et j’avais songé à m’engager dans les Marine Recon, l’unité d’élite du corps des Marines. Mais ma famille, surtout ma mère, tenait à ce que je suive un cursus universitaire. Je finis par me ranger à leur avis : j’irais d’abord à l’université, et je m’engagerais ensuite. De cette manière, je pourrais prendre un peu de bon temps avant de passer aux choses sérieuses.
Je pratiquais toujours le rodéo et je commençais à faire pas mal de progrès. Mais ma carrière s’interrompit brutalement durant ma première année d’université, lorsqu’un cheval sauvage me tomba dessus alors qu’il s’apprêtait à sortir d’une bétaillère pour un rodéo à Rendon, au Texas. Les gars qui m’aidaient ne pouvaient ouvrir la bétaillère en raison de la manière dont le cheval était tombé, aussi ils durent le tirer en arrière en le faisant passer sur mon corps. J’avais toujours un pied coincé dans un étrier, et je reçus tant de coups de sabots pendant qu’on me tirait de là que je perdis connaissance. Je me réveillai à bord d’un hélicoptère des services d’urgence volant vers l’hôpital. Je finis avec des broches dans le poignet, une épaule déboîtée, des côtes cassées, un poumon et un rein écrasés.
Les broches étaient sans aucun doute ce qu’il y avait de pire. Il s’agissait en réalité de grosses vis de près d’un centimètre de diamètre qui dépassaient de quelques centimètres de chaque côté de mon poignet, comme chez le monstre de Frankenstein. Elles me démangeaient terriblement et me donnaient un air étrange, mais elles permettaient à ma main de tenir droite.
Quelques semaines après mon accident, je décidai d’appeler une fille avec laquelle je voulais sortir. Il n’était pas question que mes broches m’empêchent de passer un peu de bon temps. Tandis que nous roulions en voiture, l’une des longues vis ne cessait de cogner contre la commande du clignotant. Cela m’énerva tellement que je finis par la casser juste là où elle sortait de ma peau. J’imagine que cela ne plut guère à mon amie. Notre rendez-vous s’acheva prématurément.
Ma carrière dans le rodéo était derrière moi, mais je n’en continuais pas moins à faire la fête comme si j’étais toujours en tournée. Mes finances finirent par s’épuiser rapidement, aussi je me mis à chercher du travail le soir après les cours. Je dégotai finalement un boulot dans un dépôt de bois en qualité de livreur, pour y décharger des livraisons de bois ou d’autres produits.
J’étais un employé plutôt sérieux et je suppose que cela finit par se savoir. Un jour, un camarade vint me voir :
« Je connais quelqu’un qui possède un ranch et qui cherche un employé », me dit-il. « Je me demande si ça pourrait t’intéresser. »
« Bien sûr », répondis-je. « J’y vais tout de suite. »
Et c’est ainsi que je devins employé dans un ranch – un vrai cow-boy – même si je continuais à suivre les cours à l’université à plein temps.
LA VIE DE COW-BOY
Je commençai à travailler pour un vrai cow-boy du nom de David Landrum, dans le comté de Hood, au Texas, et je me rendis vite compte que j’étais loin d’être le cow-boy que je pensais être. David fit ce qu’il fallait pour me remettre les idées en place. Il m’apprit tout ce qu’il y avait à savoir pour travailler dans un ranch, et bien plus encore. David était quelqu’un de dur, qui vous insultait à la moindre erreur. Mais quand vous faisiez du bon travail, il ne disait rien. Néanmoins, je finis par vraiment l’apprécier.
Travailler dans un ranch avait pour moi le goût du paradis.
C’est une vie difficile, où le travail ne manque pas, mais en même temps la vie est agréable. Vous travaillez dehors tout le temps. La plupart du temps, il n’y a que vous et les animaux. Vous n’avez pas à gérer d’autres personnes ou d’autres services, à supporter les conneries d’un supérieur. Vous vous contentez de faire votre travail.
L’exploitation de David s’étalait sur quelques milliers d’hectares. C’était un véritable ranch, géré à l’ancienne. Nous avions même une vieille cantine ambulante pour nous accompagner lorsqu’il s’agissait de rassembler les troupeaux l’été venu.
J’aimerais insister sur le fait qu’il s’agissait d’un endroit merveilleux, avec de douces collines, quelques ruisseaux, et une terre si vaste que vous éprouviez le sentiment d’être vivant chaque fois que vous la regardiez. Le cœur du ranch consistait en une vieille maison qui avait sans doute servi de gîte d’étape au XIXe siècle. C’était une bâtisse majestueuse, dotée de vérandas à l’avant et à l’arrière, avec des chambres spacieuses et une belle cheminée qui réchauffait aussi bien les âmes que les corps. Bien sûr, comme je n’étais qu’un simple employé, mon logement était un peu plus primitif. Je dormais dans une pièce qui était à peine assez grande pour accueillir un lit superposé. Elle devait faire 1,80 mètre sur 3,60 mètres, et ma couchette occupait presque tout l’espace. Il n’y avait pas assez de place pour un placard ; je devais suspendre mes affaires, y compris mes sous-vêtements, à un poteau.
Les murs n’étaient pas isolés. Le Texas peut être relativement froid l’hiver et même avec la cuisinière à gaz allumée et un radiateur électrique à côté du lit, je dormais tout habillé. Mais le pire venait de ce qu’il n’y avait aucune fondation digne de ce nom sous le plancher. Je devais en permanence lutter contre les ratons laveurs et les tatous qui venaient nicher sous mon lit. Ces ratons laveurs étaient aussi têtus qu’audacieux ; j’ai dû en tuer une vingtaine avant qu’ils finissent par comprendre qu’ils n’étaient pas les bienvenus sous ma chambre.