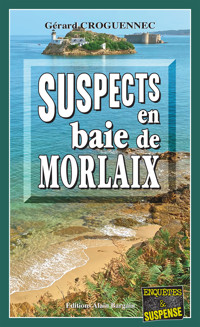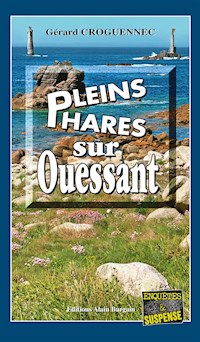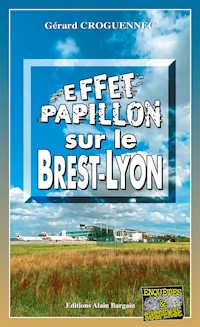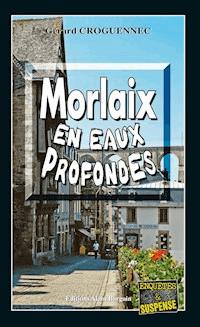Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes du Commandant L’Hostis
- Sprache: Französisch
Quel lien existe-t-il entre des chaussures en daim bleu, des plants de cannabis, l’université et des pages sombres du deuxième conflit mondial ?
Rien en apparence. C’est la découverte d’un cadavre dans les jardins ouvriers du quartier de Saint-Pierre, à Brest, qui va conduire les enquêteurs à rassembler les pièces de cet étrange puzzle, pour élucider l’affaire.
En passant par Brest, Le Conquet et Saint-Nazaire, le commandant L’Hostis, aidé de son fidèle Le Meur, nous entraîne dans un jeu de piste palpitant.
EXTRAIT
Inès marchait à pas pressés dans la rue qui la menait vers la faculté. Ne prêtant guère attention à ce qui l’entourait, car trop absorbée par ses pensées,
elle marchait tête baissée. Georges Banguard, un professeur de l’université de sociologie, qui était également son directeur de thèse, l’attendait pour leur
rendez-vous hebdomadaire. Elle aurait dû être heureuse, avoir toutes les raisons de se réjouir, mais des événements récents en avaient décidé autrement. Ainsi, alors qu’assurée que, dans moins d’une heure elle s’entendrait dire que son travail avançait bien, que l’angle d’attaque de sa thèse était original et lui
assurerait le succès, un épisode de sa vie privée la préoccupait.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né à Morlaix en 1963,
Gérard Croguennec vit avec son épouse et leurs quatre enfants dans le Beaujolais où il travaille comme formateur dans un CFA. Brestois d’origine, la Bretagne l’inspire et lui évoque grandeur, mystère et magie. Passionné de la vie, il signe ici son deuxième roman policier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À mes parents, à leur amour, à leur soutien.
I
Inès marchait à pas pressés dans la rue qui la menait vers la faculté. Ne prêtant guère attention à ce qui l’entourait, car trop absorbée par ses pensées, elle marchait tête baissée. Georges Banguard, un professeur de l’université de sociologie, qui était également son directeur de thèse, l’attendait pour leur rendez-vous hebdomadaire. Elle aurait dû être heureuse, avoir toutes les raisons de se réjouir, mais des événements récents en avaient décidé autrement. Ainsi, alors qu’assurée que, dans moins d’une heure elle s’entendrait dire que son travail avançait bien, que l’angle d’attaque de sa thèse était original et lui assurerait le succès, un épisode de sa vie privée la préoccupait. La sérénité qui l’habitait habituellement, l’abandonnait. Comment Elvio avait-il pu se montrer aussi violent ? Ils se connaissaient depuis l’enfance et jamais elle n’aurait imaginé qu’il fût capable d’un tel débordement. Depuis, elle ne parvenait plus à le voir autrement que sous les traits d’un homme rustre, primaire. Comment continuer à aimer celui dans les bras duquel elle se laissait aller ? À cette heure, il lui semblait qu’il devenait étranger à sa vie, elle ne ressentait plus rien pour lui. La violence sous toutes ses formes l’indignait et elle ne pouvait concevoir de partager le lit de quelqu’un capable de casser la figure d’un autre, fût-ce au prétexte futile d’une pseudo-jalousie.
Comme à chaque fois que son esprit la tourmentait, elle accélérait le pas, martelant le pavé de ses talons hauts. Elle trouvait dans l’expression de son visage déterminé, renvoyée par le reflet des vitrines devant lesquelles elle passait, comme un encouragement à nourrir sa colère. Soudain, alors qu’elle s’apprêtait à traverser la rue, une voiture roulant à vive allure la frôla, lui arrachant le sac qu’elle portait à la main. Elle n’eut que le temps de voir le véhicule disparaître dans la circulation. La respiration coupée, elle alla s’appuyer le long d’une façade d’immeuble et refusa l’aide que lui proposait un passant qui avait assisté à la scène. Sur le trottoir et dans le caniveau, le contenu de son sac jonchait le sol. Pêle-mêle s’étalaient des feuilles dactylographiées, des revues que le vent taquinait en les dispersant. Maladroitement, encore sous le coup de la surprise, elle s’activa à récupérer ses documents. « J’ai eu chaud, se dit-elle, à croire qu’il me fonçait littéralement dessus ! » Pour retrouver ses esprits, elle entra dans un bar tout proche. Il fallait qu’elle se pose avant son rendez-vous, elle en avait le temps, jugea-t-elle.
Le café qu’on venait de lui apporter se répandait dans l’air en volutes épais et vaporeux, chatouillant au passage ses narines d’arômes puissants. Elle porta la tasse à ses lèvres et eut la sensation que ses idées retrouvaient leur chemin. De son sac à main, elle sortit un miroir de poche et s’appliqua à redonner de l’éclat à son visage. Le noir qui la maquillait marquait le trajet de ses larmes. Après s’être essuyée avec un mouchoir en papier, elle prit le temps de se regarder, comme si elle interrogeait ces yeux qui la fixaient. Au-delà des traits harmonieux que la glace lui renvoyait, elle ne reconnut pas son regard. La peau mate, le petit nez retroussé, le léger duvet au-dessus de la lèvre supérieure, les cheveux noirs épais, qui ondulaient jusqu’aux épaules, elle se reconnaissait. Mais le regard…
Se revoyant à la soirée étudiante de la veille, la fameuse soirée du jeudi soir, elle réalisa qu’il n’était pas dans l’habitude d’Elvio de l’accompagner dans ce genre d’endroit. À vrai dire, il s’y sentait mal. Les sujets de conversation le mettaient mal à l’aise, lui qui n’avait que peu fréquenté l’école. Pourtant, il valait tous ses camarades de faculté. Certes, il ne maniait pas les concepts et l’abstraction aussi bien qu’eux, n’ayant pas grandi avec les livres. Mais ses mains, elles, savaient donner vie à la matière car il avait ce pouvoir de transformer le monde et de le modeler à son image. Sa culture était vivante et le reliait directement à l’essence même de la matière et de l’histoire. Pourtant, le charpentier qu’elle avait aimé pour sa douceur, n’existait plus pour elle aujourd’hui. « Quel gâchis ! », pensa-t-elle. Ce fut sur cette idée qu’elle se leva et sortit dans la rue où la grisaille avait fait place à un crachin poisseux qui collait à la peau.
Quand elle entra dans le bâtiment de la faculté, les couloirs lui parurent froids et impersonnels. Sa perception de l’environnement avait changé. Le bruit de ses pas sur le carrelage froid résonnait, lui renvoyant un sentiment de vide. Au détour d’un corridor, elle lut sur la porte : « Georges Banguard. » Elle s’annonça et entra.
— Bonjour Inès, comment allez-vous ?
— Bien, je vous remercie.
— Je ne vous crois pas. Vous voulez éluder ma question, mais je vois que ce n’est pas le cas. Quand je vous pose cette question, ma démarche est sincère et je suis tout disposé à prendre du temps pour vous écouter.
— Je le sais et je vous en remercie, mais je ne tiens pas à m’étendre sur mes problèmes.
— Comme vous voudrez… J’ai lu ce que vous m’avez laissé la semaine dernière, c’est bien, très bien même !
Inès était sur le point de passer sa thèse de sociologie après trois années de recherches sur un thème qui lui tenait à cœur : « Les jardins familiaux, vecteurs de lien social et de solidarité. » L’idée s’était imposée à elle tout naturellement. Depuis son plus jeune âge, elle accompagnait son père “aux Jardins d’abondance” qui s’étendaient sur un peu plus d’un hectare, surplombant la rade de Brest, juste au-dessus de l’enceinte du port militaire. En quelque sorte, elle avait grandi au milieu d’une communauté de jardiniers urbains et c’était là qu’elle avait connu Elvio, fils d’un jardinier portugais tout comme son père.
— Merci. En ce moment, je commence à réfléchir à la manière dont je pourrais présenter mon travail à l’oral pour la soutenance. Je crois que j’ai une idée…
— Ah ? Vous pouvez m’en dire davantage ?
— Non, c’est trop tôt ! D’abord, il faut que je collecte d’autres informations. C’est pour cela que je compte passer une partie de la nuit aux Jardins d’abondance aujourd’hui.
— Quelle drôle d’idée !
— Écoutez, jusqu’à présent, je ne m’y suis intéressée que pour ce qu’il m’apportait comme informations de jour, or il se trouve qu’un jardin, ça vit aussi la nuit…
— Je crains de ne pas vous suivre…
— Récemment, alors que je m’y promenais à la fin du jour, il m’a semblé qu’il s’y passait de drôles de choses.
— En quoi voulez-vous que cela vienne compléter votre travail ? Je vous l’ai dit, il n’y a rien à y ajouter !
— J’ai mon idée !
— Décidément, vous êtes têtue ! Remarquez, c’est ce trait de caractère qui vous a permis de persévérer dans la direction que vous vous étiez fixée… contre mon avis ! Au final, vous aviez raison, mais là, je me permets d’en douter. N’allez pas prendre de risques inutiles !
— C’est gentil de vous inquiéter pour moi, mais je vous assure que je sais où je vais.
Le reste de leur entrevue fut l’occasion d’apporter quelques corrections au travail écrit d’Inès et d’échanger des points de vue sur le thème de sa thèse.
Quand elle sortit de la faculté, le jour déclinait, laissant la nuit vêtir de noir la ville grise. Elle ne prit pas la peine de rentrer chez elle et se rendit directement à Saint-Pierre, le quartier de Brest où se trouvaient les jardins familiaux. Quand le bus la laissa descendre à son arrêt, elle fit l’inventaire de ses poches. Là où elle se rendait, il n’y avait pas d’éclairage public, la petite lampe qu’elle faisait tourner entre ses doigts lui serait donc bien utile en cas de besoin.
Les talus bordant le chemin qui la menait aux jardins, lui renvoyaient des odeurs de rosée. Le calme régnait en ces lieux, tout juste agrémenté du bruit des animaux nocturnes. Elle distinguait maintenant les ombres que dessinaient dans la nuit les abris des jardiniers. Un petit vent animait les feuilles des arbres et des arbrisseaux en un doux friselis. Des années à avoir arpenté les lieux les lui avaient rendus familiers, au point qu’elle pouvait s’y diriger dans la pénombre. Elle se posta à un endroit d’où elle avait une vision confortable sur les parcelles qui l’intéressaient. Blottie dans le cœur d’une haie, elle attendit.
Normalement, à cette heure, et compte tenu de la nuit qui était tombée, on n’y rencontrait plus personne. Les cabanons étaient pour la plupart petits et servaient à ranger le matériel de jardinage. Elle ne se souvint pas avoir entendu dire que quelqu’un y eût dormi. Pourtant, une semaine plus tôt, alors qu’elle était venue ici faire une promenade nocturne, elle avait surpris des bruits inhabituels ainsi que des déplacements suspects. Sur le coup, elle s’était dit qu’il pouvait s’agir de voleurs qui venaient faire leur marché dans les potagers, mais depuis l’appel téléphonique de Samuel, cet après-midi, elle s’attendait à tout autre chose. Ce qu’il lui avait dit lui paraissait tellement incroyable qu’elle avait de la peine à y croire et, pour cette raison, elle tenait à lever le voile du mystère cette nuit.
Dans la position qu’elle occupait, le temps ne se comptait pas en minutes mais plutôt en courbatures et en ankylose. L’inconfort devenait prégnant. « Je ne pourrai pas rester là très longtemps », se dit-elle. Soudain, il lui sembla entendre un bruit sur sa droite, dans la parcelle voisine de celle de ses parents, celle d’Yves Le Tallec. Ce dernier, retraité, n’y venait plus depuis bientôt un an, suite à des problèmes de dos. La terre restait à l’abandon, peuplée d’une kyrielle de mauvaises herbes. Qui pouvait donc se trouver là ? Des squatters ? Elle en doutait… mais qui alors ?
Tous les sens en éveil, elle n’existait plus qu’au travers de ce que ses oreilles et ses yeux lui renvoyaient comme informations. Dans l’obscurité, une silhouette s’affairait près du cabanon. L’inconnu, s’éclairant à l’aide d’une petite lampe, semblait couper ou secouer un végétal. À plusieurs reprises, elle le vit se retourner, comme le ferait celui qui n’a pas l’esprit tranquille. Ce petit manège durait depuis cinq minutes, quand tout à coup, il coupa son faisceau lumineux et se tapit dans l’herbe. Au même instant, Inès perçut du bruit dans un autre jardin. « De plus en plus étrange… », se dit-elle. Elle n’osait plus bouger, aux aguets. Elle retint sa respiration. Le premier inconnu s’extirpait discrètement de sa cachette et s’engageait dans le chemin, juste devant elle. Il marchait à pas de loup, portant un sac en bandoulière, duquel s’échappaient des tiges et des feuilles. Pendant un temps qui lui parut une éternité, plus rien ne bougea, plus aucun son ne filtra dans la nuit. Des odeurs de compost vinrent lui chatouiller les narines, un tas devait se trouver juste derrière elle. Elle scruta les ténèbres en quête de vie et aperçut de la lumière dans une cabane. Un petit rai filtrait en haut de la porte. Pour en savoir davantage, elle se résolut à s’en approcher et elle suivit l’allée qui y conduisait, se repérant aux ombres que traçaient les haies dans la nuit. Le petit portillon en bois, qui ouvrait sur la parcelle de jardin, lui barra la route. Précautionneusement, elle chercha le mécanisme d’ouverture et l’actionna le plus doucement possible pour éviter tout bruit. Centimètre après centimètre, elle le poussa, sans parvenir toutefois à en atténuer le grincement, léger certes, mais qui prit dans son esprit des proportions démesurées. Elle marqua une pause. Son cœur battait à tout rompre, elle était excitée à l’idée de ce qu’elle allait découvrir. Guettant autour d’elle, elle reprit sa progression.
De façon à ne pas tomber ni à alerter sur sa présence, elle fit usage de sa lampe, tout en prenant soin d’apposer une main sur le réflecteur pour en atténuer l’intensité. Elle progressa ainsi entre les plates-bandes, jusqu’à arriver à deux pas de l’abri. Les bruits à l’intérieur étaient nettement perceptibles, maintenant qu’elle s’en était rapprochée. L’occupant marchait sur ce qui lui semblait être un plancher, déplaçant des objets. Frustrée de ne “voir” qu’avec les oreilles, elle s’approcha jusqu’à coller un œil à la serrure de la porte. Mais celle-ci s’ouvrit alors violemment, la projetant à terre. La douleur la terrassa. Elle n’eut pas le temps de retrouver ses esprits qu’on lui assena un coup à la tête…
II
Le lendemain matin, le quartier de Saint-Pierre où se trouvaient les Jardins d’abondance connut un réveil moins bucolique qu’à l’accoutumée. Les oiseaux furent exceptionnellement dispensés d’annoncer le jour et ses joies. Au lieu de cela, les sirènes stridentes et le bleu blafard des gyrophares meublaient sinistrement l’espace. Comme pour couronner le tout, la journée s’annonçait timidement sous un ciel gris, agrémenté d’un crachin poisseux. L’effervescence régnait en ces lieux et les voisins se massaient derrière le périmètre de protection mis en place par la police.
Au milieu des uniformes, des hommes en civil s’affairaient. Parmi eux, le commandant L’Hostis et son adjoint, Patrick Le Meur, se tenaient près du corps qui gisait à leurs pieds. Étendue face contre terre, une jeune femme avait probablement vécu là ses derniers instants. Les flashes des appareils photo crépitaient, non pas pour en faire la star d’un jour, mais plus prosaïquement pour qu’elle figure dans le dossier d’instruction de l’enquête qui allait suivre. Car on ne meurt jamais par hasard, surtout pas dans un lieu comme celui-là. Quand les photographes et le médecin légiste eurent terminé leur part de travail, L’Hostis et Le Meur purent faire connaissance avec celle qui allait les accompagner désormais, le temps pour eux de démasquer celui ou celle qui avait hâté l’heure de sa mort. Ainsi, elle continuerait à vivre encore, tant qu’elle occuperait l’esprit des vivants.
— Quel gâchis ! s’exclama L’Hostis en retournant le corps, cette belle femme n’a pas assez vécu ! Qu’est-ce qui a provoqué la mort, Docteur ?
— À première vue, un coup porté à la tempe gauche par un objet contondant, mais il semblerait qu’il y ait également une fracture de l’os occipital ; la mort a été instantanée. Je vous en dirai plus une fois que j’aurai pratiqué l’autopsie…
La plaie sanguinolente, sur l’arrière de la tête, n’était pas belle à voir. Dans l’amas de cheveux et de sang coagulé, l’os occipital apparaissait, brisé par endroits. Alors qu’il se penchait sur le cadavre, L’Hostis sentit, au-delà de l’odeur de la mort, les restes fugaces, volatils d’un parfum qui exprimait la fraîcheur, les agrumes. Cette signature olfactive s’imprima en lui comme une supplique d’Inès de retrouver son assassin. Une façon qu’elle aurait eue de s’adresser aux vivants, au-delà des mots… ses dernières volontés…
— Vous n’avez rien noté d’anormal en découvrant le corps ? Un détail qui vous aurait interpellé ? dit L’Hostis, en s’adressant au témoin qui avait découvert le corps.
— Non, vous savez, on ne trouve pas un cadavre tous les jours, moi je n’ai vu que lui, et c’est ça que j’ai trouvé anormal…
— Oui, bien sûr !
— Le corps était étendu là, au milieu de l’allée centrale qui dessert les différents jardins, j’étais obligé de tomber dessus pour rejoindre mon lopin.
— Vous y venez tous les jours, à cette heure-ci ?
— Oui, je suis insomniaque, alors je viens au lever du jour, chaque fois que je peux. Je suis retraité, c’est tout ce qu’il me reste.
— Elle était sans chaussures, comme maintenant ? insista L’Hostis.
— Mais enfin, je vous dis que je n’ai rien touché, elle était là comme vous la voyez, sans chaussures !
Les recherches dans les alentours ne donnèrent rien, la jeune femme était entrée déchaussée au royaume des morts… Ce fait étrange mobilisa toute l’énergie de ceux qui cherchaient vainement l’accessoire manquant et de ceux qui retournaient le problème dans tous les sens. Pour le reste, la victime portait une tenue adaptée à la saison automnale, un pantalon et un chemisier à fleurs avec une veste. Son sac dont l’examen minutieux semblait indiquer qu’il n’y manquait rien, gisait à ses côtés. On y retrouva son portefeuille, avec 120 euros à l’intérieur, ainsi que sa carte de crédit. Ses papiers d’identité, quant à eux, leur apprirent son identité. Inès de Almeida, l’étudiante de sociologie, était décédée sur le terrain de jeux qu’elle affectionnait tant, quand, petite, elle accompagnait son père au jardin.
Ce dernier, d’ailleurs, arrivait, accompagné de son épouse. Effondrés l’un et l’autre, on les accompagna jusqu’à L’Hostis et Le Meur. L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, avança, blême, les mâchoires crispées, jusqu’à la dépouille de sa fille, soutenant une mère dévastée par le chagrin. Personne n’osa les interrompre alors que l’un et l’autre, dignement, pleuraient la perte de celle qui fut leur joie, leur fierté aussi. Comme la flamme d’une bougie, fragile, elle s’était éteinte. La vie est cruelle pour ceux qui restent…
Doucement, L’Hostis s’approcha d’eux et, avec tact, les invita à le suivre un peu à l’écart.
— C’est une épreuve terrible pour vous. Excusez ma maladresse, je suis bouleversé, tout comme vous, et les mots qu’on dit dans ces cas-là paraissent vains et futiles, mais sachez que vous pouvez compter sur mon aide et que je ferai tout pour retrouver celui ou celle qui vous a pris la vie de votre fille.
Il détestait ces moments pesants, comme figés dans le sablier du temps, qui l’obligeaient à annoncer ces nouvelles tragiques. Il peinait toujours à trouver les mots justes, censés apaiser la douleur de ceux à qui il s’adressait. Le Meur, quant à lui, jugea que son collègue s’en sortait plutôt bien, estimant qu’il n’aurait certainement pas fait mieux.
Le commissariat leur parut plus propice pour recevoir la déposition des parents d’Inès. Ils y apprirent qu’à 26 ans, elle était l’aînée d’une fratrie de 5 enfants. Sa réussite scolaire les comblait au-delà de leurs espérances. Petite-fille d’immigrés portugais, son parcours universitaire signait une intégration réussie.
— Rendez-vous compte, avec sa thèse en poche, elle aurait pu enseigner à l’université ! Moi qui ne suis que maçon et mon épouse femme de ménage !
L’Hostis ne put s’empêcher de penser que, décidément, les clichés avaient de belles années devant eux. Il chassa cette pensée et reprit le cours de leur entretien :
— Vous lui connaissiez des ennemis ?
— Non, qui voulez-vous qui lui veuille du mal ? s’insurgea la mère qui éclata en sanglots.
— Elle avait un petit ami ? demanda Le Meur.
Eduardo de Almeida répondit, jetant un regard compatissant à sa femme.
— Oui, Elvio Simao da Costa, le fils d’un compatriote, jardinier comme moi. Ils se connaissent depuis qu’ils sont petits. Ils devaient s’installer ensemble.
Il s’arrêta là, retenant ses larmes, fixant le sol du regard, abattu. Les renseignements qu’ils obtinrent des parents de la victime leur permirent d’y voir un peu plus clair sur la personnalité de celle-ci, mais le mobile du meurtre leur échappait toujours. Inès ne vivait plus chez ses parents depuis trois ans, la bourse d’études qu’elle avait obtenue pour préparer sa thèse lui permettait de s’assumer financièrement.
Depuis son plus jeune âge, Inès s’était montrée studieuse à l’école, présentant des aptitudes certaines pour suivre des études longues. En tant qu’aînée, elle avait été rapidement mise à contribution pour s’occuper de ses frères et sœurs plus jeunes, ce qui l’avait fait mûrir rapidement et l’avait rendue autonome. Après l’obtention de son bac, quand elle avait voulu s’installer seule dans un appartement alors qu’elle aurait pu continuer à habiter chez ses parents, ceux-ci l’avaient encouragée dans cette voie, persuadés que cela l’aiderait à réussir. Petite, c’était une enfant gaie et enjouée, qui suivait ses parents aux Jardins d’abondance où elle jouait avec les autres enfants des jardiniers. Tous les ans, elle accompagnait sa famille au Portugal pour les vacances estivales. Très attachée à ses origines, elle n’aurait jamais manqué ce rendez-vous avec oncles, tantes, grands-parents, cousins et cousines. Ils se retrouvaient tous dans une grande maison familiale située au bord de la mer près de Porto.
Depuis qu’elle suivait les cours à la fac de sociologie, elle travaillait dans un fast-food, à deux pas de son logement, dans le quartier de Recouvrance. Ces éléments de la biographie d’Inès servirait à poser les premiers jalons de l’enquête.
III
L’immeuble où elle logeait, s’imbriquait dans un ensemble d’autres édifices, tout aussi vétustes et gris que le sien. La rue débouchait sur ce qui fut la prison de Brest : Pontaniou. Pour un peu, avec beaucoup d’imagination, on pouvait trouver à ce quartier de la ville des airs de San Francisco. Les voies de circulation, tout comme dans la cité californienne, plongeaient littéralement, descentes infernales, vers la rivière de la Penfeld, mais il y manquait les tramways et les couleurs…
— Pas très “chouettos”, le quartier ! fit Le Meur.
— Moi j’aime bien, un peu glauque, mais avec un petit parfum d’aventure… un peu comme un quartier d’escale pour marins en goguette, répondit L’Hostis.
— Ils sont huit occupants si j’en juge par les boîtes aux lettres, son nom figure sur celle-là : Inès de Almeida… Le courrier a été relevé.
— Le ménage ne doit pas être fait souvent, curieux qu’elle ait choisi cet endroit pour s’installer, ça ne cadre pas avec le personnage !
— Attendons d’être là-haut, on sera peut-être surpris… Et puis elle n’avait peut-être pas le choix, elle cherchait quelque chose de pas cher, pas trop loin de la fac…
Les deux hommes gravirent les escaliers, promenant leurs regards sur les murs défraîchis et sur la rampe en bois sur laquelle ils s’appuyaient pour monter, attentifs aux grincements des marches. Elle habitait au quatrième étage, le dernier de l’immeuble. La clef que leur avaient remise ses parents n’eut pas à faire jouer le mécanisme de la serrure, la porte était déjà ouverte, ou n’avait pas été fermée… L’Hostis et Le Meur se tinrent sur leurs gardes.
— Y’a quelqu’un ? cria L’Hostis.
Seul le silence lui répondit. Il pénétra dans les lieux, arme au poing. Après un rapide coup d’œil dans la cuisine, il fit une incursion dans la salle de bains-WC. S’approchant du rideau de douche, il le tira brusquement. Personne ! Le Meur, quant à lui, fouillait l’autre pièce, sous le lit, derrière les rideaux, mais rien. Si la porte était restée ouverte, il s’agissait peut-être tout simplement d’un oubli.
L’appartement, comme le pressentait Le Meur, sentait le propre et surprenait par le caractère hétéroclite de l’ameublement : une table basse orientale, des chaises Louis XV, un bureau en pin blanc… La fenêtre de la cuisine donnait sur les immeubles d’en face, paysage urbain maussade, étalant son camaïeu de gris. La pièce bien rangée témoignait à sa façon du souci d’ordre de la propriétaire. L’Hostis inspecta les placards, en quête de quelque indice, cherchant à s’imprégner du modus vivendi d’Inès. Il se saisit d’une boîte de thé et en sentit le contenu, « jasmin », se dit-il. Passant la main sur les meubles en quête de poussière, il en fut pour ses frais, propreté absolue.
Ils passèrent dans la pièce de vie qui faisait aussi office de chambre. Pour tout mobilier, il y avait là, un lit, un bureau et une chaise, une petite bibliothèque et une commode. L’Hostis se dirigea vers le bureau. Sur la petite surface de bois de sapin, une documentation nourrie s’étalait pêle-mêle dans un joyeux désordre.
— De la sociologie, encore de la sociologie ! dit-il à son collègue.
— Je crois qu’on va en manger dans les jours à venir, de la socio, parce qu’il faudra qu’on aille enquêter du côté de la fac. Les copains, les copines, les profs…
D’un tiroir, L’Hostis retira un gros document dactylographié sur lequel s’étalait, en grosses lettres, le titre : « Les jardins familiaux, vecteurs de lien social et de solidarité : le cas des Jardins d’abondance. »
— Ce doit être le fruit de ses recherches, la thèse qu’elle devait présenter sous peu… fit l’Hostis en le tendant à son collègue.
— Beau boulot, 250 pages, rien que ça ! Je ne m’en sentirais pas capable !
— Tiens ! Ça ce n’est pas banal, regarde ce que je viens de trouver !
L’Hostis tenait à la main une brochure et plusieurs ouvrages traitant de la chasse aux nazis dans le monde. Un prospectus annonçait la tenue d’une conférence à ce sujet, mais elle avait déjà eu lieu le mois dernier.
— Curieux qu’elle s’intéresse à ce sujet ! Tu as vu le nombre de livres et de documents ! fit L’Hostis.
— Elle ne les a pas empruntés à la bibliothèque, regarde, ils portent tous un nom : Samuel Cohen.
— Ce nom me dit quelque chose, il me semble l’avoir lu sur les boîtes aux lettres, dans l’entrée de l’immeuble…
— Tu n’as pas noté quelque chose quand on est entrés dans l’appartement ? demanda Le Meur.
— Tu veux parler de l’odeur de tabac ?
— Ah ! Tu as remarqué, toi aussi ! Or, Inès ne fume pas. Dans son sac, il n’y avait pas de cigarettes, et je n’ai pas vu de cendrier ici.
— Tu as raison. Quelqu’un est donc bien venu chez elle avant nous, et il n’y a pas si longtemps, l’odeur est encore prégnante !
Si la cuisine les avait impressionnés par son ordre, la pièce principale détonnait. Quand on s’y tenait au plein milieu, le désordre vous saisissait. Le lit, défait, était recouvert de vêtements épars, de chaussures… Les tiroirs de la commode béaient, crachant un contenu hétéroclite de sous-vêtements et de parures diverses et variées… Comme si l’endroit avait fait l’objet d’une fouille… Les deux hommes en étaient sûrs désormais, l’appartement avait été visité.
Des photos accrochées sur un panneau de liège mural la montraient en compagnie de ses parents, d’autres, avec un jeune homme : Elvio, son petit copain, probablement. L’Hostis s’en saisit et regarda au dos : Elvio 2012, Porto. Il mit dans sa poche tous les clichés.
— Est-ce qu’on est sur la piste d’un détraqué sexuel ? demanda Le Meur.
— Il faut attendre l’autopsie, mais les chaussures qui manquent à l’appel pourraient le faire penser, de même que les sous-vêtements en vrac… Un fétichiste ? Allez, on prend l’ordinateur, la correspondance et on y va !
— Enquête de voisinage à suivre ?
— Comme tu dis !
Sur la porte du palier qui faisait face au “deux-pièces” d’Inès, on pouvait lire : Samuel Cohen. Ils y sonnèrent, mais personne ne répondit. Ils continuèrent ainsi leur quête de témoignages de palier en palier, mais sans grand succès. Ou les gens étaient absents ou ils ne connaissaient pas leurs voisins et n’avaient rien observé d’inhabituel.
Ils convinrent tous les deux qu’ils mangeraient chacun chez eux et se retrouveraient après au commissariat. Ce n’était pas tous les jours qu’une enquête les mobilisait tout près de leurs domiciles respectifs. Sur les quais du port de commerce, le pied-à-terre de L’Hostis regardait la rade. Du troisième étage, il jouissait d’une vue imprenable sur le bassin du quai Malbert et les bateaux qui y étaient amarrés. De sa fenêtre, il voyait la goélette La Recouvrance de même que le remorqueur de haute mer L’Abeille Bourbon, ainsi, en un seul coup d’œil, il faisait quotidiennement le grand écart entre la vieille marine à voile et les unités modernes d’aujourd’hui.
Il considérait son quartier comme le cœur vivant de la ville. Cœur qui battait au rythme des marées, promenant les coques des bateaux le long des quais et au gré des sorties en mer. La richesse des lieux tenait également à la diversité des activités liées à la mer, sauvetage, plaisance, croisières, pêche, douanes, liaisons avec les îles du Ponant…
Les couleurs des navires, quant à elles, égayaient les quotidiens faits de grisaille. La criée toute proche, exhalant ses parfums de sel, d’iode et de marée, reliait les terriens à la mer par des promesses de repas somptueux. Pour couronner le tout, les quais étaient bordés d’une succession de bars et de restaurants d’où on était sûr de ressortir rassasié de convivialité et de chaleur humaine.
Quand il pénétra chez lui, il constata qu’on avait glissé un mot sous sa porte. L’enveloppe sentait un parfum qui lui était familier. « Natacha », se surprit-il à dire à voix haute. Il s’enivra des fragrances, puis décacheta fébrilement le pli. Cela devait faire deux ou trois mois qu’ils ne s’étaient vus. Profitant du succès de sa dernière exposition de peinture, elle s’était offert un voyage en Polynésie, ne donnant pas de nouvelles depuis. Leur relation obéissait à la règle du jeu du chat et de la souris, teintée de : « Je t’aime, moi non plus ». Cela leur convenait manifestement, puisqu’aucun des deux ne proposait d’en changer les règles. Le contenu du message en était l’illustration : « 48° 36 N/4,773° O - PM 105 - 20h12 - deux bars. »
Son cœur s’emballa, jubilant à l’avance, à l’idée de décrypter le code, mais il voulait prolonger le plaisir en remettant à plus tard le décodage. Il rangea précieusement la lettre dans son portefeuille et s’attabla devant une assiette de fromages et de charcuterie, rempli de joie comme le serait un enfant. Tout en mangeant, il entreprit l’inventaire du contenu de l’ordinateur d’Inès. Les noms des dossiers défilaient sur l’écran, la plupart liés aux travaux rendus nécessaires pour la rédaction de sa thèse. Il s’arrêta un instant sur un article : « Jardins ouvriers, jardins familiaux, en zone périurbaine », dans lequel il était question de l’invention, par l’abbé Lemire en 1896, des premiers jardins ouvriers. S’échappant de la page, il lut : « Journal », et tout naturellement il s’y dirigea. « Bingo ! » pensa-t-il, en mettant à jour ce qui semblait être un journal intime. Les jeunes ont réussi le tour de force de numériser ce confident, il n’en revenait pas. Les dernières dates le renseignèrent sur l’emploi du temps des derniers jours et surtout sur les événements qui l’avaient touchée au point qu’elle avait éprouvé le besoin de les consigner.
La veille de son assassinat, elle était allée à la soirée étudiante de la fac d’histoire, accompagnée de son petit ami Elvio, y apprit-il. Mais ce qui aurait dû être une fête avait tourné au cauchemar pour elle :
« Elvio est fou ! Il a mis un coup de tête à Samuel, qu’est-ce qui lui a pris ? Il ne me semble pas qu’il avait bu. Je ne veux plus le voir ! », lut-il.
Délaissant momentanément l’ordinateur, il se dirigea vers le réfrigérateur. La faim le rappelait à l’ordre, on ne travaille pas, le ventre vide ! Les courses ne se faisant malheureusement pas toutes seules et ayant eu peu de temps à leur consacrer ces derniers jours, il constata, dépité, la frugalité de ses provisions. Il trouva néanmoins un reste de fromage de chèvre qu’il accommoda avec ce qui restait de pain et de vin, une boîte de sardines à la tomate vint compléter le festin. Il posa le tout sur la table, se servit un verre de beaujolais et se dirigea vers la fenêtre. D’un geste sûr, il imprima au vin un mouvement rotatif, de manière à l’oxygéner et à permettre aux arômes de s’exprimer. Lentement, il l’approcha de son nez et huma avec application. Subtilement, des parfums de fruits rouges, avec une dominante de cassis, se révélèrent. Il soupira d’aise alors que dehors le Fromveur appareillait. « Tiens, ce n’est pas son horaire habituel », remarqua-t-il. Portant le nectar à ses lèvres, il fit rouler le vin en bouche dans un bruit d’aspiration. Décidément, ce vin lui plaisait ! La légèreté, la finesse et les parfums du beaujolais le comblaient. Comme par magie, à chaque fois qu’il en buvait, il revoyait les paysages bucoliques de ces vignobles sous la neige, souvenirs d’une enquête qui l’avait mené jusqu’à Theizé, petit village viticole.
Tout à coup, l’attention de L’Hostis fut distraite, on frappait à la porte. Le Meur passait par chez lui pour qu’ils montent ensemble au commissariat.
— Si tu n’y vois pas d’inconvénient, je partagerais bien ton repas ! À la maison, il ne restait presque plus rien, Daphnée doit faire les courses ce soir en rentrant du travail, dit Le Meur.
— Tu ne me facilites pas la vie ! Regarde, tout ce que j’ai est là devant toi, fit remarquer L’Hostis en montrant la table. Mais bon, on va partager, on s’achètera quelque chose dans la journée.
Quand ils eurent terminé leur frugal repas, les deux hommes se penchèrent sur le journal d’Inès et firent connaissance avec ceux qu’elle fréquentait, l’un en tant que voisin, l’autre en tant qu’amant.
— Le Samuel dont elle parle, ce doit être le prêteur de livres, probablement son voisin dans l’immeuble. Les choses commencent à se préciser, on dirait ! dit Le Meur.
— On a du pain sur la planche : Elvio, Samuel Cohen, les étudiants présents à la soirée de la fac, le directeur de thèse, les jardiniers de Saint-Pierre… Si on commençait par le petit ami ?
— J’allais te le proposer, les parents d’Inès nous ont laissé son adresse, mais à cette heure, il doit travailler sur un chantier, parce qu’il est charpentier. Attends, je vais demander au commissariat de faire les recherches nécessaires, je les appelle de suite. En attendant leur réponse, je t’invite à prendre un café au “Ratafia”.
Ils descendirent dans la rue et marchèrent 300 mètres pour arriver à leur bar favori.
Le Meur leva la tête pour lire le nom du quai : quai Malbert.
— Tiens, au fait, c’est qui ce Malbert ?
— Si je te dis Remorques de Roger Vercel, si je te dis Jean Gabin, ça te met sur la voie ?
— Non, pas plus.
— C’était le commandant du premier remorqueur d’assistance et de remorquage “L’Iroise”. Son commandant, Louis Malbert, a totalisé une quarantaine de sauvetages et a sauvé près de 2000 vies humaines. Ça te prend souvent ce genre de questions ?
— Écoute, depuis un mois ou deux, je m’amuse à chercher qui sont les personnages qui ont donné leur nom à une rue, eh bien, on en apprend beaucoup, crois-moi ! Par exemple, Borda c’est un mathématicien physicien…
— Tu me raconteras plus tard !
— En tout cas, chapeau bas, quelle culture ! dit Le Meur.
Les consommations commandées arrivaient, prestement transportées sur un plateau tenu à bout de bras.
— Tu as eu des échos des soirées étudiantes sur Brest ? demanda L’Hostis au patron du bar qui déposait les cafés devant eux.
— Rien, mis à part le fait que ce sont souvent des beuveries sans fin, on se demande quel plaisir ils trouvent à se mettre dans ces états ! répondit le cafetier avant de retourner au comptoir, non sans leur avoir servi les deux cafés.
Les deux hommes tournaient leur cuillère dans leur tasse, comme animés d’un seul mouvement. Leurs regards se perdaient sur la décoration du bar, faite d’instruments de navigation et d’objets qui illustraient la culture maritime : hublot, rame, filet de pêche, fanal…
Le téléphone de Le Meur les tira de leur rêverie, le commissariat le rappelait.
— Tu dis qu’il travaille sur un chantier à Commana, dans les Monts d’Arrée ? Et le lieu-dit ? Keranton Creis, d’accord, je note. Dommage que Natacha soit partie dans les îles, parce qu’autrement, tu aurais pu la voir là-bas ! dit-il, quand il eut raccroché.
— Tu ne crois pas si bien dire ! Figure-toi qu’elle m’a adressé un message aujourd’hui, glissé sous ma porte ! Mais ce n’est pas pour autant qu’elle est rentrée au pays, elle est assez imaginative pour l’avoir fait déposer par quelqu’un d’autre. Je verrai bien tout à l’heure si la maison est occupée…
— Tu as dû être surpris ! Et qu’est-ce qu’elle te dit ?
— Message codé, probablement pour un rancard quelque part…
— Moi j’aimerais trop que Daphnée m’écrive des messages coquins comme ça, fit Le Meur, rêveur…
Pour autant, si la relation originale qu’entretenait L’Hostis et Natacha lui inspirait des fantasmes, en son for intérieur, il préférait ne pas les réaliser, peu préparé par son éducation à une telle liberté de comportement.
Sa vie ne ressemblait en rien à celle de L’hostis. Marié et père de trois enfants, il habitait avec sa petite famille au-dessus du port de guerre, sur la route de la Corniche. Bataillant sans cesse avec leurs horaires respectifs de travail, leur couple pouvait difficilement se permettre ce genre de fantaisies. Il était vrai qu’ils n’avaient pas choisi la facilité, elle infirmière de nuit et lui capitaine de police…
IV
La voiture filait sur le tablier du pont de l’Iroise. L’ouvrage se déployait, tel un papillon, entre les deux rives de l’Élorn, offrant ses ailes de haubans au goulet de la rade de Brest. Les deux hommes se taisaient. Seul le bruit lancinant des pneumatiques, glissant sur la chaussée humide, agitait la bande-son de l’habitacle. Quand ils quittèrent la voie express, pour s’enfoncer dans le centre du département, ils changèrent de monde. Tout ici renvoyait aux âges anciens, aux légendes, à l’âpreté d’un univers fait de granite et d’ajoncs. Le village de Commana s’annonça bientôt par son clocher qui défiait le ciel. Posé dans la campagne verdoyante, à deux pas de la “muraille rocheuse” des Monts d’Arrée, le bourg paisible les attendait.
Ils n’eurent pas à chercher longtemps le lieu-dit où ils se rendaient, la flèche d’une grue les y guida, mieux qu’une carte routière. L’entrepreneur, prévenu de leur arrivée, dépêcha Elvio à leur rencontre. Massif, noueux, musculeux, ce fut l’impression qu’il laissa aux deux policiers qui le voyaient pour la première fois. Le jeune homme se dirigea calmement vers eux et L’Hostis s’étonna de l’absence d’émotion sur son visage. Se pouvait-il qu’il ne soit pas au courant ? s’interrogea-t-il.
— C’est pour quoi ? fit Elvio à l’attention des policiers.
— On peut vous rencontrer dans un endroit plus discret et plus calme ? demanda L’Hostis.
La cabane de chantier semblait convenir puisqu’ils s’y dirigèrent tous les trois. Ils s’installèrent autour d’une table après avoir enlevé de celle-ci les reliefs du repas de midi des ouvriers. L’endroit sentait le tabac froid et le café, mélangé à une odeur de curry, avec pour toute décoration, les bleus de travail pendus au mur et les casques de chantier multicolores posés sur des étagères. Elvio faisait face aux deux hommes, attendant avec impatience le motif de leur visite. On n’aime pas avoir affaire à la police ; comme les médecins, moins on les voit et mieux on se porte, c’était ce qu’il pensait comme la majorité des gens. L’Hostis entama l’entretien :
— Vous avez une idée de ce qui nous amène ?
— Pas du tout, j’attends que vous me le disiez !
— Je suis surpris que vous n’ayez pas été informé du drame qui a eu lieu aujourd’hui…
—…
— Inès de Almeida a été retrouvée assassinée dans les Jardins d’abondance ce matin.
Le visage d’Elvio se décomposa, comme si on lui assenait un coup de massue sur la tête. Le temps s’arrêta, lui laissant le loisir de réaliser pleinement la nouvelle. Puis, livide, il interrogea les policiers du regard.
— Nous sommes désolés de vous l’annoncer aussi brutalement. Vous étiez son compagnon, n’est-ce pas ?
— Oui… fit-il dans un demi-souffle.
— Vous vous êtes quittés en quels termes avant-hier soir, après la soirée étudiante de la fac d’histoire ? demanda Le Meur.
— En mauvais termes ! Mais c’est normal, je me suis comporté comme un imbécile, je n’ai pas su me contrôler.
— Vous voulez parler des coups que vous avez portés à Samuel Cohen ? renchérit Le Meur.
— Ah ! Vous êtes au courant ?
— Rassurez-vous, il n’a pas porté plainte pour l’instant.
— C’était la première fois que je l’accompagnais à ce genre de soirée, commença Elvio, abasourdi, jusqu’à présent j’avais toujours décliné l’invitation. Je ne suis pas du même milieu ou, tout au moins, j’ai le sentiment de ne pas vivre dans le même monde qu’eux, alors j’ai peur de me sentir mal à l’aise.
— Qu’est-ce qui vous a poussé à vous y rendre alors ?
— La peur de perdre Inès. Cela faisait déjà un moment qu’elle côtoyait un certain Samuel, étudiant comme elle, mais en fac d’histoire. Ils habitent le même immeuble, alors vous pensez, je pouvais tout imaginer, d’autant qu’on ne vit pas ensemble.
— Ah ?
— Oui, Inès n’y tenait pas, elle voulait être tranquille pour travailler sur sa thèse.
— De là à taper Samuel…