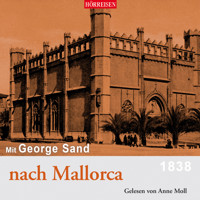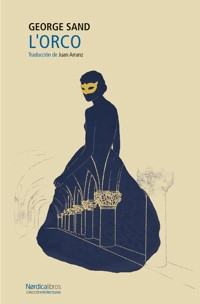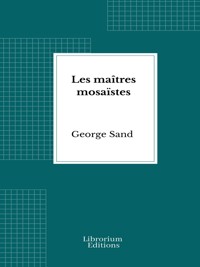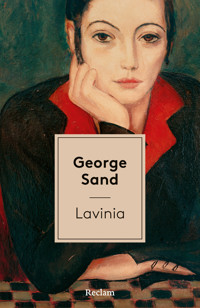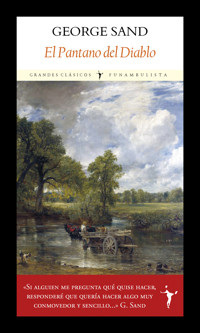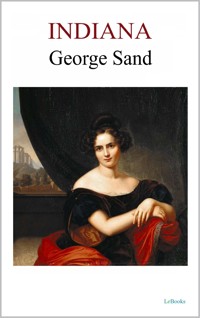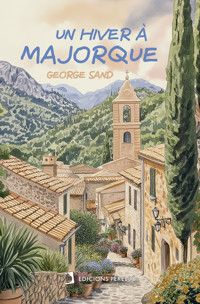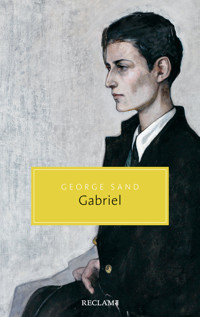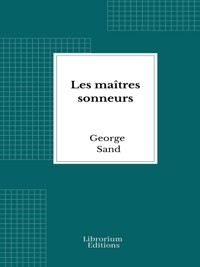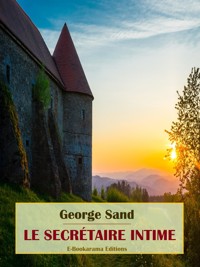Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Le conte se déroule dans un château de Normandie ou de Picardie, où vivent dame Yolande et sa fille Marguerite, qui a la figure d'une petite grenouille. Un été, une sécheresse frappe la région et les douves du château s'assèchent, ce qui tue poissons et grenouilles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contes d'une Grand-mère
Contes d'une Grand-mèreLE CHÊNE PARLANTLE CHIEN ET LA FLEUR SACRÉEPREMIÈRE PARTIE – LE CHIENDEUXIÈME PARTIE – LA FLEUR SACRÉEL’ORGUE DU TITANCE QUE DISENT LES FLEURSLE MARTEAU ROUGELA FÉE POUSSIÈRELE GNOME DES HUITRESLA FÉE AUX GROS YEUXPage de copyrightContes d'une Grand-mère
George Sand
LE CHÊNE PARLANT
À MADEMOISELLE BLANCHE AMIC
Il y avait autrefois en la forêt de Cernas un gros vieux chêne qui pouvait bien avoir cinq cents ans. La foudre l’avait frappé plusieurs fois, et il avait dû se faire une tête nouvelle, un peu écrasée, mais épaisse et verdoyante.
Longtemps ce chêne avait eu une mauvaise réputation. Les plus vieilles gens du village voisin disaient encore que, dans leur jeunesse, ce chêne parlait et menaçait ceux qui voulaient se reposer sous son ombrage. Ils racontaient que deux voyageurs, y cherchant un abri, avaient été foudroyés. L’un d’eux était mort sur le coup ; l’autre s’était éloigné à temps et n’avait été qu’étourdi, parce qu’il avait été averti par une voix qui lui criait :
— Va-t’en vite !
L’histoire était si ancienne qu’on n’y croyait plus guère, et, bien que cet arbre portât encore le nom de chêne parlant, les pâtours s’en approchaient sans trop de crainte. Pourtant le moment vint où il fut plus que jamais réputé sorcier après l’aventure d’Emmi.
Emmi était un pauvre petit gardeur de cochons, orphelin et très-malheureux, non-seulement parce qu’il était mal logé, mal nourri et mal vêtu, mais encore parce qu’il détestait les bêtes que la misère le forçait à soigner. Il en avait peur, et ces animaux, qui sont plus fins qu’ils n’en ont l’air, sentaient bien qu’il n’était pas le maître avec eux. Il s’en allait dès le matin, les conduisant à la glandée, dans la forêt.
Le soir, il les ramenait à la ferme, et c’était pitié de le voir, couvert de méchants haillons, la tête nue, ses cheveux hérissés par le vent, sa pauvre petite figure pâle, maigre, terreuse, l’air triste, effrayé, souffrant, chassant devant lui ce troupeau de bêtes criardes, au regard oblique, à la tête baissée, toujours menaçante. À le voir ainsi courir à leur suite sur les sombres bruyères, dans la vapeur rouge du premier crépuscule, on eût dit d’un follet des landes chassé par une rafale.
Il eût pourtant été aimable et joli, ce pauvre petit porcher, s’il eût été soigné, propre, heureux comme vous autres, mes chers enfants qui me lisez. Lui ne savait pas lire, il ne savait rien, et c’est tout au plus s’il savait parler assez pour demander le nécessaire, et, comme il était craintif, il ne le demandait pas toujours, c’était tant pis pour lui si on l’oubliait.
Un soir, les pourceaux rentrèrent tout seuls à l’étable, et le porcher ne parut pas à l’heure du souper. On n’y fit attention que quand la soupe aux raves fut mangée, et la fermière envoya un de ses gars pour appeler Emmi. Le gars revint dire qu’Emmi n’était ni à l’étable, ni dans le grenier, où il couchait sur la paille. On pensa qu’il était allé voir sa tante, qui demeurait aux environs, et on se coucha sans plus songer à lui.
Le lendemain matin, on alla chez la tante, et on s’étonna d’apprendre qu’Emmi n’avait point passé la nuit chez elle. Il n’avait pas reparu au village depuis la veille.
On s’enquit de lui aux alentours, personne ne l’avait vu.
On le chercha en vain dans la forêt. On pensa que les sangliers et les loups l’avaient mangé. Pourtant on ne retrouva ni sa sarclette-sorte de houlette à manche court dont se servent les porchers, – ni aucune loque de son pauvre vêtement ; on en conclut qu’il avait quitté le pays pour vivre en vagabond, et le fermier dit que ce n’était pas un grand dommage, que l’enfant n’était bon à rien, n’aimant pas ses bêtes et n’ayant pas su s’en faire aimer.
Un nouveau porcher fut loué pour le reste de l’année, mais la disparition d’Emmi effrayait tous les gars du pays ; la dernière fois qu’on l’avait vu, il allait du côté du chêne parlant, et c’était là sans doute qu’il lui était arrivé malheur. Le nouveau porcher eut bien soin de n’y jamais conduire son troupeau et les autres enfants se gardèrent d’aller jouer de ce côté-là.
Vous me demandez ce qu’Emmi était devenu. Patience, je vais vous le dire.
La dernière fois qu’il était allé à la forêt avec ses bêtes, il avait avisé à quelque distance du gros chêne une touffe de favasses en fleurs. La favasse ou féverole, c’est cette jolie papilionacée à grappes roses que vous connaissez, la gesse tubéreuse ; les tubercules sont gros comme une noisette, un peu âpres quoique sucrés. Les enfants pauvres en sont friands ; c’est une nourriture qui ne coûte rien et que les pourceaux, qui en sont friands aussi, songent seuls à leur disputer.
Quand on parle des anciens anachorètes vivant de racines, on peut être certain que le mets le plus recherché de leur austère cuisine était, dans nos pays du centre, le tubercule de cette gesse.
Emmi savait bien que les favasses ne pouvaient pas encore être bonnes à manger, car on n’était qu’au commencement de l’automne, mais il voulait marquer l’endroit pour venir fouiller la terre quand la tige et la fleur seraient desséchées. Il fut suivi par un jeune porc qui se mit à fouiller et qui menaçait de tout détruire, lorsque Emmi, impatienté de voir le ravage inutile de cette bête vorace, lui allongea un coup de sa sarclette sur le groin. Le fer de la sarclette était fraîchement repassé et coupa légèrement le nez du porc, qui jeta un cri d’alarme. Vous savez comme ces animaux se soutiennent entre eux, et comme certains de leurs appels de détresse les mettent tous en fureur contre l’ennemi commun ; d’ailleurs, ils en voulaient depuis longtemps à Emmi, qui ne leur prodiguait jamais ni caresses ni compliments. Ils se rassemblèrent en criant à qui mieux mieux et l’entourèrent pour le dévorer. Le pauvre enfant prit la fuite, ils le poursuivirent ; ces bêtes ont, vous le savez, l’allure effroyablement prompte ; il n’eut que le temps d’atteindre le gros chêne, d’en escalader les aspérités et de se réfugier dans les branches. Le farouche troupeau resta au pied, hurlant, menaçant, essayant de fouir pour abattre l’arbre. Mais le chêne parlant avait de formidables racines qui se moquaient bien d’un troupeau de cochons.
Les assaillants ne renoncèrent pourtant à leur entreprise qu’après le coucher du soleil. Alors, ils se décidèrent à regagner la ferme, et le petit Emmi, certain qu’ils le dévoreraient s’il y allait avec eux, résolut de n’y retourner jamais.
Il savait bien que le chêne passait pour être un arbre enchanté, mais il avait trop à se plaindre des vivants pour craindre beaucoup les esprits. Il n’avait vécu que de misère et de coups ; sa tante était très-dure pour lui : elle l’obligeait à garder les porcs, lui qui en avait toujours eu horreur. Il était né comme cela, elle lui en faisait un crime, et, quand il venait la voir en la suppliant de le reprendre avec elle, elle le recevait, comme on dit, avec une volée de bois vert. Il la craignait donc beaucoup, et tout son désir eût été de garder les moutons dans une autre ferme où les gens eussent été moins avares et moins mauvais pour lui.
Dans le premier moment après le départ des pourceaux, il ne sentit que le plaisir d’être débarrassé de leurs cris farouches et de leurs menaces, et il résolut de passer la nuit où il était. Il avait encore du pain dans son sac de toile bise, car, durant le siège qu’il avait soutenu, il n’avait pas eu envie de manger. Il en mangea la moitié, réservant le reste pour son déjeuner ; après cela, à la grâce de Dieu !
Les enfants dorment partout. Pourtant Emmi ne dormait guère. Il était malingre, souvent fiévreux, et rêvait plutôt qu’il ne se reposait l’esprit durant son sommeil.
Il s’installa du mieux qu’il put entre deux maîtresses branches garnies de mousse, et il eut grande envie de dormir ; mais le vent qui faisait mugir le feuillage et grincer les branches l’effraya, et il se mit à songer aux mauvais esprits, tant et si bien qu’il s’imagina entendre une voix grêle et fâchée qui lui disait à plusieurs reprises :
— Va-t’en, va-t’en d’ici !
D’abord Emmi, tremblant et la gorge serrée, ne songea point à répondre ; mais, comme, en même temps que le vent s’apaisait, la voix du chêne s’adoucissait et semblait lui murmurer à l’oreille d’un ton maternel et caressant : « Va-t’en, Emmi, va-t’en ! » Emmi se sentit le courage de répondre :
— Chêne, mon beau chêne, ne me renvoie pas. Si je descends, les loups qui courent la nuit me mangeront.
— Va, Emmi, va ! reprit la voix encore plus radoucie.
— Mon bon chêne parlant, reprit aussi Emmi d’un ton suppliant, ne m’envoie pas avec les loups. Tu m’as sauvé des porcs, tu as été doux pour moi, sois-le encore. Je suis un pauvre enfant malheureux, et je ne puis ni ne voudrais te faire aucun mal : garde-moi cette nuit ; si tu l’ordonnes, je m’en irai demain matin.
La voix ne répliqua plus, et la lune argenta faiblement les feuilles.
Emmi en conclut qu’il lui était permis de rester, ou bien qu’il avait rêvé les paroles qu’il avait cru entendre.
Il s’endormit et, chose étrange, il ne rêva plus et ne fit plus qu’un somme jusqu’au jour. Il descendit alors et secoua la rosée qui pénétrait son pauvre vêtement.
— Il faut pourtant, se dit-il, que je retourne au village, je dirai à ma tante que mes porcs ont voulu me manger, que j’ai été obligé de coucher sur un arbre, et elle me permettra d’aller chercher une autre condition.
Il mangea le reste de son pain ; mais, au moment de se remettre en route, il voulut remercier le chêne qui l’avait protégé le jour et la nuit.
— Adieu et merci, mon bon chêne, dit-il en baisant l’écorce, je n’aurai plus jamais peur de toi, et je reviendrai te voir pour te remercier encore.
Il traversa la lande, et il se dirigeait vers la chaumière de sa tante, lorsqu’il entendit parler derrière le mur du jardin de la ferme.
— Avec tout ça, disait un des gars, notre porcher n’est pas revenu, on ne l’a pas vu chez sa tante, et il a abandonné son troupeau. C’est un sans-cœur et un paresseux à qui je donnerai une jolie roulée de coups de sabot, pour le punir de me faire mener ses bêtes aux champs aujourd’hui à sa place.
— Qu’est-ce que ça te fait, de mener les porcs ? dit l’autre gars.
— C’est une honte à mon âge, reprit le premier : cela convient à un enfant de dix ans, comme le petit Emmi ; mais, quand on en a douze, on a droit à garder les vaches ou tout au moins les veaux.
Les deux gars furent interrompus par leur père.
— Allons vite, dit-il, à l’ouvrage ! Quant à ce porcher de malheur, si les loups l’ont mangé, c’est tant pis pour lui ; mais, si je le retrouve vivant, je l’assomme. Il aura beau aller pleurer chez sa tante, elle est décidée à le faire coucher avec les cochons pour lui apprendre à faire le fier et le dégoûté.
Emmi, épouvanté de cette menace, se le tint pour dit. Il se cacha dans une meule de blé, où il passa la journée. Vers le soir, une chèvre qui rentrait à l’étable, et qui s’attardait à lécher je ne sais quelle herbe, lui permit de la traire. Quand il eut rempli et avalé deux ou trois fois le contenu de sa sébile de bois, il se renfonça dans les gerbes jusqu’à la nuit. Quand il fit tout à fait sombre et que tout le monde fut couché, il se glissa jusqu’à son grenier et y prit diverses choses qui lui appartenaient, quelques écus gagnés par lui que le fermier lui avait remis la veille et dont sa tante n’avait pas encore eu le temps de le dépouiller, une peau de chèvre et une peau de mouton dont il se servait l’hiver, un couteau neuf, un petit pot de terre, un peu de linge fort déchiré. Il mit le tout dans son sac, descendit dans la cour, escalada la barrière et s’en alla à petits pas pour ne pas faire de bruit ; mais, comme il passait près de l’étable à porcs, ces maudites bêtes le sentirent ou l’entendirent et se prirent à crier avec fureur.
Alors, Emmi, craignant que les fermiers, réveillés dans leur premier sommeil, ne se missent à ses trousses, prit sa course et ne s’arrêta qu’au pied du chêne parlant.
— Me voilà revenu, mon bon ami, lui dit-il. Permets-moi de passer encore une nuit dans tes branches. Dis si tu le veux !
Le chêne ne répondit pas. Le temps était calme, pas une feuille ne bougeait. Emmi pensa que qui ne dit mot consent. Tout chargé qu’il était, il se hissa adroitement jusqu’à la grosse enfourchure où il avait passé la nuit précédente, et il y dormit parfaitement bien.
Le jour venu, il se mit en quête d’un endroit convenable pour cacher son argent et son bagage, car il n’était encore décidé à rien sur les moyens de s’éloigner du pays sans être vu et ramené de force à la ferme. Il grimpa au-dessus de la place où il se trouvait. Il découvrit alors dans le tronc principal du gros arbre un trou noir fait par la foudre depuis bien longtemps, car le bois avait formé tout autour un gros bourrelet d’écorce. Au fond de cette cachette, il y avait de la cendre et de menus éclats de bois hachés par le tonnerre.
— Vraiment, se dit l’enfant, voilà un lit très-doux et très-chaud où je dormirai sans risque de tomber en rêvant. Il n’est pas grand, mais il l’est assez pour moi. Voyons pourtant s’il n’est pas habité par quelque méchante bête.
Il fureta tout l’intérieur de ce refuge, et vit qu’il était percé par en haut, ce qui devait amener un peu d’humidité dans les temps de pluie.
Il se dit qu’il était bien facile de boucher ce trou avec de la mousse. Une chouette avait fait son nid dans le conduit.
— Je ne te dérangerai pas, pensa Emmi, mais je fermerai la communication. Comme cela, nous serons chacun chez nous.
Quand il eut préparé son nid pour la nuit suivante et installé son bagage en sûreté, il s’assit dans son trou, les jambes dehors appuyées sur une branche, et se mit à songer vaguement à la possibilité de vivre dans un arbre ; mais il eût souhaité que cet arbre fût au cœur de la forêt au lieu d’être auprès de la lisière, exposé aux regards des bergers et porchers qui y amenaient leurs troupeaux. Il ne pouvait prévoir que, par suite de sa disparition, l’arbre deviendrait un objet de crainte, et que personne n’en approcherait plus.
La faim commençait à se faire sentir, et, bien qu’il fût très-petit mangeur, il se ressentait bien de n’avoir rien pris de solide la veille. Irait-il déterrer les favasses encore vertes qu’il avait remarquées à quelques pas de là ? ou irait-il jusqu’aux châtaigniers qui poussaient plus avant dans la forêt ?
Comme il se préparait à descendre, il vit que la branche sur laquelle reposaient ses pieds n’appartenait pas à son chêne. C’était celle d’un arbre voisin qui entre-croisait ses belles et fortes ramures avec celles du chêne parlant. Emmi se hasarda sur cette branche et gagna le chêne voisin qui avait, lui aussi, pour proche voisin un autre arbre facile à atteindre. Emmi, léger comme un écureuil, s’aventura ainsi d’arbre en arbre jusqu’aux châtaigniers où il fit une bonne récolte.
Les châtaignes étaient encore petites et pas très-mûres ; mais il n’y regardait pas de bien près, et il mit comme qui dirait pied à terre pour les faire cuire dans un endroit bien désert et bien caché où les charbonniers avaient fait autrefois une fournée. Le rond marqué par le feu était entouré de jeunes arbres qui avaient repoussé depuis : il y avait beaucoup de menus déchets à demi brûlés. Emmi n’eut pas de peine à en faire un tas et à y mettre le feu au moyen d’un caillou qu’il battit du dos de son couteau, et il recueillit l’étincelle avec des feuilles sèches, tout en se promettant de faire provision d’amadou sur les arbres décrépits, qui ne manquaient pas dans la forêt. L’eau d’une rigole lui permit de faire cuire ses châtaignes dans son petit pot de terre, à couvercle percé, destiné à cet usage. C’est un meuble dont en ce pays-là tout pâtour est nanti.
Emmi, qui ne rentrait souvent que le soir à la ferme, à cause de la grande distance où il devait mener ses bêtes, était donc habitué à se nourrir lui-même, et il ne fut pas embarrassé de cueillir son dessert de framboises et de mûres sauvages sur les buissons de la petite clairière.
— Voilà, pensa-t-il, ma cuisine et ma salle à manger trouvées.
Et il se mit à nettoyer le cours du filet d’eau qu’il avait à sa portée. Avec sa sarclette, il enleva les herbes pourries, creusa un petit réservoir, débarrassa un petit saut que l’eau faisait dans la glaise et l’épura avec du sable et des cailloux. Cet ouvrage l’occupa jusque vers le coucher du soleil.
Il ramassa son pot et sa houlette, et, remontant sur les branches dont il avait éprouvé la solidité, il retrouva son chemin d’écureuil, grimpant et sautant d’arbre en arbre jusqu’à son chêne. Il rapportait une épaisse brassée de fougère et de mousse bien sèche dont il fit son lit dans le trou déjà nettoyé. Il entendit bien la chouette sa voisine qui s’inquiétait et grognait au-dessus de sa tête.
— Ou elle délogera, pensa-t-il, ou elle s’y habituera. Le bon chêne ne lui appartient pas plus qu’à moi.
Habitué à vivre seul, Emmi ne s’ennuya pas. Être débarrassé de la compagnie des pourceaux fut même pour lui une source de bonheur pendant plusieurs jours. Il s’accoutuma à entendre hurler les loups.
Il savait qu’ils restaient au cœur de la forêt et n’approchaient guère de la région où il se trouvait. Les troupeaux n’y venant plus, les compères ne s’en approchaient plus du tout. Et puis Emmi apprit à connaître leurs habitudes. En pleine forêt, il n’en rencontrait jamais dans les journées claires. Ils n’avaient de hardiesse que dans les temps de brouillard, et encore cette hardiesse n’était-elle pas grande. Ils suivaient quelquefois Emmi à distance, mais il lui suffisait de se retourner et d’imiter le bruit d’un fusil qu’on arme en frappant son couteau contre le fer de sa sarclette pour les mettre en fuite. Quant aux sangliers, Emmi les entendait quelquefois, il ne les voyait jamais ; ce sont des animaux mystérieux qui n’attaquent jamais les premiers.
Quand il vit approcher l’époque de la cueillette des châtaignes, il fit sa provision qu’il cacha dans un autre arbre creux à peu de distance de son chêne ; mais les rats et les mulots les lui disputèrent si bien, qu’il dut les enterrer dans le sable, où elles se conservèrent jusqu’au printemps. D’ailleurs, Emmi avait largement de quoi se nourrir. La lande étant devenue absolument déserte, il put s’aventurer la nuit jusqu’aux endroits cultivés et y déterrer des pommes de terre et des raves ; mais c’était voler et la chose lui répugnait. Il amassa quantité de favasses dans les jachères et fit des lacets pour prendre des alouettes en ramassant deçà et delà des crins laissés aux buissons par les chevaux au pâturage. Les pâtours savent tirer parti de tout et ne laissent rien perdre. Emmi ramassa assez de flocons de laine sur les épines des clôtures pour se faire une espèce d’oreiller ; plus tard, il se fabriqua une quenouille et un fuseau et apprit tout seul à filer. Il se fit des aiguilles à tricoter avec du fil de fer qu’il trouva à une barrière mal raccommodée, qu’on répara encore et qu’il dépouilla de nouveau pour fabriquer des collets à prendre les lapins. Il réussit donc à se faire des bas et à manger de la viande. Il devint un chasseur des plus habiles ; épiant jour et nuit toutes les habitudes du gibier, initié à tous les mystères de la lande et de la forêt, il tendit ses pièges à coup sûr et se trouva dans l’abondance.
Il eut même du pain à discrétion, grâce à une vieille mendiante idiote, qui, toutes les semaines, passait au pied du chêne et y déposait sa besace pleine, pour se reposer.
Emmi, qui la guettait, descendait de son arbre, la tête couverte de sa peau de chèvre, et lui donnait une pièce de gibier en échange d’une partie de son pain. Si elle avait peur de lui, sa peur ne se manifestait que par un rire stupide et une obéissance dont elle n’avait du reste point à se repentir.
Ainsi se passa l’hiver, qui fut très-doux, et l’été suivant, qui fut chaud et orageux. Emmi eut d’abord grand’peur du tonnerre, car la foudre frappa plusieurs fois des arbres assez proches du sien ; mais il remarqua que le chêne parlant, ayant été écimé longtemps auparavant et s’étant refait une cime en parasol, n’attirait plus le fluide, qui s’attaquait à des arbres plus élevés et de forme conique. Il finit par dormir aux roulements et aux éclats du tonnerre sans plus de souci que la chouette sa voisine.
Dans cette solitude, Emmi, absorbé par le soin incessant d’assurer sa vie et de préserver sa liberté, n’eut pas le temps de connaître l’ennui. On pouvait le traiter de paresseux, il savait bien, lui, qu’il avait plus de mal à se donner pour vivre seul que s’il fût resté à la ferme. Il acquérait aussi plus d’intelligence, de courage et de prévision que dans la vie ordinaire.
Pourtant, quand cette vie exceptionnelle fut réglée à souhait et qu’elle exigea moins de temps et de souci, il commença à réfléchir et à sentir sa petite conscience lui adresser certaines questions embarrassantes. Pourrait-il vivre toujours ainsi aux dépens de la forêt sans servir personne et sans contenter aucun de ses semblables ?
Il s’était pris d’une espèce d’amitié pour la vieille Catiche, l’idiote qui lui cédait son pain en échange de ses lapins et de ses chapelets d’alouettes. Comme elle n’avait pas de mémoire, ne parlait presque pas et ne racontait par conséquent à personne ses entrevues avec lui, il était arrivé à se montrer à elle à visage découvert, et elle ne le craignait plus. Ses rires hébétés laissaient deviner une expression de plaisir quand elle le voyait descendre de son arbre. Emmi s’étonnait lui-même de partager ce plaisir ; il ne se disait pas, mais il sentait que la présence d’une créature humaine, si dégradée qu’elle soit, est une sorte de bienfait pour celui qui s’est condamné à vivre seul. Un jour qu’elle lui semblait moins abrutie que de coutume, il essaya de lui parler et de lui demander où elle demeurait. Elle cessa tout à coup de rire, et lui dit d’une voix nette et d’un ton sérieux :
— Veux-tu venir avec moi, petit ?
— Où ?
— Dans ma maison ; si tu veux être mon fils, je te rendrai riche et heureux.
Emmi s’étonna beaucoup d’entendre parler distinctement et raisonnablement la vieille Catiche.
La curiosité lui donnait quelque envie de la croire, mais un coup de vent agita les branches au-dessus de sa tête, et il entendit la voix du chêne lui dire :
— N’y va pas !
— Bonsoir et bon voyage, dit-il à la vieille ; mon arbre ne veut pas que je le quitte.
— Ton arbre est un sot, reprit-elle, ou plutôt c’est toi qui es une bête de croire à la parole des arbres.
— Vous croyez que les arbres ne parlent pas ? Vous vous trompez bien !
— Tous les arbres parlent quand le vent se met après eux, mais ils ne savent pas ce qu’ils disent ; c’est comme s’ils ne disaient rien.
Emmi fut fâché de cette explication positive d’un fait merveilleux. Il répondit à Catiche :
— C’est vous qui radotez, la vieille. Si tous les arbres font comme vous, mon chêne du moins sait ce qu’il veut et ce qu’il dit.
La vieille haussa les épaules, ramassa sa besace et s’éloigna en reprenant son rire d’idiote.
Emmi se demanda si elle jouait un rôle ou si elle avait des moments lucides. Il la laissa partir et la suivit, en se glissant d’arbre en arbre sans qu’elle s’en aperçût. Elle n’allait pas vite et marchait le dos courbé, la tête en avant, la bouche entr’ouverte, l’oeil fixé droit devant elle ; mais cet air exténué ne l’empêchait pas d’avancer toujours sans se presser ni se ralentir, et elle traversa ainsi la forêt pendant trois bonnes heures de marche, jusqu’à un pauvre hameau perché sur une colline derrière laquelle d’autres bois s’étendaient à perte de vue. Emmi la vit entrer dans une méchante cahute isolée des autres habitations, qui, pour paraître moins misérables, n’en étaient pas moins un assemblage de quelques douzaines de taudis.
Il n’osa pas s’aventurer plus loin que les derniers arbres de la forêt et revint sur ses pas, bien convaincu que, si la Catiche avait un chez elle, il était plus pauvre et plus laid que le trou de l’arbre parlant.
Il regagna son logis du grand chêne et n’y arriva que vers le soir, harassé de fatigue, mais content de se retrouver chez lui. Il avait gagné à ce voyage de connaître l’étendue de la forêt et la proximité d’un village ; mais ce village paraissait bien plus mal partagé que celui de Cernas, où Emmi avait été élevé. C’était tout pays de landes sans trace de culture, et les rares bestiaux qu’il avait vus paître autour des maisons n’avaient que la peau sur les os. Au-delà, il n’avait aperçu que les sombres horizons des forêts. Ce n’est donc pas de ce côté-là qu’il pouvait songer à trouver une condition meilleure que la sienne.
Au bout de la semaine, la Catiche arriva à l’heure ordinaire. Elle revenait de Cernas, et il lui demanda des nouvelles de sa tante pour voir si cette vieille aurait le pouvoir et la volonté de lui répondre comme la dernière fois. Elle répondit très-nettement :
— La grand’Nanette est remariée, et, si tu retournes chez elle, elle tâchera de te faire mourir pour se débarrasser de toi.
— Parlez-vous raisonnablement ? dit Emmi ; et me dites-vous la vérité ?
— Je te dis la vérité. Tu n’as plus qu’à te rendre à ton maître pour vivre avec les cochons, ou à chercher ton pain avec moi, ce qui te vaudrait mieux que tu ne penses. Tu ne pourras pas toujours vivre dans la forêt. Elle est vendue, et sans doute on va abattre les vieux arbres. Ton chêne y passera comme les autres. Crois-moi, petit. On ne peut vivre nulle part sans gagner de l’argent. Viens avec moi, tu m’aideras à en gagner beaucoup, et, quand je mourrai, je te laisserai celui que j’ai.
Emmi était si étonné d’entendre causer et raisonner l’idiote, qu’il regarda son arbre et prêta l’oreille comme s’il lui demandait conseil.
— Laisse donc cette vieille bûche tranquille, reprit la Catiche. Ne sois pas si sot et viens avec moi.
Comme l’arbre ne disait mot, Emmi suivit la vieille, qui, chemin faisant, lui révéla son secret.
« Je suis venue au monde loin d’ici, pauvre comme toi et orpheline.
J’ai été élevée dans la misère et les coups. J’ai gardé aussi les cochons, et, comme toi, j’en avais peur. Comme toi, je me suis sauvée ; mais, en traversant une rivière sur un vieux pont décrépit, je suis tombée à l’eau d’où on m’a retirée comme morte.
Un bon médecin chez qui on m’a portée m’a fait revenir à la vie ; mais j’étais idiote, sourde, et ne pouvant presque plus parler. Il m’a gardée par charité, et, comme il n’était pas riche, le curé de l’endroit a fait des quêtes pour moi, et les dames m’ont apporté des habits, du vin, des douceurs, tout ce qu’il me fallait. Je commençais à me porter mieux, j’étais si bien soignée ! Je mangeais de la bonne viande, je buvais du bon vin sucré, j’avais l’hiver du feu dans ma chambre, j’étais comme une princesse, et le médecin était content. Il disait :
« La voilà qui entend ce qu’on lui dit. Elle retrouve les mots pour parler. Dans deux ou trois mois d’ici, elle pourra travailler et gagner honnêtement sa vie.
« Et toutes les belles dames se disputaient à qui me prendrait chez elle.
« Je ne fus donc pas embarrassée pour trouver une place aussitôt que je fus guérie ; mais je n’avais pas le goût du travail, et on ne fut pas content de moi. J’aurais voulu être fille de chambre, mais je ne savais ni coudre ni coiffer ; on me faisait tirer de l’eau au puits et plumer la volaille, cela m’ennuyait. Je quittai l’endroit, croyant être mieux ailleurs. Ce fut encore pire, on me traitait de malpropre et de paresseuse. Mon vieux médecin était mort. On me chassa de maison en maison, et, après avoir été l’enfant chéri de tout le monde, je dus quitter le pays comme j’y étais venue, en mendiant mon pain ; mais j’étais plus misérable qu’auparavant. J’avais pris le goût d’être heureuse, et on me donnait si peu, que j’avais à peine de quoi manger. On me trouvait trop grande et de trop bonne mine pour mendier. On me disait :
« Va travailler, grande fainéante ! c’est une honte à ton âge de courir les chemins quand on peut épierrer les champs à six sous par jour.
« Alors, je fis la boiteuse pour donner à croire que je ne pouvais pas travailler ; on trouva que j’étais encore trop forte pour ne rien faire, et je dus me rappeler le temps où tout le monde avait pitié de moi, parce que j’étais idiote. Je sus retrouver l’air que j’avais dans ce temps-là, mon habitude de ricaner au lieu de parler, et je fis si bien mon personnage, que les sous et les miches recommencèrent à pleuvoir dans ma besace. C’est comme cela que je cours depuis une quarantaine d’années, sans jamais essuyer de refus. Ceux qui ne peuvent me donner d’argent me donnent du fromage, des fruits et du pain plus que je n’en peux porter. Avec ce que j’ai de trop pour moi, j’élève des poulets que j’envoie au marché et qui me rapportent gros. J’ai une bonne maison dans un village où je vais te conduire. Le pays est malheureux, mais les habitants ne le sont pas. Nous sommes tous mendiants et infirmes, ou soi-disant tels, et chacun fait sa tournée dans un endroit où les autres sont convenus de ne pas aller ce jour-là. Comme ça, chacun fait ses affaires comme il veut ; mais personne ne les fait aussi bien que moi, car je m’entends mieux que personne à paraître incapable de gagner ma vie. »
— Le fait est, répondit Emmi, que jamais je ne vous aurais crue capable de parler comme vous faites.