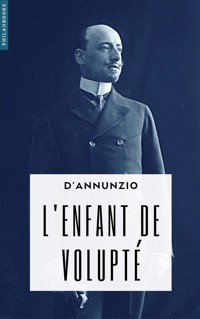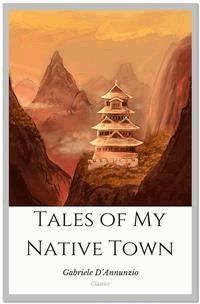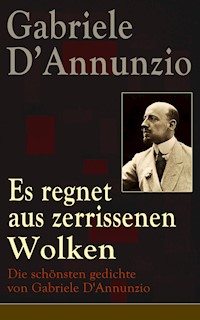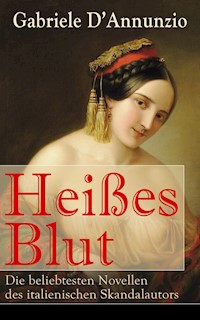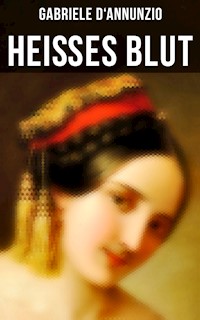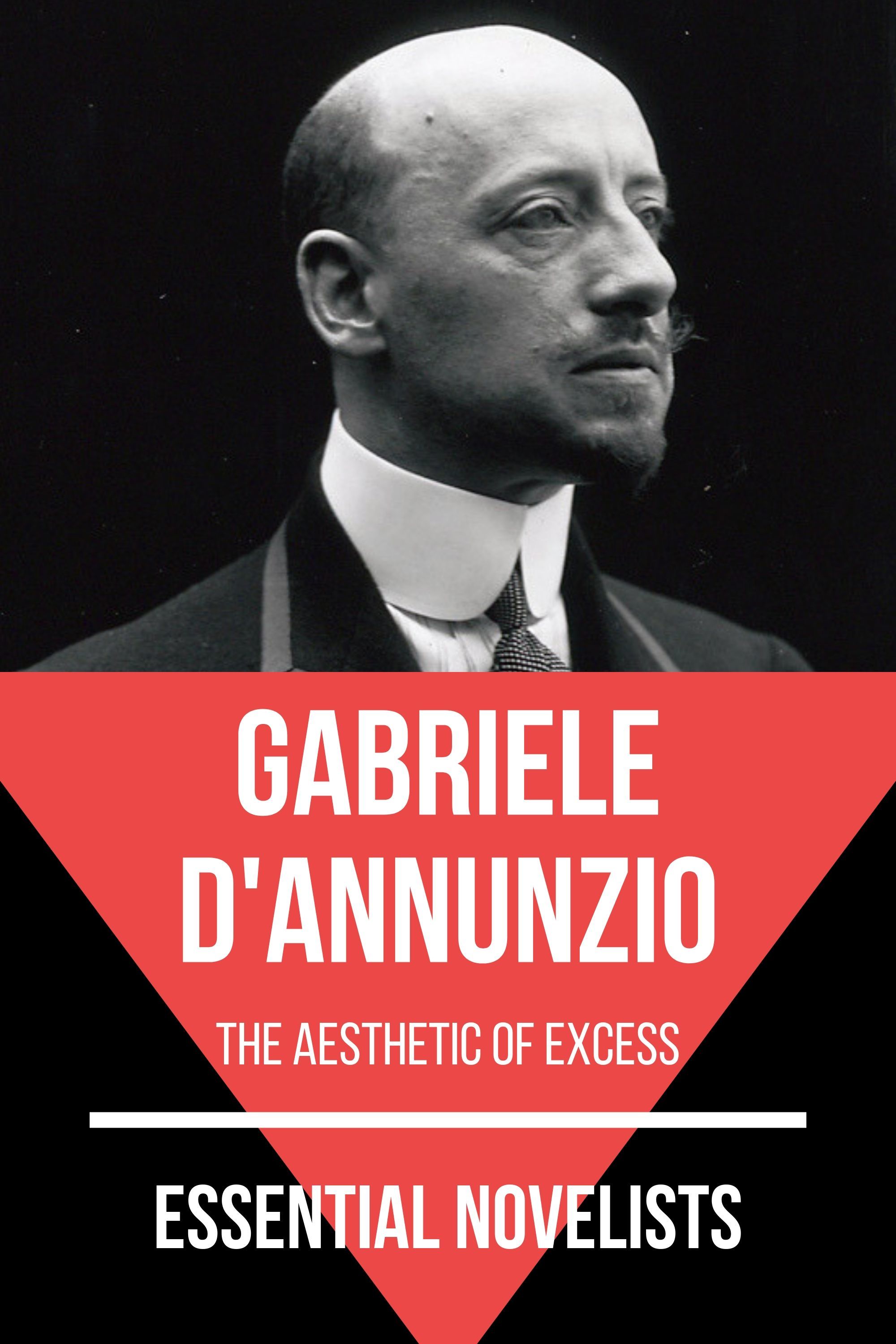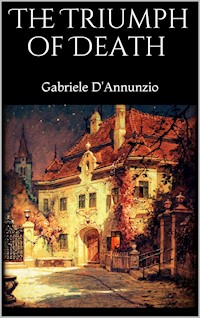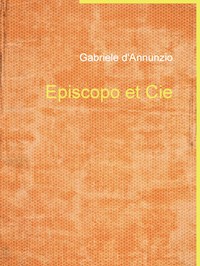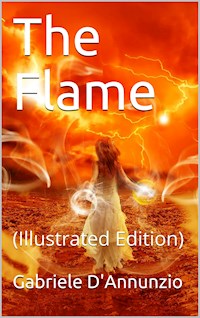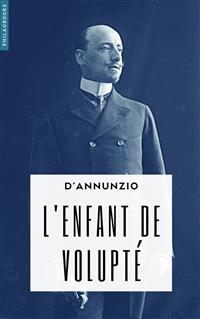0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
À vrai dire, nous n’avons pas obtenu de M. d’Annunzio sans quelque insistance l’autorisation de traduire les nouvelles qui composent le présent recueil. Celui qui, dans une préface célèbre, a pris pour sa devise : « Ou se renouveler, ou mourir », n’est pas de ces écrivains qui, ayant trouvé une première formule d’art, s’en contentent indéfiniment et s’imitent pour ainsi dire eux-mêmes jusqu’au bout de leur carrière. Son esprit, toujours en quête du meilleur, se dégoûte vite de l’œuvre finie pour s’attacher à un idéal nouveau, pour poursuivre une perfection supérieure. Aussi, à l’heure actuelle, n’attribue-t-il guère à ces écrits déjà anciens qu’une valeur de « documents littéraires ». Mais nous sommes convaincus que les lecteurs, plus équitables que l’auteur, trouveront à ces nouvelles beaucoup de charme propre, et qu’en outre il ne sera pas sans intérêt pour eux d’y suivre, comme pas à pas, le développement graduel d’un talent si original et si sympathique. Georges Hérelle. Recueil de nouvelles écrites entre 1880 et 1891 : Les cloches (1880 La belle-sœur (1883); La sieste (1884); Saint Pantaléon (1884); Les sequins (1884); Le héros (1884) ; La huche (1885); Le martyr (1885); Annales d’Anne (1885); Episcopo et Cie (1891).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Episcopo et cie
et autres nouvelles
Gabriele D’Annunzio
Traduction parGeorges Hérelle
philaubooks
Table des matières
Préface
1. Episcopo et Cie
2. Les cloches
3. La belle-sœur
4. La sieste
5. La huche
6. Les sequins
7. Le martyr
8. Saint Pantaléon
9. Le héros
10. Annales d’Anne
Sources et ressources
Préface
Depuis la publication de l’Intrus 1, M. Gabriel d’Annunzio compte en France beaucoup de chauds amis littéraires. Aussi avons-nous cru faire plaisir à ceux qui ont goûté ce beau roman et qui attendent avec une curiosité bienveillante d’autres œuvres du même auteur, en leur offrant aujourd’hui la traduction d’un choix de Nouvelles écrites par lui entre 1880 et 1891, c’est-à-dire depuis ses tout premiers débuts jusqu’à l’époque où il est arrivé à la plénitude de son talent.
Disons d’abord quelques mots de sa personne.
G. d’Annunzio est né en 1864, à bord du brigantin Irène, dans les eaux de l’Adriatique. Et cette circonstance a peut-être exercé sur son esprit quelque influence secrète ; car la mer a toujours eu pour lui un attrait profond : il l’aime vraiment comme une patrie.
Élevé dans les Abruzzes, il eut, très jeune encore, une réputation d’enfant prodige. Selon ses souvenirs personnels, il n’aurait pas moins mérité celle d’enfant capricieux, volontaire et violent. En lui, le développement de la sensibilité avait été très précoce ; ses émotions, ses désirs, ses répugnances avaient une véhémence singulière ; la moindre contrariété lui causait des colères furieuses qui aboutissaient parfois à des crises convulsives.
Quand il eut neuf ans, son père, pour lui donner la connaissance et la pratique du pur idiome toscan, l’envoya au collège de Prato, où il fit toutes ses études, jusqu’en 1880. Il y était encore écolier et avait à peine quinze ans lorsque la lecture des Odi barbare de Carducci lui révéla qu’il était aussi poète. En deux ou trois mois il composa un volume de vers qui, par la complaisance de son père, fut imprimé sous le titre latin : Primo vere. Ce premier essai, déjà remarquable par l’élégante facilité de la forme et plein de hardiesses un peu étranges pour un auteur de cet âge, attira l’attention d’un des critiques qui régnaient alors en Italie sur la république des lettres ; le bruit se répandit partout qu’« un nouveau poète » était né ; et la subite renommée de l’adolescent vola même jusqu’au delà des Alpes. En effet, Marc Monnier, dans la Revue suisse, lui consacra un article qui se terminait par ce joli mot : « Si j’étais un de ses maîtres, je lui donnerais une médaille et le fouet. »
Au sortir du collège, G. d’Annunzio vint à l’Université de Rome et y fut accueilli avec enthousiasme par un cénacle de jeunes gens qui faisaient alors leurs premières armes dans la Cronaca bizantina. Il avait toute la fougue de la jeunesse ; il était aussi avide de plaisirs que de gloire ; et ces deux passions, au lieu de se contrecarrer l’une l’autre, s’entr’aidèrent. En 1882, il publia coup sur coup un volume de prose, Terra Vergine, et un volume de vers, Canto novo ; puis, en 1883, un nouveau volume, l’Intermezzo di rime, où il chantait les voluptés de la chair en grands vers plastiques d’une impeccable prosodie. En même temps, toutes les portes s’ouvraient devant lui ; il allait de triomphe en triomphe ; et (comme il l’a rappelé naguère) il commettait faute sur faute, il longeait mille précipices. Son nom courait sur toutes les bouches, aussi célèbre par les succès mondains que par les succès littéraires ; et cette double célébrité ressemblait un peu à un scandale.
Cette effervescence tumultueuse de puberté virile et artistique n’était pas sans danger. Une heureuse nécessité arracha G. d’Annunzio au péril en le contraignant à retourner dans ses terres, sur le rivage bienfaisant de la mer natale. Là, il reprit possession de lui-même, se détacha des légères amours et des frivoles vanités, trouva enfin la voie définitive qui convenait à son génie. Ce fut alors qu’il écrivit les nouvelles du recueil il Libro delle Vergini (1884) et la plupart de celles qui ont été réunies un peu plus tard sous le titre de San Pantaleone (1886).
Depuis cette période de retraite, G. d’Annunzio a successivement habité Rome, Naples et les Abruzzes. Voici dix-huit mois environ qu’il est rentré dans son pays, dans cette chère province de Chieti où il a placé le théâtre de son dernier roman. Il y vit au bord de la mer, dans la demi-solitude d’un village, près de son ami l’illustre peintre F.-P. Michetti. Grand liseur, grand travailleur, il connaît à fond les littératures étrangères, spécialement celle de la France, et il poursuit avec un labeur infatigable son œuvre propre de poète et de prosateur : plus épris maintenant de la prose que des vers, et convaincu que le roman est la meilleure forme d’art pour exprimer toutes les subtilités et toutes les complexités de l’âme moderne.
Pendant les huit dernières années, il a publié :
— en vers, l’Isotteo (1886), la Chimera (1888), les Elegie romane (1892), le Poema paradisiaco (1893) ;
— en prose, il Piacere (1889), Giovanni Episcopo (1892), l’innocente (1892) et le Trionfo della Morte (1894).
G. d’Annunzio est aujourd’hui un homme de trente ans, qui paraît plus jeune que son âge ; de taille moyenne, blond malgré son origine méridionale, régulier de traits, doux d’expression, parlant un peu lentement. Ses succès, devenus européens dans les dernières années, ne lui ont donné aucune morgue ; et on serait tenté de lui appliquer ce qu’il dit d’un de ses personnages de roman : « Il est beaucoup plus simple que ses ouvrages. » Très affable, très bon pour ses amis, très attentif à ne pas désobliger même les indifférents, il sait écouter avec une bienveillance parfaite les observations critiques qui lui paraissent procéder, non d’une hostilité maligne, mais d’un zèle affectueux ; inébranlable d’ailleurs dans sa foi d’artiste, admirateur ému de la beauté partout où il la rencontre, saisi d’une émotion presque muette devant les chefs-d’œuvre.
M. Gabriel d’Annunzio, tout jeune qu’il est, a donc un passé déjà riche d’œuvres diverses. Un jour viendra peut-être où nous révélerons le poète au public français. Mais aujourd’hui, c’est seulement le prosateur dont nous avons voulu faire connaître les origines, le progrès et l’avènement.
À vrai dire, nous n’avons pas obtenu de M. d’Annunzio sans quelque insistance l’autorisation de traduire les nouvelles qui composent le présent recueil. Celui qui, dans une préface célèbre2, a pris pour sa devise : « Ou se renouveler, ou mourir », n’est pas de ces écrivains qui, ayant trouvé une première formule d’art, s’en contentent indéfiniment et s’imitent pour ainsi dire eux-mêmes jusqu’au bout de leur carrière.
Son esprit, toujours en quête du meilleur, se dégoûte vite de l’œuvre finie pour s’attacher à un idéal nouveau, pour poursuivre une perfection supérieure. Aussi, à l’heure actuelle, n’attribue-t-il guère à ces écrits déjà anciens qu’une valeur de « documents littéraires ». Mais nous sommes convaincus que les lecteurs, plus équitables que l’auteur, trouveront à ces nouvelles beaucoup de charme propre, et qu’en outre il ne sera pas sans intérêt pour eux d’y suivre, comme pas à pas, le développement graduel d’un talent si original et si sympathique.
M. René Doumic a dit de M. d’Annunzio « qu’il possède des facultés qui ne sont pas incompatibles, mais qu’on n’a pas coutume de trouver réunies ». Or, si ces facultés, comme cela est naturel, existaient déjà en germe dans les ébauches de jeunesse, c’est pourtant dans un ordre successif et en quelque sorte par voie d’adjonction qu’elles sont arrivées à leur épanouissement complet. Le fond commun qui a pour ainsi dire servi de base à tout le reste, c’est l’amour passionné d’une belle forme, pure, harmonieuse, expressive, pleine d’images et de mouvement. Mais la forme n’est qu’un moyen de rendre les choses, extérieures ou intérieures. Ce sont d’abord les choses extérieures que M. d’Annunzio paraît s’être appliqué à rendre, avec une extraordinaire vivacité de coloris et de relief. Puis ce sont les choses intérieures, les spectacles et les drames plus mystérieux de la vie psychologique, qui l’ont séduit à leur tour. Et cette série de métamorphoses a été pour lui, non pas une suite de désertions, mais une suite de conquêtes ; les qualités nouvelles se sont ajoutées aux qualités acquises ; l’art s’est enrichi en se transformant. Notre recueil contribuera, croyons-nous, à mettre cette vérité en évidence.
Pour ce qui concerne la pureté et l’éclat de la forme, c’est un genre de mérite qu’une traduction ne permet guère au lecteur d’apprécier. Il nous suffira de dire que M. d’Annunzio, après avoir fait l’orfèvre et le ciseleur de mots, après s’être épris de toutes les opulences et de toutes les préciosités de la forme, est revenu ensuite à une manière plus calme, plus fine et plus noble. À cet égard, on constate déjà un changement manifeste lorsqu’on passe de la Belle-sœur aux Annales d’Anne, de Saint-Pantaléon à Episcopo et Cie. Et aujourd’hui, ses adversaires les plus déclarés ne lui contestent pas du moins la maîtrise de la langue.
Quant au sentiment des choses extérieures, il apparaît très vif et très précis dès les premières pages que M. d’Annunzio ait écrites. Les Cloches ne sont, si l’on veut, qu’une « narration d’écolier ». Il nous a semblé cependant que cette narration était assez curieuse pour trouver place dans notre recueil, parce qu’elle atteste chez l’auteur encore enfant une singulière vision des contours et des couleurs, une vision de peintre qui serait aussi musicien. M. d’Annunzio n’a-t-il pas dit de lui-même : « Toutes mes recherches d’art tendent à fondre parfaitement dans ma prose et dans ma poésie les éléments picturaux et musicaux qui ont ma prédilection ? » En général, cette prédilection s’adresse aux peintres précurseurs de la Renaissance et aux musiciens des XVIIe et XVIIIe siècles ; et ce qu’il aime par-dessus tout, c’est la Beauté simple et subtile qui caractérise les œuvres de ces anciens maîtres. Quelquefois néanmoins, par exception, il a décrit des scènes de brutalité et de violence, comme dans la Huche, les Sequins et Saint-Pantaléon. Cela s’explique sans doute par ce fait qu’il est « un voyant » et que l’image conçue l’obsède comme une sensation réelle. Mais, alors même qu’il traite un sujet de ce genre, il reste fidèle à sa nature d’artiste. Un critique italien, en parlant de Saint-Pantaléon, a pu comparer cette nouvelle à « un bas-relief ébauché par Michel-Ange adolescent » ; et un critique français a pu dire que « tout ce que touche M. d’Annunzio est transformé en beauté. »
« Il y a des gens qui marchent au milieu d’une foule comme au milieu d’une forêt d’arbres pareils, avec indifférence ; mais il y a quelqu’un qui, sur tout visage, épie une muette réponse à une muette question. » M. d’Annunzio est aussi ce questionneur d’âmes ; et, dans la Belle-sœur, dans les Annales d’Anne, surtout dans Episcopo et Cie, on voit apparaître, remarquable déjà, ce goût des enquêtes psychologiques qui deviendra si pénétrant dans les grandes œuvres ultérieures. Que M. d’Annunzio ait d’abord exercé de préférence sa subtilité d’analyste sur des anomalies morales, sur des passions criminelles, sur des égarements imbéciles de superstition idolâtrique, il n’y a pas lieu de s’en étonner : l’étrangeté même de tels sujets leur donne un attrait spécial pour un jeune romancier curieux de ce qui est rare et extraordinaire.
Dans le Plaisir3, dans l’Intrus, dans le Triomphe de la Mort4, on retrouve encore cette même recherche des cas singuliers, des exceptions et des perversions, bien que l’auteur y ait déployé des qualités de plus en plus larges et profondes. Mais ces trois romans, réunis sous le titre commun de Romans de la Rose, forment une première série qui est close maintenant.
M. d’Annunzio vient d’entreprendre une seconde série de romans où, résolu à ne pas limiter son étude à certains états morbides de la conscience humaine, il exercera ses puissantes facultés de représentation sur des domaines nouveaux. « Les écrivains dont je suis, disait-il dans un article récent, acceptent la vie tout entière ; et ils estiment que l’art doit plonger ses racines jusque dans les profondeurs où pullulent les premières sources. Donc, nulle limitation. Mais, comme il n’est pas possible à ces écrivains de manifester d’un seul coup toute leur force et toute leur pensée, il est naturel qu’ils cherchent à développer leurs facultés graduellement et à monter de cercle en cercle, selon leur pouvoir, jusqu’à un sommet d’où il leur sera donné d’embrasser les plus larges espaces. » Que nous apportera cette évolution nouvelle de M. d’Annunzio ? En pareille matière, il est toujours extrêmement périlleux de prophétiser. Cependant, à certains indices, on pressent que la pensée du romancier tend à devenir plus profonde, plus éprise des grands problèmes moraux, plus essentiellement « spirituelle ».
Quoi qu’il en soit, la généreuse ambition de cet artiste passionné n’est pas inférieure à l’attente de ceux que son œuvre intéresse. Et cette attente ne sera pas déçue.
G. H.
1L’Intrus, Calmann Lévy éditeur, Paris, 1893. L’original italien a été publié sous le titre l’Innocente, F. Bideri, Naples.
2Edition italienne de Giovanni Épiscopo.
3La traduction de ce roman va paraître sous le titre : L’Enfant de volupté.
4Le Triomphe de la Mort sera aussi publié prochainement en français.
1
Episcopo et Cie
Écrit en janvier 1891 ; publié sous le titre de Giovanni Episcopo, Luigi Pierro éditeur, Naples, 1892.
Vous voulez donc savoir… Que voulez-vous savoir, monsieur ? Que faut-il vous dire ? Quoi ?… Tout !… Eh bien ! je vais vous raconter tout, depuis le commencement.
Tout, depuis le commencement ! Comment faire ? Je ne sais plus rien ; je vous assure que je ne me souviens de rien. Comment faire, monsieur ? Comment faire ?
Ah ! mon Dieu ! Voici… Attendez, s’il vous plaît. Un peu de patience ; ayez, je vous prie, un peu de patience, parce que je ne sais pas parler. Quand même je me rappellerais quelque chose, je ne saurais pas vous le dire. Au temps où je vivais parmi les hommes, j’étais taciturne ; j’étais taciturne même après avoir bu, toujours.
Non, non, pas toujours. Avec lui je parlais, mais avec lui seulement. Certains soirs d’été, dans le faubourg, ou encore sur les places, dans les jardins publics… Il mettait son bras sous le mien, son pauvre bras maigre, si frêle que je le sentais à peine. Et nous nous promenions ensemble en raisonnant.
Onze ans, — pensez, monsieur, — il n’avait que onze ans ; et il raisonnait comme un homme, il était triste comme un homme. On aurait dit qu’il savait déjà la vie, toute la vie, et qu’il souffrait toutes les souffrances. Déjà sa bouche connaissait les mots amers, ceux qui font tant de mal et qui ne s’oublient pas !
Mais y a-t-il des gens qui oublient jamais quelque chose ? Y en a-t-il ?
Je vous disais : je ne sais plus rien, je ne me souviens plus de rien… Oh ! cela n’est pas vrai.
Je me souviens de tout, de tout, de tout ! Vous entendez ? Je me rappelle ses paroles, ses gestes, ses regards, ses larmes, ses soupirs, ses cris, les moindres particularités de son existence, tout, depuis l’heure où il est né jusqu’à l’heure où il est mort.
Il est mort. Voilà seize jours déjà qu’il est mort. Et moi, je suis encore vivant. Mais je dois mourir ; et, plus tôt je mourrai, mieux cela vaudra. Mon enfant veut que j’aille le rejoindre. Chaque nuit il vient, s’assoit, me regarde. Il est nu-pieds, le pauvre Ciro ! et j’ai besoin de tendre l’oreille pour distinguer ses pas. Dès que la nuit tombe, je suis continuellement, continuellement aux écoutes ; et, lorsqu’il met le pied sur le seuil, c’est comme s’il le mettait sur mon cœur, mais d’une façon si douce, si douce, sans me faire mal, léger comme une plume… Pauvre âme !
Toutes les nuits, maintenant, il est nu-pieds. Mais croyez-moi ; jamais, de son vivant, jamais il n’a marché nu-pieds ; jamais, je vous le jure.
Je vais vous dire une chose. Faites bien attention. S’il vous mourait une personne chère, prenez soin qu’il ne lui manque rien dans son cercueil. Habillez-la, si vous pouvez, de vos propres mains ; habillez-la complètement, minutieusement, comme si elle devait revivre, se lever, sortir. Rien ne doit manquer à celui qui s’en va du monde. Rien, souvenez-vous-en.
Eh bien ! regardez ces petits souliers… Vous avez des enfants ?… Non. Alors, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas comprendre ce qu’est pour moi cette mauvaise paire de petits souliers qui ont contenu ses pieds, qui ont conservé la forme de ses pieds. Je ne saurai jamais vous le dire ; jamais aucun père ne saura vous le dire, aucun.
Au moment où ils entrèrent dans la chambre, où ils vinrent pour m’emmener, est-ce que, tous ses vêtements n’étaient point là, sur la chaise, à côté du lit ? Pourquoi donc ne me préoccupai-je que des souliers ? Pourquoi les cherchai-je sous le lit, anxieusement, avec la sensation que mon cœur se fendrait si je ne les trouvais pas ? Pourquoi les cachai-je, comme s’il y était resté un peu de sa vie ? Oh ! vous ne pouvez pas comprendre.
Certains matins, en hiver, à l’heure de l’école… Le pauvre enfant souffrait des engelures. L’hiver, ses pieds n’étaient qu’une plaie, tout saignants. C’est moi qui lui mettais ses souliers, qui les lui mettais moi-même. Je savais si bien ! Puis, pour les lacer, je me baissais et je sentais s’appuyer sur mes épaules ses mains déjà tremblantes de froid ; et je m’attardais… Mais vous ne pouvez pas comprendre.
Quand il est mort, il n’en avait qu’une paire, celle que vous voyez. Et je la lui ai prise. Et sûrement on l’a enseveli tel quel, comme un petit pauvre. Est-ce que personne l’aimait, excepté son père ?
Maintenant, tous les soirs, je prends ces deux souliers et je les pose l’un près de l’autre sur le seuil, à son intention. S’il les voyait en passant ? Peut-être les voit-il, mais il n’y touche pas. Il sait peut-être que je deviendrais fou si, au matin, je ne les retrouvais plus à leur place, l’un près de l’autre…
Vous me croyez fou ? Non ? Il me semblait lire dans vos yeux… Non, monsieur, je ne suis pas fou encore. Ce que je vous raconte, c’est la vérité. Tout est vrai. Les morts reviennent.
Il revient aussi, l’autre, quelquefois. Quelle horreur ! Oh ! oh ! quelle horreur !
Vous voyez ; pendant des nuits entières j’ai tremblé comme à présent, j’ai claqué des dents sans pouvoir m’en défendre, j’ai cru que la terreur allait me disloquer les os aux jointures ; j’ai senti sur mon front, jusqu’au matin, mes cheveux pareils à des aiguilles, raides, dressés. N’ai-je pas les cheveux tout blancs ? Ils sont blancs, n’est-ce pas, monsieur ?
Merci, monsieur. Vous voyez, je ne tremble plus. Je suis malade, très malade. Combien de jours de vie me donneriez-vous encore, à en juger sur ma mine ? Vous savez, je dois mourir, et le plus tôt sera le mieux.
Mais oui, oui, je suis calme, parfaitement calme. Je vous raconterai tout, depuis l’origine, selon votre désir ; tout, par ordre. La raison ne m’a pas encore abandonné, croyez-moi.
Donc, voici l’affaire. C’était dans une maison des quartiers neufs, dans une espèce de pension bourgeoise, il y a douze ou treize ans. Nous étions une vingtaine d’employés, tant jeunes que vieux. Nous y allions dîner le soir, ensemble, à la même heure, à la même table. Nous nous connaissions tous plus ou moins, quoique nous ne fussions pas tous du même bureau. C’est là que j’ai connu Wanzer, Giulio Wanzer, il y a douze ou treize ans.
Vous… vous avez vu… le cadavre ?… Ne vous a-t-il point paru qu’il y avait quelque chose d’extraordinaire dans ce visage, dans ces yeux ?… Ah ! j’oublie, les yeux étaient fermés… Pas tous les deux, cependant, pas tous les deux. Cela, je le sais bien. Il faut que je meure, ne serait-ce que pour m’ôter des doigts l’impression de cette paupière qui résistait… Je la sens, je la sens ici, toujours, comme si en cet endroit s’était attaché un peu de cette peau. Regardez ma main. N’est-ce pas une main qui a déjà commencé de mourir ? Regardez-la.
Oui, c’est vrai. Il ne faut plus y penser. Je vous demande pardon. Je vais maintenant tout droit au but. Où en étions-nous ? Le commencement allait si bien ! Et puis, tout d’un coup, je me suis perdu. C’est sans doute parce que je suis à jeun, rien autre chose ; non, rien autre chose. Depuis bientôt deux jours je n’ai pas mangé.
Je me souviens qu’autrefois, quand j’avais l’estomac vide, il me venait une espèce de délire léger, si étrange ! Il me semblait que je m’évanouissais ; je voyais des choses…
Ah ! j’y suis. Vous avez raison. Je disais donc : c’est là que j’ai fait connaissance avec Wanzer.
Il dominait tout le monde là dedans, il opprimait tout le monde, il ne souffrait pas la contradiction. Toujours le verbe haut, et, quelquefois aussi, la main haute. Une soirée ne se passait pas sans qu’il eût quelque dispute. On le haïssait et on le redoutait comme un tyran. Tout le monde parlait mal de lui, murmurait, complotait ; mais à peine paraissait-il, que les plus enragés eux-mêmes faisaient silence. Les plus timides lui souriaient, le cajolaient. Qu’est-ce qu’il avait donc, cet homme ?
Je ne sais pas, moi. À table, j’étais presque en face de lui. Involontairement, mes yeux le regardaient sans cesse. J’éprouvais une sensation bizarre que je suis incapable d’exprimer : un mélange de répulsion et d’attraction, quelque chose d’indéfinissable. Cela ressemblait à un magnétisme malfaisant, très malfaisant, que cet homme robuste, sanguin et brutal projetait sur moi, si faible dès lors, et maladif, et sans volonté, et, pour tout dire, un peu lâche.
Un soir, vers la fin du repas, une discussion s’éleva entre Wanzer et un certain Ingletti, dont la place était à côté de la mienne. Selon son habitude, Wanzer haussait le ton et s’irritait. Ingletti, à qui le vin sans doute donnait de la hardiesse, lui tenait tête. Moi, je restais presque immobile, les yeux sur mon assiette, n’osant pas les relever ; et je sentais à l’estomac une horrible contraction. Soudain Wanzer saisit un verre et le lança contre son antagoniste. Le coup faillit et le verre vint se briser sur mon front, là où vous voyez une balafre.
Dès que je sentis le sang chaud sur ma figure, je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, j’avais déjà la tête bandée. Wanzer était à mon côté, la mine dolente ; il m’adressa quelques mots d’excuse. Il me reconduisit à la maison avec le médecin ; il assista au second pansement ; il voulut rester dans ma chambre jusqu’à une heure avancée. Il revint la matinée d’après ; il revint souvent. Et ce fut le commencement de mon esclavage.
Il m’était impossible d’avoir à son égard une autre attitude que celle d’un chien qui a peur. Quand il entrait chez moi, il prenait des airs de maître. Il ouvrait mes tiroirs, se peignait avec mon peigne, se lavait les mains dans ma cuvette, fumait ma pipe, fouillait dans mes papiers, lisait mes lettres, emportait les objets à sa convenance. Chaque jour, son despotisme devenait plus insupportable ; et, chaque jour, mon âme s’avilissait, se rapetissait davantage. Je n’eus plus ombre de volonté ; je me soumis simplement, sans protestation. Il m’enleva tout sentiment de dignité humaine, comme ceci, d’un seul coup, avec autant de facilité qu’il m’aurait arraché un cheveu.
Et pourtant, je n’étais pas devenu stupide. Non. J’avais conscience de tout ce que je faisais, une très claire conscience de tout : de ma faiblesse, de mon abjection et, spécialement, de l’impossibilité absolue où j’étais de me soustraire à l’ascendant de cet homme.
Je ne saurais vous définir, par exemple, le sentiment profond et obscur que ma cicatrice éveillait en moi. Et je ne saurais vous expliquer le trouble extrême qui m’envahit, un jour que mon bourreau me prit la tête dans ses mains pour examiner cette cicatrice encore fraîche et enflammée. Il passa le doigt dessus à plusieurs reprises et dit :
– Elle est fermée parfaitement. Dans un mois il n’y paraîtra plus. Tu peux remercier Dieu.
Il me sembla au contraire, à partir de cette minute, que je portais au front, non pas une cicatrice, mais un sceau de servitude, une marque infamante qui sautait aux yeux et que je garderais toute ma vie.
Je le suivis partout où il voulut ; je l’attendis des heures entières dans la rue, devant une porte ; je veillai la nuit pour lui recopier les papiers de son bureau ; j’allai porter ses lettres d’un bout de Rome à l’autre ; cent fois je gravis les escaliers du Mont-de-Piété, je courus d’usurier en usurier, hors d’haleine, pour lui trouver l’argent dont il attendait son salut ; cent fois, dans un tripot, je restai derrière sa chaise jusqu’à l’aube, mourant de fatigue et de dégoût, tenu éveillé par l’explosion de ses blasphèmes et par l’âcre fumée qui me mordait la gorge ; et ma toux l’impatientait, et il m’accusait de sa déveine ; et puis, quand nous sortions, s’il avait perdu, il me traînait avec lui comme une guenille, dans les rues désertes, sous le brouillard, jurant et gesticulant, jusqu’au moment où, à un détour, surgissait une ombre qui nous offrait le petit verre d’eau-de-vie.
Ah ! monsieur, qui me dévoilera ce mystère avant que je meure ? Il y a donc sur terre des hommes qui, rencontrant d’autres hommes, peuvent en faire ce qu’ils veulent, peuvent en faire des esclaves ? Il y a donc moyen d’ôter à quelqu’un sa volonté comme on lui retirerait d’entre les doigts un fétu de paille ? Cela est donc possible, monsieur ? Mais pourquoi ?
Devant mon bourreau, je n’ai jamais pu vouloir. Et pourtant j’avais mon intelligence ; pourtant j’avais le cerveau plein de pensées ; j’avais lu beaucoup de livres, je savais beaucoup de choses, je comprenais beaucoup de choses. Il y a une chose, une surtout, que je comprenais bien : c’est que j’étais irrémissiblement perdu. Au fond de moi-même, sans trêve, j’avais un effroi, une épouvante ; et, depuis le soir de ma blessure, il m’était resté la peur du sang, la vision du sang. Les faits divers des journaux me troublaient, m’ôtaient le sommeil. Certaines nuits, lorsque, rentrant avec Wanzer, je passais par un couloir sombre, par un escalier obscur, si les allumettes tardaient à s’enflammer, je me sentais un frisson dans l’échine et mes cheveux commençaient à devenir sensibles. Mon idée fixe était qu’une nuit ou l’autre cet homme m’assassinerait.
Cela n’arriva point. Ce qui arriva, c’est au contraire ce qui ne pouvait pas arriver. Je pensais : mourir de ces mains, une nuit, atrocement, voilà mon destin, à coup sûr. Et au contraire…
Mais écoutez. Si, ce soir-là, Wanzer n’était pas venu chercher dans la chambre de Ciro, si je n’avais pas aperçu le couteau sur la table, si quelqu’un n’était pas entré en moi à l’improviste pour me donner la terrible poussée, si…
Ah ! c’est vrai. Vous avez raison. Nous n’en sommes qu’au commencement, et je vous parle de la fin. Vous ne pourriez pas comprendre si je ne vous racontais pas d’abord toute l’histoire. Et pourtant je suis déjà fatigué ; je m’embrouille. Je n’ai plus rien à vous dire, monsieur. J’ai la tête légère, légère ; on dirait une vessie pleine de vent. Je n’ai plus rien à vous dire. Amen ! amen !
Allons, c’est passé. Merci. Vous êtes bien bon ; vous avez pitié de moi. Personne sur terre n’a eu pitié de moi, jamais.
Je me sens mieux ; je puis continuer. Je vais vous parler d’elle, de Ginevra.
Après l’accident du verre, quelques-uns de nos camarades quittèrent la pension ; d’autres déclarèrent qu’ils resteraient si Giulio Wanzer était exclu. Cela fit que Wanzer reçut de la patronne une espèce de congé. Après avoir, selon son habitude, tempêté contre tout le monde, il partit. Et, lorsque je fus en état de sortir, il voulut m’emmener avec lui, il exigea que je le suivisse.
Nous errâmes longtemps de restaurant en restaurant, sans nous décider. Et il n’y avait rien de plus triste pour moi que l’heure des repas qui, pour les gens fatigués, est une heure de soulagement et quelquefois d’oubli. Je mangeais à peine, en me forçant, de plus en plus dégoûté par le bruit que faisaient les mâchoires de mes commensaux : des mâchoires de bouledogues, formidables, qui auraient broyé de l’acier. Et petit à petit commençait à s’allumer en moi la soif, cette soif qui, une fois allumée, dure jusqu’à la mort.
Mais, un soir, Wanzer me laissa libre. Et le jour d’après, il m’annonça qu’il avait découvert un endroit très agréable où il voulait me conduire immédiatement.
– J’ai trouvé. Tu vas voir. Cela te plaira.
En effet, la nouvelle pension était peut-être meilleure que l’ancienne. Les conditions me convenaient. Il y avait là quelques-uns de mes camarades de bureau ; plusieurs autres habitués ne m’étaient pas inconnus. Je restai donc. D’ailleurs, vous le savez bien, il m’aurait été impossible de ne pas rester.
Le premier soir, lorsqu’on apporta le potage sur la table, deux ou trois pensionnaires demandèrent en même temps, avec une vivacité singulière :
– Et Ginevra ? Où est Ginevra ?
On répondit que Ginevra était malade. Alors tous s’informèrent de la maladie, tous manifestèrent beaucoup d’inquiétude. Mais il ne s’agissait que d’une légère indisposition. Dans la conversation, le nom de l’absente vint sur toutes les bouches, prononcé au milieu de phrases ambiguës qui trahissaient le désir sensuel dont tous ces hommes, vieux et jeunes, étaient troublés. Moi, je tâchais de saisir les mots au vol d’un bout de la table à l’autre. Vis-à-vis de moi, un jeune libertin parla de la bouche de Ginevra, longuement, avec chaleur ; et il me regardait en parlant, parce que je l’écoutais avec une attention extraordinaire. Je me souviens qu’alors mon imagination se forma de l’absente une idée fort peu différente de la figure réelle que je vis plus tard. Je me souviens toujours du geste significatif que fit Wanzer et de la moue gourmande de ses lèvres lorsqu’il prononça en dialecte une obscénité. Je me souviens aussi que, quand je sortis, je sentais déjà sur moi la contagion d’un désir pour cette femme inconnue, et en même temps une légère inquiétude, une certaine exaltation très étrange, presque prophétique.
Nous sortîmes ensemble, moi, Wanzer et un ami de Wanzer, un nommé Doberti, celui-là précisément qui avait parlé de la bouche. Chemin faisant, ils continuèrent à causer entre eux de grossières voluptés, et ils s’arrêtaient de temps à autre pour rire à leur aise. Moi, je restais un peu en arrière. Une mélancolie pareille à un chagrin, une surabondance de choses obscures et confuses gonflait mon cœur déjà si oppressé, si humilié.
Cette soirée, après douze ans, je me la rappelle encore. Je n’en ai rien oublié, pas même les plus insignifiants détails. Et je sais maintenant, comme alors je sentis, que cette soirée décida de mon sort. Qui m’envoyait donc cet avertissement ?
Est-ce possible ? Est-ce possible ? Un simple nom de femme, trois syllabes sonores, ouvrent devant vous un abîme inévitable ; et, vous avez beau l’apercevoir, vous le savez inévitable. Est-ce possible, cela ?
Pressentiment, clairvoyance, vue intérieure… Des mots, rien que des mots ! J’ai lu dans les livres, moi. Non, non, ce n’est pas ainsi que les choses se passent. Vous êtes-vous jamais regardé en dedans ? Avez-vous jamais surveillé votre âme ?
Vous souffrez, et votre souffrance nous paraît nouvelle, jamais éprouvée. Vous jouissez, et votre jouissance vous paraît nouvelle, jamais éprouvée. Erreur, illusion. Tout a été éprouvé, tout est arrivé. Votre âme se compose de mille, de cent mille fragments d’âmes qui ont vécu la vie tout entière, qui ont produit tous les phénomènes, qui ont assisté à tous les phénomènes. Comprenez-vous où je veux en venir ? Écoutez-moi bien ; car ce que je vous dis, c’est la vérité, la vérité découverte par quelqu’un qui a passé des années et des années à regarder continuellement en lui-même, seul au milieu des hommes, toujours seul. Écoutez-moi bien ; car c’est une vérité beaucoup plus importante que les faits que vous voulez connaître. Lorsque…
Une autre fois ? Demain ? Pourquoi demain ? Vous ne voulez donc pas que je vous explique ma pensée ?
Ah ! les faits, les faits, toujours les faits ! Mais les faits ne sont rien, ne signifient rien. Il y a au monde, monsieur, quelque chose qui vaut beaucoup davantage.
Eh bien ! voici encore une autre énigme. Pourquoi la vraie Ginevra ressemblait-elle presque trait pour trait à l’image qui avait flamboyé dans mon esprit ? Mais laissons cela. Après trois ou quatre jours d’absence, elle réapparut dans la salle, portant une soupière dont la vapeur lui voilait le visage.
Oui, monsieur, c’était une servante, et elle servait une table d’employés.
L’avez-vous vue ? L’avez-vous connue ? Lui avez-vous parlé ? Vous a-t-elle parlé ? Alors, il n’y a pas de doute : vous avez, vous aussi, ressenti un trouble subit et inexplicable, s’il lui est arrivé de vous toucher la main.
Tous les hommes l’ont désirée ; tous la désirent, la convoitent ; ils la convoiteront toujours. Wanzer est mort ; mais elle aura un autre amant, elle aura cent autres amants, jusqu’à l’heure de la vieillesse, jusqu’à l’heure où les dents lui tomberont de la bouche. Quand elle passait dans la rue, le prince se retournait dans son carrosse, le loqueteux s’arrêtait pour la regarder. Dans tous les yeux j’ai surpris le même éclair, j’ai lu la même obsession.
Elle est changée maintenant, très changée. Alors elle avait vingt ans. J’ai souvent essayé, sans y réussir, de la revoir en moi-même telle qu’elle était quand je la vis pour la première fois. Il y a là un secret. N’avez-vous jamais fait cette remarque ? Un homme, un animal, une plante, un objet quelconque ne vous livre son aspect véritable qu’une seule fois, au moment fugitif de la première perception. C’est comme s’il vous donnait sa virginité. Aussitôt après, ce n’est plus cela, c’est autre chose. Votre esprit, vos nerfs lui ont fait subir une transformation, une falsification, un obscurcissement. Et au diable la vérité !
Eh bien ! j’ai toujours porté envie à l’homme qui pour la première fois voyait cette créature. Me comprenez-vous ? Non, sans doute, vous ne me comprenez pas. Vous croyez que je radote, que je m’embrouille, que je me contredis. Cela ne fait rien. Passons ; revenons aux faits.
… Une chambre éclairée au gaz, surchauffée, d’une chaleur aride qui dessèche la peau ; une odeur et une fumée de viandes ; un bruit confus de voix, et, par-dessus toutes les autres voix, la voix âpre de Wanzer, qui donne à chaque mot un accent brutal. Puis, de temps en temps, une interruption, un silence qui me semble effroyable. Et une main m’effleure, enlève l’assiette devant moi, en pose une autre, me communique le frisson que me donnerait une caresse. Ce frisson, chacun autour de la table l’éprouve à son tour ; cela est visible. Et la chaleur devient étouffante, les oreilles s’échauffent, les yeux luisent. Une expression basse, presque bestiale, apparaît sur les visages de ces hommes qui ont bu et mangé, qui ont atteint le but unique de leur existence journalière. L’étalage de leur impureté me donne un coup si cruel que je me sens près de défaillir. Je me ramasse sur ma chaise, je ramène mes coudes pour élargir l’intervalle entre mes voisins et moi. Une voix crie dans le vacarme :
– Episcopo a la colique !
Une autre :
– Non ! Episcopo fait du sentiment. N’avez-vous pas vu la mine qu’il prend lorsque Ginevra lui change son assiette ?
J’essaye de rire. Je lève les yeux et je rencontre ceux de Ginevra fixés sur moi avec une expression ambiguë.
Elle sort de la salle. Alors Filippo Doberti fait une proposition bouffonne :
– Mes amis, il n’y a pas d’autre solution. Il faut qu’un de nous l’épouse… pour le compte des autres.
Ce ne sont pas exactement les termes qu’il emploie. Il prononce le mot cru ; il nomme la chose et le rôle que les autres joueront.
– Aux votes ! Aux votes ! Il faut élire le mari.
Wanzer clame :
– Episcopo !
– Maison Episcopo et Cie !
Le vacarme augmente. Retour de Ginevra, qui peut-être a tout entendu. Et elle sourit, d’un sourire calme et tranquille qui la fait paraître intangible.
Wanzer clame :
– Episcopo, fais ta demande !
Deux pensionnaires, avec une gravité feinte, s’avancent pour demander en mon nom la main de Ginevra.
Elle répond avec son sourire habituel :
– J’y penserai.
Et de nouveau je rencontre son regard. Et j’ignore vraiment si c’est de moi qu’il s’agit, si c’est de moi qu’on parle, si je suis cet Episcopo qu’on bafoue. Et je ne parviens pas à imaginer la physionomie que j’ai en ce moment-là…
Un rêve, un rêve. Toute cette période de ma vie ressemble à un rêve. Vous ne pourrez jamais comprendre ou imaginer quel sentiment j’avais alors de mon être, quelle conscience j’avais de mes actes en voie d’exécution. Je revivais en rêve une phase de vie déjà vécue : j’assistais à la répétition inévitable d’une série d’événements déjà arrivés. Quand ? Nul ne le sait. Au surplus, je n’étais pas bien sûr d’être moi-même. Souvent il me semblait que j’avais perdu ma personnalité ; parfois, que j’en avais une artificielle. Quel mystère que les nerfs de l’homme !
J’abrège. Un soir, Ginevra prit congé de nous. Elle annonça qu’elle ne voulait plus servir et qu’elle nous quittait ; elle dit qu’elle ne se sentait pas bien, qu’elle s’en allait à Tivoli, qu’elle y resterait quelques mois chez sa sœur. À l’instant des adieux, tout le monde lui tendit la main. Et, souriante, elle répétait à tout le monde :
– Au revoir, au revoir !
À moi, elle me dit en riant :
– Nous sommes promis, monsieur Episcopo. Ne l’oubliez pas.
Ce fut la première fois que je la touchai, la première fois que je la regardai dans les yeux avec l’intention de pénétrer son cœur. Mais elle resta pour moi une énigme.