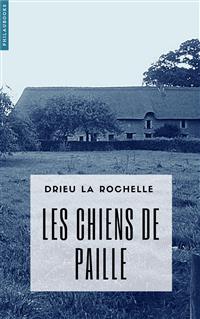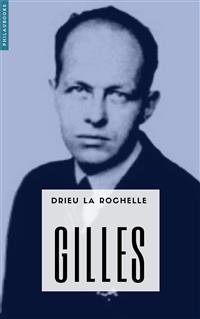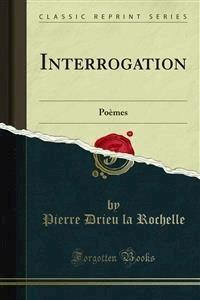1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les enfants ne sont pas de la même époque, de la même race, du même continent que les hommes. Ils vivent dans des âges révolus ou attendus. Compagnons farouchement tendres et dévoués. Ils sont audacieux, cruels, non point amoureux de la nature, mais ses maîtres. Armés par tous leur sens d’une puissante divination, ils parlent avec tout l’univers une langue mystique qu’ils oublient bientôt et ils habitent des terres vierges. Ils ont le corps souple et grêle des sauvages. Comme eux ils se laissent domestiquer, et comme eux ils meurent de la perte de leur liberté.
Il y a des hommes que les autres ont chargé de tromper l’appétit des enfants. Ils écrivent pour eux des histoires comme on jette aux lionceaux des beafsteaks tout découpés. Ce sont des agents provocateurs qui les attirent dans le piège de l’imagination. La race inconnue, sans cesse oubliée des jeunes humains, ardente, sérieuse, impatiente, périt dans les rêvasseries.
Extrait.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
État civil
Pierre Drieu la Rochelle
philaubooks
Copyright © 2019 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.
ISBN : 979-10-372-0079-2
Réalisé avec Vellum
Table des matières
Partie I
1. État civil
2. La peur
3. Dieu
4. L’amour
5. Tradition
6. Lectures et combats
7. Lieux
Partie II
1. Derrière la porte
2. Les faire jouer
3. Dieu
4. Ici commence une autre histoire
Partie III
1. Rencontre de l’époque
2. Petit-fils d’une défaite
3. Pèlerinage d’Angleterre
4. Cogle tourne court
5. Un univers
Partie I
1
État civil
J’ai envie de raconter une histoire. Saurai-je un jour raconter autre chose que mon histoire ? Il était une fois un petit garçon de trois ans. J’écris ce qui me passe par la tête. Mais un ordre s’impose. Tout ce qui me reste de divin, cet ordre.
Où suis-je ? À la campagne. Pourquoi pas à la ville ? Non, à la campagne.
Le jardin est à pic. Une allée descend en escalier sous les arbres. Ce lieu obscur est plein de périls. Mais voici l’ombre favorable du vieux jardinier appuyée sur un râteau.
Je suis là, mais je ne me vois pas. Mon ombre parle à son ombre.
Chaque degré de l’escalier taillé dans la terre est d’une longue enjambée et forme une petite terrasse qui est bordée d’un rondin de bois. Ou plutôt ce rondin est en ciment sculpté à l’imitation d’une écorce. Nul doute : ce contact trop dur et trop froid que je ressens encore.
Une autre impression de vive fraîcheur, mais non plus sur ma main, sur ma joue. J’entre dans la maison aussi rudimentaire à mes yeux qu’un dessin d’enfant. Entre deux pièces claires il y a une séparation bizarre. De chaque côté du seuil sans porte, formé de deux piliers, on a abattu le mur jusqu’à hauteur du genou. Ce qui reste forme une banquette que je chevauche toute la journée. Cette banquette est peinte en jaune. J’appuie longuement mon visage contre sa boiserie. C’est frais.
Dans le salon les meubles sont énormes. Il y a du bleu et du rose. Je me cache derrière un canapé pour manger du sucre dérobé à l’insu de tout le monde sur la table à thé. On savoure une liberté animale dans ce gîte. Je me plais à manger salement pour me détendre de la contrainte qu’on m’impose dans le monde des grandes personnes. Je me fais encore plus petit pour fraterniser avec le chien. Mais là-haut : « Il ne comprend pas, nous pouvons parler ». Je les épie.
Derrière la maison il y a, à un étage plus élevé de la colline, une terrasse. J’entends :
Il était une bergère
Et ron, et ron petit patapon.
Un petit bois où j’ai une chèvre. Elle mange mes fraises. Je tâche de l’en empêcher. Coups de cornes.
Entre le jardin et la rivière, je traverse d’abord la route où passe un tramway. Il me fait peur parce que je suis renseigné : la locomotive est un ogre. Plus loin des champs. Un dimanche matin mon père m’y promène, je le vois rarement, je suis fier et heureux.
Encore un jardin. Des enfants plus grands que moi, des filles. Après ma première leçon d’écriture, on nettoie mes doigts tachés d’encre avec de l’oseille.
Une maison au milieu d’un champ. C’est là qu’habite le vieux jardinier. Sa mère est vieille, vieille.
Allons chercher Bon Papa à la gare.
À Paris. Dans la salle à manger, le long du mur il y a trois chaises de cuir sur lesquelles je m’allonge : « Tu vas tomber ». Le cuir sent bon. J’y écrase mon nez. Encore cette fraîcheur.
Un soir un ami dîne. Il s’appelle M. Bara. Je suis satisfait, pourquoi ? C’est un homme extraordinaire. Je ris pour faire comme les autres. Cela m’amuse beaucoup de rire.
La maison de mes parents était proche de celle de mes grands-parents. Sur le chemin il y avait une minuscule boutique noire où l’on achetait des images à une vieille petite demoiselle. Elle a pour moi un respect attendri.
C’est tout.
Tiens, je me rappelle une heure passée avec ma chèvre. C’est sûrement le matin. La lumière qui ailleurs assène ses coups passe délicatement les doigts à travers le feuillage et me caresse. Mais non, ce sous-bois, c’est un tableau dans le cabinet de mon grand-père. Et, il y a un mouton au premier plan, non pas une chèvre. C’est tout.
Aujourd’hui, le ciel gris est une paupière baissée. Pourtant un soleil se lève, c’est ma conscience. Je suis né aujourd’hui et j’écris. Il n’est que ce soleil qui s’échauffe en moi à cette heure. Je suis l’astre solitaire qui illumine le monde.
Pour moi le temps n’existe pas qui se succède. Il n’y a qu’un moment éternel, le moment où je pense.
Mon soleil, je ne connais que toi. Qu’est-ce que les soleils abolis ? Ont-ils été ? Je renonce à la foi des hommes qui s’assurent qu’un soleil s’est levé il y a quelques années et que ce fut le jour de leur naissance, aussi évident que ce jour qu’ils sont en train de vivre.
Mais mon soleil s’embrase de toutes parts. Voici que s’éclaire une zone, une hémisphère, que j’appelle le passé, qui est une partie de mon être, mystérieux comme une sphère.
Reprenons le langage des hommes. Quand et où suis-je né ? Dans ce jardin sous les yeux de ce bonhomme, c’était le matin... J’appelle ma naissance le moment où je suis devenu conscient d’être le personnage que je suis encore, le seul que j’ai rencontré au monde. Rien ne me certifie que dans ce jardin j’ai commencé d’être celui que je suis. Ai-je vu ce jardin avec le même œil qui voit maintenant cette table ? N’étais-je pas un autre dont l’étrangeté ressemble aux effets du sommeil ? La vue de ce jardin s’était imprimée peut-être dans mon esprit comme sur une plaque photographique et c’est seulement depuis quelque temps qu’elle est révélée. Ces deux actes se sont-ils accomplis pendant le même ploiement du ressort ? Où a-t-on remonté la montre ? Il me semble que j’ai toujours vu ce jardin. J’ai lu des livres de psychologie, mais je les ai oubliés. Je vis, je fais un certain système de ma vie, et j’ai pris la plume pour tracer ici ma mince vérité. Je rêve que je suis un enfant de trois ans. Ai-je vraiment ces cheveux blonds, ou suis-je chauve ?
« Bonjour ma mère. Te rappelles-tu un petit garçon de trois ans ?
— « Oui, je me rappelle même plus loin en deçà quelque chose dans mon sein qui pouvait devenir quelqu’un et j’espérais que cela deviendrait un petit garçon et un monsieur comme toi maintenant.
— « C’est toi qui as vécu plusieurs années de ma vie ! »
Une ombre émerge de ma préhistoire. Je savais peu de moi-même, moins que des choses autour de moi. Je ne me reconnaissais pas. Est-ce que je savais me regarder dans une glace ? Un jour pourtant je me suis rencontré. Je suis devenu double. Je ne me le rappelle pas.
Ainsi donc j’ai vécu sans périls, sans épreuves, pendant des années ? Pourtant, j’ai pleuré. Ce froid qui m’a saisi à la première heure, la cruauté de ce jour qui lacérait mes paupières. Je ne me rappelle rien. Quand donc fut ma première angoisse ? Quand donc le premier soupçon ?
J’étais faible, affaibli par trop de puissance. Le petit Cogle était fils de roi, l’unique et puissant héritier des hommes. Mais ma puissance était hors de moi, faite de celle des autres. Mon corps et mon âme dépérissaient depuis ma naissance accablés par tant de dons. Mes élans étaient prévenus par l’offre perpétuelle de toute chose. Mon espèce, ma classe m’empêchaient de revivre leur passé, leurs conquêtes étaient un mur entre moi et le monde. Quand je suis devenu celui que je suis encore, mes plus hautes prouesses s’étaient accomplies. J’avais appris une langue, pour avancer je me servais de mes jambes comme d’échasses.
Je ne sais comment cela est arrivé et si ma mère ne me l’avait pas raconté plus tard je n’aurais jamais su que ma nourrice m’avait laissé tomber sur un perron et qu’on me vit pendant longtemps condamné à la laideur et au désespoir.
J’ai vécu ignorant auprès de ma mère qui filait distraitement ma mémoire. Ne serait-elle pas anéantie si ma famille ne m’en avait transmis le fragile récit, la vie de ces petits personnages qui ont porté mon nom ? Livrés à eux-mêmes ceux que j’ai été jusqu’à cinq ou six ans seraient morts.
Quand je naquis à moi-même, les hommes me connaissaient déjà depuis trois ans ? Ils m’ont connu avant que je me connaisse. Je veux bien les croire. Jusqu’à trois ans, j’étais encore dans le monde, je faisais encore partie de ce qui est mon commencement, ma fin. Mais pour un instant, chère minute, je suis cela qui est différent du monde. Humain. Tout ce qui précède la scène du jardin est aussi obscure que la vie antique de mes éléments, le ventre de ma mère, la terre qui comblera mes orbites, mes bons sommeils, la folie qui est l’aventure d’un prisonnier abandonné par ses geôliers.
Soleil d’aujourd’hui je ne connais que toi.
Le sang, ce hiéroglyphe se dessine partout sous ma peau, mystérieux comme le nom d’un dieu. Je subis son influence mais je ne saurai jamais trouver le mot magique où elle se sublimerait. Le sang est subtil comme l’esprit. Des maladies passent dans le sang et la couleur des yeux.
Je voyais que tel de mes gestes était de cet homme-ci. « Je suis son fils ! Mais d’un autre que je n’ai vu qu’une fois j’ai gardé pour toujours la façon d’ouvrir les yeux. Mon corps, sans que je m’en doute, s’abandonne à ceux qui m’approchent. La face, les membres d’un jeune homme sont offerts. Chacun porte la main sur moi, l’un me plie le bras, l’autre tire ma lèvre, un troisième pince les cordes de ma voix.
Quand j’ai eu quinze ans, j’ai compris que, mes parents étaient morts avant ma naissance, et que l’instinct pouvait me lancer sur des étrangers. S’il me voit près de mon père, un sot s’écrie : « Comme ils se ressemblent ». Mais un observateur : « Comme ils sont différents ». Entre les grandes lignes de ma figure qui acceptent une correspondance formelle, mille inflexions s’accusent par quoi je me dérobe à la domination de l’homme qui a été auprès de moi le représentant des hommes. Si ma mère s’approche à son tour, voilà le sot qui s’étonne encore. Mais mon père et ma mère s’opposent irréconciliablement et ils ne s’harmonisent qu’en moi qui les anéantit.
Enfin je tiens de celui-ci ou de celle-là dans la famille des traits particuliers qui n’évoquent que la futilité de la Nature ou ses intentions par trop dissimulées, ou les accidents qui lui arrivent on ne sait d’où.
Le sang est un fleuve immense, anonyme comme les siècles, qui me traverse venant des origines du monde. Réfléchit-il plutôt les derniers paysages qu’il a baignés ? Cela peut être vrai, mais mes yeux ont reflété des aspects qui ne se reconnaissent plus sur cette planète, et ils m’étaient plus familiers que les berges du plus proche amont. De quel droit un père parle-t-il seul, au nom des absents ? J’en appelle si je veux, à de lointains ancêtres, je dis que je suis celui qu’ils attendaient et comme un dieu à ses précurseurs, je leur prête ce qu’ils m’ont donné mais qu’ils n’ont pas connu.
Si j’avais été un enfant abandonné à un poteau-frontière, quelle eût été ma patrie, ma religion, ma classe ? Des crapules peut-être auraient changé mon sexe.
Mais j’ai été séparé de tout ce qui se confond avec la mort, j’ai été admis à ce que les hommes appellent la vie, je suis toujours resté dans le même lieu, je connais quelques-uns de mes ancêtres, dans tous les sens j’ai des liens solides avec ce qui existe.
Du reste si j’avais été perdu, tôt ou tard il en serait advenu de même. Peut-être aurais-je été élevé en Allemagne ? J’aurais été un Allemand comme les autres, car les hommes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils peuvent à la rigueur discerner un nègre d’un blanc, mais si la clairvoyance ne leur est pas facilitée, si un Français parle allemand depuis sa naissance, ils le prendront pour un Allemand et lui-même n’y verra que du feu. J’ai du reste joué à ce petit jeu-là pendant la guerre. J’avais laissé pousser ma barbe, elle tirait en touffes diverses sur le roux, l’albinos, le châtain. J’avais trouvé une calotte bavaroise. Je m’amusai à ahurir mes camarades par une brusque apparition boche au détour de la tranchée. Je ne croyais pas que mon geste fût sacrilège et insultât en rien à la sainteté de la patrie. J’avais vu aussi une photo qui représentait des soldats anglais et français mêlés ; en signe de fraternité ils avaient échangé leurs uniformes. Je n’avais pas lu la légende et j’admirais sous la casquette plate le caractère britannique de telle figure paysanne de chez nous. Cela ne faisait pas honneur à ma science des physionomies.
Mais pourrait-on camoufler toute une race ? Je me trompais sur quelques-uns, mais si pendant plusieurs années, l’Allemagne et la France échangeaient leurs nouveau-nés, un voyageur après un long séjour à l’étranger constaterait à Paris quelque chose d’insolite dans les visages de la jeunesse, en dépit de l’art des tailleurs, de la délicate influence de l’air et du contact des femmes.
« Ah ! s’écriait-il, nous n’avions pas des gueules comme celles-là dans notre génération ! »
Je ne me risque qu’à ces suppositions superficielles sur les déguisements changeants que sont les physionomies interprétées selon nos préjugés sociologiques et autres. Pourtant les avatars les plus intéressants sont ceux de l’esprit. Mais le jeu est audacieux de parier sur l’application des lois inexorables et inconnues. Il me faut tout de même avouer que je soupçonne que ces transplantés seraient plus français intérieurement qu’extérieurement. Car enfin ils aimeraient Racine, ils craindraient Kant, et avec notre rigueur même qui coupe fin mais qui sépare entièrement. Il n’y aurait personne — on leur cacherait le secret de leur origine — pour leur insinuer l’idée sans laquelle aucun instinct ne leur manifesterait qu’ils sont autres qu’ils ne croient être.