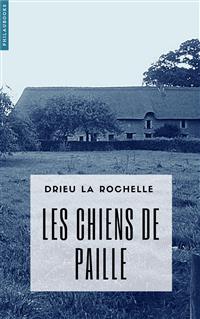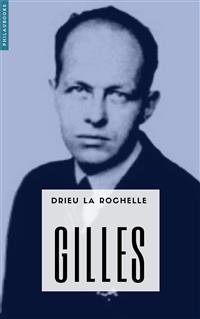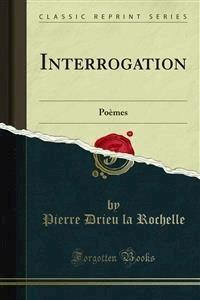Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce roman est le dernier de Drieu la Rochelle. Il l'écrivit de 1943 à 1944. À propos d'une intrigue assez simple, qui pourrait être celle d'un roman d'aventures – la lutte, autour d'un dépôt d'armes caché dans une demeure mystérieuse, de petits groupes de Français activistes (gaullistes, collaborateurs, communistes, nationalistes) –, Drieu a imaginé un roman qui transcende de très haut les drames de ces années. Constant, dernière incarnation des héros de Drieu – un Gilles vieilli –, qui a tout connu, tout éprouvé, tout lu, bien qu'encore profondément attaché à un jeu politique dont il occupe le centre, regarde d'un œil de plus en plus absent les fureurs et les intrigues de ces hommes de proie. Pour lui qui, depuis des années, médite sur Judas et la signification de son prodigieux destin, le temps de Dieu et le temps de la mort sont venus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre Drieu La Rochelle - Les chiens de paille
PRÉFACE
J’ai écrit ce petit livre au printemps 1943. Comme ses parties extérieures étaient faites de l’actualité la plus éphémère, la plus insidieuse, qui se trouvait être celle de 1942, avant les débuts véritables de la guerre civile, j’ai voulu le laisser dormir longtemps pour voir si les actualités suivantes n’allaient le tuer sinon dans ses œuvres vives que je croyais à l’abri, du moins dans ces dehors qui en se fanant et en retombant sur les œuvres vives pourraient les étouffer.
Mais je me suis rappelé que tout livre est lié au moment où il a été fait et qu’il ne peut prendre vie que dans ce moment. Ensuite, peu importe que certains de ses éléments vieillissent, ils vieillissent avec toute la vie. Et ce vieillissement lent et insensible permet à la substance la plus profonde, s’il en est une, de transparaître à la lumière.
J’ai constaté en relisant cette brève fable, à quel point moi qui suis devenu depuis plus de dix ans un homme d’opinion tranchée, je suis resté sensible à l’existence des autres. Oh certes, quelque chose d’essentiel m’échappe en eux, surtout quand, dépassant eux et moi et le monde des opinions pour m’efforcer dans un autre monde, je jette en arrière sur eux comme sur moi un regard plus dédaigneux que charitable ; mais enfin je ne les ignore pas tout à fait. Cela m’autorise à prendre dans des doigts qui se prétendent d’artiste encore après l’avoir été de polémiste ces questions déchirantes comme des lames de couteaux : je m’y blesse autant que j’y blesse les autres.
Je suis resté un artiste, et je le suis même devenu davantage en m’assurant par ailleurs dans mes préférences passionnées. Quel est celui de nos maîtres du passé qui n’a pas été à ses heures un homme d’emportement ? Même les sectateurs de l’art pour l’art prenaient encore parti, en osant se détacher de la société.
Un artiste est, tour à tour, détaché et attaché, riche et pauvre ; il fait sa richesse de demain de sa pauvreté d’hier et reparaît plus secret dans un roman après une campagne dans les journaux.
D’avoir attendu au moins quelques mois me permet de donner ce livre en toute présence d’esprit comme un document irrémédiable qui porte l’horrible palpitation d’un moment. Il fera crier, il me fait crier. Combien de lignes je voudrais déjà modifier. Mais impossible.
J’ai cru aussi que ce livre ne pourrait pas « passer ». Et pourtant il « passe », on le laisse passer. Sans doute comprend-on que le meilleur argument pour intéresser à la défense européenne, c’est de montrer tout ce qu’elle contient d’angoisse.
Un écrivain, qui est un socialiste européen, qui dénonce l’invasion et la destruction de l’Europe, a écrit cette brève histoire en même temps que ses articles de combat. Il n’a pas craint de montrer tous les doutes, toutes les réticences, toutes les langueurs, tous les regrets dont il étouffe l’intime sédition au fond de sa poitrine.
Cela a été principalement incarné et réduit dans un personnage, Constant, qui représente assez bien je crois une des tendances existant chez les intellectuels d’aujourd’hui en France. Constant n’est pas l’auteur. Un personnage n’est jamais l’auteur ; un personnage n’est jamais qu’une partie de l’auteur.
La route n’était pas large, encaissée entre deux murs de sapins qui pesant sur elle tantôt d’un côté tantôt de l’autre lui imposaient des perspectives sans avenir. « Je n’aime pas le vert, mais surtout je n’aime pas ce vert-là », mâchonnait le râtelier de Constant tandis que ses jambes variqueuses se ployaient et se déployaient sur son beau vélo de course. « D’un autre côté, j’aime mieux cette route tout le temps abrégée que celle de tout à l’heure avec son ruban indéfini. Ce pays-là est bien fermé. Pour le moment il ne me dit rien du tout : mais quel est le pays qui ne parle pas quand on l’interroge ? Un homme fait mieux parler un pays qu’un homme. J’aime les forêts, mais je n’aime pas les forêts de sapins. Sauf dans les vrais pays du Nord. Mais n’es-tu pas dans un pays du Nord ? Voire. Regarde le ciel. Les hommes, surtout quand ils sont à vélo, ne regardent pas le ciel. Le ciel est d’un gris sans nom et pourtant il écrase moins la route que ces deux murs de sapins. J’aime les pays fermés, ils ne vous trompent pas. » Un motocycliste tout gris le passa avec une indifférence hiératique. « Les puissants me doublent ainsi depuis toujours, mais moi j’avance vers la mort tranquillement. »
Une borne lui annonça qu’il approchait. Brusquement les bois de sapins cessèrent, mais le pays n’en resta pas moins court ; tout plat, il finissait à la première haie. Un ancien garage était au bord de la route, un homme était devant le garage. Constant sauta de sa monture. L’homme était petit et noiraud. « Il n’est pas du pays, c’est un de ces mécanos échappés de la ville. Tiens, pourtant il a des yeux verts. »
— Tu connais par ici la maison d’un M. Susini ?
Le petit noiraud, qui l’avait tranquillement regardé venir, posa sur lui un regard encore plus tranquille.
— La Maison des Marais ? Oui, je vais t’expliquer.
Il expliqua avec une précision insolite, une autorité agressive, tout en le dévisageant, en lui dépiautant le masque avec un couteau. Mais sur les os de Constant, masque et visage, meurtris et tannés, ne faisaient qu’un. Et il avait lui aussi un regard à jamais dégainé que rien ne pouvait faire dévier. Cela mettait tout de suite chacun de plain-pied avec l’autre.
— Mais il n’est pas là, Susini, fit le noiraud.
— Ça ne fait rien.
— Tu ne trouveras personne à qui causer.
— J’attendrai. C’est Susini qui m’envoie.
L’œil vert était de plus en plus tranquille. Il parcourait le personnage considérable et délabré, les vastes épaules près de crouler et qui ne croulaient pas, ses vêtements usagés et cocassement commodes.
— Ah, c’est différent.
— Et toi, ajouta Constant, comme répondant à la réflexion du petit noiraud, qu’est-ce que tu fous là, maintenant qu’il n’y a plus d’autos ?
L’autre dédaigna de répondre « Je bricole », mais avec son audacieuse tranquillité il proposa :
— Tu as soif. Viens boire un coup.
— Pas de refus.
Ils entrèrent. L’intérieur était propre, d’une austérité un peu surprenante : il n’y avait pas les petites babioles habituelles sur les murs. Une jeune femme montra le même regard impassible.
— Donne-nous de la bière.
Ils s’accoudèrent à la toile cirée, ne se regardant plus avec attention, chacun ayant fait son plein de l’autre. Constant sortit un paquet de caporal. Le noiraud sourit froidement.
— Tu dois en avoir plein tes poches avec Susini ?
— On a ce qu’il faut.
Quand la bière fut là et qu’ils en eurent bu :
— Tu travailles avec Susini ?
— Il m’a donné du travail à mon retour d’Allemagne.
— Évadé ? Vieille classe ?
— Oui.
De nouveau le regard vert s’attachait :
— Oui, tu avais fait l’autre.
— Dame… Je vois que tu connais Susini.
— Oui. Il passe par ici quand il vient. Je m’occupe de ses bagnoles. Il n’y a pas très longtemps qu’il a la maison.
— Et toi, il y a longtemps que tu es dans le pays ?
— Quelques années.
— Tu n’étais pas mobilisé ?
— Réformé.
Le petit noiraud avait l’air chétif, mais il était dur par en dessous.
— Tu vas rester longtemps chez Susini ? demanda-t-il.
— Je ne sais pas.
On ne sait jamais avec Susini. Y a que lui qui sait ce qu’il veut.
— Dame.
Tu étais déjà venu par ici ?
— Autrefois.
Constant n’était jamais venu dans ce pays plat et gris, mais il avait beaucoup voyagé et aussi dans des pays plats et gris.
— Tu n’es pas de Paris, fit le noiraud.
— Si. Et toi ?
— On ne dirait pas. Moi, je suis de Paris.
— C’est possible.
Ni l’un ni l’autre ne cherchaient d’effet, mais l’un et l’autre marquaient les coups imperceptibles, sans rien préjuger du résultat d’ensemble. Ils parlèrent encore un peu de choses et d’autres, délimitant patiemment la zone de résistance de chacun.
— Je vais m’en aller, fit Constant. Combien je te dois ?
— Rien.
Dehors, Constant vit sur la façade son nom : Gabriel Salis.
— Viens me voir chez Susini.
— Oui.
Il enfourcha son vélo et fila, ses grandes épaules disloquées sur le guidon. L’autre se dit : « Ce qui fait sa force, c’est ce râtelier, on croit que c’est son point faible, et c’est par là qu’il se défend le mieux. Susini choisit bien ses hommes. »
Constant fila entre des haies : le pays commençait à lui plaire. « S’ils sont tous comme celui-ci. Mais non, c’en est un comme on n’en rencontre que de loin en loin. Le reste, ce sera du mou. Est-ce ici que je finirai ma vie ? Il faut pourtant que je la finisse. J’arrive à des âges impossibles. La sagesse des vieillards, il y a longtemps que je suis dedans. Après tout, le vert du sapin a du bon : je dis toujours que je n’aime pas le vert, c’est une couleur qui me borne. Mais combien de verts m’ont contraint à saluer. On est bien obligé de saluer la nature puisqu’on a un chapeau et une main au chapeau. » Il n’avait pas de chapeau, mais une énorme tignasse poivre et sel, coupée court.
Il filait entre les haies larges et hautes. De temps en temps une maison basse, peu de monde. Pas de Fritz. « Ils sont plus loin, en haut dans la baie. » Il suivait avec sûreté l’itinéraire de Salis. Il savait amèrement les petites choses de la vie et de mieux en mieux à mesure que le moment de l’autre chose se rapprochait, moment désiré dans une vie nullement méprisée, savourée au contraire. « Mais la sagesse des vieillards, non c’est trop facile ; quand on a connu la sagesse d’un jeune homme qui se jetait durement à la découverte de la vie et en même temps de l’au-delà de la vie… »
Il arriva à la longue allée qui menait à la Maison des Marais. Il sauta à terre et alluma une cigarette. « Encore une, il y en a toujours une. » L’allée d’arbres formait chaussée et du côté droit, vers le nord-ouest, c’était déjà le marais. Il passa entre les arbres pour se rapprocher du bord. La chaussée se déhanchait un peu et on apercevait, au-delà de l’eau plate, le terre-plein et la maison. Une longue maison basse, de briques et de pierre, bien encapuchonnée sous des pentes gondolées de tuiles anciennes. C’était vieux, solide, solitaire, tout à fait étranger au temps présent et pourtant complice de tous les écoulements du temps.
— C’est bien, c’est bien, fit-il à haute voix. Je pourrai rester là un bout de temps. Voilà une bonne halte.
La cigarette était odorante dans le gris et le calme. Le marais s’étendait assez loin, coupé de chaussées et de haies et de lignes d’arbres. Par l’atmosphère ouatée et empaquetée, c’était un peu la Poméranie, s’il le voulait. Une Europe basse et grise, une Europe poméranienne, puis batave et frisonne, s’allongeait jusqu’ici, jusqu’où César avait poussé ses légions qui avaient enfoncé leurs pieux réglementaires dans la vase. Et tant de dieux qui marchaient avec elles. Y avait-il une différence fondamentale entre ces dieux et ceux de ces marais ? Ceux du marais étaient moins connus, et pourtant ils vivaient encore dans l’âme des hommes, et peut-être dans celle de Constant. « J’ai connu les routes et les dieux, et leurs odeurs particulières. À vos souhaits. »
Il enfila son vélo et la chaussée.
La maison était gardée par deux femmes aussi édentées l’une que l’autre, bien que l’une fût jeune si l’autre était vieille. Elles avaient cet air convaincu et satisfait de tous les gens qui servaient Susini, cet air bien abrité des pauvres qui aident à s’enrichir ceux qui ont prouvé une fois pour toutes qu’ils savent le faire. De l’autre côté de la maison, les marais étendaient vers l’ouest des moires presque sans entraves de chaussées et de lignes d’arbres et finissaient à une ligne de sable. La vieille conta que la mer était au-delà de cette ligne de sable.
Deux jours après, un monsieur vint voir Constant.
— J’étais venu voir si Susini était là.
— Je ne sais pas quand il viendra.
— Il reste quelquefois très longtemps sans venir.
Le monsieur qui était devant Constant l’examinait avec une curiosité incapable de se dissimuler. C’était un de ces corps trop grands, trop maigres avec des dents en avant vertes et sales, comme en produit la province avaricieuse, alcoolique, tarée. Ces hommes-là portent la syphilis dans leur honorable état civil bourgeois. « Moi aussi j’ai la syphilis, songeait Constant, mais c’était une syphilis d’Afrique jeune et forte qui autrefois m’a travaillé à chaud. » Il était obligé de faire effort pour se rappeler cette syphilis de jeunesse qui avait si vigoureusement tordu et laminé sa perspective de vie. Était-ce elle qui lui avait fait perdre ses dents ?
— Je m’appelle M. Philippe Préault. Je suis le directeur de l’usine de métallurgie qui est à l’embouchure de la Vère. Vous connaissez ?
— J’ai été en vélo jusqu’au bord de la Vère et j’ai vu votre usine de l’autre côté. Je m’appelle Constant Trubert.
À gauche de la Maison des Marais, vers le sud-ouest, les marais et les sables finissaient au bout d’une morne rivière canalisée et au-delà on apercevait une longue usine basse, plantée de deux puissantes cheminées.
— Mais vous travaillez encore ?
— Oui, pour les Allemands.
— Et les Anglais vous laissent ?
— Sans doute ont-ils d’autres chiens à fouetter.
M. Préault scrutait Constant avec une hâte désordonnée. « Ce n’est pas comme Salis. » Visiblement, ce M. Préault était venu pour lui, pour savoir qui il était et ce qu’il faisait là. Par qui avait-il été prévenu ? En dehors des vieilles femmes, Constant n’avait encore causé qu’avec Salis. Mais il y avait les gens rencontrés sur les routes. N’ayant pas grand-chose à faire, il avait déjà beaucoup roulé et marché ; ce pays, il commençait à le comprendre et à l’aimer dans l’aveu lent et long de sa platitude, dans sa rêverie cernée et concentrée. Ce n’était pas brillant, ça ne disait que ce que ça voulait dire.
Je suis étonné de voir comme les Allemands ont peu fortifié la lagune.
La lagune est dans le fond de la baie. Les entrées de la baie sont très fortes. Et puis, quand même, vous avez vu les fortins dans les dunes.
Je ne me suis pas encore trop risqué dans les dunes. Je suis un inconnu dans ces parages.
— Évidemment, vous avez raison. Vous avez fait cette guerre ?
— Les deux. Et vous ?
— Oui, je suis capitaine de réserve d’artillerie.
Les hommes se parlent toujours de la guerre, même quand ils ne l’aiment pas ou la font mal. Celui-ci devait aimer l’armée plus que la guerre : les hommes voient plutôt le moyen que la fin.
— Moi, j’étais dans l’infanterie, admit Constant.
— Mais excusez-moi, vous êtes d’une vieille classe.
— Oui, mais j’étais volontaire.
Le visage de Préault s’éclaira.
— Ah, très bien.
Constant ne haussa pas les épaules. M. Préault se crut encouragé.
— Ce n’est pas fini.
— Non, ce n’est pas fini, répondit Constant, constatant un fait général plus que particulier, sur un ton doux, mais court.
— Et vous avez été fait prisonnier ?
Tiens, c’est le garagiste Salis qui a averti ce M. Préault.
— Oui.
— Vous avez été rapatrié avec les vieilles classes ?
Ils ont rapatrié les vieilles classes ; leur calcul n’était pas mauvais, je suis bien fatigué.
— Je comprends ça, fit M. Préault avec regret.
Constant et lui se racontèrent leur courte campagne.
M. Préault s’en alla, respectant sans conviction la réserve du nouvel employé de M. Susini. On devait se revoir.
Constant reconnaissait pas à pas ce pays naturellement fermé sur lequel pesait encore la contrainte de la guerre. Mais n’y a-t-il pas toujours plusieurs contraintes sur un pays ? Les marais étaient ternes, les bois étaient muets, les gens bouche cousue. Il avait porté à la Kommandantur les papiers qui l’autorisaient à séjourner dans la zone côtière et, les jours suivants, il avait lié connaissance comme il convenait avec quelques Allemands. Il savait quelques mots d’allemand. Après cela il s’était risqué à circuler dans la zone des dunes qui était entre la mer et les marais. Cette zone l’attirait pour sa douceur blonde et parce qu’en temps ordinaire il y aurait chassé les oiseaux de mer. Comme il aurait aimé les longs affûts dans ces creux de sable, embroussaillés de plantes dures. Ces temps-ci la mer était aussi plate que le marais. Il ne s’extasiait pas beaucoup sur la mer, il l’avait trop connue dans sa rondeur étroite, quand on est dans son plein : c’est comme la cour d’une prison entourée d’un mur circulaire, avec une cargaison de forçats au milieu. Il aimait mieux la forêt ou le désert. Les déserts étaient les lieux du monde où il s’était trouvé le mieux. Pourquoi les avait-il quittés ? Il avait à jamais au fond de son âme l’âme du désert. Ces dunes, c’était un peu le désert – ces terrains nus, parlant un langage sobre et net à travers les longues lignes enlacées d’une écriture indéniable. Le désert n’est pas vide, il porte des broussailles qui sont les signes de l’ascétisme. Près d’un gros fortin allemand il aima d’abord surtout la pointe de sable qui était à l’extrémité de la Vère, face à l’usine de M. Préault.
Salis vint le voir. Constant déboucha une bouteille de Cinzano. Susini faisait bien les choses, ici comme ailleurs : il y avait une bonne réserve d’alcool et de tabac.
— Tu travailles ou tu ne fous rien ? demanda Salis.
— Je ne fous rien, j’attends Susini qui me fera peut-être travailler.
— Tu as déjà travaillé avec lui ?
— Oh, oui, depuis plusieurs mois.
— Alors, tu es à la page ; d’ailleurs, tu devais y être avant.
— Dame.
— Susini ne t’a rien dit de spécial pour ici ?
Non, mais est-ce que je peux quelque chose pour ton service ?
Peut-être, pas aujourd’hui. J’ai des copains qui ont besoin d’être aidés.
— Le vivre et le couvert ?
— Les vivres, comme tu dis ; pour le couvert, ils aiment mieux la forêt en arrière.
Constant sourit intérieurement : les hommes comme Salis avaient toujours confiance en lui, ce n’était pas seulement à cause de Susini.
— Il y a des réserves de vivres ici, tu peux envoyer tes types, déclara Constant.
Il ajouta aussitôt :
— Il y a un M. Préault qui est venu.
— Ah, Préault. Oui, c’est un drôle de mec, hein ? Un peu déjeté, mais il a de bons côtés.
— Qu’est-ce qu’il fait dans son usine ? Il travaille pour les Fritz ?
— Il ne les aime pas.
— Probable.
— Et toi ?
— Et toi ?
— Préault fait de la ferraille pour leurs bunkers. Ils le laissent entrer un peu partout, et pourtant ils savent qu’il ne les aime pas.
Qu’est-ce que tu veux qu’ils fassent d’autre. Ils ont besoin de lui… Il n’y a pas grand monde dans le pays.
— Y a encore pas mal d’ouvriers chez Préault, ils habitent de l’autre côté de la Vère, surtout à Pont-de-Vère. En dehors de ça, c’est des croquants.
— Ils sont pas causants.
— Ils se méfient.
Constant poussa ses randonnées du côté opposé à la Vère jusqu’à la base de la presqu’île qui ferme la baie de Wahy au fond de laquelle, derrière les dunes et le marais, était la maison de Susini. Par là il y avait beaucoup d’Allemands. Pourtant, il trouva un coin à la limite de la dune et du marais qui devint son coin préféré.
Au revers de la dune, il y avait un bouquet de sapins d’où l’on pouvait contempler en arrière tout le marais et au loin la Maison des Marais. Il se couchait dans un creux et sortait un livre. Tous les livres qu’il lisait, il les avait déjà lus, aux quatre coins du monde. Quelle idée d’être revenu en France. Mais le monde entier était maintenant à peu de chose près comme la France. Là ou ailleurs, il pouvait aussi bien attendre la mort qui venait. Par-dessus l’épaule de la mort, il regardait ce qui ne se voit pas. Il ne lisait que des livres qui parlaient de cela. Ces livres répétaient tous la même chose, et ils étaient touchants et précieux pour leur monotonie de plantes ascétiques dans le désert. Il n’en lisait pas long : une phrase suffisait et sur la trace d’une méditation ancienne son esprit de plus en plus familier avec lui-même coïncidait aussitôt avec l’essentiel de son passé, de sorte qu’il n’y avait qu’un présent aussi insistant que l’aiguille d’une boussole en plein Oural magnétique. Il lisait une phrase et dans le sable il considérait le signe infini que faisait une touffe d’herbes sèches et salées. Dans son esprit la phrase et la touffe étaient nouées. Il était ce nœud et le monde était ce nœud.
Il était ailleurs, mais aussi dans le marais. Étant dans le marais une pensée amère le traversait : comme je sais bien me cacher. Il était passé dans la vie absolument inaperçu ; ses amis n’avaient pas connu sa famille et ne s’étaient pas connus entre eux. Non par calcul, mais par instinct il avait empêché leur conjuration et ces rares amis l’avaient perdu tôt ou tard. « Un ami ne peut pas vivre plus longtemps qu’un chien. » Mais alors si les autres ne le voyaient pas et qu’il les voyait, il était un spectateur ? Non, il avait agi, sa vie avait été une action secrète, une action rare. Dans chacun de ses jours, il y avait eu une pensée et un acte qui n’avaient fait qu’un et qui avaient imprégné ce jour d’une seule odeur, de sorte que le jour était tombé indélébile goutte d’essence dans l’éternité. Chaque jour avait eu la saveur d’une pensée et chacune de ces pensées avait eu la saveur d’un acte. Mais avait-il assez agi ? Maintenant qu’il allait mourir, ne fallait-il pas au dernier moment penser et agir d’une façon suprême ? On ne peut jamais si bien vivre qu’au moment où l’on meurt, si toutefois l’on meurt jeune. Il faut savoir mourir jeune.
Sachant se dissimuler et passer inaperçu dans ce marais, comme il avait fait dans la vie, le vieux Constant peu à peu s’emparait de toute la vie du pays. Les humains comme les animaux et les choses tombaient peu à peu dans son filet. Un jour il aperçut une silhouette de femme dans ce petit bois de sapins qui était à la limite des dunes et des marais. C’était une silhouette bien formée ; complaisamment formée d’une main oisive, ce n’était pas la masse brute d’une paysanne.
Préault revint :
— Mon cher Trubert, Salis m’a dit que vous lui aviez proposé d’abriter à la Maison des Marais de ses camarades, je n’attendais pas moins de vous, un volontaire dans l’infanterie, à quarante… Pardon, de quelle classe êtes-vous ?
— J’ai dans les quarante-cinq ans, cinquante ans. C’est curieux, je ne peux rien dire à Salis sans qu’il vous le répète.
— Mon cher, Salis et moi, nous sommes liés par les mêmes sentiments, la même haine et le même amour. Il n’en a pas toujours été ainsi : nous étions violemment opposés dans ce pays.
— Est-ce que l’aspect des choses a beaucoup changé pour lui comme pour vous ?
— Nous partageons les mêmes espoirs et les mêmes risques.
— Vous courez en effet de grands risques ; vous vous confiez au premier venu, vous ne savez pas qui je suis.
— Ça se sent tout de suite.
— Croyez-vous ?
— Et puis, nous connaissons les sentiments de M. Susini. Si vous travaillez avec lui…
— Vous avez de la chance, si vous connaissez les sentiments de M. Susini.
— C’est un homme très discret, mais enfin…
— Eh bien, moi, je suis tout à fait hors de la politique.
— Susini dit cela aussi, nous comprenons qu’il y est obligé. Vous aussi. Enfin, vous aimez la France ?
— Ne commencez pas un interrogatoire. Je connais ces interrogatoires qui vous mènent par des chemins que je ne fréquente pas. Je vous ai dit que j’étais revenu très fatigué d’Allemagne. J’ai eu une vie très dure à l’étranger pendant vingt ans, j’en ai vu de toutes les couleurs. Il y a des tas de choses à quoi je ne veux pas m’intéresser.
Préault était extrêmement déconcerté et choqué. Cependant, Constant lui parlait sur un ton si tranquillement jovial et il lui paraissait si impossible qu’on ne se passionnât pas pour ce qui le passionnait, alors qu’on était passionné comme visiblement l’était Constant Trubert, qu’il s’en alla persuadé que celui-ci se défendait par prudence, par ordre de Susini ou parce qu’il avait été attaqué un peu brusquement.
Quelques jours plus tard, la nuit, alors que Constant fumait dans sa chambre, on toqua au volet. Il éteignit et ouvrit.
— C’est toi, Trubert ?
— Oui.
— C’est Salis. Laisse-moi entrer. J’ai à te parler.
— Entre.
Salis escalada la fenêtre que Constant referma. À la lumière, Salis le regarda avec ses yeux verts, où il y avait des irradiations noires, précises.
— Trubert, Préault m’a dit ce que tu lui avais dit, que tu ne faisais pas de politique. Il m’a même dit de me méfier de toi, mais il n’y comprend rien. Moi, je sais ce que sont les hommes. J’ai su tout de suite que tu étais un type en qui, moi, je pouvais avoir confiance. Tu es affranchi, comme nous disions autrefois. Bon, alors il y a là, dans le noir, deux hommes, traqués, il faut que tu les caches dans la maison.
— Ceux qui les traquent sont sur la piste immédiate ?
— Non, je ne te demanderai pas l’impossible. Il n’y a pas trente chances sur cent qu’ils viennent les chercher ici.
— Entendu.
Constant fit le nécessaire, en dehors des deux gardiennes. Il montra beaucoup d’expérience et de prudence. Quand, deux jours plus tard, Salis vint rechercher ses hommes, Constant lui dit :
— Une autre fois, je te prie de me demander mon avis plus tôt.
— Force majeure.
— Je t’emmerde.
L’autre avait ri doucement et était parti dans le noir. Après cela la conversation était facile et même avec Préault qui était assez façonné par l’action pour ne pas tout le temps tenir compte de ses anciens préjugés, bien qu’ils subsistassent dans les devants vétilleux de sa conscience.
— Au fond, je te comprends, dit Salis à Constant, tu es un anarchiste. Je l’ai été, je peux te comprendre, mais je ne le suis plus. Toi, tu es trop vieux pour changer, faut te foutre la paix.
Constant sourit avec dédain mais ne protesta pas ; il y avait des années qu’il n’avait plus entamé une querelle de langage avec qui que ce soit. Il se mouvait dans un ordre de pensées qui n’avait rien à faire avec l’anarchisme ; quant à ce qui l’intéressait, il ne voulait pas en parler, surtout à des hommes enchaînés, asservis comme Préault et Salis. Il avait plus de sympathie pour Salis que pour Préault, il s’était toujours senti étranger aux bourgeois.
Il se rencognait avec volupté dans le Creux, près du petit bois. Il n’était pas dérangé par cette silhouette de femme qui glissa entre les sapins deux, trois fois. Cette silhouette semblait aussi familière de cet endroit. Qu’y venait-elle chercher ? Si elle y venait chercher le monde et l’au-delà du monde comme Constant, ce ne devait pas être dans la foison des images convoquées pour être saisies, broyées, sublimées, anéanties par la puissance du rêve, ce devait être dans une seule image, immédiate, momentanée, exclusive et toute brute. Elle devait avoir un rendez-vous, la silhouette, quelque part dans ce bois de sapins ; la silhouette devait s’accoupler avec une autre silhouette, soupirer, gémir, composer dans le sable une instance de murmures et de torsions. Le Creux n’en changeait point pour cela de caractère et les livres de l’obstination spirituelle se lisaient avec autant de calme.
Constant allait voir Préault de temps en temps ou Salis. Susini lui avait recommandé de prendre connaissance de la région. Constant devait parfois faire effort sur lui-même, surtout pour aller à l’usine de la Vère. Le Creux, à la lisière des dunes, lui plaisait plus – surtout quand une femme n’en faisait pas son boudoir. Mais il était encore parmi les humains et il avait accepté de servir Susini. D’ailleurs, une fois qu’il était devant Préault il oubliait sa répugnance ; son ultime curiosité à l’égard des humains était aiguë et si souple qu’elle ressemblait de quelque manière à la charité.
Il y avait dans Préault une passion qui pour être pétrie de colère et de haine n’en était pas moins douloureuse, au contraire. Il était complètement buté, plus il s’enfonçait dans l’asservissement et plus il se croyait libre, ou en voie de le devenir. Il était enchaîné à son poste de T.S.F. ; la vie lui arrivait par là. Fuyant la présence des Allemands, il s’identifiait aux Anglais qui étaient libres des Allemands, mais il ne s’apercevait pas que dans cette identification il perdait la qualité de Français qu’il voulait justement sauver. C’était exactement le phénomène inverse de celui qui se produisait pour d’autres qui, s’assimilant aux Allemands, ne se considéraient pas comme occupés. Et, en effet, ils ne l’étaient pas, mais alors ils n’étaient plus français, ce qu’ils prétendaient demeurer avec le même entêtement absurde que Préault.
Salis montrait une conscience beaucoup plus vive, une hypocrisie beaucoup plus active, un cynisme beaucoup plus dur. Il savait au moins qu’il n’était plus français et qu’il ne faisait plus semblant de l’être. Il savait au moins que son patriotisme n’était qu’un mot d’ordre. Il croyait que les Russes et lui se confondaient dans un type d’homme commun où le Russe se dépouillait tout autant que lui.
Préault, sans religion, aimait la France comme ses ancêtres avaient aimé Notre-Dame. Bien qu’il eût été élevé dans un milieu de gauche assez avancé, il ne l’avait pas ignorée avant la guerre de 1914 ; l’avait aimée violemment pendant cette guerre et depuis n’avait jamais tout à fait oublié son amour, à la différence de tant d’autres. Il répétait tout le temps ce nom et la familiarité de ce nom l’habitait. Pendant les années de paix bien qu’il eût senti autour de lui l’indifférence, la moquerie, la méfiance, il avait toujours conservé son amour, toutefois en le dissimulant un peu. Puis était venu le moment où il n’avait plus eu besoin de rien cacher, bien au contraire. Il avait vu les moqueurs, les blasphémateurs, les haineux et même les indifférents entrer tour à tour, au moins en paroles, dans sa passion. Il avait certes fallu pour cela que l’étranger donnât l’exemple ; il avait fallu que les Russes, qui depuis la fin du siècle dernier tendaient peu à peu à remplacer les Allemands dans la vénération de la petite bourgeoisie intellectuelle à laquelle Préault appartenait, donnassent l’exemple. Lénine avait décidé que – comme lui-même qui sous les abstractions était si foncièrement, si charnellement, si orgueilleusement russe, autant que Tolstoï ou Dostoïevsky – tout Russe pouvait être patriote et qu’un étranger pouvait l’être aussi à condition qu’ils rendissent d’abord hommage à la patrie russe. L’entrée dans le patriotisme des communistes, si oblique que fût la démarche, avait eu un effet irrésistible sur tous les petits bourgeois intellectuels pour qui tout ce qui venait de ce côté-là était tabou. Préault avait considéré de son regard myope, furtif, qui était doucement acharné, cet heureux changement. Le fait qu’il n’était jamais parvenu à dissimuler tout à fait son patriotisme aux contempteurs lui donna parmi ceux-ci, quand ils se mirent dans l’ornière, le prestige un peu attendrissant et un peu ridicule d’un ancêtre dont on doit à la fin admettre en vieillissant qu’il avait toujours eu raison, mais qui a le tort d’être un ancêtre. En tout cas, Préault n’avait pas abusé de la nouvelle situation car il était fort discret et fort retenu et s’il éprouvait maintenant la joie de se détendre et de se rouler dans sa passion, il ne montrait toute la violence de cette satisfaction qu’en des éclats brefs, mais qui étonnaient encore chez cet homme à la voix doucement chantante, au regard aussi vite rentré que sorti, à la démarche hâtive et frileuse.