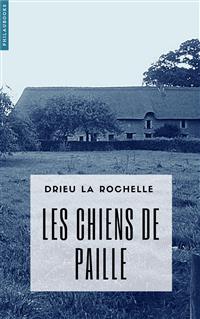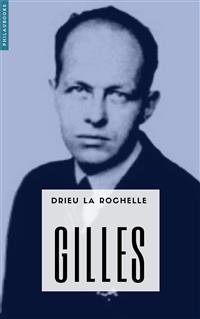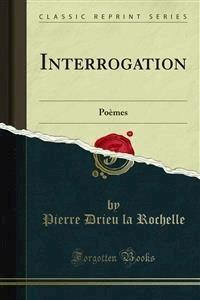Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Quand Drieu publie donc en 1941 ses " Notes pour comprendre le siècle ", il a l'immense mérite de poser le problème de manière doublement courageuse. Il s'écarte d'abord d'un conformisme officieux dominant. Celui-ci tendait à ne rechercher à la situation dramatique et à l'effondrement de la France que des responsabilités superficielles et strictement institutionnelles. D'autre part, il se sépare aussi de cet ersatz d'anticonformisme dit " des années 1930 ". On soulignera aussi, au besoin, que le rapport des " Notes pour comprendre le siècle " au christianisme et au Moyen Âge, pas éloigné de celui d'un Berdiaeff par exemple, l'écarte tout à fait des interprétations abusives. Le conformisme des uns comme le faux anticonformisme des autres conduisaient et aboutirent effectivement aux dévoiements technocratiques du Front Populaire en 1936, de Vichy en 1941 ou des diverses formules de l'immédiat après-guerre entre 1944 et 1947.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NOTESPOUR COMPRENDRELE SIÈCLE
« … et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. »
I. — ÉQUILIBREDUCORPSETDEL’AMEAUMOYENÂGE
— Dans les plus lointains textes où peut remonter notre lecture suivie, l’antiquité grecque — comme les dix antiquités que nous connaissons maintenant — a loué le corps. Mais sans insister, car la force et la beauté alors allaient de soi. Il y a un demi-silence de l’homme sur son corps qui veut dire possession, épanouissement, joie. Dans les Pythiques et les Olympiques de Pindare, l’éloge du corps n’est à aucun moment le but ; il s’agit plutôt que de louer de beaux effets de louer la puissance des causes : dieux, familles. La vie est toute religion et la force des athlètes va de pair avec la profondeur et l’efficacité des mythes et des rites. De même dans Homère, les premières parties de la Bible, les poèmes indiens, iraniens, babyloniens, égyptiens.
Plus tard, l’Antiquité opère toutes les distinctions que nous connaissons, distinctions fatales. Elle isole le corps sous le faux jour de l’esthétique. Faux jour un instant splendide, mais le corps et l’âme séparés vont s’opposer. On surprend ce mouvement chez Platon. Il prône l’équilibre dans les Lois, il y définit avec précision les droits et les devoirs du corps, mais déjà ce n’est plus que dans une vue d’utilité politique, et par ailleurs il sépare l’âme du corps qui en devient la prison. L’âme réduite à elle-même va perdre pied. Arrivent les philosophies qui bien avant le premier christianisme négligent, réprouvent, ou nient le corps et par là préparent l’amaigrissement, l’égarement, la destitution de l’âme.
— Dans le cycle d’histoire où nous sommes, le Moyen Âge traite d’abord le corps comme la première Antiquité. Car il est une première Antiquité, toute jeune et fraîche.
Sur ce chapitre, comme sur les autres, la plupart des gens instruits se satisfont de vieux préjugés. Ils croient encore que le Moyen Âge a poussé plus loin qu’aucun autre temps l’oubli ou la haine du corps. Or, il faut voir ce qu’a été réellement la vie et la pensée des Européens pendant ces siècles.
Le Moyen Âge a été une magnifique époque de jeunesse. Cette jeunesse a triomphé non seulement dans les mœurs, mais dans les arts, la poésie, la philosophie, la religion.
Étant une époque de jeunesse, c’est une époque de force physique. Jusqu’au XVIe siècle, le corps jaillit spontanément. Époque de splendeur corporelle, splendeur qui n’a peut-être pas tant à envier à l’Antiquité de la bonne époque, ni pour les actes, ni pour la représentation qui en fut faite.
— L’homme du Moyen Âge a pourtant déjà perdu beaucoup de sa vivacité en perdant beaucoup de sa rudesse. Ce n’est pas un primitif.
— La notion de primitivité du fait des progrès de l’histoire et de la préhistoire est infiniment reculée. Aussi loin que nous saisissions l’homme d’après quelque vestige figuré, 5.000 ans avant le Christ, notre science actuelle le trouve déjà dans les liens de la civilisation, déjà atténué et amorti, policé et urbanisé. De ce point de vue, Homère et Pindare paraissent des raffinés de basse époque.
— Quand commence l’histoire de l’Europe moderne, au moment où les traits de la vie féodale sont composés du mélange du monde romain et du monde germanique, la rudesse cesse dans une partie de l’Europe. Elle est reléguée au Nord et à l’Est, aux marches du Royaume des Francs qui confond Gaule et Germanie. En France, l’homme du XIe siècle est aussi loin du sauvage désordre post-carlovingien que nous le sommes des fureurs de la Fronde.
— Cet homme vit dans ce que nous sommes convenus d’appeler une civilisation, dans une société de nouveau plus qu’à demi ordonnée. Du côté de la Méditerranée, il a derrière lui des milliers et des milliers d’années de vie élaborée. L’héritage de mainte culture lui est plus sensiblement présent qu’on ne croit. Il vit dans le voisinage éblouissant de Byzance et de l’Empire arabe.
Du côté nordique, il est moins loin, mais déjà fort loin de ses débuts. Nous savons maintenant qu’il y a eu dans le nord de l’Europe, tant chez les Celtes que chez les Slaves, chez les Germains que les Scandinaves, de nombreux stades de création originale, et aussi beaucoup de contacts avec toutes les autres aires de civilisation.
— Cependant cet homme a encore un corps, et un corps magnifique. C’est pour lui le plein du printemps. Il est assez civilisé pour raffiner sur sa vigueur, pas assez pour commencer de la détruire. Le XIIe, le XIIIe siècle, ce sont les beaux siècles archaïques de la Grèce.
— Cet homme est plus ou moins un paysan et un guerrier. Il n’y a pas alors de différence aussi forte qu’aujourd’hui entre le campagnard et le citadin. Le moine hier encore était un pionnier et il vit à la campagne. Le marchand est un voyageur armé. L’artisan, le bourgeois dans leur petite ville fortifiée sont à même la campagne. De leur taudis, de leur rue puante, ils n’ont que trois pas à sauter pour aller aux champs où ils ont encore affaire. Il y a peut-être moins de distance en ces siècles entre le baron et le roturier qui commence à se risquer comme homme de pied en rase campagne qu’aux siècles précédents quand la noblesse d’essence germanique, croisée d’éléments gallo-romains retrempés, vivait dans une notable supériorité d’entraînement physique par rapport au reste du peuple, encore mal remis de son long internement dans les cités romaines.
Alors, tous les hommes devaient résister au froid et au chaud, à la faim et à la soif, aux sièges, aux incendies, aux inondations, aux épidémies, aux massacres, à la torture. Les conditions étaient rudes pour les pauvres comme pour les riches. Les épreuves physiques étaient presque universellement répandues. Mais sans doute ne faudrait-il pas croire que la guerre et la maladie fissent une sélection toujours sûre des plus robustes.
— Quand on considère les monuments qui nous restent de cette époque, on y trouve une expression éclatante de la force et de l’allégresse des corps. Cela éclate dans l’architecture, dans la sculpture, l’enluminure, la poésie et la philosophie religieuse.
Ces châteaux et ces cathédrales n’ont pu être bâtis par des chétifs ni par des tristes. Il y a à la fois une raison et une audace de la raison dans le plan des cathédrales qui ne peuvent être comprises seulement comme l’effet d’une ardente foi extraterrestre, mais comme confiance dans la vie, joie de vivre, affirmation exubérante de l’immédiat.
Cela se certifie dans les figures des contemporains que l’imagier nous a léguées. Aussitôt que la sculpture médiévale sort de ses tâtonnements, ou plutôt des réserves inspirées par l’art byzantin, elle trace un poème à la gloire du corps humain qui rejoint les réussites de l’art grec, égyptien ou assyrien. En dépit de la défaveur d’un climat moins ensoleillé qui ronge tout, en dépit des subséquents ravages huguenots ou jacobins, on peut voir encore quelque chose de ce qui fut témoigné d’une humanité en plein épanouissement. Regardez les statues de Reims ; elles valent les Korai d’Athènes. Voyez ces corps élancés, sveltes et souples, ces membrures fortes et élégantes, ces visages secrètement expressifs ; ils valent les visages grecs de l’époque archaïque, ceux qui ont été tracés avant la fixation trop rationnelle et trop extérieure d’un type.
Et ne demeurez pas sans imagination devant ces formes, évoquez les couleurs. Songez que là où aujourd’hui règne la morne grisaille du vieillissement éclatait un bariolage printanier, dans les costumes, dans la décoration des maisons et des églises. Il suffit d’ouvrir un livre d’heures pour être ébloui par la révélation multicolore de ces siècles qui furent créateurs autant et plus que nos autres siècles créateurs.
Si vous vous arrêtez devant cette vieille grotte noircie et poussiéreuse qu’est aujourd’hui une cathédrale, songez que tout y rutilait comme sur un temple grec ou égyptien. Les vitraux qui n’ont pas été fracassés par les iconoclastes des siècles soi-disant plus civilisés vous crient ce que fut le Moyen Âge ; mais vous ne voyez pas qu’ils ne sont que la dernière réverbération de ce qui flambait sur la pierre alors vivante, maintenant morte, et sur la chair en fleur qui comblait ces grands vaisseaux.
Regardez un vitrail, un livre d’heures, des armoiries, vous verrez surgir une époque éclatante, où l’or, l’argent, l’azur, le gueules, le sinople composent un chœur puissant. Tout cela ardait au porche des cathédrales et sur leurs murs intérieurs, dans les salles des châteaux et sur le costume des seigneurs, des bourgeois, des manants.
Encore aujourd’hui, en dépit de la mort des couleurs, vous en voyez les restes humiliés aux costumes des paysans, des soldats. Même la sobriété des vêtements religieux fait des taches plus heureuses que celle de nos costumes.
Tout cela n’était-il point un hymne physique, un hymne à la joie des sens ? Tout cela ne glorifiait-il pas le corps en même temps que l’âme ?
Et toute cette humanité chante, ruisselle de chant et de musique. Et ce sont sans cesse de grandes fêtes collectives où se mêlent généreusement le tragique et le comique.
— Le Moyen Âge a eu un corps puissant et, le sachant à peine, il s’en est réjoui.
Qu’est-ce que Rabelais ? Le dernier grand cri de joie du Moyen Âge.
— Cette absurde notion de Renaissance est venue tout fausser. La vraie Renaissance, c’est tout le Moyen Âge à partir du XIe siècle, à partir du moment où il s’est dégagé du chaos post-carolingien. L’art roman, n’est-ce pas déjà la Renaissance ? La Renaissance, telle que nous la comprenons, n’est qu’un rebondissement et par bien des côtés un déclin du formidable mouvement de vie et de création qui se développe sans arrêt aussitôt que l’Européen peut souffler après les invasions (qui se prolongent tard, car après les invasions germaniques, c’est l’arabe, puis la normande et la hongroise, puis la turque qui rebondit jusqu’au XVIIe siècle. Rarement l’homme a le temps de souffler).
— Lisez les chansons de geste que vous n’avez jamais lues, qu’on ne vous a jamais fait lire, et qui sont le premier et le plus grand œuvre de la France, son plus vaste rayonnement sur toute l’Europe. Bien que dans une grande sobriété de langage, elles chantent et louent la force du corps avant toutes choses. Les trouvères jugent un homme d’abord à sa force physique — et ensuite au courage qui découle de cette force et qui en décuple les effets.
La chanson de Roland désigne d’abord Charlemagne par ses qualités physiques :
… Gent ad le cors et le contenant fier
S’est kil demandct ne l’estoct enseigner…
… « son corps est noble et sa contenance fière, celui qui le cherche n’a pas besoin qu’on le lui désigne…
» Il a rencontré Roland. Jamais il ne l’a vu : il le reconnaît pourtant à son fier visage, à son beau corps, à son regard, à son allure… »
« Vivien s’avance devant son oncle sur le riche tapis. Il est de grande beauté, la tête blonde et bouclée, le cou droit, les épaules larges et la taille libre… » (Enfances Vivien…)
Les héros manifestent même une force incroyable, impossible ; ce sont des géants, des surhommes. On peut voir dans cette exubérance créatrice de légende l’amour du corps pour la joie qu’il donne à l’être humain. Le trouvère se sent si heureux de louer la force physique, si sûr en le faisant de donner une complète satisfaction à ses auditeurs qu’il se laisse aller dans son exaltation au rêve de dépasser la mesure connue.
« Le comte (Roland) le frappe si vertueusement qu’il lui fend le heaume jusqu’au nasal, lui tranche le nez, la bouche et les dents, tout le corps et le haubert aux bonnes mailles, et le troussequin d’argent de sa selle d’or, et profondément le dos de son cheval. Point de remède, il les a tués tous deux et ceux d’Espagne gémissent tous. Les Français disent : « Notre garant frappe bien. »
Les contemporains justifiaient cet outrepassement, ayant tenté tout le possible du courage corporel ; ils étaient parvenus à ses ultimes frontières ; témoin, les croisés. Mais comme les Grecs d’Homère, ils voient très clair la contre-partie de la force qui est la douleur. Celle-ci leur paraît horrible, et son spectacle leur arrache de longs cris de pitié. La douleur d’être fort et courageux et d’être ainsi voué à tous les coups est modulée en accents profonds. Les héros vont au-devant de la mort avec un élan sans réserve ; mais ensuite ils lamentent la souffrance de la blessure et de l’agonie dans des explosions d’extrême sensibilité. Ils savent que l’héroïsme est une atmosphère mystique qui presse à l’infini la faculté de jouir et de pâtir par le corps, tout comme la sainteté.
L’héroïsme est considéré comme un excès admirable, enivrant, fascinant, mais comme un excès. Le héros, un peu déjà comme aujourd’hui, est entouré d’une admiration effrayée. Le trouvère ne parle pas autrement de Vivien ou de Guillaume d’Orange que nos journalistes de tel aviateur ou de tel officier d’Afrique.
Il ne faut pas oublier que les chansons de geste ont été écrites ou récrites assez tard. Quand on chante l’héroïsme c’est qu’il s’éloigne et le trouvère est déjà un homme de lettres prêt à ricaner sur ce qu’il loue, par-ci par-là, jaloux, méfiant des exploits de la noblesse. C’est donc que ces exploits vont s’atténuant.
Quand Vivien, entraîné par l’enthousiasme et le sentiment de la vengeance, jette devant Guillaume d’Orange le serment fatal : « Or, écoutez-moi tous ; je fais serment à mon Seigneur Dieu, le roi du Ciel, devant vous, devant mes pairs, de ne jamais céder d’une longueur de lance aux Sarrasins, Turcs ou Persans, quel que soit leur nombre et quelles que soient mes blessures ! »… la joie s’arrête, les barons sont consternés… Beaucoup craignent qu’un jour à cause de ces paroles orgueilleuses on ne voie en France une grande douleur et beaucoup de sang versé. Cependant, aussitôt, « cinq fils de comtes et cinq mille damoiseaux viennent s’offrir à lui ».
C’est le commandant Marchand, le père de Foucauld, de Bournazel ou Mermoz.
Sur le champ de bataille d’Aliscans, on pleure et on lamente au soir de la bataille comme sur celui de Roncevaux. Imaginant Vivien à l’agonie, le trouvère de la Chanson de Guillaume d’Orange s’écrie : « En vérité, c’est un martyr. »
« Guillaume est sanglant, grisé d’amertume et de colère. Le silence qui l’environne l’étouffe. Il erre entre les armes amoncelées et les mourants… Il aperçoit Vivien. « Oh Vivien, misérable que je suis. Je n’espérais plus qu’en toi, le plus hardi de mes jeunes hommes : et te voilà mort sur le sable comme ils sont tous ! Terre, ouvre-toi, dévore-moi. Comtes, barons, vous m’attendrez en vain dans Orange ! » Il pleure, il tord ses poignets, il ne peut plus se tenir en selle ; il se pâme et tombe… »
Le héros finit par rejoindre le saint. Guillaume d’Orange, fatigué d’être un héros, se fait moine.
— Qu’est-ce qu’un saint au Moyen Âge ? C’est un explorateur et un missionnaire comme saint Colomban ou saint Boniface ; c’est un orateur et un entraîneur de foules comme saint Bernard ou saint Dominique ; c’est un actif docteur comme saint Anselme ou saint Thomas d’Aquin. Il y a aussi les papes césariens. Les purs mystiques sédentaires et désincarnés ne restent seuls qu’au XVe et au XVIe. Devant ces saints héroïques dont Jeanne d’Arc et saint François-Xavier sont les derniers spécimens, on a de la peine à comprendre que saint François de Sales soit aussi un saint.
— Ce n’est pas en dépit du christianisme, mais à travers le christianisme que se manifeste ouvertement et pleinement cette joie de vivre, cette joie d’avoir un corps, d’avoir une âme dans un corps, de nourrir l’un par l’autre, cette joie d’être.
On a dit que la beauté avait éclaté dans les cathédrales en dépit de l’Église. Quelle absurdité ! Comment comprendre une civilisation où la force dominante serait en contradiction complète avec les autres forces ?
La vérité, c’est qu’il y a bien une contradiction, mais elle est dans l’Église même ; et elle est portée par elle allégrement. Il y a une contradiction dans toute époque ; mais l’époque forte est celle qui peut la hausser à bras tendus et la porter en avant. Les premiers Jacobins résolurent dans leur élan la contradiction du bonheur individuel et de la grandeur collective sous laquelle plient nos démocrates.
Au Moyen Âge, la pensée de l’Église exalte la contradiction de la beauté de la vie avec son horreur, exalte la création et en même temps la caducité dont cette création ne peut être sauvée que par la grâce. Elle se dresse entre le corps et l’âme, le mal et la grâce, Dieu et le Diable, la force et la faiblesse comme à sa belle époque la pensée grecque entre Dionysos et Apollon, comme à sa belle époque la pensée hébraïque entre le Dieu de bonté et le Dieu de colère.
Cela éclate aux voûtes des cathédrales où alternent la hideur comique et la beauté tragique.
On ne me fera jamais croire que les prêtres et les moines n’ont pas aimé, compris le Christ que les « francs-maçons » mettaient au porche des cathédrales, ce Christ qui exprime le sentiment médiéval de la jeunesse et de la force, la splendeur de l’incarnation de Dieu dans l’homme, l’épanouissement du spirituel dans le corporel.