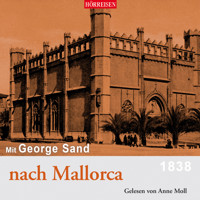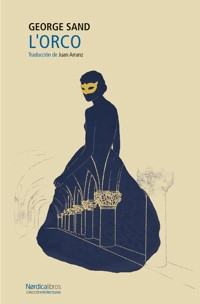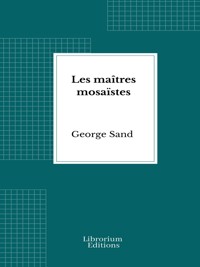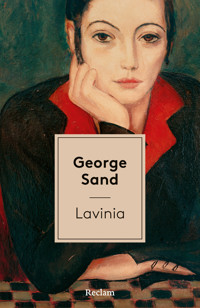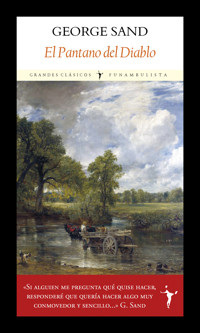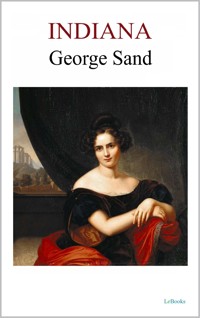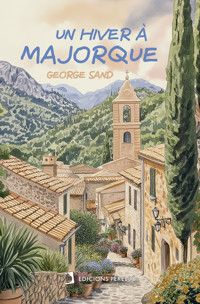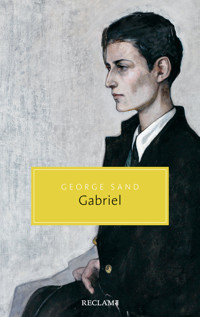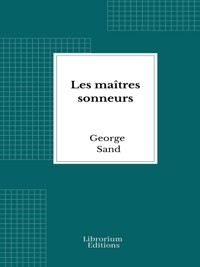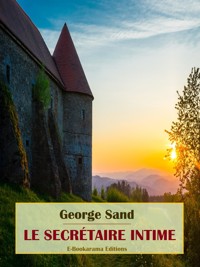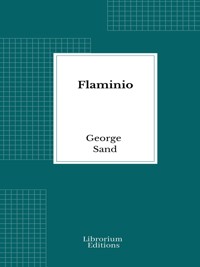
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
J’ai fait autrefois un roman intitulé Tévérino, qui ne contenait qu’une situation, une journée : la rencontre d’un bohémien par une femme du grand monde, un instant d’amour de cette femme pour le bohémien, puis l’effroi, la honte, le repentir, et enfin une sorte d’estime pour ce caractère étrange, développé en causeries d’art et de sentiment. J’ai repris cette idée, ce type d’aventurier, cette situation, pour faire une sorte de prologue scénique, après lequel j’ai fait une pièce en trois actes, où le caractère de l’homme se transforme et s’ennoblit par l’amour, où celui de la femme (changé dès le prologue) se développe dans le sens de l’amour exclusif et chaste. J’y ai ajouté des types nouveaux, enfin j’ai continué ma fantaisie en la faisant même très différente, dès le début de la pièce, de ce qu’elle m’était apparue à la fin du roman. Probablement, à l’époque où me vint ce roman, il y a une dizaine d’années, je n’aurais pas osé continuer et idéaliser l’amour de lady Sabina pour Tévérino. Je ne l’aurais pas osé dans ma pensée ; mais ma pensée a changé ou marché, puisque, aujourd’hui, je l’ai osé dans ma pièce, bien que le théâtre soit un terrain plus difficile à fouler délicatement que le roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
George Sand
FLAMINIO
Comédie en trois actes et un prologue
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385742508
J’ai fait autrefois un roman intitulé Tévérino, qui ne contenait qu’une situation, une journée : la rencontre d’un bohémien par une femme du grand monde, un instant d’amour de cette femme pour le bohémien, puis l’effroi, la honte, le repentir, et enfin une sorte d’estime pour ce caractère étrange, développé en causeries d’art et de sentiment. J’ai repris cette idée, ce type d’aventurier, cette situation, pour faire une sorte de prologue scénique, après lequel j’ai fait une pièce en trois actes, où le caractère de l’homme se transforme et s’ennoblit par l’amour, où celui de la femme (changé dès le prologue) se développe dans le sens de l’amour exclusif et chaste. J’y ai ajouté des types nouveaux, enfin j’ai continué ma fantaisie en la faisant même très différente, dès le début de la pièce, de ce qu’elle m’était apparue à la fin du roman. Probablement, à l’époque où me vint ce roman, il y a une dizaine d’années, je n’aurais pas osé continuer et idéaliser l’amour de lady Sabina pour Tévérino. Je ne l’aurais pas osé dans ma pensée ; mais ma pensée a changé ou marché, puisque, aujourd’hui, je l’ai osé dans ma pièce, bien que le théâtre soit un terrain plus difficile à fouler délicatement que le roman.
Je ne me pique d’aucune habileté, et j’aime beaucoup celle des autres ; car plus j’avance dans la vie, moins je sens en moi de parti pris pour ou contre les manières, les écoles, les règles, les modes. Je me laisse aller à aimer tout ce qui me plaît, sans vouloir qu’on me dise si c’est bien ou mal fait selon certaines conventions reçues par les uns, repoussées par les autres. J’entends parler d’une école du bon sens, d’une école du réalisme, etc. ; je ne demande pas mieux, cela m’est égal. Je vois du talent, du cœur, de la poésie dans les manières qu’on prétend les plus opposées, et j’avoue que je ne sens pas beaucoup les limites qu’on prétend établir entre ces diverses manières. Il me semble qu’il n’y a de bon que ce qui m’émeut ou me charme, et, comme je n’ai aucune théorie qui me gêne et me tende contre ma propre impression, je goûte souvent de très doux plaisirs dans l’absence de toute discussion intérieure.
La tolérance que j’ai pour les autres me conduit nécessairement à tolérer mes propres fantaisies, bien que je sache qu’on ne me rendra pas toujours la pareille en impartialité et en bonne foi. Cela ne me fait rien : on est si heureux de se sentir encore naïf en dépit de l’âge et de l’expérience, qu’on peut bien pardonner aux autres de vous trouver niais. Des personnes de mauvaise humeur me reprocheront toujours de leur présenter des personnages trop idéalement candides ou aimants. Si j’y crois, moi, à ces personnages, s’ils ont une existence réelle dans mon cerveau, dans ma conscience, dans mon cœur, sont-ils donc impossibles dans l’humanité ? Voulez-vous me faire croire que je porte en moi un idéal plus pur et plus brillant que le vôtre ? Eh bien, moi, je ne le veux pas croire ; cela me rendrait orgueilleux ou triste, et, vous aurez beau dire, je ne le croirai pas. L’humanité est meilleure que les habiles raisonneurs ne veulent nous l’accorder, à nous autres poètes. On dit que nous regardons à travers un prisme qui fait voir tout en rose. Hélas ! il y a aussi le prisme qui fait voir tout en noir, et nous y regardons aussi malgré nous, à de certaines heures de la vie. Laissez-nous donc libres de vous traduire l’effet de notre vision, quelle qu’elle soit. Qu’il y ait de l’ombre ou du soleil sur les tableaux et sur les faces humaines qu’ils représentent, le soleil et l’ombre sont des choses tout aussi réelles que les objets qui les reçoivent.
L’usage autorise les remerciements personnels en tête de ces petites publications. Recevez les miens, chers et excellents artistes du Gymnase-Dramatique. Vous, d’abord, digne ami, qui dirigez ce théâtre et cette troupe d’élite, vous avec qui il est si utile et si doux de travailler à l’épuration de toutes les parties de la représentation d’une fiction intime. Et vous aussi, talent sympathique, admirable et pur comme votre âme, Rose !… et Anna ! nobles sœurs, qui savez élever jusqu’à vous-mêmes, et c’est tout dire, les aspirations de l’écrivain. Merci à Lafontaine, qui, cette fois, a conquis une des premières places parmi les artistes du premier ordre ; heureuse et puissante nature que l’on croyait plus propre aux émotions concentrées qu’à la passion entraînante, et qui joint à la passion le charme de l’exquise candeur et de la profonde sensibilité. Merci à Lesueur, ce grand comique, si original, si ingénieux, si fantaisiste et si consciencieux. Merci à Villars, qui, d’un rôle de vingt lignes, sait faire une création complète et sérieuse sous son apparente bouffonnerie d’invention. Merci à la charmante Figeac, qui jette la lumière de sa vivacité, de sa grâce et de son esprit sur les petits rôles comme sur les grands ; à la jolie enfant Judith Ferreira, qui rit et pleure si naïvement. Merci à un nouvel acteur du Gymnase M. Garraud, qui étudie avec soin, intelligence et dévouement, et dont les moyens très réels n’attendent qu’une création plus complète et plus intéressante pour se compléter eux-mêmes et se fier à eux-mêmes.
DISTRIBUTION
FLAMINIO
MM. Lafontaine.
LE COMTE GÉRARD DE BRUMEVAL
Garraud.
LE DUC DE TREUTTENFELD
Lesueur.
LE COMTE DÉMÉTRIUS DE KOLOGRIGO
Villars.
LADY SARAH MELVIL
Mmes Rose-Chéri.
MISS BARBARA MELVIL
Chéri-Lesueur.
LA PRINCESSE EMILIA PALMÈRANI
Figeac.
RITA
Judith Ferreira.
JOSEPH
MM. Blondel.
Un Groom
Blondel.
Un Valet de chambre
Louis.
Une Femme de chambre
Mme Constance.
PROLOGUE
Un coin de paysage dans la montagne ; un chalet sur la gauche ; montagnes à l’horizon ; arbres, gazons et rochers au premier plan.
SCÈNE PREMIÈRE
SARAH MELVIL, LE DUC DE TREUTTENFELD, LE COMTE GÉRARD DE BRUMEVAL.
LE DUC,à Sarah, à laquelle il donne le bras en lui tenant son ombrelle. Ils entrent en marchant ; Gérard les suit, portant un fusil de chasse.
C’est là leur prétention, et…
GÉRARD, l’interrompant.
Ah ! voici enfin de l’ombre… et un chalet.
LE DUC.
Et c’est pour ça que je plaide !
SARAH, distraite.
Pour ce chalet ?
LE DUC.
Non ! la prétention de ce Kologrigo…
SARAH, quittant son bras.
Pardon ! je suis un peu fatiguée… (à Gérard, en s’asseyant) de cette histoire.
LE DUC.
Ils ne peuvent pas me contester mon nom et mon titre. Il n’y a pas d’autre duc de Treuttenfeld que moi. Mais cet Olibrius… ou Démétrius de Kologrigo, un Morlaque, qui se fait appeler M. le comte, je ne sais pas pourquoi…
SARAH, sans l’écouter, à Gérard.
Eh bien, où est donc ma belle-sœur ? Elle nous suivait.
LE DUC, sans se déconcerter et s’asseyant.
Il se porte créancier de la succession pour des sommes fabuleuses, sous prétexte que son aïeul, qui était une espèce de pirate, je vous en réponds, avait prêté à mon aïeul de quoi racheter son duché, perdu au jeu du temps de Marie-Thérèse. Je plaide la prescription et il a gagné en Allemagne. Mais je trouve moyen de transporter le débat à Paris, à cause d’un hôtel.
GÉRARD, à Sarah.
Patience ! nous approchons de la fin.
LE DUC.
Voilà le grand avantage d’être un peu cosmopolite.
SARAH, ennuyée.
Ah ! vous êtes cosmopolite ?
GÉRARD, bas, à Sarah.
Imprudente ! Il va reprendre son histoire au déluge.
LE DUC.
Je vous l’ai déjà dit.
SARAH, vivement.
Ah ! c’est vrai, oui, oui !
LE DUC.
Mais je recommence.
SARAH, à part.
Miséricorde !
LE DUC.
Feu mon père, Auguste de Treuttenfeld, avait épousé une actrice française. Abandonné et renié de sa famille pour ce fait, il vivait sans bruit à Venise. J’y suis né ; me voilà donc Allemand par mon père, Français par ma mère, Italien par ma naissance, et parlant avec facilité ces trois langues.
SARAH, à Gérard.
Ah ! s’il pouvait n’en parler aucune !
LE DUC.
Orphelin et sans fortune, ce cosmopolitisme m’a mis à même de me tirer d’affaire tant bien que mal, souvent assez mal, jusqu’au moment où mon propre oncle, le duc régnant Max de Treuttenfeld, se laisse mourir sans autre postérité que moi, pas plus tard que l’année dernière. C’est alors que… (Se levant.) Mais je songe que j’ai des lettres à écrire, et qu’il faut que je sois à la ville avant le départ du courrier ; c’est ce qui me prive de l’honneur d’une plus longue rencontre avec vous. Sans cela…
SARAH.
Oh ! ne vous dérangez pas, monsieur le duc ; nous serions désolés…
GÉRARD, à son groom, qui entre chargé de plusieurs objets, une petite malle, un nécessaire, des manteaux, etc.
Bien ; pose tout cela ici, et va déballer les vivres.
Le groom pose les objets à la porte du chalet et sort.
SARAH, bas, à Gérard.
Ah ! ciel ! vous parlez de manger, il va rester.
LE DUC.
Un beau pays, n’est-ce pas, que la Savoie ? Vous y êtes pour toute la saison des bains ?
SARAH.
Non ; nous partons dans trois jours, et voici notre dernière excursion.
LE DUC.
Un dîner sur l’herbe… près d’un chalet ? Bonne idée, en cas d’averse. Le temps menace, je ferais peut-être bien d’attendre.
GÉRARD, vivement, à Sarah.
Vous ne comptez pas dîner avant deux ou trois heures d’ici, n’est-ce pas ?
LE DUC.
En ce cas, merci. Ça me retarderait trop, et il n’y a pas de courtoisie qui tienne contre les nécessités d’un procès. Milady Melvil, je vous baise les mains ; mes hommages à miss Barbara Melvil.
Il s’en va par le fond à gauche.
SCÈNE II
SARAH, GÉRARD, puis MISS BARBARA.
SARAH.
Enfin !
GÉRARD.
Ah çà ! c’est votre cauchemar que ce pauvre duc ! Il manque d’usage comme un homme qui a vécu on ne sait trop de quoi ni comment ; mais, quand il a réussi à vous faire avaler l’histoire de son Kologrigo, il n’est pas plus ennuyeux qu’un autre, et ne manque ni d’esprit ni de bonhomie.
SARAH.
Moi, je le trouve charmant quand il a fini de raconter, parce qu’il s’en va. Mais savez-vous que je suis inquiète de ma belle-sœur ?
Elle se lève.
GÉRARD.
Non, elle déballe tous ses engins de chasse et de pêche. Vous savez bien qu’elle ne peut pas quitter son château pour un jour, sans se munir de tout ce qu’il faudrait pour dévaster un continent. Tenez, elle arrive !
BARBARA,avec un fusil de chasse à la main. Accent prononcé.
Oh ! je chercher le nécessaire de moi pour le ligne de pêche !
GÉRARD, à Sarah.
Quand je vous le disais ! (À Barbara, cherchant avec elle dans les paquets.) Le voici… avec toutes vos munitions de guerre !
BARBARA.
Oh bien ! Et les munitions de vous pour le dessin ? Et aussi le habillement ?
GÉRARD.
Et pour vous aussi, en cas de pluie. J’ai tout surveillé.
BARBARA, à Sarah.
Ici est le rendez-vous pour le manger ?
GÉRARD, essayant d’ouvrir le chalet, qui est fermé.
Oui, et, si nous pouvons découvrir les habitants de ce chalet, nous aurons de la crème et du miel.
BARBARA, qui prend divers objets dans le nécessaire.
Je trouverai le habitantes.
SARAH.
Vous voilà déjà repartie ? sans reprendre haleine ?
BARBARA.
Oh ! je reposer moi avec le pêche, dans le bord de cette petite lac.
SARAH.
Alors, vous n’avez que faire de remporter votre fusil ?
BARBARA.
Oh ! oui ! pour tiouer le sarcelles. Il est amiousante, et mon chien nager lui dans l’eau beaucoup bien.
SARAH.
Je n’ai plus le courage de marcher ; sans cela, j’irais admirer vos prouesses. (Bas.) Car Gérard est absurde aujourd’hui… par moments ! Si vous l’emmeniez ?
BARBARA.
Oh ! s’il offenser vous, vous prenez le fiousil de lui. Jamais l’hôme inconséquente, avec le fâme qui porter le fiousil.
Elle sort.
SCÈNE III
GÉRARD, SARAH.
SARAH à part.
Elle en parle bien à son aise, l’heureuse femme à qui personne ne s’est jamais imaginé de faire la cour !
GÉRARDqui a ouvert sa malle, et qui en a tiré un album et des crayons. Il est assis à droite.
Eh bien, vous retombez dans le spleen ? (Posant l’album et le crayon, à part.) Au fait, j’aime mieux sa mélancolie que sa gaieté. (Haut.) Pourquoi ne voulez-vous pas me dire la cause… ?
SARAH, vers la fontaine.
De mon spleen ? Il est dissipé : ne vous en tourmentez pas.
GÉRARD.
Si fait, vous êtes mélancolique : c’est votre habitude. Voyons, vous avez vingt-quatre ans : vous êtes intelligente, instruite, charmante ; vous appartenez à une grande famille, vous avez une grande existence, et, dans tout cela, je ne vois pas de motifs pour maudire votre étoile. Je vous accorde que le passé n’a pas été riant, qu’on vous a sacrifiée, enfant, à l’ambition ; que milord Melvil avait le porto et le cherry fort maussades. Mais vous êtes veuve depuis trois ans, vous vivez où il vous plaît et comme il vous plaît. Élevée en France, Française par la grâce et l’esprit, pourquoi ne l’êtes-vous pas par le cœur et le courage ? pourquoi vous obstiner dans cette réserve, dans cette froideur de relations, qui est l’idéal ou le supplice des femmes anglaises ?
SARAH, rêveuse.
Tenez, Gérard, je n’ai qu’un mot pour vous répondre. Je ne veux aimer qu’une fois, et ce sera pour toute ma vie… Mais le moment n’est pas venu.
GÉRARD.
C’est-à-dire la personne ! Grand merci. Ah ! vous êtes d’une franchise…
SARAH.
C’est le premier devoir d’une amitié vraie. Voyons, cher comte, il y a déjà des années que nous nous connaissons, et des semaines que, rapprochés par le hasard…
GÉRARD.
Ah ! vous croyez encore que c’est le hasard qui m’a amené cette année aux eaux de… ?
SARAH.
Disons, si vous voulez, la destinée. Elle avait déjà voulu que vous fussiez le plus intime ami du frère chéri que j’ai perdu, et je suis habituée à vous regarder…
GÉRARD.
Comme un second frère ? Et vous croyez que c’est là un rôle facile auprès d’une femme comme vous ?
SARAH.
C’est un rôle que vous aviez accepté sans effort, et qui ne peut pas être devenu impossible, du jour au lendemain. Mais j’ai tort de vouloir parler raison avec vous aujourd’hui. Pour la première fois, vous êtes bizarre… ou plutôt vous êtes vulgaire. Vous voilà avec moi comme tous les Français se croient obligés d’être avec les femmes.
Elle redescend.
GÉRARD, piqué ; il s’est levé.
Vous avez bien raison de dédaigner les Français ! Les Anglais sont si tendres !
SARAH.
Les Anglais ont une personnalité raisonnée, systématique. La vôtre est instinctive et impérieuse. Je ne sais laquelle vaut le mieux ; mais je sais, mon ami, que vous n’êtes pas amoureux de moi sérieusement, et que vous vous sentez irrité parce que je ne veux pas être coquette avec vous.
GÉRARD.
Et qui me dit que vous ne l’êtes pas ? Que sait-on de vous, qui restez sans cesse sur le qui-vive de la pruderie ?
SARAH.