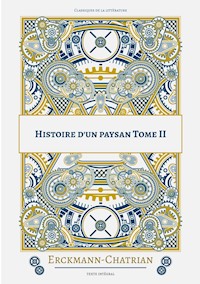Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "En 1816, me dit le vieil herboriste Renaud, je travaillais comme surnuméraire chez M. Benoît, huissier à Saint-Nicolas-du-Port, en Lorraine. Mon père était piéton de la poste aux lettres ; il avait cinq enfants, deux garçons et trois filles, et gagnait 400 francs par an. Tu peux penser si nous mangions tous les jours à notre appétit."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En 1816, me dit le vieil herboriste Renaud, je travaillais comme surnuméraire chez M. Benoît, huissier à Saint-Nicolas-du-Port, en Lorraine. Mon père était piéton de la poste aux lettres ; il avait cinq enfants, – deux garçons et trois filles, – et gagnait 400 francs par an. Tu peux penser si nous mangions tous les jours à notre appétit.
Je venais d’entrer dans ma dix-septième année, et je me désolais de vivre encore à la charge de mes parents, lorsque fut publiée la fameuse ordonnance du roi Louis XVIII, portant qu’il serait formé dans chaque canton un comité gratuit et de charité, afin de surveiller et d’encourager l’instruction primaire.
Les ordonnances, les arrêtés, les circulaires sur l’instruction du peuple n’ont jamais manqué depuis cinquante ans, mais l’argent. On a toujours trouvé de l’argent pour les rois, pour les empereurs, les princes, les évêques, les ministres, les généraux et les soldats ; mais, pour éclairer le peuple et récompenser les instituteurs, les caisses ont toujours été vides.
Enfin, comme en ce temps de grande disette la petite miche de trois livres coûtait 4 francs, comme M. Benoit ne voulait pas me donner un centime, et que ceux qui entraient dans l’instruction publique devaient être exempts du service militaire, je résolus de me faire maître d’école.
C’était la plus mauvaise idée qui pouvait me venir ; j’aurais mieux fait de m’engager tout de suite, ou d’entrer chez un épicier pour casser du sucre et servir la pratique ; mais à dix-sept ans on voit les choses en beau, et la profession d’instituteur me paraissait alors la meilleure et la plus honorable de toutes.
Bref, le 13 octobre 1816, je partis de Saint-Nicolas avec une lettre de M. le chanoine promoteur de Briqueville pour M. le curé Bernard, du Chêne-Fendu, trente sous dans ma poche, deux chemises, une paire de souliers et quelques effets d’habillement dans un petit paquet au bout de mon bâton. Ma seule crainte était de ne pas être reçu comme sous-maître.
Je passai par Lunéville, Blamont et Héming. À Lorquin, je demandai le chemin du Chêne-Fendu, car la route s’arrêtait au bout de ce village, et je craignais de me perdre.
« Prenez à droite, » me dit un gros homme qui fumait sa pipe sur le devant de sa porte.
Puis, comme je m’éloignais :
« Attendez, cria-t-il, vous pourriez vous tromper, je vais vous mettre sur le chemin. »
Et ce brave homme vint avec moi jusqu’au bout du village. Il était boiteux, et tellement grêlé que je n’avais jamais rien vu de pareil. Tout en marchant, il me demanda ce que j’allais faire au Chêne-Fendu. Je lui répondis que j’espérais m’y placer comme sous-maître.
« Mauvais état, fit-il en secouant la tête, mauvais état ! Enfin il faut vivre. Tenez, voici votre chemin ; il remonte la Sarre. Toujours droit devant vous. Dans deux heures, vous serez au Chêne-Fendu. »
Je le remerciai de sa complaisance et je repartis avec une nouvelle ardeur.
Il faisait déjà froid. Les grands coups de vent d’automne balayaient les feuilles mortes ; de loin en loin, une troupe d’enfants, dans le tournant des vallées, gardaient les vaches, accroupis autour de leurs petits feux. C’est tout ce qui me revient. Quand on cherche sa vie, le plus beau pays du monde ne vous dit rien ; on pense toujours à sa triste position ; on tourne et l’on retourne la même idée dans sa tête.
J’arrivai tard au Chêne-Fendu ; la nuit commençait, quelques petites lumières tremblotaient dans le brouillard d’une rivière : c’était le village, qui suit la Sarre-Rouge. Plus près, entre les fumiers des premières baraques, rencontrant une vieille femme, pieds nus, qui chassait devant elle deux chèvres, je lui demandai la maison de cure.
« C’est là, » me dit-elle en me montrant à droite, au fond d’une ruelle, une bâtisse plus grande, entourée d’un jardin et d’un petit mur blanc, avec un escalier sur la façade.
Alors mes inquiétudes me revinrent. Je descendis lentement la ruelle, et je m’arrêtai deux secondes au bas de l’escalier, à respirer et à réfléchir. Les volets de la maison étaient fermés, rien ne bougeait ; plus loin, à gauche, dans le brouillard, du côté de la rivière, s’entendait le tic-tac d’un moulin. Enfin je grimpai les marches et j’ouvris la porte, ce qui fit carillonner une sonnette. Une servante parut au bout du vestibule avec une lampe, et, me voyant là tout craintif, avec mon paquet sous le bras, elle me demanda :
« Que voulez-vous ?
– J’ai une lettre pour M. le curé Bernard. »
En même temps quelqu’un cria de la chambre voisine : « Eh bien, entrez. »
Et j’entrai dans la chambre. M. le curé finissait de souper. C’était un homme de quarante à quarante-cinq ans, grand, brun, la figure osseuse et l’air brusque.
Il pelait encore une poire, son verre de vin rouge sur la table, près de l’assiette.
« Vous avez une lettre pour moi, dit-il après m’avoir regardé, de qui ?
– De M. le chanoine de Briqueville. »
Sa figure changea. Je lui donnai ma lettre, qu’il se mit à lire attentivement.
« Asseyez-vous, mon ami, disait-il en la lisant, asseyez-vous. M. de Briqueville va bien ?
– Très bien, monsieur le curé, Dieu merci !
– Oui, je vois cela. – Et vous désirez entrer comme sous-maître chez M. Guillaume ?
– Oui, monsieur le curé.
– Ça suffit ; du moment que M. de Briqueville vous recommande, ça suffit ! »
Et d’une voix forte il appela la servante :
« Justine !
– Monsieur ?
– Vous allez tenir mon café chaud. Je conduis ce jeune homme au père Guillaume, et je reviens tout de suite. Vous m’entendez ?
– Oui, monsieur. »
Il prit son tricorne, releva son écharpe, et me dit brusquement :
« Arrivez ! »
Il sortit. Je le suivais. En montant la rue noire, entre les fumiers, les charrettes, les tas de bois et les fenêtres à ras de terre, il me demanda :
« Vous savez lire, écrire, chiffrer ?
– Oui, monsieur le curé, lui dis-je timidement.
– Est-ce que vous connaissez le service de l’église ?
– Pas tout à fait bien, monsieur le curé, mais je l’apprendrai.
– Oui, c’est le principal. Il faudra vous y mettre tout de suite. »
Nous arrivions alors à la maison d’école, une ancienne bâtisse décrépite, la grande salle en bas, cinq fenêtres sur la rue, avec la porte d’entrée, quatre de côté, sur un petit carré de légumes, pois, haricots, fèves, dont les perches étaient en faisceaux. Au-dessus était le logement de M. Guillaume et de Mme Catherine, sa femme, et plus haut une sorte de mansarde recouverte de bardeaux et les fenêtres en tabatière.
L’escalier, en dehors, avec sa rampe de bois, montait sur l’autre façade, du côté de l’église. M. le curé grimpa l’escalier quatre à quatre, devant moi, jusqu’à la petite galerie. Il ouvrit une porte et dit en entrant :
« Monsieur Guillaume, voici votre sous-maître ; c’est M. de Briqueville qui vous l’envoie ; il vous convient sous tous les rapports. »
Le vieux maître d’école et sa femme, en train de peler des pommes de terre et de manger ensemble du lait caillé dans un grand saladier, s’étaient levés. Moi, derrière M. le curé, près de la porte, j’attendais encore avec inquiétude ce qu’ils allaient répondre ; mais il était clair que la recommandation du vénérable père faisait tout, car M. Guillaume, un homme de cinq pieds huit pouces, en camisole de tricot gris, culotte de molleton et bas de laine, avait tiré son bonnet et répondait humblement, sans même me regarder :
« Monsieur le curé, puisqu’il vous convient…
– Oui, il fera votre affaire ; il sait lire et écrire, ça suffit ! Comme chantre, il n’a pas encore de voix, il est trop jeune ; mais vous en avez, ainsi tout s’arrange.
– Catherine, donne donc le fauteuil à monsieur le curé, dit le vieux maître d’école.
– Non, c’est inutile, je pars à l’instant. Je suis venu vous dire cela ; voilà tout. Allons, au revoir. »
M. Guillaume, son bonnet de coton à la main, reconduisit M. le curé jusqu’au bas de l’escalier, puis il revint. Sa femme, grande, sèche, la peau jaune et les joues creuses, me regardait d’un air curieux, sans rien dire.
« Vous arrivez de loin ? me demanda le maître d’école en rentrant.
– De Saint-Nicolas, monsieur.
– Vous avez été sous-maître ?
– Non, j’ai travaillé comme surnuméraire chez un huissier.
– Ah ! Et vous connaissez M. le chanoine promoteur de Briqueville ?
– Mon père le connaît ; ils sont du même village.
– Je comprends,… je comprends,… fit-il en lançant un coup d’œil à sa femme. Est-ce que M. le curé vous a dit nos conditions ?
– Il ne m’a rien dit.
– Eh bien, vous serez blanchi, nourri, logé, et vous aurez cent sous par mois. Quant au service, vous sonnerez les offices, vous balayerez l’église et la sacristie tous les lundis, et l’école tous les jours ; vous m’aiderez à faire la classe ; vous tiendrez tout propre ; vous ferez tout ce que je vous dirai…
– Eh ! mon Dieu, Guillaume, s’écria la femme, tu vois bien que le pauvre garçon tombe ensemble.
– C’est bon, c’est bon, fit-il ; d’abord il faut s’entendre. Est-ce que cela vous convient ? »
Je regardais les belles pommes de terre fumantes et le bon lait caillé, sentant mon estomac se réveiller, comme pour aller au-devant.
« Je ferai ce que vous m’ordonnerez, répondis-je. Je ne demande qu’à gagner ma vie, à m’instruire, à vous contenter. »
Mon âge, mon air de soumission rassurèrent ces gens ; ils n’avaient pas à craindre de me voir prendre leur place de sitôt, et, m’entendant tout accepter sans observation, ils furent de bonne humeur.
« Voyons, donnez-moi cela, dit la femme en prenant mon bâton et mon paquet, asseyez-vous et mangez.
– Oui, puisque nous sommes d’accord, asseyons-nous, » dit le père Guillaume.
Je m’assis. Mme Catherine me remit une cuiller d’étain, et le maître d’école, allongeant ses grandes jambes sous la table avec satisfaction, s’écria :
« Voici le tas, vous n’avez qu’à vous régaler ! »
Il avait raison, jamais je ne me suis mieux régalé ; ces grosses pommes de terre roses et farineuses de la montagne et ce bon lait caillé bien frais sont encore l’un de mes meilleurs souvenirs. Et pourtant je ne m’en donnai pas autant que j’aurais voulu ; nous mangions à la même écuelle, et je n’osais avancer la cuiller qu’à mon tour, ni prendre plus de pommes de terre que mes hôtes. L’idée me venait que tout était cher, et que, si ces gens se doutaient de mon terrible appétit, ils me regarderaient comme une véritable peste et me renverraient bien vite. Aussi je me retenais.
« Allons, courage, » me disait le maître d’école.
Et sa femme lui répondait :
« S’il n’a plus faim, ce garçon, il ne faut pas le forcer. Vous êtes fatigué, n’est-ce pas ?
– Oui, bien fatigué, madame. Je suis parti de grand matin ; j’ai fait plus de quinze lieues.
– Voilà, disait-elle, quand on est trop las, la faim passe.
– Eh bien, dit M. Guillaume en voyant le fond de l’écuelle, dans ce cas, il faut se coucher et dormir. Catherine, conduis le sous-maître à la chambre en haut. »
La femme prit mon paquet et mon bâton, et je la suivais en boitant, lorsque le père Guillaume, encore à table, me cria :
« Eh ! que je sache au moins le nom de mon sous-maître… Comment vous appelez-vous ?
– Je m’appelle Jean-Baptiste Renaud.
– Eh bien, bonne nuit, Jean-Baptiste ; demain à six heures il faudra commencer.
– Je vous éveillerai, me dit la femme, l’école commence à sept heures. »
Nous grimpions alors l’échelle de meunier et nous entrions dans ma petite mansarde. Elle avait deux lucarnes sur le toit, l’une du côté de la vallée, où brillaient quelques étoiles, l’autre du côté de la montagne sombre. À droite était le lit dans sa grande caisse de sapin, garni de gros draps propres et recouvert d’un large plumon à carreaux bleus, selon la mode des Vosges. Un crucifix, un bénitier en bois et un petit miroir, large comme la main, pendaient aux murs.
« Voilà, me dit la mère Catherine, c’est la chambre du sous-maître : l’autre, Philippe, était un trop bon garçon, il s’est sauvé, il n’a pas voulu rester ; mais vous aurez plus de courage et de bon sens. »
Elle posa sa lampe sur le plancher et me dit en descendant d’avoir soin d’éteindre la lumière. Alors je me déshabillai, je soufflai la lampe, et, m’étant couché, je tombai presque aussitôt dans le plus grand sommeil. Mon cœur était soulagé : je n’étais plus à la charge de mes parents… J’avais une place… J’allais enfin gagner ma vie !
Le lendemain, avant le jour, des sabots montaient lentement l’escalier, et la mère Catherine, le nez à ras du plancher, m’appelait tout bas :
« Jean-Baptiste !… Jean-Baptiste !… »
Je m’éveillai.
« C’est l’heure, dit-elle en posant la lampe et une grande écuelle d’eau fraîche sur la dernière marche, levez-vous. »
Et je sautai de mon lit chaud, pendant qu’elle redescendait.
Le brouillard de la vallée, qui s’élève tous les matins, entrait jusque sous les bardeaux de la mansarde. Jamais je n’avais senti cette fraîcheur, et je me dépêchais en grelottant de passer mon pantalon, de mettre mes souliers, et puis de me laver les mains, la figure, le cou dans la grande écuelle. Les vitres de mes petites lucarnes étaient comme ouatées de brouillard ; en bas, le feu pétillait dans la cuisine, et les gros souliers de M. Guillaume se traînaient déjà sur le plancher. Dans ces baraques, presque entièrement construites en planches, en madriers de sapin, on entend les moindres mouvements à l’intérieur. Au bout de quelques instants, j’étais habillé, je n’avais plus qu’à descendre ; mais alors le soleil commençait à percer les nuages, et de longues traînées d’or couraient sur la Sarre, éclairant les vieux sapins verdoyants et les hêtres roux sur la côte. J’ouvris la lucarne, et je regardai une minute ce spectacle grandiose : J’étais content de vivre là !
Ensuite je descendis, et je trouvai le père Guillaume qui se promenait dans la chambre, les épaules courbées, l’air rêveur.
Je lui souhaitai le bonjour, et tout de suite il me dit :
« Aujourd’hui pour la dernière fois j’ai sonné matines et l’école, parce que vous étiez fatigué ; mais ce n’est pas l’affaire de l’instituteur de sonner les cloches, ça regarde le sous-maître, il faudra vous lever une heure plus tôt.
– C’est bon, monsieur, je ne l’oublierai pas.
– Oui, fit-il. Et maintenant causons d’autre chose. »
Il s’était redressé et me regardait dans les yeux.
« Vous savez lire, écrire, c’est bien ; mais connaissez-vous la cursive, la bâtarde, la gothique ? Écrivez-vous en fin, en moyen, en gros ?
– Oui, monsieur.
– Oui,… chacun peut dire oui, c’est facile ; mais il faut voir. Après ça, connaissez-vous vos quatre règles ? »
Je n’osais plus répondre.
« Et les fractions, fit-il en élevant la voix, connaissez-vous les fractions ? »
À la manière dont M. Guillaume me demandait cela, je voyais qu’il considérait les fractions comme une chose terriblement difficile et que peu d’instituteurs connaissaient. Je les savais pourtant, ayant été parmi les bons élèves de M. Bastien de Saint-Nicolas ; mais la timidité me gagnait, je baissais les yeux.
« C’est tout cela qu’il faut voir, dit-il en se remettant à marcher. Quant aux fractions, je ne demande pas absolument qu’un sous-maître les sache, plus d’un maître est embarrassé sur la multiplication des deux tiers par les quatre cinquièmes… Oui,… c’est une chose grave,… il faut avoir fait de bonnes études ; mais pour la bâtarde et la cursive je veux un bon sous-maître. Vous ferez deux exemples, un de chaque écriture, et je verrai. »
Il me posa d’autres questions encore, me demandant si je savais toiser, traîner la chaîne, planter les piquets et poser le niveau. Puis la mère Catherine, en jupon de laine et bras de chemise, ses grandes poches d’une aune pendues à droite et à gauche, apporta l’écuelle de soupe aux pommes de terre et la posa sur la table : du lait, des pommes de terre écrasées, un peu de beurre, du sel, quelques tranches de pain coupées bien minces et des poireaux, voilà cette bonne soupe, dont l’odeur seule en passant me fit tourner la tête.
On s’assit et l’on mangea de bon appétit. Les bancs de l’école au-dessous se remplissaient, on entendait rouler les sabots.
Tout en mangeant, M. Guillaume me dit qu’il voulait bien croire que j’écrivais la bâtarde, la cursive et la gothique, mais que cela ne suffisait même pas, et qu’un vrai sous-maître devait savoir aussi se faire respecter, que depuis le printemps dernier deux sous-maîtres avaient été forcés de partir, faute d’avoir la poigne assez solide.
« Vous saurez, me dit-il, que dans ce pays les enfants ne valent pas deux liards, qu’ils sont tous coureurs, dénicheurs de nids, fainéants, joueurs, batailleurs, rapineurs, enfin qu’ils ont tous les défauts réunis ensemble, comme leurs parents, qui ne les enverraient jamais à l’école s’il ne fallait pas avoir fait sa première communion pour apprendre un état. Sans la première communion, ils resteraient toute l’année, comme des sauvages, dans les rochers, dans les bois, aux pâturages, à déterrer les carottes, les pommes de terre et les navets des autres. S’il ne fallait pas avoir une religion, tous ces gens-là ne se moqueraient pas mal de nous, l’instituteur et son sous-maître mourraient de faim ! Heureusement il faut une religion, et c’est pour cela que pendant les deux ou trois ans qu’ils apprennent le catéchisme, et que nous les tenons sous notre coupe, nous avons juste le temps de les redresser. On les redresse à coups de baguette. Voyez ce paquet de noisetiers que j’ai là derrière l’horloge, dit-il, j’en use tous les ans deux ou trois pareils sur leur dos. Il ne faut pas avoir peur de les casser, la côte en produit en abondance. Si quelqu’un de ces mauvais gueux vous manque de respect, s’il fait des signes, soit avec la main, en clignant de l’œil, ou bien en riant pour exciter le rire des autres, tombez dessus et tapez !… Tapez jusqu’à ce qu’il crie et que la salle, en entendant cela, pense : – Celui-là n’est pas un M. Jacques ou un M. Philippe ; c’est un vrai sous-maître ! – Alors ils vous respecteront, et vous n’aurez qu’à regarder à droite ou à gauche du coin de l’œil, tous frémiront dans leur peau et se dépêcheront de mettre le nez dans la croisette. Vous m’entendez ?
– Oui, monsieur.
– Eh bien, maintenant descendons, la salle est pleine. Et prenez une baguette, il faut que chacun ait la sienne. »
Lui-même visita le paquet et m’en remit une des plus solides, grosse comme le petit doigt, et nous descendîmes. Toute ma vie j’aurai devant les yeux cette grande salle d’école remplie d’enfants, avec ses trois lignes de bancs au milieu pour les petits, que le père Guillaume appelait « bancs des chats », et ses tables en carré autour des murs, où se trouvaient assis des deux côtés les grands, tout crasseux, déguenillés, les vestes et les pantalons percés aux coudes et aux genoux, quelques-uns en sabots, d’autres pieds nus comme de vrais sauvages. Pas un, j’en suis sûr, n’avait été lavé depuis des semaines et des mois.
Tout cela ne sentait pas bon.
Au moment où nous entrions dans l’allée, un bruit de disputes, d’éclats de rires et de batailles faisait trembler la vieille baraque ; mais à peine M. Guillaume eut-il touché le loquet que tout se tut ; on aurait entendu voler une mouche. Il s’arrêta sur la porte deux secondes ; chacun était à sa place penché sur son livre. Malgré cela les plus hardis me regardaient en tournant les yeux en dessous et se grattant l’oreille ou la hanche d’un air de réflexion, comme des singes qui rêvent à quelque chose ; ils pensaient sans doute : – Voilà le nouveau sous-maître, celui qui remplace l’autre, que nous avons fait partir. Est-ce qu’on pourra se moquer de lui ? Est-ce qu’il se fâchera ?… Est-ce qu’il se laissera grimper sur les épaules ?
Cela se voyait clairement à leur mine, et pourtant ils ne bougeaient pas et faisaient semblant d’étudier.
M. Guillaume s’avança lentement jusqu’au milieu de la salle et me dit :
« Monsieur Jean-Baptiste, approchez !… Et, vous autres, écoutez bien ce que je vais vous dire : – Voici le nouveau sous-maître !… Celui-là ne ressemble pas aux autres ; c’est un bon sous-maître, que j’ai fait venir exprès, comme il en faut un pour des gueux de votre espèce, qui n’entendent rien à la douceur et se plaisent dans la fainéantise. Eh bien, vous allez être contents… Gare !… gare à celui qui ne fera pas son devoir ; je ne vous dis que ça ! »
Alors il alla s’asseoir dans sa chaire pour tailler les plumes. Moi, je me promenais dans la salle, inspectant les ardoises. On se mit ensuite à chanter le B A, B A, pendant une demi-heure. M. Guillaume m’avait fait signe de m’asseoir dans sa chaire et d’écrire deux exemples. Il paraissait content et me dit :
« Ça marchera !… »
Puis, ayant donné le signal aux petits de se taire, il m’ordonna d’aller faire réciter le catéchisme à ceux de la première classe, et comme je m’approchais, ne connaissant pas encore le nom des élèves, un de ces polissons, un brun crépu, les cheveux ébouriffés, le nez camard et la peau tannée par le grand air, se mit à se moucher lentement.
« Levez-vous, » lui dis-je.
Mais il avait la tête baissée et continuait de se moucher avec un bruit de clarinette, sans avoir l’air de m’entendre.
« Levez-vous, » lui dis-je encore.
Et lui redoublait, de sorte que toute l’école partit d’un éclat de rire. Alors, me rappelant la recommandation du maître, je lui donnai deux coups de baguette pas trop fort, mais qui le firent crier comme si je l’avais écorché.
M. Guillaume avait vu ces choses. Tout à coup il arriva, la figure pâle et mauvaise, avec son noisetier ; il serrait les dents et lança d’abord un coup terrible au gueux, un coup qui fit une raie blanche sur sa veste, depuis l’oreille jusqu’au bas des reins. Il bégayait : « Ah ! tu cries,… ah ! tu cries… Eh bien, je vais te donner des raisons de crier. »
Et il continuait tellement que le garçon n’avait plus la force de crier, et qu’il se penchait sur la table, comme en faiblesse.
Les autres entendant ces grands coups se suivre, les cheveux leur en dressaient sur la tête. À la fin, le père Guillaume finit pourtant et me dit :
« Vous connaissez maintenant la manière de vous y prendre. Hardi ! hardi ! il n’y a que le premier pas qui coûte. »
Pour dire la vérité, ce moyen me parut très commode ; j’étais dans l’âge où le plus simple vous paraît toujours le meilleur, et, puisque les autres sous-maîtres avaient été forcés de partir à cause de leur douceur, je résolus de taper solidement, plutôt que de m’en aller. Si la race sauvage ne voulait pas obéir, tant pis pour elle, cela devait lui causer plus d’ennuis qu’à moi. – Voilà ce que je me dis, en voyant que l’ordre s’était rétabli tout de suite, et que chacun se levait bien vite, lorsque je lui faisais signe, sans avoir envie de rire ni de se moucher. Aussi le reste de la classe se passa très bien, et vers onze heures, après la prière, tous les élèves partirent tranquillement en criant :
« Bonjour, monsieur Guillaume ! bonjour, monsieur Jean-Baptiste ! »
Une fois la salle vide, le vieux maître, riant tout bas, me dit :
« Vous les entendez,… ils savent déjà votre nom : "Bonjour monsieur Jean-Baptiste !" C’est bon signe. Maintenant, à l’école du soir, si l’on vous manque, recommencez ; tapez sec, et dans huit jours ils auront plus de considération pour vous qu’ils n’en avaient pour les autres en six mois. »
En montant l’escalier dehors et en voyant cette foule d’enfants s’en aller par trois, par quatre, causant entre eux du nouveau sous-maître, il me dit encore :
« Tenez, les autres jours ils courent, et remplissent le village de leur vacarme ; aujourd’hui tous sont comme étonnés… Et ce grand Arnette, cette espèce de nègre, comme il se frotte encore le dos… Ah ! gueux, tu veux faire rire les autres, eh bien, nous allons voir celui qui rira le dernier. »
Étant alors entrés dans la grande chambre en haut, nous trouvâmes la mère Catherine en train de lever la lessive qu’elle avait étendue sur des perches autour du poêle. La brave femme lavait aussi le Linge de l’église et n’avait pas d’autre séchoir que cette chambre ; mais à notre arrivée les fenêtres furent bientôt ouvertes, le linge en tas et la table mise. Je jetais en attendant un coup d’œil sur les livres de M. Guillaume, rangés entre deux planchettes, contre le mur. C’étaient le Catéchisme historique, de M. l’abbé Fleury, la Doctrine chrétienne, de M. l’abbé Fleury, les Mœurs des Israélites et des Chrétiens, de M. l’abbé Fleury, l’Histoire de France du vénérable père Loriquet, le Traité des sons de la langue française, de M. l’abbé Bouillotte, le Traité d’arithmétique, de M. l’abbé Borne, etc. Depuis j’ai revu ces livres cent fois, c’est pourquoi je m’en souviens.
Le père Guillaume, me voyant attentif devant sa bibliothèque, allait et venait la tête penchée.
« Si vous avez envie de lire, me disait-il, ne vous gênez pas ; moi, depuis longtemps je ne lis plus. De mon temps c’était l’Arithmétique de Bezout, la Grammaire de Wailly, le Traité d’arpentage de M. Paissant. Toutes ces grammaires, ces rudiments et ces traités nouveaux sont faits avec les anciens, excepté l’histoire du père Loriquet, tout à fait nouvelle et recommandée. Il faut du nouveau, il faut que le commerce roule ; les vénérables pères de la foi marchent avant tout le monde, ils ont de nouvelles lumières et donnent seuls les approbations. »
M. Guillaume ne parlait pas sérieusement : il avait traversé le règne de Louis XVI, la république, l’empire, et vu bien des choses ; mais il conservait sa manière de voir pour lui-même, car alors les vénérables pères de la foi, fondus depuis avec les jésuites, ne plaisantaient pas, et d’un souffle balayaient les instituteurs qui se permettaient la moindre observation contre eux. Je n’en fus pas moins content d’obtenir la permission de prendre ces livres, et de pouvoir m’instruire à mes moments perdus. Ensuite on se mit à table devant une bonne soupe et un grand plat de choux. J’allai sonner l’école vers une heure, et la classe du soir commença. Ce fut la même répétition que le matin, sauf les coups de baguette, que M. Guillaume n’eut pas l’occasion d’appliquer ; le grand Arnette lui-même en avait assez ; il ne bougea pas, et les autres se contentèrent aussi d’une seule représentation en ce jour.
Le lendemain et le surlendemain il fallut me montrer, et le vieux maître d’école s’étonna du nerf que j’avais ; il me dit même en particulier de ménager le fils de notre maire, M. Bauquel, les deux garçons de Jean Placial, ceux des frères Henriot, les maîtres papetiers, et généralement de tous les notables bourgeois connaissant l’ordonnance qui défendait de battre les enfants, et pouvant se plaindre aux autorités supérieures. Ceux-là devaient être mis en pénitence, à genoux sur un rondin, ou bien à la retenue au pain sec pendant les heures de repos. Mon ardeur l’étonnait ; il ne me permettait de taper que sur les autres.
Enfin ce jour-là tout s’accomplit dans le plus grand ordre ; le soir, après souper, j’allai me coucher paisiblement, et je dormis comme un bienheureux.