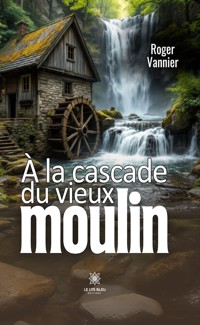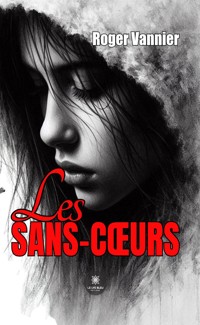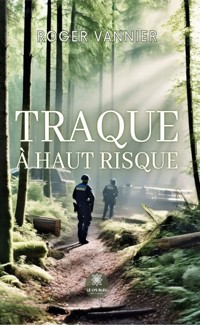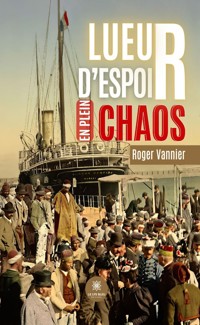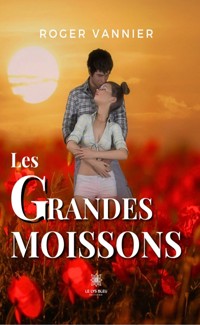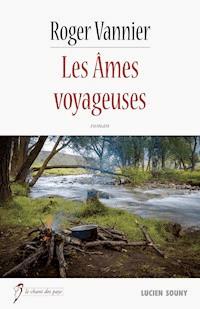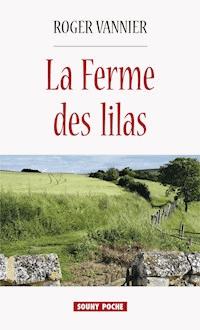Le soleil avait disparu depuis un long moment derrière les toits de l’agglomération. Peut-être avait-il déjà franchi, à l’occident, la ligne de l’horizon. Au fond de la vallée où coulait l’Arnon, la clarté persistait et, en ce début d’été, la chaleur se maintenait. Devant leur maison, les Guérin, installés autour de la table de jardin, dînaient en compagnie d’Aurélie Rizeux, leur petite-fille. Le calme régnait. Dans les arbres, qui bordaient le potager, seules les tourterelles se
donnaient des coups d’aile. Elles viendraient, le lendemain matin, picorer les miettes de pain qu’elles trouvaient dans l’allée et près des chaises en plastique blanc. Derrière la haie de troènes, la rivière émettait son timide et perpétuel murmure. Au loin, perché sur son rocher, le château fort exposait à l’est sa façade imposante et attendait, comme depuis des siècles, l’arrivée de la nuit. Au-delà du cours d’eau, entre les vergnes qu’il arrosait, on apercevait les ânes et les poneys qui, avant de rejoindre les écuries, profitaient des dernières heures du soir pour brouter l’herbe de leur pacage.
Culan venait de changer de rythme. Les gens étaient rentrés chez eux pour le souper et le repos nocturne. Seul un léger ronflement, provenant de la départementale, témoignait d’une activité continue. La route passait sur le versant opposé, à moins de cinq cents mètres derrière la maison des grands-parents maternels d’Aurélie. Cette dernière mangeait en silence tout en regardant, à la dérobée, la coupe de cerises et le saladier de fraises enrobées de crème fraîche et de sucre en poudre. Benoît observait sa petite-fille qui, même à table, ne cessait jamais de parler. En ce moment, son calme inhabituel
signifiait un comportement qui l’étonna.
— À quoi penses-tu, ma jolie ?
— Elle a vu le petit-fils des Perron, tout à l’heure. C’est sans doute ça qui la rend songeuse, supposa grand-mère Rosine.
— Ils m’en ont parlé, l’autre jour. Il est arrivé quand ?
— Avant-hier. Faut voir les voisins comme ils sont heureux de l’avoir auprès d’eux. Mais je t’assure que je n’ai jamais vu un Noir d’Afrique aussi noir.
— Il est beau, lâcha Aurélie.
— Quoi ? fit sa grand-mère, stupéfaite. Tu trouves qu’il est beau ? Un Noir ? Enfin !
— C’est un être humain comme nous. Il n’a pas la même peau, c’est tout, dit Benoît.
— C’est vrai qu’il a les traits fins. C’est un gentil garçon.
— Ah ! Tu vois que j’ai raison, grand-mère.
— C’est quand même un Noir.
— Oui, mais il est très beau.
Ludovic avait effectivement belle allure. Il avait onze ans et il était d’origine éthiopienne. Ses parents, Élodie et Simon Laborissière, avaient fait de l’humanitaire dans l’est de l’Afrique et ils l’avaient adopté. Sa mère, médecin, et son père, responsable d’un laboratoire, habitaient aujourd’hui une immense demeure, avenue Marx-Dormoy, à Montluçon. Mais Ludovic n’appréciait pas trop la vie tumultueuse de cette ville et, à chaque congé, il se réfugiait chez ses grands-parents maternels qui aimaient le calme aussi et qui le
choyaient comme le faisaient, en général, les anciens à l’égard de leur descendance. En début d’année, ces derniers, Anne-Marie et Alexis Perron, avaient acheté, pour leur retraite, une grande maison dans le faubourg de Culan. Celle-ci était située à quelque deux cents mètres de la propriété verdoyante des Guérin. Seuls la séparaient de cette dernière, la rivière, son pont soi-disant romain et la prairie au pied de la forteresse. Il s’agissait d’un logis solide qu’ils avaient fait rénover. Une cour, assez vaste et bien ombragée à la belle saison, offrait des conditions idéales pour un repos bien mérité. Le grand-père, inspecteur du travail, et la grand-mère, secrétaire dans un ministère, avaient pris leur retraite et avaient opté pour ce petit coin du Berry, terre d’origine d’Alexis.
Tout à l’heure, Aurélie Rizeux revenait de promenade avec Rosine et son regard avait rencontré celui de Ludovic. Son étonnement, devant sa couleur de peau, avait immédiatement laissé la place à des sentiments confus comme si elle avait éprouvé de l’admiration et un besoin de le revoir, d’en faire un camarade de jeux pendant ses vacances d’été. L’espoir, qu’il ne la rejetterait pas, mais que, au contraire, il rechercherait sa compagnie,
avait subitement germé dans son esprit. La veille, accoudée au parapet du pont, elle l’avait vu au bord du lavoir tendant sa ligne dans les eaux basses de la rivière. Il avait appuyé sa canne sur les herbes de la berge et s’était assis en tailleur, fixant sa plume d’un air rêveur. Il n’avait pas l’allure d’un pêcheur. Aujourd’hui, le trouble l’avait saisie et elle n’arrêtait pas de penser à ce jeune Africain qui devait avoir à peu près son âge. Avec ses dix ans, Aurélie n’avait pas conscience que son cerveau venait d’intégrer des sensations nouvelles. En elle, avait finalement pris naissance de l’intérêt, de l’attirance même, pour ce petit garçon à la peau si noire et à la chemise si blanche.
Le lendemain matin, en prenant son petit-déjeuner, elle devina une silhouette sur la route. La seconde suivante, celle-ci
avait disparu derrière le feuillage du verger. Elle pensa au petit-fils des Perron qui aurait pu
emprunter le pont pour atteindre l’autre rive de l’Arnon. Elle estima qu’une fois sur la berge rien ne devrait l’empêcher de passer à pied sec sous la quatrième arche et de venir pêcher dans le petit filet d’eau qui s’allongeait devant les troènes avant d’aller rejoindre le gros du courant. Pleine d’espoir, elle resta immobile et silencieuse, sa tartine beurrée à la main et le contenu de son bol refroidissant. Un bruissement, de l’autre côté de la haie, lui indiqua qu’elle avait peut-être vu juste. Au loin, à travers les claires-voies du portillon du jardin, une tache blanche passa et s’effaça aussitôt. Elle termina son pain, but son lait chocolaté et alla ouvrir. Elle s’approcha du petit pêcheur qui, son pantalon remonté, avait les deux pieds dans l’eau et lui tournait le dos. La situation du garçon était délicate. Sa gaule pliait et le fil était tendu à l’extrême. Son hameçon avait accroché une racine ou un galet. Il avait beau tirer et secouer, sa ligne était fermement retenue par le fond.
— Tu veux que je t’aide ? lui demanda Aurélie.
— Ah, oui ! je veux bien. Tiens ma canne. Ce n’est pas creux. Je vais suivre le fil.
Il avança, plongea sa main dans les flots, dégagea son hameçon coincé entre les pierres et revint vers Aurélie qu’il remercia en reprenant sa gaule.
— Je peux aller avec toi ?
— Oui, si tu veux. Je vais aller pêcher de l’autre côté.
— Attends-moi, je vais avertir grand-mère Rosine.
Ils se retrouvèrent au bord de la rivière, installés à l’ombre, la ligne tendue dans une eau quasi stagnante. Ils restèrent là, dans le calme, tournant le dos au faubourg, étonnés d’être l’un près de l’autre et curieusement fascinés par l’ampleur de leur différence.
Aurélie était une petite fille blonde aux yeux bleus. Le teint clair de ses joues faisait
penser à une poupée de porcelaine. Elle était jolie. Sa taille était fine. Son visage traduisait intelligence et gentillesse.
Les deux enfants, qui se faisaient presque face, étaient assis en indien. Ils étaient devant un ancien lavoir où les femmes autrefois venaient nombreuses frapper le linge de leur battoir et
torsader au-dessus de l’Arnon les draps gorgés d’eau savonneuse. À leur gauche, le pont de pierres, d’aspect massif avec ses contreforts, témoignait de sa longue existence. L’ouvrage, qui aidait à franchir les flots en bas du faubourg, avait forcément servi aux Gaulois et à leurs envahisseurs. Il avait certainement, et à plusieurs reprises, connu des aménagements, des réparations. Il avait peut-être même laissé la place à une construction plus solide. Néanmoins, on l’appelait toujours le pont romain.
Ils s’étaient demandé leur prénom respectif et étaient redevenus silencieux. L’émotion leur faisait baisser la tête et arracher des brins d’herbe qu’ils jetaient devant eux, au fur et à mesure. Ludovic releva sa ligne, vérifia l’appât et reposa le tout au même endroit. De nouveau près d’Aurélie, il remarqua que celle-ci l’observait.
— Pourquoi me regardes-tu comme ça ?
— Parce que je te trouve très beau.
— Ah, curieux ! C’est la première fois qu’une fille me dit cela. Toi aussi, tu es belle. La couleur de ma peau ne t’effraie pas ?
— Non ! Je voudrais avoir la même que toi.
— Pour quelle raison ?
— Parce qu’elle brille au soleil. Elle me plaît. Pourquoi tu portes toujours une chemise blanche ?
— Mes parents y tiennent beaucoup. Ma grand-mère, Anne-Marie, aussi.
— Ça te va bien. Seulement, les poissons te voient facilement dans l’eau claire.
— Ah, tu crois ? Que devrais-je faire ?
Aurélie lui conseilla de ne pas s’approcher trop près du bord ou de brouiller l’eau quand il mettrait les pieds dedans. Peu après, suivi de la jeune fille, il alla déposer sa canne à pêche chez ses grands-parents. Les deux enfants repartirent, empruntèrent les ruelles du faubourg et passèrent devant l’entrée de la forteresse. C’était nouveau pour le petit-fils des Perron et la petite blonde était tout heureuse de le guider dans le Culan médiéval.
L’après-midi, en prenant les voies étroites qui montaient en lacets, ils traversèrent de nouveau le vieux quartier et se retrouvèrent en centre-ville. Ils parcoururent la Grande-Rue, s’arrêtèrent un instant devant les vitrines et entrèrent dans une épicerie pour acheter des sucreries. Pour Aurélie, Culan était une ville. Quant à Ludovic, il avait le sentiment de se trouver dans un gros village où certaines personnes avaient tendance à le fixer avec un brin de curiosité. Selon son amie, il était rare de voir des gens de couleur dans la région. Les habitants d’ici n’étaient pas habitués. Il n’y avait que des Blancs dans cette campagne bocageuse, d’où l’étonnement de quelques passants.
En descendant la rue qui menait directement en bas du faubourg, Ludovic se
servit de la leçon que sa maîtresse de maternelle avait faite sur les couleurs.
— Prends deux tubes de gouache. Une peinture blanche et une noire.
— Et alors ?
— Étale la noire sur une feuille. Elle fait penser à quelle peau ?
— À la tienne.
— Fais la même chose avec la blanche. À laquelle ressemble-t-elle ?
— À la mienne.
— Tu es sûre d’avoir l’épiderme aussi blanc que de la gouache blanche ?
— Ah, non !
— On dit, en parlant de vous, que vous êtes blancs, mais c’est faux. Tu n’as pas la peau blanche. Cependant, tu es très belle. Tes cheveux, c’est comme un soleil et tu me plais beaucoup.
— Ah oui ? C’est gentil. C’est pareil pour moi.
Arrivés au domicile des grands-parents Perron, les deux amis se quittèrent, les yeux brillants de bonheur et, sur leurs lèvres, se formait l’amorce d’un sourire complice.
Les jours suivants, ils firent de courtes promenades à bicyclette sur de petites routes tranquilles. Parfois, ils emportaient leur goûter sur leur porte-bagages et s’arrêtaient pour le prendre dans des endroits bien ombragés. Ils n’imaginaient pas partir dans la nature l’un sans l’autre. Les Guérin et les Perron les emmenaient même parfois visiter des lieux pittoresques, assister à des fêtes de village ou chiner sur des brocantes. L’été fut beau et les journées leur semblèrent courtes. Les deux premières années, ils vécurent la totalité de leurs vacances scolaires unis par la bonne entente et l’attirance mutuelle.
Pour trouver le domaine du Boisseau, propriété des Rizeux, située dans la commune de Saint-Désiré, il fallait parcourir quelques kilomètres sur la route nationale 943, en direction de Montluçon, et prendre, juste avant le hameau de Goéla, la petite route menant à Saint-Éloy-d’Allier. La famille habitait une maison somptueuse de construction récente. Un hangar imposant, bâti à l’écart, abritait le matériel agricole. Bernard Rizeux était céréalier. Aurélie avait fait ses premiers pas dans une cour fleurie que jouxtaient de vastes
champs de blé, de colza, de maïs ou de tournesol. Les centaines d’hectares de terre, qui entouraient la demeure, changeaient de couleur au fil des
saisons et ces immensités vertes ou jaunes imitaient parfois la houle sous l’effet du vent.
Bernard Rizeux, le maître des lieux, qui considérait l’étranger comme un danger pour ses semblables et pour tous ceux dits de « bonne famille », était aussi un despote et un grippe-sou. L’argent était sa raison de vivre. Habitaient avec lui ses parents trop âgés pour travailler, sa femme, Mathilde, et sa fille. Le domaine du Boisseau était isolé. Le hameau le plus proche, en repartant vers Goéla, se trouvait à un bon kilomètre. C’était donc la solitude au milieu des champs sans bouchures.
Aurélie avait vécu ses dix premières années au centre de cette nature surexploitée. À l’âge de sa scolarité, elle était montée dans la voiture de ses parents pour aller à l’école primaire de Saint-Désiré. À l’automne de 1990, Bernard Rizeux vendit ses terres et acheta une plus grande propriété dans la commune de Vesdun. Par contre, il conserva la maison du Boisseau dans
laquelle ses parents voulaient rester vivre. Ainsi, il changeait de lieu et de
département et sa fille dut suivre son CM2 dans un nouvel établissement.
Le Montet. Contrairement à l’idée que ce nom pouvait suggérer, la nouvelle exploitation du sieur Rizeux s’étendait sur un sol pratiquement plat. Au-delà d’un étang, qui servait en période de sécheresse à arroser le maïs, on trouvait une friche et un bois de trois hectares qu’il souhaitait raser pour en faire des terres cultivables. Le logis était grand et moderne, mais les bâtiments agricoles étaient soit vétustes soit inappropriés à son activité. Un hangar métallique était en montage pour abriter son matériel et les constructions en dur étaient destinées à la démolition. Le céréalier avait plusieurs raisons de se réjouir. La terre était de bonne qualité. Ensuite, ses vieux étant restés au Boisseau, il en était débarrassé. Et, dans quelques années, le fils unique de ses voisins ferait un parfait époux pour sa fille. En s’installant ici, il avait aussi envisagé l’avenir. Une alliance serait un moyen de doubler le foncier. Près de mille hectares, peut-être plus, tomberaient alors dans la corbeille du mariage.
Une fois bien établi dans la commune de Vesdun, le père Rizeux se mit aussitôt à cultiver ses nouvelles terres. Un jour, alors qu’Aurélie était en classe, Mathilde demanda à son mari :
— Il a quel âge le fils des Morillon ?
— Arnaud ? Il doit avoir seize ans.
— Et tu voudrais qu’il épouse ta fille ? Il est bien trop âgé. Aurélie n’a que dix ans.
— Elle va en avoir bientôt onze. Toi et moi, on a bien cinq ans de différence. Quand ils seront plus grands, ça ne se connaîtra plus.
— Mais Arnaud peut aller en voir une autre, quand il aura vingt ans et plus. Et
peut-être même avant.
— Bah ! Ce n’est pas un souci. Les Morillon savent aussi où est l’intérêt de nos familles.
Le hasard voulut que Bernard Rizeux prît connaissance de l’amitié particulière qui existait entre Aurélie et Ludovic. Il désapprouva ce lien qu’il jugea malsain. Comme quoi le racisme, qu’avaient exalté les partisans de l’empire colonial, demeurait toujours dans la tête des gens. Il ne perdit pas de temps pour s’adresser à Mathilde sur un ton autoritaire :
— Pendant les vacances, pour Aurélie, Culan, c’est fini. Elle ira chez ses grands-parents, au Boisseau. Je ne voudrais tout de
même pas avoir pour gendre un Noir.
— Ce n’est qu’une gamine. Pour elle, c’est un compagnon de jeu, c’est tout.
— Oui, certainement. S’ils continuent à jouer comme tu dis, devine quel sera leur jeu dans quelques années.
— Tu vois le mal partout.
— Exactement ! Et je ne veux pas d’un bamboula dans ma maison. Il me semble que je suis assez clair.
La jeune fille terminait avec succès sa sixième au collège de Saint-Amand. Une fois chez elle, confrontée aux nouvelles conditions imposées par son père, elle comprit que sa vie ne pourrait plus aller de pair avec les sentiments
qu’elle éprouvait pour Ludo. Ne plus séjourner chez ses grands-parents, c’était ne plus voir son compagnon et cette disposition la faisait souffrir énormément. Toutefois, ses parents virent qu’il leur serait difficile de priver Rosine et Benoît de sa présence. Finalement, Aurélie eut encore l’occasion de rencontrer son ami et de prendre avec lui des dispositions pour ne
jamais se perdre de vue. Mais ses séjours à Culan devenaient très courts.
Pour rester en contact avec Ludo, il lui fallut exclure toute communication téléphonique, sachant que son père s’y opposerait fermement. En cachette, la jeune fille écrivait à Montluçon ou chez les grands-parents Perron lorsque son ami était en vacances chez eux. Quant à ce dernier, pour s’adresser à elle, il devait envoyer le courrier au frère d’une de ses camarades de classe, qui le lui remettait ensuite.
Le garçon saisit tout de suite la raison de ce stratagème, mais il fit celui qui ne comprenait pas. La jolie blonde affirma que ses
parents liraient ses lettres, ce à quoi elle ne tenait absolument pas. Ludo secoua la tête, en guise d’acquiescement, pour ne pas la mettre dans l’embarras.
Chacun s’habituait à se voir moins souvent et la correspondance palliait les restrictions imposées par le père. Dorénavant, les vacances d’été les réunirent durant un mois seulement. Aurélie allait entrer au lycée à la rentrée prochaine et Ludovic, très en avance dans sa scolarité, envisageait des études supérieures. À Culan, un après-midi, ils décidèrent de visiter le château féodal et de suivre un groupe de touristes. Ils avancèrent avec eux dans le dédale des couloirs, traversèrent de grandes salles, se retrouvèrent en haut des tours, virent les cuves où chauffait l’huile, les hourds par où on la jetait, les meurtrières pour les arbalétriers, et écoutèrent sagement, à la limite de l’ennui, le guide raconter sur un ton monocorde l’histoire ancienne des lieux. Ils sortirent de la forteresse un peu éberlués. C’était comme s’ils avaient vécu des siècles en arrière dans la fraîcheur des pièces et qu’ils se retrouvaient subitement dans le présent sous une chaleur torride. En revenant, par les ruelles, vers le bas du
faubourg, Aurélie prit Ludo par la main. Celui-ci s’en étonna, mais sourit intérieurement. Pour apparaître naturel, il engagea la discussion sur un sujet qu’il jugea sérieux. Son grand-père Alexis s’était procuré, auprès d’un ami, une thèse dans laquelle étaient rassemblés les faits qui avaient marqué l’existence mouvementée de la forteresse.
— Le passage de Jeanne d’Arc en ce lieu médiéval est une tromperie manifeste.
— Pourquoi dis-tu cela ?
— Dans le fascicule que mon grand-père s’est procuré, on indique qu’elle guerroyait dans le nord de la France à l’époque où on voudrait qu’elle ait séjourné à Culan.
— Si ça se trouve, elle n’a jamais mis les pieds ici.
— Possible. Mais pour attirer le touriste, que ne ferait-on pas ? C’est comme George Sand qui serait venue pique-niquer au pied du château !
— Où as-tu appris cela ?
— Dans la plaquette de mon grand-père. Si elle est venue ici, je voudrais bien savoir par quel moyen elle aurait
fait ce voyage. En calèche ? En tacot ? Ce dernier moyen de transport et le viaduc existaient-ils ? L’ouvrage ne fournit pas l’année de sa visite. L’auteur émet des suppositions, c’est tout.
— Tu t’imagines George Sand et son entourage étalant leurs victuailles sur l’herbe ?
— Peut-être même dans la prairie où paissent les ânes et les poneys ?
Ils éclatèrent de rire. Ils rentrèrent calmement chez Anne-Marie et Alexis et, dans la cour, ils s’installèrent autour d’une table garnie de boissons et de friandises.
Au mois d’octobre 1995, Benoît Guérin s’éteignit silencieusement. Il s’était installé à la table du salon et lisait tranquillement quand son cœur lâcha. Sa tête reposa doucement sur son journal. La mort mettait fin à une courte retraite de cheminot. Le grand-père d’Aurélie avait été conducteur de train, roulant le jour comme la nuit, se reposant ici et là, à un terminus, dans une chambre anonyme. Pendant ce temps, Rosine, elle aussi,
avait travaillé dans des conditions quasi identiques comme aide-soignante dans un hôpital parisien. L’un et l’autre avaient pratiqué un métier usant.
Le week-end suivant, Élodie et Simon conduisirent leur fils Ludovic à Culan. Le malheur y avait retenu Aurélie qui avait prié Anne-Marie de téléphoner à Montluçon. Cette nouvelle avait attristé le jeune garçon qui, sans attendre, désira aller réconforter son amie.
Les obsèques de Benoît eurent lieu en milieu de semaine et, dans la petite maison du bord de l’Arnon, son absence faisait forcément un vide bouleversant. Aurélie et Ludovic eurent l’occasion de se promener un peu. Ils avaient l’air sombres. Ils réalisaient que leur insouciance d’enfant et de jeune adolescent avait pris fin, que le temps des grands-parents,
avec leur réconfort, leur protection et leurs gâteries, n’était pas éternel. Ils se dirigeaient vers l’âge adulte, vers le moment où ils devraient décider eux-mêmes de leur avenir.
Aurélie annonça à Ludo que son père ou sa mère devrait venir la chercher en fin d’après-midi, et que le mieux serait qu’au retour il ne l’accompagnât pas jusque chez Rosine. Son ami, comme pour les lettres, se força pour paraître compréhensif. Elle décida enfin de lui fournir la véritable raison.
— Mon père ne tient absolument pas à ce que je me promène avec toi. Mais lui, c’est lui, et moi, c’est moi. L’ennui c’est que je ne suis pas encore majeure.
— C’est pour cette raison que je dois t’écrire chez le frère de ta copine ?
— Oui ! Excuse-moi, mais je n’osais pas te le dire. Il y a autre chose de plus grave : Rosine, pour ne pas se retrouver toute seule, doit aller habiter dans la
maison du Boisseau, chez mes autres grands-parents. En plus, mon père veut vendre celle d’ici.
— Quoi ? Rosine est d’accord ?
— Non ! Mais c’est mon père qui décide de tout.
— Alors on ne se verra plus jamais ?
— On pourra toujours s’écrire et quand j’aurai dix-huit ans, j’irai te rejoindre à Montluçon ou ailleurs, si tu le souhaites, bien sûr.
En lui disant cela, elle le fixa de ses beaux yeux bleus. Elle lui prit la tête et lui tendit ses lèvres. Après cette étreinte, qui signifiait beaucoup de choses, elle ajouta :
— Je ne t’oublierai jamais.
— Moi, non plus. Et quand tu seras majeure, on pourra se voir quand tu voudras, même ici, chez mes grands-parents.
Au pied de la forteresse médiévale, ils s’embrassèrent de nouveau et ils rejoignirent la grande rue du faubourg en se tenant par
la taille, certains d’avoir bientôt un avenir commun.
***
Ludovic venait de terminer ses études et, chargé des pleins pouvoirs, il remplaçait son père à la tête du grand laboratoire de la Trinité, rue des Grands-Prés, à Montluçon. Ses parents s’étaient embarqués sur le voilier de leurs amis, les de Portello, pour une croisière en Atlantique et en Méditerranée. Ils étaient partis des Sables-d’Olonne et ils devaient rejoindre La Ciotat où le bateau de plaisance de la famille Laborissière avait son port d’attache.
Après des études de médecine, Ludo s’était orienté vers la pharmacologie. Il avait additionné les diplômes tout au long de sa scolarité. Il était assis dans le bureau de direction et lisait la lettre d’Aurélie que le facteur venait de lui remettre. Au-dessus du texte, qui abondait en
mots tendres, ses yeux brillaient et ses lèvres, qui s’écartaient légèrement, témoignaient de son grand bonheur.
Les deux amoureux ne s’étaient jamais perdus de vue. Chaque semaine, ils s’étaient écrit. Et, quand Aurélie fut majeure, quand elle fut reçue au concours des Postes, qu’elle se trouva derrière un guichet parisien, elle prenait généralement le train, le samedi après-midi, pour rejoindre son ami à Montluçon ou à Clermont-Ferrand. Elle passait tous ses congés et la plupart de ses week-ends avec lui.
Jérôme Chartier, le second du laboratoire et son ami fidèle, entra dans le bureau. Il devina l’origine du courrier qu’il lisait.
— Comment va Aurélie ?
— Bien ! Elle te transmet le bonjour.
— Maintenant, il serait peut-être utile qu’elle vienne s’installer ici. Ce n’est pas le travail qui manque au secrétariat.
— La venue d’Aurélie parmi nous est prévue.
— Ça soulagera Audrey qui se voit souvent débordée et ce serait plus pratique pour envisager votre mariage. Mais ce dernier point
n’est pas de mon ressort.
— Effectivement ! Mais tu seras quand même mon témoin.
— Je n’en demandais pas tant.
Ludovic était anxieux. Ses parents étaient partis depuis trois semaines et il y avait près de quinze jours qu’il n’avait pas de nouvelles. Il avait tenté de joindre le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, mais celui des Sables, situé à Audierne, n’ouvrait pas avant le 15 juillet au public. À la capitainerie, on ne fut même pas en mesure de lui dire si le voilier en question avait une radio VHF pour
rester en contact avec la terre. Il avait le sentiment qu’on ne le prenait pas au sérieux. Enfin, il avait beau se dire que les vacanciers, bercés par les vagues et le vent dans les voiles, prenaient des bains de soleil sur
le pont, cela n’empêchait pas son inquiétude de se transformer parfois en mauvais pressentiment. Il n’était pas le seul à se soucier. Il y avait Jérôme, bien sûr, mais aussi, Audrey Salbris, la secrétaire de direction, qui avait toujours pensé qu’elle pourrait suivre le périple de son patron et qui, depuis plusieurs jours, pinçait les lèvres chaque fois qu’elle apprenait que le silence était total.
Ludovic quitta le laboratoire pour rejoindre la maison familiale. Une fois à l’intérieur, il éprouva aussitôt un sentiment de solitude. Dans les vastes pièces de cette demeure, il y manquait Élodie et Simon qu’il adorait au même titre qu’Anne-Marie et Alexis. Ses parents adoptifs avaient veillé sur lui comme s’il avait été un petit prince qu’il fallait absolument protéger des méchants. Ils avaient toujours pris soin de sa santé et de son confort, même quand il était devenu grand et avait fréquenté les universités. À Culan, ses grands-parents l’avaient gâté, admiré et avaient toujours eu le souci de son bien-être. Il avait été et était toujours un privilégié.
Dans son bureau où se rassemblaient ses souvenirs d’école, de la maternelle à la faculté, il feuilletait machinalement une revue médicale tout en ressassant les différents sujets qui le préoccupaient. Outre le silence des vacanciers, il y avait aussi le mariage avec
Aurélie qu’il fallait décider cette année et le laboratoire qui le conduisait à assumer de lourdes responsabilités.
Autour de lui s’entassaient des livres scolaires, une bibliothèque renfermant des livres de grands auteurs. Sa table d’écolier, sur laquelle reposait son ordinateur, était poussée dans un coin. Au mur, quelques photos et deux posters lui rappelaient son
enfance. Aujourd’hui, toutes ces choses n’avaient qu’un intérêt limité. Il les regardait d’un air vague et son esprit n’entrevoyait qu’un avenir incertain. Enfin, pas tout à fait ! Il épouserait Aurélie très prochainement. Cette décision était bel et bien inscrite à son programme et elle était irrévocable.
Les fenêtres de son bureau donnaient sur l’avenue Marx-Dormoy. Ce soir encore, il s’en approcha et regarda la nuit qui tombait sur la ville, l’esplanade qui s’éclairait, les passants qui se pressaient, les voitures qui se garaient ou qui
quittaient leur emplacement.
Ludovic avait grandi dans cette grande maison cossue qu’il prenait pour un château quand il était petit. Les pièces y étaient nombreuses, vastes et hautes. Les couloirs étaient larges et, au rez-de-chaussée, des colonnes énormes et blanches, sculptées jusqu’au plafond, ressemblaient plus à de l’ornement qu’à une nécessité architecturale. Au premier étage, côté jardin, sous l’avancée du toit, une terrasse ornée de plantes vertes offrait le silence, la fraîcheur et le repos, quand il faisait très chaud. En bas, l’herbe tondue avait remplacé le potager et, au fond, dans un local vitré, l’employé de maison y avait étendu le linge à la saison des pluies avant qu’un appareil électrique vînt enfin moderniser la buanderie.
Il était tard, mais il imagina ses grands-parents Perron, Aurélie et sa colocataire, devant la télévision. Il téléphona aux premiers : toujours pas de nouvelles d’Élodie et de Simon. Avec Aurélie, qui préférait parler à l’homme de son cœur plutôt que de suivre le film sur le petit écran, il resta un long l’oreille collée sur l’appareil. Sa fiancée souhaitait travailler derrière son guichet jusqu’à son prochain congé annuel qui n’aurait pas lieu avant le mois d’août. Pour leur mariage, fallait-il attendre les vacances de la postière ? C’était un sujet à débattre au cours de leur prochaine rencontre.
En ces moments de solitude, Ludovic revenait parfois sur son enfance, sur ses
origines. Il se revoyait tout petit, à l’école maternelle, habillé comme un prince. Le nœud papillon et la chemise blanche, qu’il arborait sous un costume de belle coupe, le faisaient toujours un peu sourire
aujourd’hui. Il avait le souvenir des marques de respect que lui portaient ses camarades
et se demandait si ses tenues bourgeoises n’avaient pas joué un rôle contre la xénophobie. Élodie et Simon ne lui auraient-ils pas imposé ces habillements ostentatoires pour le préserver des méchants ? Maintenant, il s’habillait avec beaucoup moins de minutie. À l’époque, si ses vêtements étaient, pensait-il, des éléments nécessaires à sa tranquillité, le brillant élève qu’il était en classe devait certainement lui permettre aussi de jouer dans la cour de
récréation sans ressentir le moindre rejet.
Quand ce n’était pas l’employée de maison qui l’accompagnait, son père ou sa mère l’emmenait dans une luxueuse voiture, le déposait devant l’école et l’embrassait tendrement avant de repartir. Son arrivée était généralement remarquée et il se voyait aussitôt entouré comme si les écoliers étaient fiers d’être en sa présence.
Quand le hasard l’amenait à réfléchir à son pays d’origine, il lui venait à l’esprit la géographie des lieux, la population, ses élites et ses millions de pauvres. Il se disait que, s’il avait grandi là-bas, il appartiendrait inévitablement à la dernière catégorie. Évidemment, il ne craindrait pas le racisme, mais il souffrirait sûrement de la misère et de la faim.
Le racisme ! Quand il était enfant, son grand-père Perron lui avait certifié que les races n’existaient pas, que c’était une invention de ceux qui s’étaient imposés aux populations africaines, entre autres, et qui aimeraient pouvoir continuer.
Tous les êtres humains se ressemblaient, avait-il dit, et la couleur de la peau n’était qu’un détail sans intérêt. N’empêche que, si scientifiquement rien ne nous distinguait comme le prétendait Alexis, Ludovic savait que le racisme était un sentiment de haine qui guidait beaucoup de personnes. Il était bien placé pour s’en rendre compte. Ses grands-parents paternels, Hortense et Louis-Étienne, n’avaient jamais accepté son adoption. C’était des intégristes, des activistes, des extrémistes. Hortense était morte depuis quelques années. Mais, encore aujourd’hui, Louis-Étienne, avec ses quatre-vingts ans largement dépassés, ne pouvait s’empêcher de distiller son venin dans son dos. Il habitait dans une grande villa située entre la rue de Nerdre et la voie verte Montluçon-Néris. Cardiologue renommé, il avait exercé dans de grands hôpitaux et, jusqu’en 1990, il avait dirigé d’une main de fer le laboratoire de la Trinité. Simon, qui s’était toujours plié à son autoritarisme, avait pris la relève et avait craint ses visites inattendues qui étaient toujours source de tensions.
Tout petit, déjà, Ludovic n’était jamais allé de gaieté de cœur chez ce grand homme et son épouse. Sa conscience était balbutiante, mais son instinct lui avait fait comprendre qu’il n’était pas le bienvenu dans leur superbe maison qu’il prenait, elle aussi, pour un palais. Chez eux, il se rappelait qu’il était regardé comme un objet de curiosité, qu’on lui parlait sèchement et qu’il pleurait parfois. Il se souvenait des propos que Louis-Étienne tenait à sa mère quand celle-ci venait le récupérer. « Tu viens chercher ton bamboula ? », demandait-il. Ou encore : « Si avec ton travail, tu ne peux pas le garder chez toi, ton Noir, il ne fallait
pas l’adopter. » Simon voulait habituer ses parents à garder son fils durant quelques heures afin de leur permettre de se rapprocher
de lui, mais ce fut peine perdue. Avec sa peau couleur noir de cirage, ce petit-fils n’était forcément pas de leur sang.
Cette situation avait entraîné toute une série de disputes. Élodie s’était souvent fâchée, mais elle était restée toutefois mesurée. Quant à Simon, poussé hors de lui, il avait fini par traiter son père de fasciste, de raciste, de pétainiste, mais le vieil homme avait levé un bras, avait tourné le dos et s’était retiré sans dire un mot. Cependant, il avait fallu qu’un jour ne fût pas comme les autres pour que Ludovic ne remît plus les pieds chez Hortense et Louis-Étienne Laborissière.
Il avait à peine sept ans quand il fut traité avec un mépris inégalé. Les faits étaient devenus vagues au fil des années. Seuls quelques détails lui étaient restés en mémoire : ses grands-parents piétinaient d’impatience dans le hall de leur château ; sur le gravier, devant les rosiers, une superbe voiture attendait, moteur
tournant ; puis, des trottoirs, des gens, des lumières. De plus, ses parents n’aimaient pas vraiment s’étendre sur l’incident.
Hortense et Louis-Étienne Laborissière devaient assister à une réunion importante. Seulement, le bamboula était dans leurs jambes et Simon, ou Élodie, avait trop tardé à venir le prendre. Sans scrupule, ils avaient mis Ludovic dehors, avaient fermé leur luxueuse demeure, avaient conduit le gamin sur le trottoir, lui avaient
indiqué la voie à suivre et ils s’en étaient allés. L’enfant avait marché le long de la rue des Faucheroux. Il avait pris ensuite la rue Barathon au lieu
de poursuivre tout droit par la rue Saint-Jean. Il s’était dirigé sans le savoir vers le boulevard de Courtais et s’était demandé alors s’il ne s’était pas perdu. Il s’était arrêté et les larmes étaient venues aussitôt s’ajouter à son désarroi. Un artisan, qui rangeait ses outils dans son utilitaire, l’avait vu et avait réussi à le faire parler. Le pauvre enfant avait pu dire qui il était et où il habitait. Il fut alors sauvé et ramené chez lui. Ses parents l’avaient cherché en sillonnant quelques rues avant d’avertir la police de sa disparition.