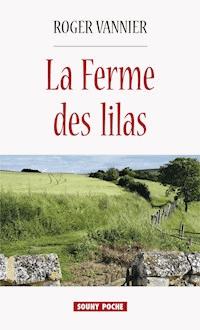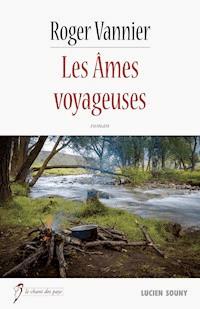
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Joseph Dumarais dédie sa vie à la défense des gens du voyage. Mais tout le monde n'est pas de son avis...
Sauvé par le passage d'une roulotte sur le pont d'où il comptait se jeter, Joseph Dumarais, un Poilu meurtri, indigné et diminué, reprend espoir grâce à un bohémien de passage. À partir de ce jour, Joseph se fera le protecteur de tous les gens du voyage qu'il rencontrera. La guerre et ses lois le confronteront bien vite à sa promesse...
Des années plus tard, son fils Gérard, élu municipal, perpétue l'engagement de son père, et évite la fermeture de l'école en scolarisant les deux enfants de la famille Ziderman, qui vit en contrebas de la rivière. Il déclenchera du même coup les foudres de certains villageois, prêts à tout pour expulser les "voleurs de poules". À l'école, les enfants n'écouteront que leur cœur et feront fi de leurs origines sociales. Oseront-ils affronter le regard des autres et tordre les conventions ? Parviendront-ils à repousser les idées étroites et les attitudes hypocrites de ceux qui les entourent ?
Découvrez, dans ce roman, le récit d'une famille de bohémiens persécutée dans un village de France. Un récit intemporel sur l'acceptation de l'autre dans une époque troublée.
EXTRAIT
Le portail de la cour de l’école fut ouvert pour accueillir les élèves. Ce matin-là, Gérard, le maire et Antoine étaient présents. Les trois petits Ziderman furent pris en charge par la maîtresse et, du côté du préau, on les vit faire connaissance avec les uns et les autres. Les adultes, restés sur le bord de la route, souhaitaient vivement que l’accueil des petits Ziderman se fît dans les meilleures conditions.
Antoine devait se rendre à la mairie pour y régler plusieurs formalités. Il avait en poche trois certificats de scolarité et devait d’abord se mettre en conformité avec les services sociaux. Dès lors, dans la commune de Montplaisant, les Ziderman prenaient la voie de la sédentarité.
C’était au tout début d’un après-midi de Toussaint sans nuages. Antoine, assis sur une chaise adossée à la caravane, écorçait et fendait des brins d’osier. Les enfants jouaient sur le chemin. Maria s’occupait à l’intérieur. Les chevaux n’en finissaient pas de brouter l’herbe des talus et les chèvres de se dresser contre les haies. La volaille, après avoir picoré tant et plus sur des coulées de sable, avait disparu dans les friches d’à côté. La paix et le bonheur régnaient au milieu du vignoble. Sauf que c’était jour de chasse et que trois hommes, au loin, cherchant à débusquer le garenne ou le lièvre, s’avançaient dans les rangs. Antoine les avait aperçus et avait distingué par moments le reflet du soleil sur le bronze des canons. Il n’aimait pas voir des gens s’aventurer avec un fusil autour de son campement. Après les vendanges, un arrêté municipal fixait la date et l’heure de l’ouverture dans toutes les parcelles. C’était alors la pétarade du matin jusqu’au soir. Les garçons avaient peur. Maria et lui n’étaient pas tranquilles. Ils voyaient dans cette invasion guerrière un inconvénient de taille, que la proximité de l’école compensait à peine.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Roger Vannier est né dans le Cher, à Reigny. Instituteur, il a d’abord enseigné en Algérie, puis il est rentré sur ses terres natales pour terminer sa carrière. Aujourd’hui à la retraite, il mène une activité artistique à laquelle il associe l’écriture. Il vit à Chateaumeillant. Son univers s’enracine dans sa région natale, le Berry, dont il restitue toute la finesse, l’âme et la beauté.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Les Âmes voyageuses
Joseph Dumarais fut incorporé en 1913. Il traversa la plupart des tueries de masse de la guerre de 1914-1918 et vit des horreurs inimaginables. Il fut l’un des soldats qui composaient des armées se faisant face, se vidant mutuellement de leur sang, arc-boutées l’une contre l’autre malgré leurs forces déclinantes. Il battit la semelle dans le froid des tranchées, connut des repos cauchemardesques dans l’inconfort des cagnas, et avala le rata froid ou chaud pour soulager son estomac crispé. Il fit Verdun, le Chemin des Dames, les Flandres. Ses permissions se transformèrent en séjours de soins pour blessures légères. En été 1918, près d’Armentières, il eut la jambe déchiquetée par un éclat d’obus. On l’amputa, des complications s’ensuivirent et il fut ballotté d’un hôpital à un autre.
Au printemps de 1919, dans un dispensaire de la région parisienne, il achevait un long séjour de remise en forme. Il attendait donc sa démobilisation et son billet de sortie. Il avait une jambe de bois munie, à une extrémité, d’une enveloppe de cuir molletonnée à l’intérieur pour gainer son moignon. Un harnais avec ceinture empêchait la prothèse de se désolidariser de sa cuisse. Pour marcher, il avait deux béquilles, des fourchasses, selon les paysans. Il s’appuyait sur la latte, recouverte de laine, qui reliait leurs deux branches en V. Il ne se voyait pas avancer dans la vie avec cet attirail. On avait beau lui dire que le support n’était que provisoire, qu’il servait au départ à s’habituer à marcher, et qu’il pourrait très tôt s’en dispenser, il ne s’imaginait pas se mêler à la foule avec un membre en moins et une perche coincée sous chaque aisselle. Dans sa tête, il y avait encore la douleur, celle ressentie au front et celle du scalpel des chirurgiens. Il y avait aussi le bruit des combats, des explosions, des cris, les sons horribles de cette folie bestiale empilés dans sa mémoire tout au long de ces quatre années de calvaire. Les conditions étaient loin d’être réunies pour qu’il pût voir la réalité en face. Il était toujours jeune. Il avait encore toute une vie devant lui. Mais, dans son esprit, il n’avait plus aucun avenir.
Joseph Dumarais connut son premier bain de foule dans le hall et sur le quai de la gare de Corbeil-Essonne. En tant que handicapé, il fut accompagné. On l’aida à monter dans son train et à s’asseoir sur un siège. On plaça au-dessus de lui son paquetage, on lui souhaita un bon retour et on le quitta. Il eut tout de suite la sensation d’abandon, celle d’un homme isolé, démuni et diminué parmi tous ces passagers vaillants. Le convoi roulait et les gens qui l’entouraient le regardaient avec indifférence. Qui, autour de lui, pouvait imaginer la tragédie qu’il avait vécue ? Qui s’apitoyait aujourd’hui sur le drame qu’avaient connu des millions de jeunes gens et leur famille ? Certainement pas ceux que l’âge avait épargnés de l’enfer ! Il savait, d’après les journaux qu’il avait eu l’occasion de lire dernièrement, que les Français étaient tournés vers le présent et l’avenir, et qu’ils se préoccupaient surtout de relance économique. Revenir sur la Grande Guerre et analyser les raisons de cette confrontation n’étaient plus d’actualité. On veillait à orienter le lecteur vers le superficiel, sur les faits divers, à l’amener à réfléchir sur des sujets simplistes. En fait, on voulait lui faire tourner le dos aux massacres, aux terribles années de plomb, d’obus, de feu et de gaz moutarde.
Les voyageurs les plus proches jetaient, de temps à autre, un regard béat sur sa prothèse et sur ses fourchasses qui s’appuyaient contre la paroi du wagon. Lui, la tête penchée vers la vitre, il laissait le paysage défiler sous ses yeux qui, eux, semblaient avoir fixé à jamais les sols brûlés et troués, les arbres brisés en deux et les étendues dévastées.
À Nevers, il s’aperçut qu’il était allé trop loin. Il avait dépassé, de plusieurs dizaines de kilomètres, la station où il aurait dû descendre et attendre une correspondance. Il se leva péniblement, s’empara de ses béquilles et se dirigea vers la sortie. Personne ne daigna l’épauler. Seul le chef de gare l’accueillit et l’aida à descendre. Le train repartit. Joseph se donnait du courage pour avancer quand il se rappela que son paquetage était resté dans le wagon, sur l’étagère de bois jauni. Sur le quai, il demeura un moment désemparé. Sur lui, il avait son portefeuille, de l’argent et ses pièces d’identité. Mais dans son grand sac de l’armée, qui poursuivait le voyage, il y avait ses vêtements, ses papiers militaires et ses médailles. Décidément, plus rien ne lui souriait.
Il quitta la gare, avança doucement sur les trottoirs, suivit plusieurs rues et se dirigea vers une église. Son chemin croisa celui d’un curé qui s’arrêta et qui, pris de compassion pour son infirmité, lui demanda où il allait. Joseph lui donna son adresse et lui raconta sa mésaventure. L’ecclésiastique l’invita à dîner au presbytère et à dormir dans un lit moelleux placé au fond d’un large couloir.
Après avoir pris un repas frugal, dans le silence et le recueillement, Joseph partit se coucher. Il connut d’abord un sommeil de plomb. Puis, durant les deux dernières heures de la nuit, son corps fut saisi de soubresauts. Sa tête s’agita dans tous les sens. Venant d’un vasistas situé au-dessus de lui, le jour, qui commençait à poindre, laissa deviner ses yeux révulsés. Joseph était plongé dans un rêve cruel. Il était en Artois, ou peut-être plus au nord, en France ou en Belgique. Il avait le sentiment que ses hallucinations prenaient leur source dans ces parages. Des visages apeurés, des barbes blondes hirsutes, des loques à casques à pointe défilaient devant lui. L’horizon était en flammes. Des explosions et des hurlements lui déchiraient les tympans. Il vit partir dans les airs une jambe qui s’accrocha aux branches d’un arbre qu’un obus foudroya. Il porta sa main à l’extrémité de sa cuisse et il comprit que c’était la sienne qui venait de s’envoler. Au moment où il allait pousser un cri, le curé vint le réveiller.
— Vous avez fait un cauchemar, mon fils.
— Oui. Ce n’est pas le premier et je crains fort que ce ne soit pas le dernier !
Le prêtre le pria de venir prendre le petit-déjeuner. Il s’était renseigné, et il l’informa qu’il pouvait prendre le train aux alentours de dix heures pour se rapprocher de chez lui. Quelqu’un l’accompagnerait jusqu’à la gare, au cas où il le souhaiterait. La veille, si l’ecclésiastique avait tenu compte de sa fatigue, de ses angoisses, et avait respecté le silence, devant le casse-croûte du matin, il chercha à satisfaire sa curiosité. Toutes les réponses à ses questions lui ayant été fournies, son regard se porta un instant sur la capote bleu clair que son hôte avait posée sur une chaise, et sur la dorure ternie des galons qu’il apercevait sur une épaulette. Il demanda à son invité :
— Vous étiez sous-officier, mon fils ?
— Lieutenant, mon père !
— C’est bien, mon fils !
— Non ! C’est une distinction qui vous donne du pouvoir et de l’autorité, mais qui vous rend directement responsable de tous ceux qui tombent autour de vous !
— Mais non, mon fils ! Vous n’êtes pour rien dans la mort des soldats que vous aviez sous vos ordres. Ce sont les Prussiens, ces barbares, qui sont les coupables. Il vous faut plutôt vous réjouir. Tous ceux qui sont tombés sont allés rejoindre Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a su les accueillir chaleureusement.
— C’est votre Seigneur qui a ordonné cette boucherie ? Si c’est lui, croyez-moi, mon père, il ne doit pas manquer de compagnie, aujourd’hui !
— Allons, mon fils ! C’est mal, ce que vous dites ! C’est blasphémer contre Notre-Seigneur Jésus-Christ !
— Excusez-moi, mon père. Je ne sais plus ce que je dis. Mais ceux qui nous ont lancés les uns contre les autres devraient être arrêtés, jugés et condamnés.
— C’est parler comme ce traître de Jaurès !
— Avec tout le respect que je vous dois, mon père, si, comme moi, après avoir fait la guerre durant quatre ans, vous aviez eu devant les yeux toutes les horreurs qui ont défilé sous les miens, et si, après cela, vous vous en étiez réchappé avec une jambe de bois et deux béquilles, vous ne parleriez pas de traître.
— Oui. C’est bien triste, ce qu’il vous est arrivé, mon fils !
Vers huit heures, on lui donna de vieux vêtements. Il en fit un balluchon qu’il porta en bandoulière. Il refusa qu’on l’accompagnât et quitta le presbytère. Si, pendant le petit-déjeuner, il avait avoué au curé qu’il ne savait plus ce qu’il disait, cette affirmation, de toute évidence, traduisait que dans sa tête les choses n’étaient pas vraiment claires. Le cauchemar de cette nuit lui revint à l’esprit. Il n’avait jamais vécu les faits bizarres provenant du royaume des songes. Même sa jambe ne s’était nullement détachée de son corps : il avait fallu des chirurgiens pour se charger de cette opération.
Il n’avait pas l’intention de reprendre le train. Son souhait était de marcher et de traîner avec lui, comme un trophée morbide, les souvenirs macabres accumulés durant ces quatre années de guerre. Le pays était enfin en paix. Joseph en faisait facilement le constat. Il était dans un monde de liberté, et pourtant celui-ci lui faisait peur. Il était comme le détenu désemparé à sa sortie de prison, aveuglé par un univers qui l’aspire et qui n’a rien à lui offrir. Il pensa à Angèle Bourdieu avec laquelle il avait fait le serment de s’unir. Il y aurait bientôt six ans qu’ils ne s’étaient pas vus. Celle-ci l’avait certainement oublié depuis.
Il avançait sur des trottoirs plus ou moins déformés et glissants par endroits — il y avait eu un orage en fin de nuit –, et ceux-ci étaient parsemés de flaques d’eau. Il fit le lien entre sa jambe de bois, ses fourchasses et Angèle. Son corps, son âme, son cœur, son esprit, tout fut anéanti en même temps. Ou elle était mariée à quelqu’un d’autre, ou elle se détournerait du pitoyable infirme qu’il était. Il empruntait un pont qui enjambait la Loire quand il se convainquit que la vie n’avait plus de sens pour lui. Il atteignit le milieu de celui-ci et regarda le fleuve qui charriait les eaux tumultueuses du printemps. Sans se soucier des voitures à cheval et des torpédos qui passaient, il leva sa jambe de bois et la posa sur le parapet. Il allait basculer son torse dans le vide quand une main le retint par l’épaule. Il se retourna et vit le visage basané d’un homme, coiffé d’un vieux chapeau de feutre noir, qui le fixait avec tendresse et lui faisait non de la tête.
Il regarda autour de lui et aperçut une roulotte, tirée par un cheval, qui venait vers eux. Un enfant tenait la bête par la bride.
— Il fait beau ! Le soleil brille ! Tu es jeune et tu as toute la vie devant toi ! dit son sauveur, dans un français approximatif.
Et, regardant sa prothèse et ses béquilles, il ajouta :
— C’est ça qui t’ennuie ?
— Qu’est-ce que je vais faire, maintenant ?
Joseph se mit à pleurer sur l’épaule du bohémien qui le consola.
— Tu as des yeux pour voir, une bouche pour parler et manger. Tu as un cœur pour aimer, pour aider.
La roulotte était à l’arrêt. L’enfant, une femme et une adolescente les entouraient. D’une voiture qui passa, des cris et des rires, traduisant de la moquerie et de la haine, fusèrent, puis ils s’estompèrent dans le lointain.
— Où habites-tu ? lui demanda le nomade.
Joseph fut incapable d’expliquer où se trouvait son domicile. Sa maison natale lui revint à l’esprit. Mais l’idée traumatisante d’avoir voulu se suicider lui enlevait les moyens d’exprimer le moindre mot pour dire où se situait la ferme de ses parents. Il était désorienté et il avait toujours les yeux pleins de larmes.
— Tu n’es pas capable d’avancer comme ça, dit son sauveur. Tant que tu n’auras pas dépassé ce pont, je ne serai pas tranquille. Nous allons vers le sud ; si ça te convient, tu peux monter dans ma roulotte.
Joseph acquiesça de la tête. On l’aida à se hisser à l’intérieur et il s’allongea, épuisé, sur un empilement de couvertures placées à l’arrière. La roulotte reprit la route, et son bruit monotone ne tarda pas à l’endormir. Il se réveilla en fin d’après-midi, se redressa et se demanda ce qu’il faisait sur ce grabat. Il se rappela son aventure matinale. Devant lui, par une large ouverture, il voyait un chemin montant et un cheval qui broutait les herbes du talus. Plus loin, une petite chèvre se dressait contre une haie. Dans son dos, un rideau, tirant sur le rouge foncé, l’isolait dans ce minuscule habitat. Autour de lui, le silence régnait. Soudain, il entendit des voix, des phrases qui s’apparentaient à une sorte de dialecte dans lequel il put saisir le mot « Diego ». Un garçon se présenta devant lui et repartit aussitôt. Son père vint ensuite.
— Je vais t’aider à descendre. Le repas est prêt.
Une fois sur le chemin, il se dirigea avec son sauveur vers un feu de camp, entouré de pierres, dont les courtes flammes léchaient une petite marmite. Plus bas, un ruisseau coupait le sentier. C’était un passage à gué et les flots ondulaient sur les galets. Deux vieilles chaises étaient posées contre la roulotte. D’autres objets servaient de sièges. Chacun prit une écuelle remplie d’un brouet fait de graminées, d’herbes et de racines cuites. De petits morceaux de viande se découvraient sous la cuiller. Joseph avait faim, mais il craignait de faire la grimace et d’être observé. Cependant, il mangea sans répugnance et trouva même la cuisine à son goût. Rien à voir avec le rata. Il termina son repas par du fromage sec et une sorte de pain de gruau, une chose dure et granuleuse à souhait. Il se demanda comment cet aliment avait pu être préparé dans de telles conditions quand il vit la femme poser sur le brasier un plat rond dans lequel elle répandit une pâte épaisse et brune, un mélange de grains pilés et de lait de chèvre, qui, durant toute la nuit, allait se durcir sous l’effet de la chaleur. L’homme s’adressa à lui en écorchant le moins possible la langue française :
— Je m’appelle Jason Fernandes. Voici ma femme, Luana, ma fille, Misha, et mon fils, Diego. Nous allons veiller un peu et nous reposer ensuite. La nature est belle et douce à cette saison. Nous repartirons après-demain matin. Comment te sens-tu ?
— Bien ! Au fait, je m’appelle Joseph Dumarais et j’habite plus au sud, dans un département tout proche, dans la commune de Montplaisant. Nous n’avons traversé que la Loire ?
— Le grand fleuve ?
— Oui, la Loire ! C’est tout ? Pas l’Allier ?
— Le grand fleuve. C’est tout.
— Alors, nous sommes toujours dans la Nièvre… Ou peut-être déjà dans l’Allier.
— J’ai dit le grand fleuve, c’est tout !
— Oui ! L’Allier, c’est une grande rivière, mais c’est aussi le nom d’un département.
— Ah bon ! Enfin, on va vers le sud. Quand tu seras proche de chez toi, tu le diras.
On laissa durant la nuit le cheval brouter en toute liberté. La petite chèvre au pelage noir et blanc fut autorisée, au bout d’une longue corde, à déguster les jeunes ronces et les herbes sauvages. Noiraud, un chien discret jusque-là, resta couché près du feu que Luana réalimenta. Jason aida l’infirme à monter se coucher, et ce fut le silence.
Joseph n’avait pas sommeil. Bercé depuis le matin par le cahotement de la roulotte, il avait pratiquement dormi tout le jour. Beaucoup d’idées lui venaient à l’esprit. La nuit était fraîche. Il s’était allongé sous sa capote de l’armée, sur laquelle il avait ajouté une couverture. Un rideau obstruait la fenêtre arrière, mais l’air du dehors lui caressait le visage. Malgré cela, il se sentait bien et il pouvait réfléchir à sa guise. « Sans ces braves voyageurs, pensa-t-il, je ne serais plus de ce monde ! » Si tout s’était passé convenablement dans sa tête, il aurait pu reprendre le train à Nevers et rentrer plus tôt chez lui. Mais, finalement, traverser une partie de la France avec des nomades était, indéniablement, une expérience enrichissante.
Il avait toussé tout à l’heure quand il était près du feu, à écouter les bruits de la nuit qui tombait : une miette de pain dur était restée collée sur son palais. Luana avait fait le geste signifiant le mal de poitrine. Non, il n’était pas tuberculeux, lui avait-il fait comprendre. Ces êtres libres, indépendants, ne vivaient ni dans le confort ni dans l’hygiène, et pourtant ils étaient très attachés à leur santé. Les grands espaces leur avaient permis de fuir la guerre, et l’air pur des quatre saisons les avait préservés de la phtisie. L’hiver, parfaitement isolés dans leur intérieur, leur bien-être devait provenir de leur chaleur humaine à laquelle s’ajoutait, sans doute, celle d’un feu : le tuyau sortant au-dessus de la roulotte laissait supposer l’existence d’un poêle.
Il se revoyait tout gamin dans la cour de récréation de l’école de son village, regardant, à travers la grille, passer des nomades avec leur cortège de misère. Il entendait encore ses camarades crier des horreurs à ces malheureux. Peut-être avait-il, lui aussi, fait partie de la meute de petits imbéciles. Il ne s’en souvenait plus, mais la seule idée qu’il aurait pu s’y trouver associé le rendait triste. Qu’avaient-elles de plus ou de moins qu’eux, ces personnes itinérantes ? Certes, elles avaient un mode de vie très différent du leur, mais elles avaient un cœur. Elles savaient aimer et profiter de la nature. Mis à part la roulotte et le reste, elles étaient comme eux : des êtres humains.
Bien sûr, elles ne savaient ni lire ni écrire. Mais combien d’illettrés avait-il rencontrés dans les casernes et sur le front ? Avant la guerre, combien de fils de paysans attelés aux travaux champêtres avaient eu le temps d’aller en classe ? Pendant le conflit, le vide intellectuel avait souvent, dans les deux camps, accompagné les hécatombes. Joseph avait eu de la chance que ses parents aient été soucieux de ses études, de son avenir. Grâce à eux, il avait travaillé avec sérieux et était allé jusqu’au collège. Il avait un peu d’instruction, mais il ne se prenait pas pour un savant, loin de là. Son jugement était généralement pertinent, et ses analyses s’avéraient souvent précises et justes. Mais il aimait rester modeste et accommodant, sauf quand on lui portait sur les nerfs, comme avait fait, ce matin, le gros ecclésiastique.
Les Fernandes étaient des gens simples. Ils connaissaient les plantes qui nourrissaient et qui guérissaient. Ils savaient les assembler pour les cuisiner. Ils tiraient profit de l’herbe des chemins, de l’eau des ruisseaux, du hérisson des bouchures. À la pensée de cette bête, il se demanda si, dans sa soupe, ces petits morceaux de viande cuite, qui nageaient et qu’il avait mangés, ne provenaient pas de cet animal réservé aux bohémiens. En attendant, il s’était régalé et continuerait de faire honneur à la cuisine de Luana, quel que fût le mets. La nourriture avait été tellement mauvaise, pendant la guerre.
Les jours suivants, la roulotte avança à son rythme habituel. Elle partait tôt le matin et s’arrêtait en fin d’après-midi. Les nomades prenaient toujours le temps de vivre ; ils n’étaient jamais pressés. Il y eut ainsi de courtes étapes et de longues escales au creux de la campagne. Joseph faisait partie du voyage, assis sur son grabat et accoudé sur une fourchasse. La fenêtre était dégagée, et il pouvait surveiller les arrières. Il avait sous les yeux Noiraud et la biquette, qui suivaient nonchalamment, attachés à une corde fixée à chaque ridelle. Quand l’allure régulière qu’imposait le cheval paraissait au soldat monotone et ennuyeuse, ce dernier se penchait sur son passé récent, ou il observait les paysans dans leur champ et le bétail dans les prés. Il sortait de sa torpeur dans les traversées de hameaux et de villages. Il se levait et brandissait par la fenêtre l’une de ses béquilles pour effaroucher les chiens qui se lançaient à la poursuite du cortège. Il mettait en garde les gamins qui proféraient des insultes et qui, étonnés, s’arrêtaient, tout penauds. Jason lui avait conseillé d’ignorer ces humiliations. Il lui avait fait comprendre que les gens comme eux les subissaient depuis des siècles et qu’ils n’avaient pas eu d’autre choix que de s’y habituer. Mais, pour l’ancien officier de la Grande Guerre, un tel comportement était inadmissible. Aurait-il été dans cet état d’esprit, avant ? Ce qu’il ressentait aujourd’hui n’était-il pas le résultat d’une conversion ?
Joseph faisait effectivement une expérience enrichissante. Il se rendait compte que les peuples sédentaires ne cohabitaient jamais aisément avec des nomades, que ces derniers avaient une vie qui les rendait peu aptes à se conformer à des règles fixes. Il apprit, au cours des haltes, que ces gens aimaient la musique, les chansons et les rires, et qu’ils savaient braconner. Les nuits de grande lune, dans les cours d’eau calmes et peu profonds, la prise du poisson à la fourchette édentée n’était pas un secret pour eux. De même, la caisse à furets, accrochée sous la roulotte, était prévue pour le garenne dans son terrier qu’ils découvraient au hasard des arrêts. Pour mener une telle existence, ils devaient connaître de nombreuses astuces et bénéficier des acquis transmis de génération en génération.
Voilà plus de deux semaines que la famille Fernandes et leur passager avaient progressé en direction du sud. Un matin, vers dix heures, l’attelage s’arrêta sur la place d’un gros village, à l’ombre des platanes. Misha et Diego s’emparèrent de plusieurs paniers que leur père confectionnait paisiblement au cours des escales. Des fagots de rotin et d’osier, enveloppés d’une toile de jute et accrochés à la roulotte, constituaient la matière première de ces objets d’art. Les adultes attendaient le retour des enfants en espérant un sourire sur leurs lèvres, et donc quelques pièces dans leur poche. Joseph comprit que des provisions manquaient, qu’il fallait du sel, de la chicorée, des allumettes et du pétrole, et que l’argent faisait défaut. Il leur montra son portefeuille et sortit de sa vareuse quelques pièces de monnaie. D’un coup de tête, il indiqua l’épicerie située de l’autre côté de la rue. Il allait traverser avec Luana quand un petit bonhomme, coiffé d’un chapeau melon et portant de longues moustaches, vint vers eux et dit en forçant la voix :
— Il ne faut pas rester là ! C’est interdit !
— On vient d’arriver. On fait des achats et on s’en va, lui expliqua Jason.
— Qui êtes-vous pour parler sur ce ton à ces braves gens ? lui demanda Joseph.
— Le maire ! Et vous, que faites-vous avec ces romanichels ?
— Je voyage. Vous voyez, je suis sorti des tranchées et je reviens de la guerre dans cet état. Alors, laissez-nous en paix quelques minutes. Votre village n’a rien à craindre de nous.
Un attroupement s’était déjà formé. Le maire retourna dans son bureau. Sans un mot et sans bouger, les curieux regardèrent la bohémienne et ce militaire se diriger vers l’épicerie. Ce dernier, pour impressionner les gens autour de lui, aimait garder sur ses épaules sa capote arborant ses galons.
Luana entra la première. L’épicière, qui s’apprêtait à accueillir sa cliente en lui adressant sans doute des mots plus ou moins aimables, garda la bouche ouverte à la vue du soldat qui suivait. Mme Fernandes regarda Joseph qui lui fit comprendre de la tête qu’elle pouvait commander. Ainsi, les provisions s’alignèrent sur le comptoir, l’infirme en ajouta un peu plus et il paya. La marchande, étonnée, ne put s’empêcher de lâcher :
— Elle profite de vous, vous ne le voyez pas ?
— Rendez-moi donc la monnaie et occupez-vous de ce qui vous regarde !
— Oh, moi ! Ce que je vous dis, c’est pour votre bien !
Je connais ces gens. Je sais de quoi ils sont capables.
— Justement ! Le mari de cette dame m’a sauvé la vie.
Au pied de la roulotte, Misha et Diego attendaient, la mine plutôt triste. Ils n’avaient vendu qu’un seul panier et avaient sans doute essuyé leur lot habituel d’humiliations. Mais, dans les grands sacs en papier qu’avaient rapportés Luana et Joseph, il y avait, en plus des provisions nécessaires, du café, du sucre, et même des bonbons qui, à n’en pas douter, allaient leur redonner le sourire. Pourtant, selon les parents, il s’agissait d’un luxe auquel il ne fallait pas habituer les enfants. Le soldat comprit qu’il avait gaffé en voulant bien faire.
***
Estimant qu’il allait bientôt se retrouver près de chez lui, Joseph sortit un crayon de sa poche. Il écrivit sur un papier son nom et son adresse. Il indiqua aussi qu’en cas de besoin les Fernandes pourraient faire appel à lui s’ils étaient de passage non loin du Fort d’Anglet, nom qu’on donnait à la ferme de ses parents. Il leur suffirait de montrer ce mot pour obtenir avec précision la direction à suivre. Il leur signala que le moulin des Lottes, sur la rivière appelée la Joyeuse, était un lieu de campement prisé par les gens du voyage, quand ils étaient de passage.
Ils arrivèrent dans une bourgade située à quelques kilomètres de la ferme des Dumarais. Joseph demanda qu’on s’arrêtât sur la place du champ de foire. Pour le blessé de guerre, l’expérience prenait fin. Il donna à ses compagnons ses coordonnées ainsi que les billets de banque et les pièces de monnaie qui lui restaient : il n’en avait plus besoin. Il porta la main de Luana à ses lèvres, donna l’accolade à Jason, embrassa chaleureusement les deux enfants et s’en alla. Dix mètres plus loin, il se retourna, leva haut l’une de ses béquilles comme pour les saluer et leur dire merci une dernière fois.
Une voiture à cheval le ramena au Fort d’Anglet. Un ami, rencontré dans le bourg, s’était montré heureux de le revoir et avait attelé tout de suite sa jument. Il y avait un peu plus de cinq kilomètres à parcourir. Il aurait aimé connaître la situation de sa famille, mais le conducteur n’arrêtait pas de lui poser des questions auxquelles il répondait par politesse. Il apprit, toutefois, que ses parents et son frère se portaient bien, mais qu’ils étaient inquiets pour lui. En haut d’une côte, au-delà de la Joyeuse qui coulait au fond de la vallée, il vit la ferme de ses parents qui s’imposait à flanc de colline. Cette apparition lui fit un choc. Il réalisa, une fois de plus, qu’il revenait de très loin. Il ne savait pas comment, dans l’au-delà, l’enfer était fait, mais il se disait certain que, sur terre, il ne pouvait y avoir pire que celui qu’il avait connu. Enfin, il arrivait chez lui et il se sentait heureux.
Le fameux Fort d’Anglet étonnait toujours à cause de l’originalité de son architecture. Avec un peu d’imagination, on parvenait à se convaincre qu’il était élevé sur les fondations d’un château féodal. On y entrait par un porche immense qui faisait penser au Moyen Âge, et même à l’existence, à cette époque, d’un pont-levis. De chaque côté, un rempart, épais et haut, cachait une partie des bâtiments. À l’intérieur, les murs des étables, des granges et des écuries surprenaient les visiteurs par leur épaisseur et donc par leur solidité. Accolée à l’enceinte, une tour énorme faisait fonction de pigeonnier et s’élevait au-dessus des grands marronniers qui plongeaient leurs racines sous un canal où nageaient et barbotaient des canards. Le plan d’eau était alimenté par un ruisseau qui descendait du bois Jodel. Il allait rejoindre celui qui traversait, plus loin, la forêt du Loup Gondard, laquelle portait sans doute le nom du chasseur qui aurait tué, dans l’ancien temps, l’une des bêtes féroces, voire la dernière, fréquentant cet endroit. Ces deux petits cours d’eau passaient à travers les prairies pour, une fois réunis, se jeter dans la Joyeuse. Le logis retenait aussi l’attention. Il était composé d’un étage. Un monticule donnait accès au rez-de-chaussée. Les baies étaient grandes et garnies de petits carreaux. Les boiseries étaient peintes en rouge foncé. Beaucoup de pièces donnaient sur la vallée et la rivière. La moindre pierre, à cet endroit, indiquait que l’ensemble remontait aux temps anciens et avait su résister aux bouleversements de l’histoire.
L’émotion fut à son paroxysme quand Joseph arriva. Son père et son frère étaient absents, mais sa mère, Alphonsine, était là. Elle s’était approchée de l’attelage, s’était arrêtée et, les mains sur les hanches, les yeux exorbités, avait ouvert la bouche à la vue de son fils qui prenait mille précautions pour descendre de la voiture à cheval, se faisant aider par le cocher. Elle savait que son aîné était infirme depuis plusieurs mois, mais le voir de près, avec sa jambe de bois et ses béquilles, lui fendait le cœur. Elle avança la main avec hésitation pour le toucher, comme si elle avait craint de lui faire mal. Elle le prit enfin dans ses bras et elle pleura.
L’ami, qui l’avait amené en sa demeure, respecta l’intimité des retrouvailles et fit demi-tour. Joseph gravit le terre-plein, non sans peine, et entra dans sa maison natale. Il posa ses fourchasses et alla s’asseoir à table, d’un pas mal assuré.
— Tu as faim ? Tu as soif ? Dans quel état ils t’ont mis, mon pauvre enfant !
— Je boirais bien un verre de vin ! Il y a longtemps que je n’ai pas eu ce plaisir.
— Comment as-tu fait pour arriver jusque-là ? lui demanda sa mère tout en lui apportant un verre et une bouteille de rouge.
— Dans le train jusqu’à Nevers. Après, j’ai fait le voyage avec des bohémiens.
— Avec des romanos ? Ce n’est pas possible ? Qu’est-ce qu’il t’est passé par la tête pour décider de continuer ta route avec eux ?
— Un concours de circonstances m’a conduit à les suivre, c’est tout !
— Des gens répugnants, des voleurs de poules…
— Ne dis pas cela, mère ! Ce sont des personnes chaleureuses et pleines de bon sens. Je ne les ai jamais vus chaparder. S’il leur arrive peut-être de prendre ici ou là ce dont ils ont besoin, sache que, sur terre, ce ne sont pas eux les vrais escrocs.
— N’empêche qu’ils ne sont pas fréquentables, et on n’aime pas les avoir près de chez soi.
— Ce sont des préjugés malsains. Je leur dois une fière chandelle. Ils m’ont sauvé la vie, ils m’ont pris en charge et ils m’ont instruit sur la nature, sur les plantes, les bêtes et les hommes. Dès lors, je ne veux plus qu’on dise du mal d’eux et qu’on les persécute.
— Ils t’ont sauvé la vie, tu dis ? Comment ça ?
— Ce serait trop long à te raconter. Que font mon père et mon frère, en ce moment ?
— Ils piochent les légumes dans le champ des châtaigniers, mais ils ne vont pas tarder à rentrer. Quand même, on se demandait si tu allais nous arriver un jour. Ton frère et ton père sont capables de tourner de l’œil quand ils vont te voir. Enfin, j’exagère un peu.
Alors que Joseph avait retrouvé sa chambre et se reposait sur son lit en attendant le retour des travailleurs, Alphonsine épluchait les pommes de terre pour mettre la soupe à cuire. Elle s’activait tout en réfléchissant, et la réjouissance que lui procurait l’arrivée de son aîné était plutôt mitigée. Il était rentré à la maison après de nombreuses années d’absence et elle en ressentait un profond soulagement. Mais il avait perdu une jambe dans cette saloperie de guerre et il ne pourrait plus travailler à la ferme. De plus, il avait voyagé avec des romanichels, des voleurs de grands chemins. « Allez donc savoir si ceux-ci n’ont pas envoûté mon garçon ! » Ce dernier avait franchement l’air de les avoir appréciés. Pour elle, c’était inconcevable d’avoir fait la route dans une roulotte et d’y avoir dormi. Combien de jours avait-il vécu avec ces dépenaillés, ces vauriens ? La question des repas lui vint à l’esprit et elle ne put s’empêcher de penser : « À coup sûr, ils lui auront fait manger du hérisson ! Beurk ! » Elle n’arrivait pas à admettre qu’il avait fréquenté ces gens-là, qu’il s’en était bien trouvé et qu’il en faisait des éloges. Elle se rappela qu’il avait dit avoir été sauvé par eux. Que s’était-il donc passé ? Au dîner, elle lui poserait la question. Il devrait dire de quoi il retournait et raconter comment ces bohémiens s’étaient comportés avec lui.
De retour du champ et avant de s’occuper des derniers travaux de la ferme, Paul, son frère, et Julien, son père, allèrent serrer dans leurs bras le jeune officier si longtemps attendu. Au souper, Joseph répondit à toutes les questions. À celles que sa mère lui posa et qui concernaient les bohémiens, il évoqua le pont de la Loire et la famille Fernandes qui était arrivée dans son dos juste à temps pour éviter l’irréparable.
— Qu’est-ce qui t’a pris ? lui demanda Alphonsine.
— Tout ce que j’avais vu pendant la guerre tourbillonnait dans ma tête et devenait insupportable. Ces souvenirs me rendaient fou et, avec ma jambe de bois, j’ai pensé que je n’avais plus d’avenir.
— Mais tu vis ! Ce n’est pas comme si tu avais perdu tes deux jambes ; il t’en reste une, tu es en bonne santé et tu as une longue existence devant toi, estima son père.
— Oui. Mais qu’est-ce que je vais faire, maintenant ? Rien ! Je ne pourrai même pas travailler !
— Tu iras à la pêche ! Tu t’assoiras au bord de l’eau ! Tu vas aussi pouvoir te marier et avoir des enfants ! lui prédit sa mère.
— Tu crois sans doute qu’une femme voudra de moi avec mon infirmité ?
— Mais elle t’attend ! Ça fait des années que tu ne lui écris plus ! Elle se demande pourquoi. Elle réclame souvent de tes nouvelles, surtout depuis qu’elle sait que tu as été blessé et que tu as perdu ta jambe.
— Qui ça ?
— Mais Angèle, voyons !
Joseph garda la bouche ouverte et les yeux écarquillés. Il avait fait l’étonné, mais il avait compris juste avant qu’Alphonsine ne prononçât le nom. Seulement, pour lui qui revenait de l’enfer, l’information ouvrait un horizon tellement radieux qu’il avait marqué un moment d’hésitation avant de la prendre en compte.