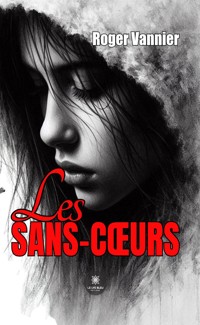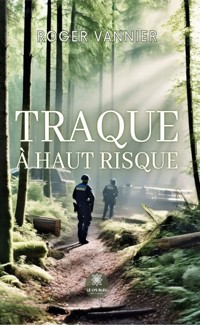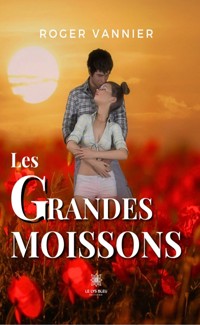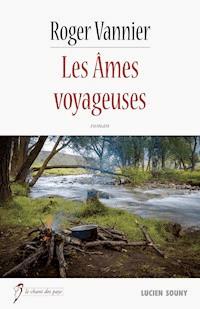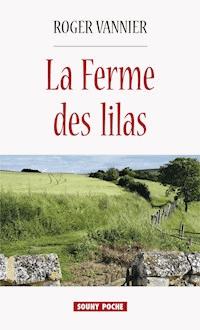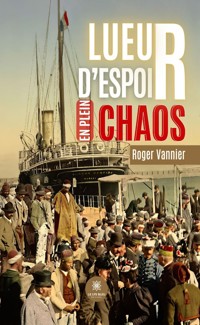
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En 1945 à Valcrouze, Pierre et Jeannette, âgés de 5 ans, entament leur histoire. Après la mort de ses parents, Jeannette est élevée par sa tante Simone. Le départ de Pierre au Sénégal, à l’âge de 10 ans, la bouleverse. Plus tard, elle est enlevée, plongeant Pierre et le village dans l’émoi. Après des études militaires, Pierre est envoyé en Algérie et assiste à l’exode des pieds-noirs en 1962 dans le sud de la France. Convaincu que Jeannette est parmi eux, il part à sa recherche, ignorant qu’elle souffre d’amnésie. Parviendra-t-il un jour à la retrouver ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Enseignant à la retraite et ancien élu local,
Roger Vannier est un écrivain publié depuis 2009. Ses ouvrages abordent des thèmes tels que la justice, l’antiracisme et les sentiments généreux. Lueur d’espoir en plein chaos est son douzième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roger Vannier
Lueur d’espoir en plein chaos
Roman
© Lys Bleu Éditions – Roger Vannier
ISBN : 979-10-422-2346-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Chapitre 1
— Il tombe encore des grêlons, mais on sait bien que c’est pour rire.
— Je crois que tu t’es trompée !
— Ah oui ! Où ? Dis-moi !
— Le mieux, c’est que tu reprennes ton cahier.
— Pierre venait d’interrompre Jeannette, mais il n’était pas certain du bien-fondé de son intervention. Leur vieil enseignant leur avait donné cette belle récitation pour lundi prochain et on était jeudi. Les deux écoliers de huit ans trouvaient ce texte de Maurice carême un peu ardu. Si la fillette y attachait beaucoup d’importance, le garçon, quant à lui, ne s’en souciait guère. D’ailleurs, il n’était pas sûr qu’elle se fût trompée, car lui-même, avait très peu étudié le poème. Il voulait seulement qu’elle pensât à autre chose, qu’elle profitât, avec lui, de cette soirée de printemps.
C’était un après-midi d’avril 1948. Les enfants, qui habitaient le même village, Valcrouze, et qui vivaient la dernière semaine des vacances de Pâques, étaient au bord d’un petit lavoir. Ils étaient assis sur de vieilles souches qui traînaient sur la rive et ils regardaient, rêveurs, le ruisseau qui charriait les eaux de fin d’hiver. Tout près, les planches des lavandières s’appuyaient sur une bouchure. Les femmes venaient là pour y faire leur lessive. Après avoir terminé, elles retournaient chez elles en poussant, sur une montée caillouteuse, leur brouette chargée de bassines ou de corbeilles pleines de linge mouillé. C’était une véritable corvée, surtout pour les grands-mères.
En fait, Pierre ne savait pas, dans le poème, s’il pleuvait ou s’il tombait des grêlons. Comme son amie, il écoutait le bruit du courant sur les galets, le chant des oiseaux dans les arbres, et il regardait de temps à autre le bleu du ciel. Le soleil brillait, il faisait beau, et loin de lui étaient les vers du poète.
— Des machines à laver, ça existe, annonça Jeannette comme pour elle-même.
— Tu rêves, ma parole ! Tu n’es pas sérieuse ?
— Je ne mens pas. La sœur de mon oncle en a une.
— Tu l’as vue ?
— Oui ! Liliane l’a installée dans son sous-sol.
— Elle a dû coûter cher. Il est vrai qu’elle est mariée à un riche. Elle a un moteur ?
— Oui ! Pourquoi on n’en a pas, nous ?
— Tout simplement parce qu’on n’a pas assez d’argent pour en acheter une. Encore faut-il que ça existe.
— Je t’ai dit la vérité. Si je comprends bien, tu laisses entendre que nous sommes pauvres. Pourquoi ?
— C’est comme ça ! Il y en a qui ont des moyens et d’autres qui n’en ont pas.
— Ma tante dit qu’elle ne fait pas du bon travail, que ce qui en sort n’est pas propre. Elle dit aussi que sa belle-sœur devrait plutôt aller à la rivière.
— Rien ne vaut l’eau claire de nos sources. Au moins, quand les femmes sont au lavoir, elles discutent. Elles rient parfois.
— Oui, c’est vrai ! Mais c’est pénible.
Jeannette avait vu une machine à laver pour la première fois. Il s’agissait d’un gros bidon cylindrique rempli d’eau savonneuse dans lequel on entassait les vêtements à nettoyer. Un système électrique faisait tourner le tout. Pour le rinçage, on renouvelait l’opération avec de l’eau pure. Fixés au-dessus de l’engin et se superposant, deux rouleaux servaient à l’essorage. On tournait une manivelle et on glissait le linge entre eux. Certes, le résultat n’était pas celui qu’on attendait, mais dans ce domaine, un tel appareil était synonyme de modernité.
Jeannette et Pierre, comme la plupart des écoliers, avaient attendu la veille de la rentrée pour s’intéresser au travail scolaire du lendemain. Pour être tranquilles durant leurs vacances, ils avaient fait leurs exercices écrits dès le premier jour. Maintenant, en ce dimanche après-midi, ils étaient assis à l’abri d’une bouchure. Ils s’étaient posés sur un morceau de bâche et avaient glissé dans une musette des livres et des cahiers. Ils lisaient et relisaient leur fameuse poésie. Ils devaient l’apprendre par cœur et il leur faudrait aussi réciter, sans hésiter, les résumés d’histoire et de sciences.
Le temps était encore agréable. Seuls des nuages assombrissaient parfois le ciel. Un vent soufflait par rafales, mais la nature les protégeait. Serrés l’un contre l’autre, ils étaient heureux malgré les tracasseries que leur infligeait leur école de La Chapeaudière. Cette dernière étant située à quatre kilomètres de Valcrouze, ils s’y rendaient à vélo, le cartable sur le dos et le panier du déjeuner sur le porte-bagages.
Là-bas, à l’entrée du chemin, Pauline se montra. Les deux superbes chèvres, qui l’accompagnaient, se dressèrent aussitôt contre les haies à la recherche des jeunes pousses du printemps. La chevrière trouva sa place dans un creux du talus et se mit à tricoter ou à raccommoder. Les enfants la connaissaient. Une mauvaise odeur les incommodait toujours quand ils passaient devant chez elle en allant en classe et en revenant. Elle possédait un bouc qui sentait extrêmement fort et les étables, accolées au logis, longeaient un étroit sentier qui recueillait les eaux de pluie et le purin. C’était un endroit particulièrement insalubre où personne ne s’attardait. Il valait mieux retenir sa respiration et passer vite fait devant sa maison.
— Elles sont belles !
— Qui ça ? Les chèvres ?
— Oui ! Quand je serai grande, je voudrais en avoir tout plein.
— Tu les mettras où ?
— Je ne sais pas ! Chez tes grands-parents. Ils ont des prés et des étables.
— C’est un fait, mais ils en ont besoin. Eux aussi ont des animaux.
— J’achèterai une petite ferme avec de grandes prairies et je les laisserai en liberté.
— Avec quel argent ? Et puis, qu’est-ce que tu feras de toutes ces bêtes ?
— Des fromages et j’irai les vendre sur les marchés.
— Tu rêves ! Pour l’instant, tu n’as pas le sou.
— Tu verras ! Plus tard, j’en aurai.
Les deux amis se remirent à étudier. Ils décidèrent de se réciter mutuellement leurs leçons et se rendirent compte qu’ils devraient encore fournir des efforts. Alors, ils se penchèrent de nouveau sur leurs textes. Seulement, quelques secondes après, un gros nuage arriva au-dessus de leur tête. Les premières gouttes de pluie les obligèrent à ranger livres et cahiers, à endosser leur capuchon et à rejoindre leur domicile. Rentrés chez eux, ils savaient qu’il y aurait toujours un petit travail domestique à accomplir et qu’il ne serait plus question d’apprendre. Claudine Pichot, la maman de Pierre, saurait se faire obéir et, Simone Langlois, la tante de Jeannette Chassaing ferait de même, mais avec un peu plus de psychologie.
Le lendemain soir, Pierre avait une triste mine en quittant l’école. Ce lundi s’était mal déroulé. Il était habitué à se faire plus ou moins sermonner en classe, mais cette fois, ce ne pouvait pas être pire. Il fut interrogé sur toutes les leçons. Il eut un trou de mémoire en récitant chacune d’elles. Pour son poème, il fut bloqué dès la deuxième strophe. Son problème de mathématique fut faux et il recueillit un zéro en dictée. Il ne connut pas de journée aussi détestable. Il pédalait sur son vélo en baissant la tête et en pinçant les lèvres. Jeannette, qui le suivait, était aussi silencieuse, comme si la tristesse de l’un se communiquait à l’autre. Elle fit un effort et se porta à sa hauteur.
— Tu n’as pas eu de chance, aujourd’hui.
— Ne m’en parle pas !
— Bah, ça passera ! Demain, tu auras oublié.
— Il ne m’a pas loupé. Il s’est acharné sur moi, ce vieux « machin ».
— Mais tu ne savais pas bien tes leçons. Même ta récitation ! C’est tout juste si tu as pu dire le début.
— Toi, il t’a soufflé vers la fin. Moi, il ne m’a jamais aidé. Il m’a toujours laissé le bec dans l’eau.
— Tu ne fais pas assez d’efforts pour retenir.
— N’empêche que j’ai récolté 100 lignes pour demain. Mais je vais me dépêcher et je vais écrire gros.
Cent lignes. Écrire n’importe quoi pendant plusieurs minutes, voire plus d’une heure. Remplir des pages d’un cahier de brouillon en copiant sur un livre de lecture. Résultat : perte de temps et apport intellectuel néant. Mais Pierre n’analysait pas les choses ainsi. Pour lui, c’était une punition et il maudissait son maître.
Les deux amis roulaient à leur allure habituelle. Derrière, leurs camarades avaient mis pied à terre et discutaient. Un différend semblait les animer, mais avec le temps, l’un d’entre eux finirait par avoir le dernier mot et ils repartiraient. Jeannette, voulant détendre l’atmosphère, se mit à réciter son poème. Elle obtint l’effet inverse. Dès les premiers vers, Pierre accéléra et secoua la tête, montrant ainsi sa réprobation. Elle entama le troisième couplet :
— « Les fauvettes et les pinsons
ont tant de choses à se dire
Que… »
Mais Pierre l’arrêta.
— Oh, ça va ! Je sais que tu la connais par cœur, ta récitation.
— Hier, avant la soupe, ma tante m’a envoyée dans ma chambre pour continuer à étudier. Mais toi, tu t’es certainement amusé avec tes soldats de plomb.
— Et alors !
— Ce serait bien si tu te décidais à bien travailler à l’école. Tu devrais jouer moins souvent à la guerre. Tu me promets de devenir un bon élève ? Ça me ferait plaisir. Hein, tu me promets ?
— Bon, d’accord ! Je vais essayer. Mais c’est bien parce que c’est toi.
Quelques semaines plus tard, en revenant de l’école, Pierre tomba de vélo et se fit mal à une jambe. Jeannette et lui avaient encore devancé les autres qui n’arrêtaient pas de se chamailler. Ils avaient tourné la tête pour les regarder et le garçon avait été déséquilibré : son pantalon s’étant coincé dans la chaîne. Ce dernier se frotta le mollet, remonta sa jambière et enfourcha de nouveau sa bicyclette. Avec son amie, il reprit la route du retour.
Nous étions le mercredi 19 mai de cette même année 1948 et le temps était clément. Les accotements, les haies et les prés étaient d’un vert éclatant. Les oiseaux étaient devenus fous et ils volaient tels des flèches d’un arbre à l’autre. Maurice Carême avait eu raison d’écrire qu’ils avaient tant de choses à se dire. Mais on était plus en mars comme le soulignait le titre de son poème. Le printemps était bien avancé et les élèves pensaient déjà aux grandes vacances.
Jeannette s’adressa à Pierre :
— Je ne sais pas si je te l’ai déjà dit, mais tu devrais faire comme les autres garçons. Maintenant qu’il fait beau, pourquoi tu ne prendrais pas une culotte courte ? Avec, tu ne serais pas tombé !
— Je n’aime pas ça. Ma mère non plus.
— C’est pour cacher tes jambes ?
— Mais non ! L’été, devant toi, je pose le tout pour entrer dans la rivière. Tu les vois bien ?
— Moi, j’ai le droit. Mais tu les montrerais aux autres ?
— Parfaitement ! Pourquoi je ne le ferais pas ? Même avant d’aller à l’école, j’ai toujours porté un pantalon.
On était à la veille des vacances d’été. Le lendemain serait la fin de l’année scolaire 1947-1948. À pied ou à vélo, les enfants quittaient l’école dans la joie. Le village de La Chapeaudière qui, chaque soir, avait résonné de leur criaillerie, retrouverait son calme et pourrait même « somnoler » durant tout l’été.
L’après-midi avait été merveilleux. Les trois enseignants avaient regroupé leurs élèves et tout le monde était parti en classe promenade. Le groupe était allé jusqu’au petit bois. Un chemin ombragé y menait. L’ensemble avait marché lentement pour ne pas fatiguer les tout petits. Les grands avaient observé les insectes, capturé des papillons, cueilli des fleurs. Tous avaient profité de ce moment exceptionnel. Dans la forêt, à l’ombre des arbres, plusieurs dizaines d’écoliers s’étaient assis en cercle et certains avaient récité des poèmes. Le vieux maître avait même lu quelques histoires fantastiques. Chacun en gardait un agréable souvenir.
Cette journée d’école terminée, les deux petits amis prirent le chemin du retour. En passant devant une maison abandonnée, Jeannette dit, tout en pédalant :
— Il n’est plus là, le monsieur ? Sa porte et ses volets sont fermés depuis deux semaines, au moins.
— Tu n’es pas au courant ? lui demanda Pierre.
— Non ! Qu’est-ce qu’il a eu ?
— Les gendarmes l’ont emmené.
— Ah bon ! Pourquoi ?
— C’est un homme dangereux.
— Qui t’a dit cela ?
— Mon grand-père Armand. C’est le maire qui l’a informé.
— Il avait l’air gentil, pourtant. Il nous attendait sur la route et nous arrêtait pour nous offrir des bonbons.
— Il en donnait surtout aux filles !
— Des caramels aussi ! C’est bon, mais ça colle aux dents.
— Ta tante a dû te conseiller de ne pas t’arrêter et de poursuivre ton chemin au cas où il reviendrait ?
— Oui ! Mais je n’ai pas compris pourquoi !
— Sache que c’est un mauvais « type » et qu’il faut l’éviter. Mais je veillerai sur toi. Simone me l’a demandé.
L’homme s’appelait Jocelyn Lejaune. Il vivait à cinq cents mètres du village de La Chapeaudière. Devant le logis qu’il louait, une cour étroite était gravillonnée et, encadrant un portillon, un muret surmonté d’un grillage bordait la route. Lejaune n’était pas originaire de la commune. Il venait d’ailleurs, on ne savait d’où, et il avait une quarantaine d’années. Pour les gens d’ici, il était étranger. Il avait très peu de contacts avec eux. La population avait des doutes sur son passé et sur ses moyens d’existence. Seuls le maire et les instituteurs surent à qui ils avaient affaire une fois que les gendarmes lui eurent mis les menottes aux poignets.
Lejaune avait discuté avec une fillette, l’avait poussée dans un coin, lui avait fait des attouchements et les parents, arrivés à temps, avaient porté plainte. C’était un pervers. Les forces de police étaient forcément au courant, mais le maire, les enseignants, les parents d’élèves avaient été laissés dans l’ignorance jusqu’à ce jour.
Jeannette et Pierre approchaient de Valcrouze. La fillette, sur son petit vélo, n’avait plus prononcé un mot depuis la mise au point du garçon. Elle se décida enfin à relater ce qui la tracassait :
— Alors, c’est vrai ce qu’a raconté Madeleine l’autre jour, à la récréation ?
— Qu’a-t-elle dit ?
— Que Mariette a été embêtée par ce monsieur qu’elle a appelé…, comment déjà ?
— Lejaune !
— Pourquoi il a fait ça ?
— Je ne sais pas ! Mais c’est certainement grave puisque les gendarmes l’ont emmené.
Chapitre 2
Jeannette était une pied-noir. Elle était orpheline. Elle vivait depuis l’âge de cinq ans chez sa tante et son oncle, Simone et Robert Langlois. Elle avait perdu ses parents en mai 1945. Ils se seraient tués dans un accident de voiture vers Guelma. La petite Jeannette, avec l’aide d’une femme de ménage, avait rejoint ses grands-parents paternels, à Alger. Ceux-ci avaient des magasins dans cette ville, d’immenses orangeraies dans la Mitidja et une grande propriété à blé dans les environs de Miliana. Ils avaient trop de responsabilités pour s’occuper d’une enfant d’un aussi jeune âge. Certes, elle était née sur le sol algérien, mais sa mère n’était pas des leurs. C’était, comme ils disaient, une fille de bouseux qui venait du fin fond de la France métropolitaine. Elle était pourtant enterrée ici, avec leur fils, dans le cimetière européen, tout près de leur villa, mais elle avait une sœur, là-bas, qui saurait veiller sur l’enfant et en prendre soin. Pour ces riches colons d’Afrique du Nord, la question de descendance importait beaucoup moins que les affaires et les profits, et Marignane n’était pas si loin. Accompagnée d’une servante, leur petite fille, en avion, ne mettrait guère plus d’une heure pour traverser la Méditerranée.
Pourquoi Claude Chassaing, ce pied-noir, avait-il été dans ce lycée de France – exceptionnellement mixte –, que fréquentaient Simone et sa sœur Éliane ? Pourquoi cette dernière était-elle tombée amoureuse de ce beau jeune homme, raciste et violent ? Il y avait pourtant, dans les grandes villes d’Algérie, des établissements scolaires de qualité. Cependant, il avait fallu qu’un des descendants de ceux qui avaient colonisé ce pays se fût trouvé là, et une idylle s’était ébauchée. Avec un bébé à venir, un mariage réprouvé par ses beaux-parents, Éliane avait donc traversé la Méditerranée et, à Guelma, avait mis au monde la petite Jeannette.
Les Langlois avaient reçu une lettre d’Alger et Simone s’était rendue à Marignane. Dans le train qui la menait à Marseille, elle avait savouré l’idée de prendre en charge sa nièce tout en craignant d’arriver en retard à l’aéroport. Elle s’était juré qu’elle serait une mère pour l’enfant de sa sœur qu’elle avait perdue. Que les deux vieux Chassaing s’en fussent désintéressés n’avait guère heurté sa sensibilité. Dans son esprit, ce qui dominait était qu’elle aurait bientôt, à ses côtés, la fille d’Éliane.
Jeannette découvrit Valcrouze en juillet 1945. Son installation chez les Langlois n’avait posé aucun problème. Claudine avait assisté à l’arrivée de Simone et de la petite pied-noir. Pierre était aussi venu et s’était aussitôt familiarisé avec la fillette. Malgré le long voyage que cette dernière avait fait, elle n’avait pas montré de fatigue. Au contraire, elle avait présenté une mine resplendissante. Dans la douceur de l’été, elle avait même suivi le garçon qui, tout joyeux et bavard, s’était empressé de lui montrer le village et les chemins des environs. Dès la première heure, elle avait découvert la campagne, la France profonde, et rencontré un bon petit compagnon.
À son arrivée, tout le monde lui avait ouvert les bras et elle n’avait pas mis longtemps pour comprendre que Pierre avait toutes les qualités pour lui plaire. Il avait son âge, il était bienveillant et elle l’avait trouvé beau.
Avant la venue de Jeannette, ce dernier s’était souvent senti seul. Dans le village, les autres enfants étaient soit plus jeunes que lui, soit beaucoup trop âgés. Son environnement familial se composait de sa mère et de ses grands-parents maternels. Il avait appris à marcher et à parler sans son père. Il avait atteint ses cinq ans sans le connaître. Après le maquis et la libération du pays, celui-ci, qui s’appelait Jean Pichot et qui était encore en Allemagne, avait décidé de rester dans l’armée. Le garçonnet n’avait pas eu d’autre choix que de jouer en solitaire. La présence de la petite pied-noir avait donc contribué à transformer sa vie.
Nous étions au début de l’été 1948. Les enfants, qui étaient en vacances, avaient reçu l’ordre d’aller chercher, à chaque fin d’après-midi, le lait du petit déjeuner du lendemain matin. Jeannette et Pierre attachaient beaucoup d’importance à cette mission quotidienne. Chaque soir, ils allaient avec leur pot à la main et ils arrivaient juste au moment de la traite chez Marie Sauveur, la grand-mère du garçon. Cette dernière « tirait » les vaches. Elle employait ce verbe par habitude, un mot du langage paysan.
Jeannette prenait énormément de plaisir à la voir presser sur les tétines, à entendre le bruit de ce liquide blanc et crémeux tomber dans le seau qui se remplissait. Il y avait toujours, près des animaux, posant la main sur leur croupe pour soi-disant les calmer, la voisine qui assistait à l’opération. C’était une petite vieille maigrichonne qui s’appelait Joséphine. Elle venait, une tasse à la main, et elle savait qu’elle repartirait une fois celle-ci remplie. Cette démarche avait pour elle un avantage. Chaque jour, elle récupérait son lait gratuit et elle discutait avec la fermière. Celle-ci ne s’ennuyait pas. Elle travaillait sans vraiment s’en rendre compte. Elle avait affaire à une bavarde qui avait toujours quelque chose à raconter.
Jeannette regardait et écoutait. Que d’histoires bizarres, elle enregistrait ! Elle prit vite l’habitude de rester immobile près de la porte de l’étable, attendant que Marie ait fini et que Joséphine s’en allât avec sa coupe à la main qui ne tremblait pas. Puis, leur pot rempli, les deux enfants repartaient chez eux.
Un soir, en revenant de chez la grand-mère de Pierre, Jeannette demanda :
— C’est vrai ce qu’a dit Joséphine au sujet du monsieur avec un couteau.
— Lequel ? Celui qui a couru derrière Jules ?
— Je ne sais pas ! Mais ta grand-mère connaissait aussi l’histoire. J’ai compris qu’il l’a insulté et menacé.
— Il a même voulu grimper sur la charrette, mais Jules l’a repoussé avec son pied.
— Il voulait le tuer ? Pourquoi ?
— Il est malade. Mais tout s’est bien terminé, paraît-il. Mon grand-père, avant-hier, s’est arrêté chez ma mère et en a parlé. C’est pour ça que je suis au courant.
Avec l’alcool et le désœuvrement, Gustave Robin était devenu fou. De sa fenêtre, il avait vu, debout sur sa voiture à cheval, Jules Durieux qui rentrait chez lui. Il était sorti, s’était avancé sur la route, avait remarqué que l’attelage s’éloignait, s’était mis à courir derrière et avait retiré son couteau de sa poche. Il n’avait même pas pensé à sortir la lame du manche. Il avait rejoint la charrette et avait tenté de monter dessus pour agresser Jules. Ce dernier l’en avait empêché, non sans peine. Gustave s’était calmé et avait été ramené par son épouse. L’événement n’avait pas eu de conséquence, mais on aurait bien voulu savoir si, à la folie de Gustave, ne s’ajoutait pas de la rancune.
Jeannette était troublée. Elle ne comprenait pas qu’il pût y avoir sur terre des gens ayant des comportements étranges. Elle n’avait pas très bien compris l’affaire Lejaune et, maintenant, on lui rapportait un fait où un homme s’était montré violent. Elle acceptait déjà mal les chamailleries des écoliers dans la cour de récréation, mais là, il s’agissait d’un adulte avec une arme. Pour elle, c’était le comble.
— De quoi il souffre, ce… ?
— Gustave ? Il boit trop ! Son cerveau est dérangé. Il devrait se faire soigner.
— Il y en a d’autres, comme lui ?
— Où ? Ici ? Mais non ! D’ailleurs, l’incident s’est passé loin de chez nous.
— J’avoue quand même que ça fait peur.
La rentrée des classes avait eu lieu et cette première journée s’était apparemment bien déroulée. En ce mois de septembre 1948, les écoliers repartaient chez eux. Le vieux maître avait pris sa retraite et son remplaçant, un jeune instituteur, avait entamé sa première année scolaire. Jeannette et Pierre, qui étaient déjà au CM1, avaient été attentifs et s’étaient appliqués. Pourtant, sur la route du retour, la fillette, sur son vélo, était triste et silencieuse. Elle aurait bien voulu exposer son problème à son ami, mais celui-ci, avec un plus grand garçon que lui, discutait d’une affaire qui semblait sérieuse.
À l’école, dans la cour de récréation, les filles étaient séparées des garçons. Il en était de même pendant les repas qui se prenaient dans leur salle. Sur leur table, sur une serviette, ils avaient leur pain, du fromage, et parfois une pomme. Dans leur pot, qu’une employée avait fait réchauffer, ils y trouvaient de la purée, des nouilles, des petits pois ou des haricots. Ils s’y mêlaient des morceaux de viande : du bœuf, du poulet ou du lapin. Ils avaient aussi leur bouteille d’eau et ils buvaient au goulot. On frôlait la frugalité, mais personne ne se plaignait.
Tout au long de la journée, Jeannette n’avait donc pas pu s’adresser à Pierre. Ce dernier était enfin seul avec elle et il roulait à ses côtés. Elle demeurait plongée dans ses pensées quand son ami la questionna.
— Tout s’est bien passé ce premier jour. Au fait, à quoi penses-tu ?
— Jocelyne était absente. Elle est malade ?
— Non ! Ils se sont installés en ville.
— Qui ? Ses parents ?
— Oui ! Toute la famille.
— Comment sais-tu ça ? Tu es toujours au courant. Moi, jamais !
— C’est mon grand-père Armand qui l’a dit à ma mère. Tout le monde en parle dans la commune. Simone et Robert auraient dû t’en informer.
— Je vais les rappeler à l’ordre. Pourquoi j’ignorerais ce qui se passe près de chez moi ? Jocelyne était ma meilleure copine depuis 3 ans. Qu’elle ne soit plus là, ça m’ennuie beaucoup.
Fin septembre, Jean Pichot avait annoncé, par courrier, qu’il serait bientôt en partance pour le Sénégal. Claudine avait aussitôt communiqué l’information à ses parents et à son fils. Ainsi, la mélancolie avait gagné Pierre et ses résultats scolaires en pâtissaient. Quand verrait-il son père ? Alors qu’il avait grandi, qu’il pourrait apprécier sa présence, l’observer, le suivre et lui parler, ce dernier allait s’éloigner davantage. Il serait cette fois dans un pays lointain. Il ne connaîtrait même pas son visage si sa photo ne trônait pas sur le napperon qui recouvrait le dessus du vieux poste de TSF. Autrefois, en coup de vent, il était passé le voir, mais il était si jeune, si petit, qu’il n’en avait aucun souvenir.
Plusieurs jours après cette affligeante nouvelle, Pierre gardait encore son chagrin pour lui. À Jeannette, qui s’étonnait de le voir sombre et taciturne, il affirmait que tout allait bien. Un soir, en revenant de l’école, il lui fournit enfin la raison de son air maussade.
— C’est où, le Sénégal ? lui demanda-t-elle.
— Je ne sais pas. Je crois bien que c’est en Afrique.
— On cherchera sur notre livre de géographie.
— C’est une bonne idée. Curieusement, je n’y avais pas pensé.
— Ma tante a également un gros atlas. Tu sais qu’elle est allée au lycée avec ma mère. Et la tienne ?
— Je ne sais même pas si elle a eu son certificat d’études.
Ces quelques mots échangés eurent le mérite de dissiper les mauvaises pensées qui plongeaient souvent Pierre dans la morosité. Les enfants parlaient alors de pays lointains, de leurs connaissances en géographie, de leur désir de métier, de ce qu’ils feraient quand ils seraient plus grands. Discuter entre eux les menait toujours sur une voie pleine d’intérêts. Ils envisageaient leur avenir, et leur présent était fait de rêves merveilleux, de gais bavardages, de rencontres sympathiques.
Ils allaient en direction de Valcrouze avec l’idée de faire leurs devoirs dès ce soir. Le lendemain serait jour de relâche et ils verraient ensemble l’endroit où devrait aller Jean Pichot.
— Simone a aussi un gros dictionnaire, dit Jeannette.
— Il y a des cartes dessus ?
— Oui ! Je l’ai feuilleté, un jour. Il y a l’Afrique, l’Asie… On devrait y trouver notre bonheur.
— Il nous faut surtout le Sénégal avec ses villes, ses routes. Enfin, tous les renseignements possibles au sujet de ce pays.
— Avec nos livres et ceux de ma tante, on trouvera.
Ils approchaient de Valcrouze, ce hameau paisible qu’ils adoraient. Déjà le toit des premières maisons émergeait des arbres. Ils s’arrêteraient d’abord chez les grands-parents de Pierre, y trouveraient Claudine, embrasseraient tout le monde et rejoindraient leur demeure avec le lait encore tiède dans son pot. Quel bonheur ! Certes, le village n’arborait pas la noblesse des grandes villes comme celle d’Alger qu’avait quittée Jeannette. Elle était si jeune quand elle était partie de là-bas, qu’elle n’avait gardé en mémoire ni les palaces, ni les palmiers, ni les plages. Mais, aujourd’hui, elle avait la campagne, les haies, les arbres, les maisons paysannes, neuves ou vieilles, et elle se plaisait en ces lieux. Elle était heureuse.
On fêterait bientôt Noël. Les enfants étaient en vacances et ils occupaient déjà leurs premières journées à déambuler par les chemins des environs. Il leur arrivait de suivre Armand qui allait casser du bois de bouchure dans un petit pré, ou le voisin qui allait à sa vigne pour récupérer des fagots de sarment. Ils aimaient monter sur sa charrette et, les guides en main, croyaient diriger la bourrique. Ces démarches n’étaient-elles pas, pour eux, utiles et instructives ? Ils étaient en osmose avec la nature, avec les gens qui en tiraient profit et, bien que très jeunes, ils avaient le sentiment de vivre comme les adultes, de connaître leurs besoins, de s’associer à leurs travaux programmés au regard des saisons.
Le jour de Noël donnait l’occasion d’un déjeuner amélioré. La veille, pas de messe de minuit pour les habitants de Valcrouze. La Chapeaudière était trop loin pour y aller la nuit. Mais Pierre et Jeannette ne s’intéressaient pas à ces cérémonies. À noter aussi que les paysans du coin n’étaient pas de fervents catholiques. Beaucoup étaient superstitieux et croyaient fermement aux sorciers. Pour la majorité d’entre eux, le 25 décembre n’avait pas d’importance, on fêtait plutôt le 1er janvier. On se méfiait donc des institutions religieuses qui n’avaient pas joué un rôle très clair au cours de ces dernières années.
Pierre, dans son lit, ne parvenait pas à trouver le sommeil. Le facteur avait donné une lettre du père qui semblait poser beaucoup de problèmes à sa mère. Claudine avait parlé à grand-mère presque à voix basse et il n’avait rien compris. Il l’avait questionnée, mais elle lui avait répondu qu’elle lui dirait bientôt de quoi il s’agissait. Il s’endormit donc dans l’ignorance.