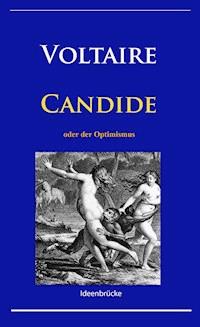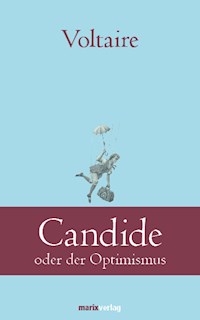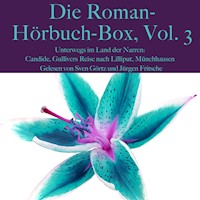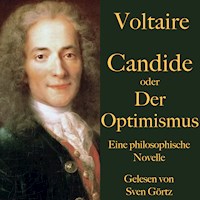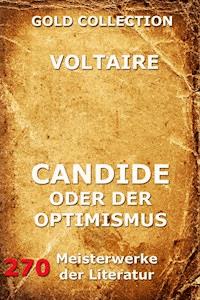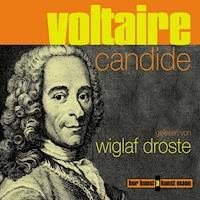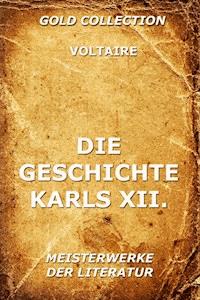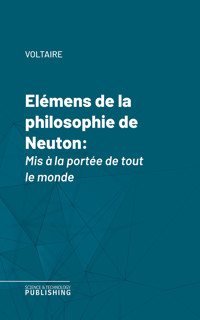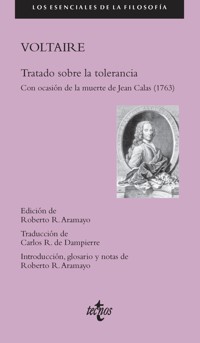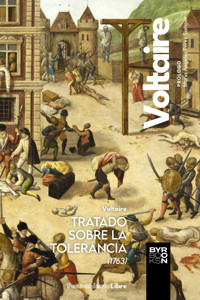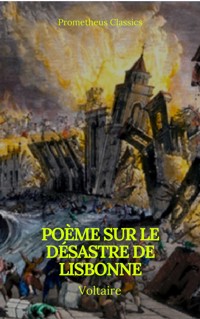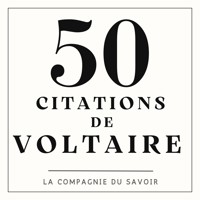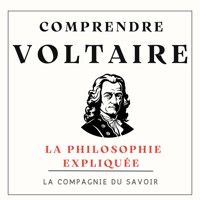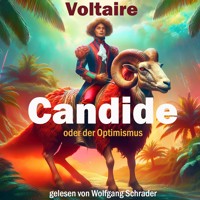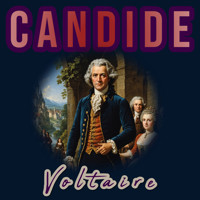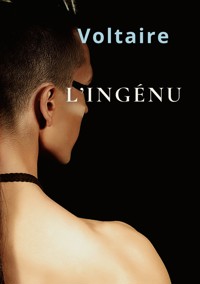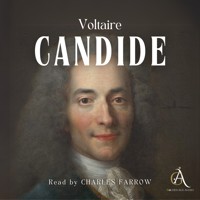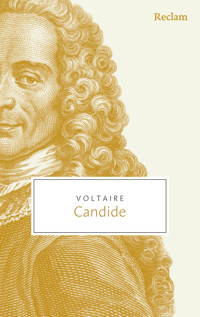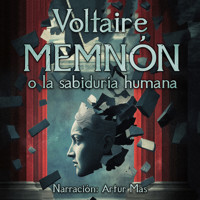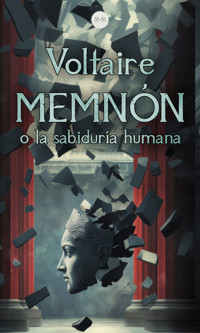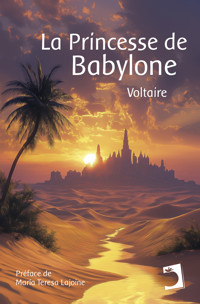
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edicions Perelló
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Universels
- Sprache: Französisch
Dans un Orient fabuleux et empreint de merveilles, la belle et sage princesse Formosante, héritière du trône de Babylone, entreprend un voyage à la recherche du véritable amour et de la vérité profonde. Sur sa route, elle rencontre le noble berger Amazan, élevé par des sages arabes, et ensemble ils traversent des royaumes exotiques, affrontant épreuves, philosophies et civilisations. Sous les apparences d'un conte de fées, Voltaire tisse une satire brillante et mordante qui interroge la liberté, l'ignorance et le fanatisme. La Princesse de Babylone est un récit aussi enchanteur que percutant, où la fantaisie sert la pensée, et l'aventure, l'esprit des Lumières.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cette collection recèle les œuvres les plus importantes de la littérature universelle, chacune dans sa langue d’origine.
Dans la série Lettres françaises, se distinguent Le Petit Prince, par Antoine de Saint-Exupéry; Le diable au corps, par Radiguet Raymond; Rouge et Noir, par Stendhal; Le tour du monde en 80 jour, par Jules Verne; Arsène Lupin, par Maurice Leblanc; Le chef-d’œuvre inconnu, par Honoré de Balzac; Le contes les plus populaires de Perrault...
François-Marie Arouet
LA PRINCESSE
DE BABYLONE
© Ed. Perelló, SL, 2025
© Préface de María Teresa Lajoinie Domínguez
Calle de la Milagrosa Nº 26, Valence
46009 - Espagne
Tlf. (+34) 644 79 79 83
http://edperello.es
I.S.B.N.: 978-84-10227-49-1
Photocopier ce livre ou le mettre en ligne librement sans l’autorisation des éditeurs
est puni par la loi.
Tous droits réservés. Toute forme de reproduction, distribution,
la communication publique ou la transformation de cette œuvre ne peut se faire que
avec l’autorisation de leurs propriétaires, sauf dans les cas prévus par la loi.
Aller à CEDRO (Centre espagnol pour les droits de reproduction, www.cedro.org)
si vous avez besoin de photocopier ou de numériser une partie de ce travail.
Préface
Les lecteurs de ce texte connaissent, sans doute, le fameux tableau Lecture de la tragédie « L’Orphelin de la Chine » de Voltaire dans le salon de madame Geoffrin (1812), plus communément nommé Une soirée chez madame Geoffrin, du peintre Anicet Charles Gabriel Lemonnier. Exécuté sous la demande de l’impératrice Joséphine durant le Premier Empire, le tableau est une reconstruction libre du lieu de sociabilisation par excellence des Lumières : les salons. Souvent entretenus par des femmes, ils deviennent des espaces incontournables pour la rencontre de philosophes, écrivains, naturalistes, gens de l’élite et d’esprit, puis pour la discussion et diffusion des idées de l’époque. Ainsi, Lemonnier réunit dans sa toile Buffon, D’Alembert, Crébillon, Condillac, Marivaux, Rousseau, la Comtesse d’Houdetot ou Vernet, entre autres. Sur le devant, l’acteur Lekain en train de lire la tragédie L’Orphelin de Chine. Le buste de Voltaire, en arrière-plan, élevé et au centre, préside la réunion, devenant le point focal et de la toile et de l’histoire qui y est narrée en images. Si l’exactitude historique a déjà été contestée à la fin du dix-neuvième siècle, la valeur synthétique et symbolique du tableau est cependant indéniable. Le lieu de préférence réservé à l’effigie voltairienne peut ainsi être lu en synecdoque de la prépondérance de sa figure : « Voltaire est celui qui incarne le mieux les Lumières ». Une telle affirmation rend bien compte de la tâche herculéenne qu’est de s’approcher de sa personne et de tenter d’en résumer tout ce qui, en homme, écrivain et philosophe fit Voltaire de son vivant. Travail également ardu que de poser ce qu’il a légué à la postérité. Nous ne pouvons donc aspirer, dans ces quelques pages, qu’à fournir une brève esquisse, une tentative de dessiner quelques traces de la figure et de l’œuvre d’un homme qui traverse presque la totalité de son siècle.
Les Lumières de Voltaire
Fils de notaire et instruit auprès de jésuites du collège Louis le Grand, François-Marie Arouet, Voltaire de son nom de plume, est une des figures phare des Lumières françaises. Très tôt dans sa jeunesse, il est introduit à la société du Temple ; Voltaire devient un libre penseur qui goûte aussi aux plaisirs mondains, le théâtre – il en fera construire un dans son domaine de Ferney – étant le principal, mais aussi l’art de la conversation. Son esprit éclairé le mène à s’intéresser et participer activement aux débats, enjeux, sujets et projets majeurs de son temps, ce qui se traduit par une production aussi prolifique et variée que parfois polémique. Il connaît la prison – il est deux fois incarcéré à la Bastille – et l’exil à plusieurs reprises. Il est alors obligé de quitter la ville de Paris, voire le pays. C’est ainsi que Voltaire se rendra à la cour de Frédéric II de Prusse, à Genève ou en Angleterre, voyage dont il sera profondément marqué et qui sera la source principale d’inspiration des Lettres philosophiques (1734). C’est précisément grâce à son séjour en territoire britannique qu’il découvre les écrits de Newton, et s’érige en l’un de ses principaux diffuseurs en France avec Éléments de la philosophie de Newton (1737), ou de Locke, tous deux influences de la pensée du philosophe. Par ailleurs, Voltaire voit dans la monarchie parlementaire anglaise, du fait de la limitation du pouvoir absolu, un système politique moins arbitraire, et par là, à suivre. Farouche combattant contre l’intolérance et en faveur de la liberté, il critique avec férocité les dogmatismes et le fanatisme, attaquant autant le pouvoir politique que religieux. Sur ce point, en tant que déiste, Voltaire s’affirme contraire à la religion révélée. Tout en acceptant l’existence de Dieu, c’est dans une démarche raisonnée, dans l’expérience et l’organisation du monde naturel que sa présence s’exprime, ce qui fera dire au philosophe « je ne puis songer que cette horloge existe et n’ait point d’horloger ». Il remet ainsi en question les rites et cultes qu’il juge comme étant des superstitions, Dieu se bornant à être le garant de la morale, et se range aux côtés de penseurs comme Rousseau (avec qui il entretenait une relation plutôt complexe) qui soutiennent la pratique d’une religion naturelle. Dans son élan contre l’injustice et l’intolérance, il prend part aux affaires Calas – qu’il reprend dans son Traité sur la tolérance (1763) – ou Sirven, toutes deux familles protestantes accusées de meurtre pour éviter la prétendue conversion au catholicisme de leurs parents respectifs. Partageant le désir des Lumières de rassembler la totalité du savoir, il participe au projet pédagogique et éclairé par excellence que fut L’Encyclopédie. Bien que toléré par le pouvoir dans un premier temps, le privilège d’impression est définitivement révoqué en 1759, ce qui ne met pas fin au projet, mais le voue à la clandestinité. Alors que Louis XV est déjà mort, Voltaire reprendra la question dans son pamphlet De l’Encyclopédie (1774) où il fait dire, non sans ironie, à Mme. de Pompadour « Sire, vous avez donc confisqué ce magasin de toutes les choses utiles pour le posséder seul, et pour être le seul savant de votre royaume? ». Sa participation dans l’ouvrage est reflétée dans le plus de trente articles dont il est l’auteur, parmi lesquels « Esprit » ou « Idole ». Convaincu que l’accessibilité du savoir est centrale pour sa diffusion, sans quoi l’ambition transformatrice des Lumières sur la société ne saurait être atteinte, Voltaire se questionne auprès de l’efficacité, ne serait-ce que matérielle, de l’œuvre. Ces doutes, il les partagera à D’Alembert : « Je voudrais bien savoir quel mal peut faire un livre qui coûte cent écus. Jamais vingt volumes in-folio ne feront de révolution ; ce sont les petits livres portatifs à trente sous qui sont à craindre ». Il écrit à son tour le Dictionnaire philosophique (1764), un recueil de textes courts présentés en ordre alphabétique, ou encore Questions sur l’Encyclopédie (1770-1772), œuvre qui entend prolonger le projet encyclopédique à l’instar duquel il naît. Voltaire ne cessera de croire que la raison, et son expérience, sont capables de dissiper les ténèbres du fanatisme et du dogmatisme, menant l’individu et, par extension, la société au progrès. Une importance donnée à l’expérience, en tant que méthode nécessaire et préalable à la connaissance, voire à l’établissement de tout système de pensée, préconisée dans son conte Candide (1759), qui s’adapte bien à la définition kantienne des Lumières. C’est donc bien à l’individu, à chaque homme et femme, à qui revient le devoir de conduire sa vie ou de « sortir d’une minorité qui n’est imputable qu’à lui ». Objet de visites récurrentes à son domaine de Ferney qui devient lieu de passage obligé pour rencontrer le « grand homme », protagoniste d’une série de peintures commandées par Catherine II de Russie, peu de figures ont connu de son vivant la renommée de Voltaire. En témoigne l’accueil à son retour à Paris, presque trois décennies après son exile. Voltaire meurt à l’âge de 83 ans et deviendra la deuxième personne, après Mirabeau, à être transférée au Panthéon, en 1791.
Voltaire écrivain et littéraire
Comme il a été déjà suggéré, Voltaire est un penseur et écrivain inépuisable. Sa production est composée, non seulement de traités et autres textes philosophiques, mais également d’œuvres littéraires, pamphlets ou, encore, une riche correspondance avec des figures notables de son temps, dont Frédéric II de Prusse, D’Alembert, le duc de Richelieu, Mme. de Pompadour ou Rousseau. Il cultive ainsi la poésie – sa production étant estimée à 250.000 vers – avec des titres comme Poème sur le désastre de Lisbonne ou examen de cet axiome : tout est bien (), La loi naturelle () ou La Henriade (). Cette épopée, consacrée à la figure du roi Henri IV et composée de dix chants, est certainement son œuvre poétique la plus importante. Son éloge du premier roi appartenant à la dynastie des Bourbons prouve son engagement envers la tolérance et contre le fanatisme en matière de religion. Rappelons à cet égard que le monarque, de foi protestante, fut obligé de se convertir au catholicisme (« Paris vaut bien une messe » aurait-il dit) pour accéder au trône de France. À une époque où les guerres de religion ravageaient le pays et semaient la terreur parmi la population huguenote, l’approbation de l’édit de Nantes en 1598 – postérieurement révoqué par Louis XIV lors de la promulgation de l’édit de Fontainebleau en 1685 – est un exemple de tolérance, ce qui expliquerait l’intérêt porté par Voltaire à la figure royale. Il s’intéresse également au genre historique avec des titres comme Histoire de Charles XII (1731) ou Le Siècle de Louis XIV (1751). Si les ouvrages furent un succès au XVIIIe siècle et comptèrent maintes réimpressions, ainsi que révisions et augmentations de la part de l’auteur, la facette d’historien est, de nos jours, peu retenue. Paradoxalement, la situation semble se reproduire avec le théâtre voltairien. Les nombreuses tragédies qu’il a écrites, dont Œdipe (1718) – représentée pour la première fois à sa sortie de sa première incarcération à la Bastille –, Zaïre (1732), Mahomet (1741) ou L’Orphelin de la Chine (1755), sont très appréciées du public. Voltaire est d’ailleurs l’un des grands dramaturges de son époque et, malgré le silence sous lequel l’avenir a fait passer ses tragédies, ses pièces représentées à la Comédie-Française sont un vrai succès. Finalement, Voltaire est aussi auteur de contes philosophiques qu’il écrira notamment dans la seconde moitié de sa vie. Critique envers le roman, ce sont cependant les contes qui ont fait perdurer son nom dans la littérature jusqu’à nos jours. Candide (1759), Zadig (1748), Micromégas (1759) ou L’Ingénu (1767) sont parmi les titres les plus connus du philosophe, habituellement inclus dans les plans académiques et scolaires comme lectures incontournables du siècle des Lumières.
Le conte philosophique
Le conte philosophique est un genre narratif qui apparaît durant le XVIIIe siècle, essentiellement lié aux Lumières. À une époque où les auteurs éclairés se heurtent à une censure implacable, le conte offre une voie permettant de présenter des idées novatrices sous l’apparence d’une « simple fable ». Ainsi, le conte philosophique se caractérise par sa nature hybride qui s’approprie de certains éléments des formes classiques auxquels il rejoint des aspects qui lui sont particuliers. Comme le conte traditionnel, les contes philosophiques se différencient du roman par une plus grande brièveté, ainsi que par leur schéma narratif conventionnel (situation initiale, élément perturbateur, péripéties et situation finale). En outre, ils situent l’histoire dans un contexte spatio-temporel éloigné : que ce soient des contrées autres ou des temps mythiques, la distance se relève aussi comme stratégie visant à détourner la censure. En revanche, la description des sociétés ou des coutumes, traditions ou traits des peuples qui sont représentés dans le conte philosophique ne cessent de rappeler et évoquer des faits, mœurs et situations contemporaines. En fait, il s’agit de l’une des spécificités du genre vis-à-vis de ses formes traditionnelles, son but étant celui de critiquer les déviances actuelles en accord à la pensée et valeurs des Lumières. Cet esprit de dénonciation se traduit par le ton satirique ou, notamment, le recours au motif du voyage et de l’étranger pour mieux relativiser, voire montrer l’absurdité de certaines habitudes et idées reçues qui sont acceptées par les sociétés auxquelles auteurs et lecteurs appartiennent. Par ailleurs, l’ironie, l’inscription de l’histoire dans des paramètres qui répondent aux goûts esthétiques de l’époque – littérature de voyages, l’Orient ou les narrations d’apprentissage – ont pour but de gagner l’intérêt et la faveur des lecteurs, puis, par là même, de produire cette transformation des esprits à laquelle les Lumières aspirent. Plus le public qui en est touché sera large, plus les valeurs éclairées pourront pénétrer et faire progresser les sociétés. Partiellement, à de différents degrés ou dans leur ensemble, ces aspects peuvent être retrouvés dans la totalité de la production voltairienne de contes, que ce soit Candide, Zadig, L’Ingénu, Micromégas ou La princesse de Babylone.
Paru en 1768, La princesse de Babylone s’accorde bien aux caractéristiques ci-dessus énoncées. Le cadre choisit est la Babylone des temps anciens, les protagonistes deux jeunes amants nobles : Formosante, princesse de Babylone – dont le père est décidé à marier suivant les indications de l’oracle – et Amazan, berger du pays de Gangarides, nation au caractère utopique. Séparés de force à la suite de la mort du père d’Amazan, Formosante entreprend un voyage vers le pays du berger qui devrait culminer avec les retrouvailles des amants. Le moment sera cependant retardé à la suite de deux événements funestes : la rencontre avec le roi d’Égypte, son ancien prétendent et concurrent d’Amazan, qui cherche à la forcer et le merle qui rapporte à Amazan le baiser que Formosante lui a donné. Or, ce que le merle ne dit pas c’est qu’il s’agit d’un subterfuge pour pouvoir fuir des lieux et, apprise la nouvelle, Amazan quitte aussitôt son pays pour commencer, à son tour, un voyage avec lequel prouver sa fidélité. Amazan visite alors la Chine – où réside « le monarque de la terre le plus juste, le plus poli, et le plus sage » (), la Cimmérie (la Russie), la Scandinavie, la Germanie, Venise, l’Espagne ou la France, tandis que son amante n’arrive que trop tard à ces territoires, une fois le berger parti. Le déplacement est l’occasion de confronter l’étrange et l’étranger, l’excuse pour Voltaire de mettre en place son regard critique. Il tourne alors en dérision l’intolérance religieuse et son goût du luxe, en qualifiant les prêcheurs de « troupe de bonze d’étrangers […] [qui] sous prétexte d’annoncer des vérités, avaient acquis déjà des richesses et des honneurs » (). Il s’attaque aux abus du pouvoir et défend la pensée individuelle et critique « la plupart des législateurs ont eu un génie étroit et despotique. […] Il vaudrait mieux n’avoir point de lois, et n’écouter que la nature, qui a gravé dans nos cœurs les caractères du juste et de l’injuste, que de soumettre la société à des lois si insociables » (). Il loue les bénéfices apportés par l’usage de la raison « les progrès que la raison et la philosophie faisaient dans le Nord [la Germanie] : tous les princes étaient instruits, tous autorisaient la liberté de penser » (). Et il soutient le pythagorisme ou végétarianisme, se ralliant aux courants sensocentristes qui, au XVIIIe siècle, commencèrent à confronter la validité de la théorie cartésienne de l’animal-machine et soutenaient, en paroles de Jérémy Bentham, que « la question n’est pas : peuvent-ils raisonner? Ni : peuvent-ils parler? Mais : peuvent-ils souffrir? ». Sous l’apparence d’un conte aux allures des Milles et une nuit, au milieu de l’invraisemblable, Voltaire condense en vint-et-deux chapitres des maximes qui permettent de reconstruire sa philosophie, et par extension, la pensée d’un siècle qui voulut que la raison se substitua à l’obscurantisme. Nous invitons, donc, le lecteur à prendre très au sérieux ce texte merveilleux.
María Teresa Lajoinie Domínguez
Universitat de València
Chapitre I
Le vieux Bélus, roi de Babylone, se croyait le premier homme de la terre : car tous ses courtisans le lui disaient, et ses historiographes le lui prouvaient. Ce qui pouvait excuser en lui ce ridicule, c’est qu’en effet ses prédécesseurs avaient bâti Babylone plus de trente mille ans avant lui, et qu’il l’avait embellie. On sait que son palais et son parc, situés à quelques parasanges de Babylone, s’étendaient entre l’Euphrate et le Tigre, qui baignaient ces rivages enchantés. Sa vaste maison, de trois mille pas de façade, s’élevait jusqu’aux nues. La plate-forme était entourée d’une balustrade de marbre blanc de cinquante pieds de hauteur, qui portait les statues colossales de tous les rois et de tous les grands hommes de l’empire. Cette plate-forme, composée de deux rangs de briques couvertes d’une épaisse surface de plomb d’une extrémité à l’autre, était chargée de douze pieds de terre, et sur cette terre on avait élevé des forêts d’oliviers, d’orangers, de citronniers, de palmiers, de girofliers, de cocotiers, de cannelliers, qui formaient des allées impénétrables aux rayons du soleil.
Les eaux de l’Euphrate, élevées par des pompes dans cent colonnes creusées, venaient dans ces jardins remplir de vastes bassins de marbre, et, retombant ensuite par d’autres canaux, allaient former dans le parc des cascades de six mille pieds de longueur, et cent mille jets d’eau dont la hauteur pouvait à peine être aperçue : elles retournaient ensuite dans l’Euphrate, dont elles étaient parties. Les jardins de Sémiramis, qui étonnèrent l’Asie plusieurs siècles après, n’étaient qu’une faible imitation de ces antiques merveilles : car, du temps de Sémiramis, tout commençait à dégénérer chez les hommes et chez les femmes.