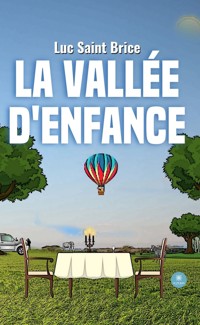Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Amour familial, décors campagnards bucoliques, moments de joie, premier amour perdu, amitié, drames humains, périples d’un petit village du Pas-de-Calais vers l’Algérie et l’Amérique…
Le chemin de la Longearne est un voyage. Prêt pour le départ ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ayant beaucoup voyagé,
Luc Saint Brice a une large perception de la vie, du fait de ses expériences. Après plusieurs articles, il partage, avec Le chemin de la Longearne, l’une d’elles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luc Saint Brice
Le chemin de la Longearne
Roman
©Lys Bleu Éditions – Luc Saint Brice
ISBN : 979-10-377-3049-7
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À Jo,
À Célia,
À ma sœur,
À Maryse, Christine et Clotilde.
Préface
Comme vous êtes loin, paradis parfumé,
Où sous un clair azur tout n’est qu’amour et joie,
Où tout ce que l’on aime est digne d’être aimé,
Où dans la volupté pure le cœur se noie !
Comme vous êtes loin, paradis parfumé !
Mais le vert paradis des amours enfantines,
Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets,
Les violons vibrant derrière les collines,
Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets,
Mais le vert paradis des amours enfantines,
L’innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Est-il déjà plus loin que l’Inde et que la Chine ?
Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs,
Et l’animer encor d’une voix argentine,
L’innocent paradis plein de plaisirs furtifs ?
« Moesta et errabunda », Les Fleurs du mal, 1861,
Charles Baudelaire
Chapitre 1
Les années soixante : l’enfance détournée
« Tu vas prendre le “super cinq”, accrocher le tonneau, et aller donner à boire aux bêtes dans le chemin des fonds »
La ferme compte deux tracteurs de marque Renault, un super cinq, d’une puissance de trente-cinq chevaux et un Renault quatre-vingt-huit, mal nommé, car d’environ quatre-vingts chevaux. Entre nous, pour abréger, on les nomme super cinq, ou « petit zinc » et quatre-vingt-huit, ou « gros zinc », ou simplement « zinc », quand le contexte ne prête à aucune confusion.
Mon frère Luc est directif et ne supporte pas la controverse. En juillet, les génisses doivent être approvisionnées en eau tous les deux jours. La moisson est proche, les travaux de préparation occupent les journées. En mil neuf cent soixante-sept, mon père a recours à l’entreprise pour récolter les escourgeons. La moissonneuse-batteuse est gigantesque, le grain est livré, en vrac, dans des remorques pas encore adaptées à la taille énorme de la machine, cette dernière récolte plus vite que notre capacité à emporter le grain au silo. Il faut assurer ! car la machine ne peut pas attendre, alors, nous roulons à tombeau ouvert, la cadence est infernale !
Mon père, enfant d’après-guerre, celle de quatorze-dix-huit, est né en mil neuf cent vingt et un. Son père, Jules, mon grand-père, est fils d’agriculteur. À cette époque, les travaux des champs ne sont pas, ou peu mécanisés, c’est un dur labeur qui ne convient pas à la silhouette longiligne, élancée, raffinée, et urbaine de Jules.
Il est né en mil huit cent quatre-vingt-huit, au siècle précédant le siècle précédent ! Il obtient son certificat d’études à dix ans. Bon élève et doué en mathématiques, doté d’une bonne mémoire, les concours sont pures formalités. Il entre à la SNCF pour fuir le mal de dos l’été, la boue et les gerçures aux mains l’hiver.
« Le travail à la ferme ne m’intéresse pas », dit-il à son père qui avait pourtant investi sur son seul fils.
Ses deux sœurs eurent un destin brisé par la guerre. Le fiancé de Thérèse meurt les premiers jours du conflit. Elle ne s’en remit jamais et resta vierge jusqu’à sa mort. Sa sœur Hélène n’eut pas plus de chance, car ses prétendants ne revinrent pas des tranchées, ce qui, finalement, concrétisa son inclination pour son cousin germain, Paul. Ils se marièrent juste après la guerre, qui eut raison de ce tabou. Mis à part quinze petits jours, Paul rentra chez ses parents après sept ans d’absence : trois ans de service militaire puis quatre ans, de guerre, passés au ravitaillement des troupes sur le front !
Paul était donc l’oncle de mon père, mon Oncle Paul. Tout le monde l’appelait Mon Oncle Paul, mon père bien sûr, mon frère, ma sœur et moi, mais aussi tous les enfants, et aussi la plupart des adultes du village ! Il incarnait la bienveillance, la bonté, la bonhomie, la gentillesse, la bonne humeur.
Les tranchées, la fatigue, le bruit de la fureur des canons, la boue, la mort au quotidien, la Grande Guerre, la der des der, a érigé Mon oncle Paul en figure, en personnage à part, tantôt perçu ultra moderne, car il était le seul à posséder une automobile dans le village, à commander des caisses de victuailles aux États-Unis : du chocolat, des graines, des semences, du zan, de la menthe… à appliquer des techniques innovantes dans sa ferme, mais tantôt perçu de façon anachronique, car resté avec des habitudes d’avant-guerre quatorze, les cigarettes de gris, roulées à la main, les bretelles hautes dans le dos, les sabots et la faux pour couper un peu d’herbe sur les talus, afin d’approvisionner ses lapins, mais aussi reconnu héros invulnérable, qui traversa les balles et les obus, au mépris du danger, selon ses nombreuses citations et décorations.
***
D’abord, il s’agit de démonter les bras du relevage qui vont gêner dans les virages, car les bras restreignent le rayon de braquage. Cela fait, accrocher le tonneau au tracteur n’est pas mince affaire, lorsqu’on est seul, peu habitué aux tâches agricoles d’été et surtout lorsqu’on a onze ans !
Pour reculer le tracteur, il faut regarder en arrière, bien sûr, et se tordre pour réussir à regarder le plus près possible de la Chappe1, afin de ne pas rater l’œillet du tonneau. La difficulté est renforcée, par le fait que les jambes sont trop courtes. Le pied gauche doit pouvoir débrayer au moment précis de la coïncidence. Il faut donc anticiper. Le bassin doit pivoter pour permettre au pied gauche d’effectuer sa manœuvre. À chaque fois que j’accroche un matériel, un mini-miracle se réalise.
Il y a un Dieu qui protège les petits garçons d’agriculteur et il a du travail ! Un dieu, et mon frère, qui veille sur ma sécurité, car, il faut pallier le manque de longueur de mes jambes. Ainsi, mon frère, jamais pris au dépourvu, invente un système : il fixe une cale de bois, d’une épaisseur de douze centimètres, avec du fil de fer sur la pédale d’embrayage. C’est mieux, car la pédale est maintenant accessible par mon pied gauche, toutefois grâce au prix de contorsions multiples !
La guille2 passée, je m’empresse d’avancer le tonneau sous l’énorme tuyau, qui, une fois alimenté, va le remplir d’eau, moyennant une bonne heure. C’est du temps perdu pour mon frère, qui, dorénavant, se chargera du remplissage la veille, afin de ne pas perdre ce temps précieux !
Une fois en vue de la pâture, les génisses reconnaissent le son du moteur du tracteur et accourent se masser le long de la clôture. Lorsqu’elles ont grand-soif, le phénomène est amplifié, et il devient difficile de stopper le tracteur, descendre ouvrir la barrière et remonter sur le « zinc », afin de pénétrer dans le pré, en évitant la fuite des bêtes. C’est un exercice souvent périlleux, lorsqu’on est seul, parfois impossible ! Il m’est arrivé, la mort dans l’âme, d’aller chercher de l’aide auprès de mon père. C’était humiliant de ne pas pouvoir se débrouiller seul, malgré les paroles réconfortantes de mon père :
« Tu ne pouvais pas y arriver, fallait venir me chercher tout de suite ».
« Personne n’y serait arrivé ! Pas même moi ! »
Cette bienveillance ne me satisfaisait pas, car mon frère, lui, le faisait seul, invariablement !
Elles n’étaient pas venues se masser devant la barrière, je n’eus donc pas de difficultés à entrer, après avoir ouvert et projeté la barrière, puis remonter le plus vite possible sur le tracteur. Ensuite, il était facile de reculer la cuve au-dessus du bac, de vider le contenu de celle-ci, environ cinq cents litres d’eau, dans le réservoir, puis ressortir sans encombre. Les génisses se pressaient toutes autour du bac et buvaient longuement cette eau fraîche et pure, par gourmandise, car, ce jour-là, elles n’avaient aucune soif !
Fier de revenir rapidement sans anicroche, j’attendais des félicitations, de la part de mon frère, je fus accueilli par :
« Tu y as mis le temps ! »
Mon frère Luc était à cette époque, « survolté », toujours pressé ! Il voulait reprendre la ferme, continuer ce que mon père avait créé, poursuivre les investissements, aller de l’avant, suivre le progrès, produire plus en amendant la terre, fournir de la craie aux sols, utiliser les produits chimiques : l’azote, les nitrates, la potasse… mais aussi utiliser les pesticides : l’atrazine, le génoxone, le glyphosate… afin d’éviter le désherbage manuel, trop long et fastidieux !
La polyculture de mon père devait être performante ou mourir ! Pour performer, il fallait utiliser les moyens à dispositions : les engrais, les pesticides, les remembrements sauvages, qui ne tenaient pas compte des ruisseaux, des haies, des amendements de boues chargées de métaux lourds, des écumes (résidus nauséabonds de betteraves à sucre) et des lisiers trop concentrés ; à cette époque, la terre semblait infinie, illimitée, elle était offerte au saccage pour la production, à la destruction pour du profit… elle était à la disposition de l’Homme !
En cette belle année mil neuf cent soixante-sept, encore un peu glorieuse, la France Agricole maintenant mécanisée réussit et innove. Pourtant, cinq ans auparavant, mon père suit à pied la moissonneuse-lieuse Massey Harris, avec une perche3.
Cette machine est un monstre pour le petit garçon que je suis, avec son énorme roue entraîneuse de tous les mécanismes. Cette machine coupe le blé, les tiges tombent sur des toiles. Un engrenage de toiles emmène les tiges pour les grouper ; à intervalles réguliers, le lieur effectue un tour complet. La gerbe de blé est liée, et éjectée sur le porte gerbe.
L’enfant assis sur la machine a pour tâche de libérer le porte-gerbe une fois empli. C’est mon travail, et je tuerai pour faire cela ! Car ainsi, je fais partie intégrante de la famille, j’ai un rôle dans l’organisation du travail familial ; chacun est sa place : mon frère au volant du tracteur, mon père derrière les toiles, et moi, perché sur le siège au plus haut du dragon. À l’origine, cette machine était tractée par des chevaux. Mon père l’avait transformée pour l’atteler derrière le tracteur. Le siège d’origine était donc prévu pour celui qui dirigeait les chevaux.
Il avait une vue plongeante sur tous les mécanismes et pouvait ainsi réglait la vitesse et la position des rabatteurs.
Mon travail se résume à tirer sur une corde, après avoir compté jusque six !
La corde sur laquelle je dois tirer pour libérer le mécanisme est d’une grosseur telle qu’elle emplit ma main, plutôt les deux mains. Il me faut tirer de toutes mes forces, calé sur les pieds, et arc-bouté afin d’utiliser tout mon corps pour réussir le largage : un défi obligatoirement relevé toutes les trois, ou quatre minutes, selon la densité de la céréale !
À mon poste, je peux observer mon père marcher à vive allure : la troisième vitesse du super cinq, au maximum ! combien de kilomètres à l’heure ? Combien de kilomètres parcourus dans la journée ? La cadence, ajoutée à l’effort physique intense et continu relevait d’une performance d’athlète !
Il manie sa perche tel un magicien ; chaque poignée de blé qui s’enfile mal sur la machine a affaire à mon père qui ne plaisante pas : un mouvement de rotation bien enlevé de la perche a vite fait de remettre dans le droit chemin ces incessantes poignées récalcitrantes, qui veulent monter invariablement l’épi en bas c’est-à-dire à l’envers ! Sans doute un défaut de la machine, ou une mauvaise conception du diviseur, ou une vitesse de rotation mal évaluée, donc insuffisante ! Si la céréale était « fondue4 », alors la machine dysfonctionnait de plus belle, et mon père avait la tâche plus ardue encore !
Mon père, et beaucoup d’autres agriculteurs, se sont crevés pour obvier une mauvaise conception de la machine !
Lorsque le champ était fauché, on s’accordait un temps de repos, quelques minutes pour boire un coup, ou une heure pour prendre le repas de midi, selon l’organisation décidée par mon père. Ma mère nous rejoignait avec le ravitaillement. Partout, et particulièrement au lieu-dit des « neuf », à proximité de la cavée de Noyelles, il y avait de nombreux buissons, quelques arbres qui permettaient une halte à l’ombre pour se restaurer, déguster des tartines délicieuses, et souvent une spécialité de ma mère : un hors d’œuvre macédoine, œufs mayo, tomates, et poulet en gelée… dans des tupperwares achetés à prix d’or !
Je n’ai plus jamais, mais vraiment jamais mangé quelque chose d’aussi bon ! Même dans un restaurant gastronomique dans le Jura, où monsieur Jacques Chirac avait mangé juste avant d’être président, non rien d’aussi bon dans la chaleur sèche et écrasante du midi, en plein été, avec pour fond sonore : le chant des alouettes, si hautes dans le ciel, et pour spectacle, les hirondelles virevoltant et rasant le sol pour gober les insectes.
***
Tout l’été, la famille était réunie, et agrandie par Hermance, une femme forte, moralement et physiquement, d’origine flamande, Léa, ma deuxième mère, qui veillera jalousement sur moi jusqu’à sa mort, compatriote du village, Léon, un homme costaud, amusette et buveur, Alexis, un vieillard, qui, lorsqu’il n’avait pas le temps de rouler sa cigarette, enfournait le tout dans la bouche, en guise de chique ! Alfred, vieil homme peu bavard, et très lent, sans oublier Rodeau, organisateur de combat de coqs certains dimanches. Il se faisait payer les yeux de la tête, à en croire ma mère. Mon père recrutait, ma mère faisait les comptes et donner l’argent contre travail rendu.
Du travail : il y en avait car une fois les gerbes à terre, on les ramassait pour constituer des monts, çà et là, le but étant de faire sécher le grain. À cet exercice, tout le monde était mis à contribution. Une trentaine de monts par hectare. Chaque mont peut contenir jusqu’à cinquante gerbes ! Avant le porte gerbe, les bottes étaient disséminées dans le champ, pas loin d’un millier de bottes éparpillées ! Avec le porte gerbe, le travail était plus rapide !
L’ambiance était bonne : on constituait les monts en chantant, ou en racontant des histoires ; de toute sorte d’histoire, bonne ou mauvaise ! les ouvriers faisaient « peur » aux enfants, ceux-ci le leur rendaient bien en les taquinant, les femmes évoquaient les derniers ragots : les hommes prenaient une pause pour rouler une cigarette et fumer à l’ombre…
Une fois le mont constitué, il fallait le couvrir afin de le préserver contre les intempéries. Il y avait deux écoles. Mon père voyait la rapidité et la rentabilité, et donc voulait un chapeau type cinq bottes inclinées à quarante-cinq degrés, facile à réaliser rapidement. Ma mère, puriste, et sensible à la poésie, voulait un véritable chapeau esthétique, constitué de bottes à l’envers, en quelque sorte une coiffe, faisant le tour du mont. Celui-là était difficile à réaliser, moins protégeant de la pluie, mais magnifique au regard, donnant une personnalité au mont, une âme au champ, une présence dans les éteules. Ma mère comparait ces monts à des gnomes géants ; ceux-ci habitaient littéralement les campagnes dès le mois d’août, jusque, parfois fin novembre, pour les retardataires.
Au moment de la confection du chapeau, mes parents entraient en conflit. Mon oncle Paul était diplomate et parvenait souvent à réconcilier les antagonistes. Il lui suffisait de rappeler le moment où il s’était endormi un instant, les rennes à la main. Son compagnon d’infortune avait récupéré la conduite de l’attelage sous les bombes. Ils allaient ravitailler la ligne de front à Verdun. Ça canonnait plus dense que d’habitude.
« Tu dors, Paul ? »
« Oui ! »
« Tu ne dors pas puisque tu me réponds ! »
« Non, je me suis assoupi quelques minutes, comment veux-tu dormir sous un tel déluge ? »
À ce moment, une explosion plus fracassante, plus terrible que les innombrables autres, car si proche, déchire les tympans : un obus de soixante-dix vient de tomber sur la charrette de devant. Les chaires, les sabots et le sang des chevaux, le vin des tonneaux, les éclats de bois : flèches mortelles, le métal constituant la charrette dont les clous, les tiges, les barres de fer tombent sur les deux poilus… ainsi que la terre, qui, soulevée par la déflagration, retombe en un jet massif et continu.
« Paul, à rien près, c’était nous ! »
***
À six ans, j’affectionne les bandes dessinées, mais pas ma mère ! Elle considère que cette littérature est bourrée de fautes d’orthographe, et ne convient pas au raffinement de mon intellect. Elle veut bien m’en acheter, à condition de les choisir avec soin, et si je suis sage !
Je suis donc attentif à ne pas la froisser, et je compte, heureusement, sur ma grand-mère, qui veille au grain. Un abonnement à Perlin Pinpin m’a permis de suivre Titounet et Titounette, chaque semaine, sans oublier, les deux inoubliables, inimitables petites souris : Tap et Top ! Lequel est le garçon ? Tap ou Top ? C’est le garçon qui fait toujours des bêtises, et la fille qui le remet dans le droit chemin. Très moralisatrice cette bande dessinée, mais véritablement exquise, si délicieuse ! si fraîche, si adorables ces animaux de la forêt !
Quel bonheur de lire ces quatre pages, en couleurs, s’il vous plaît, lorsque le facteur a enfin daigné apporter ce trésor hebdomadaire, signé Marie Mad !
Merci, Marie Madeleine Bourdin, quel plaisir infini d’avoir pu t’écrire, en ce début d’année 2019, ce témoignage de ma gratitude pour les bonheurs vécus en compagnie de tes histoires merveilleuses !
La lecture est vite faite, après cinq ou six lectures et relectures, j’abandonne ma bande dessinée, et cherche une activité dehors !
Je ne sais toujours pas rouler à vélo, ma grand-mère non plus du reste ! Personne n’était disponible pour lui apprendre à l’âge voulu, puis la guerre empêcha l’apprentissage, lui enlevant quelque chose de banal, lorsqu’on l’a, mais si important, parfois, lorsqu’on l’a pas !
Plus tard, je me moquerai souvent de ma grand-mère, qui ne savait pas rouler à vélo ! Grand-mère, je sais que tu m’as pardonné, car tu n’étais qu’amour envers moi !
Il fait très beau en cette fin d’août, et, cette fois, je suis décidé à apprendre à rouler à vélo, pour rogner toujours plus d’indépendance. Ma sœur, rentrée d’Amiens, où elle fait ses études à la Sainte Famille, me dirige gentiment. Elle ne m’a rien imposé : cela s’est fait naturellement. Mon père, ma mère, mon frère ont voulu sûrement brusquer les choses, me brutaliser ; précoce, certes, mais pas pour le vélo ! Ce désaccord avec le vélo me poursuivra toute la vie !
À cette époque, les vélos à trois roues n’existaient pas !
« Je te pousse pour démarrer, puis je t’accompagne un peu, les bras de chaque côté de toi, en courant à côté du vélo, comme ça : tu ne peux pas tomber ! »
C’est intelligent comme méthode et sans risque : je me laisse convaincre par ma sœur. Il est vingt heures !