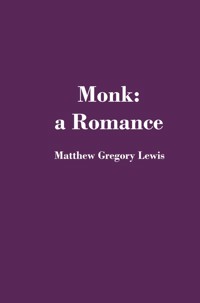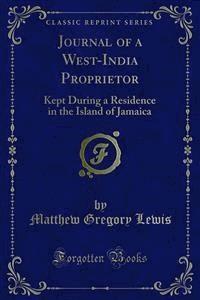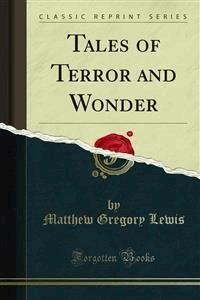Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Französisch
Voici peut-être le plus fameux des romans gothiques (ou romans noirs), ces romans qui ont tenu un grande place dans la littérature anglaise de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle et qui étaient conçus pour tenir le lecteur éveillé d'effroi la nuit. À l'époque de l'Inquisition, Ambrosio, prieur du couvent des Capucins à Madrid, est admiré pour sa vertu et la pureté de sa foi. Les fidèles se bousculent pour assister à ses célébrations de messes et tremblent devant ses sermons. Cet homme rigide et pur ne se sent d'amitié que pour un jeune moine, Rosario. Mais celui-ci va révéler sa véritable identité et la vie du prieur va basculer, entraînant de nombreuses victimes dans les pires infamies...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Moine
Chapitre 1Chapitre 2Chapitre 3Chapitre 4Chapitre 5Chapitre 6Chapitre 7Chapitre 8Chapitre 9Chapitre 10Chapitre 11Chapitre 12Notes de bas de pagePage de copyrightChapitre 1
Il y avait à peine cinq minutes que la cloche du couvent sonnait, et déjà la foule se pressait dans l’église des Capucins. N’allez pas croire que cette affluence eût la dévotion pour cause, ou la soif de s’instruire. L’auditoire assemblé dans l’église des Capucins y était attiré par des raisons diverses, mais toutes étrangères au motif ostensible. Les femmes venaient pour se montrer, les hommes pour voir les femmes : ceux-ci par curiosité d’entendre un si fameux prédicateur ; ceux-là faute de meilleure distraction avant l’heure de la comédie ; d’autres encore, parce qu’on leur avait assuré qu’il n’était pas possible de trouver des places dans l’église ; enfin la moitié de Madrid était venue dans l’espoir d’y rencontrer l’autre. Les seules personnes qui eussent réellement envie d’entendre le sermon étaient quelques dévotes surannées, et une demi-douzaine de prédicateurs rivaux, bien déterminés à le critiquer et à le tourner en ridicule.
Quoi qu’il en soit, il est certain du moins que jamais l’église des Capucins n’avait reçu une plus nombreuse assemblée. Tous les coins étaient remplis, tous les sièges étaient occupés ; même les statues qui décoraient les longues galeries avaient été mises à contribution. Aussi, malgré toute leur diligence, nos deux nouvelles venues, en entrant dans l’église, eurent beau regarder alentour : pas une place.
Néanmoins la vieille continua d’avancer. En vain des exclamations de mécontentement s’élevaient contre elle de tout côté ; en vain on l’apostrophait avec – « Je vous assure, señora, qu’il n’y a plus de place ici. » – « Je vous prie, señora, de ne pas me pousser si rudement. » – « Señora, vous ne pouvez passer par ici. Mon Dieu ! comment peut-on être si sans-gêne ! » la vieille était obstinée, et elle allait toujours. À force de persévérance, et grâce à deux bras musculeux, elle s’ouvrit un passage au travers de la foule et parvint à se pousser au beau milieu de l’église, à une très petite distance de la chaire. Sa compagne l’avait suivie timidement et en silence, ne faisant que profiter de ses efforts.
– Sainte Vierge ! s’écria la vieille d’un air désappointé, tout en cherchant de l’œil autour d’elle ; Sainte Vierge ! quelle chaleur ! quelle foule ! qu’est-ce que cela veut dire ? Je crois qu’il faudra nous en retourner : il n’y a pas l’ombre d’un siège vacant, et je ne vois personne d’assez obligeant pour nous offrir le sien.
Cette insinuation peu équivoque éveilla l’attention de deux cavaliers qui occupaient des tabourets à droite, et avaient le dos appuyé contre la septième colonne à compter de la chaire. Tous deux étaient jeunes et richement vêtus. À cet appel fait à leur politesse par une voix de femme, ils suspendirent leur conversation pour regarder qui parlait. La vieille avait relevé son voile pour faciliter ses recherches dans la cathédrale. Ses cheveux étaient roux, et elle louchait. Les cavaliers se retournèrent et reprirent leur conversation.
– De grâce, repartit la compagne de la vieille, de grâce, Léonella, retournons tout de suite chez nous ; la chaleur est excessive, et je meurs de peur au milieu de cette foule.
Ces paroles avaient été prononcées avec une douceur sans égale. Les cavaliers interrompirent de nouveau leur entretien ; mais, cette fois, ils ne se contentèrent pas de regarder : tous deux se levèrent involontairement de leurs sièges, et se tournèrent vers celle qui venait de parler.
C’était une personne dont la tournure élégante et délicate inspira aux jeunes gens la plus vive curiosité de voir sa figure. Ils n’eurent pas cette satisfaction. Ses traits étaient cachés par un voile épais ; mais sa lutte avec la foule l’avait suffisamment dérangée pour découvrir un cou qui aurait pu rivaliser de beauté avec celui de la Vénus de Médicis. Il était d’une blancheur éblouissante, et encore embelli par de longs flots de cheveux blonds qui descendaient en boucles jusqu’à sa ceinture. Sa taille était légère et aérienne comme celle d’une hamadryade. Son sein était soigneusement voilé. Sa robe était blanche, nouée d’une ceinture bleue, et laissait tout juste apercevoir un petit pied mignon et des mieux faits. Un chapelet à gros grains pendait à son bras, et son visage était couvert d’un voile d’épaisse gaze noire. Telle était la femme à laquelle le plus jeune des cavaliers offrit son siège, ce qui força l’autre de faire la même politesse à la vieille dame.
Celle-ci accepta l’offre avec de grandes démonstrations de reconnaissance, mais sans faire beaucoup de façons ; la jeune suivit son exemple, mais ne fit pour tout compliment qu’une révérence simple et gracieuse. Don Lorenzo (tel était le nom du cavalier dont elle avait accepté le siège) se mit près d’elle ; mais il avait apparemment dit quelques paroles à l’oreille de son ami, qui comprit à demi-mot, et tâcha de faire oublier à la vieille son aimable pupille.
– Vous êtes sans doute arrivée depuis peu à Madrid ? dit Lorenzo à sa charmante voisine, tant d’attraits n’auraient pu rester longtemps inaperçus ; et si ce n’était pas aujourd’hui votre première apparition, la jalousie des femmes et l’adoration des hommes vous auraient fait remarquer.
Il s’arrêta dans l’espoir d’une réponse. Comme sa phrase n’en exigeait pas absolument, la dame n’ouvrit point les lèvres : après quelques instants, il reprit :
– Ai-je tort de supposer que vous êtes étrangère à Madrid ?
La dame hésita ; et enfin, d’une voix si basse qu’elle était à peine intelligible, elle fit un effort et répondit : « Non, señor. »
– Votre intention est-elle d’y rester quelque temps ?
– Oui, señor.
– Je m’estimerais heureux, s’il était en mon pouvoir de contribuer à vous rendre le séjour agréable. Je suis bien connu à Madrid, et ma famille n’est pas sans crédit à la cour. Si je puis vous être de quelque utilité, disposez de moi ; ce sera me faire honneur et plaisir. – « Assurément, se dit-il, elle ne peut pas répondre à cela par un monosyllabe : cette fois il faut qu’elle me dise quelque chose. »
Lorenzo se trompait : la dame salua de la tête pour toute réponse.
Pour le coup, il avait reconnu que sa voisine n’aimait guère à causer ; mais ce silence provenait-il d’orgueil, de réserve, de timidité ou de bêtise, c’est ce qu’il ne pouvait encore décider.
Après une pause de quelques minutes : « C’est sans doute parce que vous êtes étrangère, dit-il, et encore peu au fait de nos usages, que vous continuez à porter votre voile ? Permettez-moi de vous le retirer. »
En même temps, il avançait sa main vers la gaze ; la dame l’arrêta.
– Je n’ôte jamais mon voile en public, señor.
– Et où est le mal, je vous prie ? interrompit sa compagne, non sans aigreur. Ne voyez-vous pas que toutes les autres dames ont quitté le leur, par respect pour le saint lieu où nous sommes ? J’ai déjà moi-même ôté le mien ; et certes, si j’expose mes traits à tous les regards, vous n’avez aucune raison de prendre ainsi l’alarme.
– Chère tante, ce n’est pas l’usage en Murcie.
– En Murcie, vraiment ! Sainte Barbara ! Qu’importe ? Vous êtes toujours à me rappeler cette infâme province. C’est l’usage à Madrid, c’est là tout ce qui doit nous occuper. Je vous prie donc d’ôter votre voile à l’instant même.
La nièce se tut, mais elle ne mit plus d’obstacle aux tentatives de Lorenzo, qui, fort de l’approbation de la tante, se hâta d’écarter la gaze. Quelle tête de séraphin se présenta à son admiration ! Cependant elle était plus séduisante que belle ; le charme était moins dans la régularité du visage que dans la douceur et la sensibilité de la physionomie. À les détailler, ses traits, pour la plupart, étaient loin d’être parfaits ; mais l’ensemble était adorable. Sa peau, quoique blanche, n’était pas sans quelques taches ; ses yeux n’étaient pas très grands, ni ses paupières remarquablement longues. Mais aussi ses lèvres avaient toute la fraîcheur de la rose ; son cou, sa main, son bras étaient admirables de proportion ; ses paisibles yeux bleus avaient toute la douceur du ciel, et leur cristal étincelait de tout l’éclat des diamants. Elle paraissait âgée d’à peine quinze ans. Un malin sourire qui se jouait sur ses lèvres annonçait en elle une vivacité qu’une timidité excessive comprimait encore. Ses regards étaient pleins d’un embarras modeste, et chaque fois qu’ils rencontraient par hasard ceux de Lorenzo, elle les baissait aussitôt ; ses joues se couvraient de rougeur, et elle se mettait à dire son chapelet.
Lorenzo la contemplait avec un mélange de surprise et d’admiration. Mais la tante jugea nécessaire de faire l’apologie de la mauvaise honte d’Antonia.
– C’est une enfant, dit-elle, qui n’a rien vu du monde. Elle a été élevée dans un vieux château en Murcie, sans autre société que celle de sa mère, qui, Dieu lui fasse paix, la bonne âme ! n’a pas plus de bon sens qu’il n’en faut pour porter sa soupe à sa bouche ; et pourtant c’est ma propre sœur, ma sœur de père et de mère !
– Et elle a si peu de bon sens ! dit don Christoval avec un étonnement simulé. Voilà qui est extraordinaire !
– N’est-ce pas, señor, que c’est étrange ? Mais c’est un fait, et malgré cela, voyez le bonheur de certaines gens ! Un jeune gentilhomme, d’une des premières familles, ne se mit-il pas en tête qu’Elvire avait des prétentions à la beauté ! Quant à des prétentions, le fait est qu’elle n’en manquait pas ; mais, quant à la beauté ! – si j’avais pris pour m’embellir la moitié autant de peine. – Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Comme je vous le disais, señor, un jeune homme tomba amoureux d’elle, et l’épousa à l’insu de son père. Leur union resta secrète près de trois ans ; mais enfin la nouvelle en vint aux oreilles du vieux marquis, lequel, comme vous pouvez bien le supposer, n’en fut pas très charmé. Il prit la poste et se rendit en toute hâte à Cordoue, résolu de s’emparer d’Elvire et de l’envoyer n’importe où, pourvu qu’il n’en entendît plus parler. Bienheureux saint Paul ! comme il tempêta quand il vit qu’elle lui avait échappé, qu’elle avait rejoint son mari, et qu’ils s’étaient embarqués pour les Indes ! Il jura contre nous tous, comme s’il eût été possédé du malin esprit ; il fit jeter mon père en prison, mon père, le cordonnier le plus honnête et le plus laborieux qui fût à Cordoue ; et à son départ, il eut la cruauté de nous prendre le petit garçon de ma sœur, alors à peine âgé de deux ans, et que, dans la précipitation de la fuite, elle avait été obligée de laisser derrière elle. Je présume que le pauvre petit misérable fut cruellement traité par lui, car, peu de mois après, nous reçûmes la nouvelle de sa mort.
– C’était, señora, un terrible homme que ce vieillard.
– Horrible ! et si totalement dénué de goût ! Le croiriez-vous, señor ? quand je m’efforçai de l’apaiser, il me traita de maudite sorcière, et il souhaita que, pour punir le comte, ma sœur devînt aussi laide que moi ! Laide ! en vérité ! il est adorable !
– On n’est pas plus ridicule ! s’écria don Christoval. Sans aucun doute le comte eût été trop heureux de pouvoir échanger une sœur contre l’autre.
– Oh ! Jésus ! señor, vous êtes réellement trop poli ! Néanmoins, je suis enchantée, ma foi, que le comte ait été d’un autre avis. Elvire a fait là une si brillante affaire ! Après être restée à bouillir et à rôtir aux Indes pendant treize longues années, son mari meurt, et elle revient en Espagne, sans un toit pour abriter sa tête, sans argent pour s’en procurer. Antonia, que voici, était toute petite alors, et c’était le seul enfant qui lui restât. Elle trouva son beau-père remarié ; il était toujours furieux contre le comte, et sa seconde femme lui avait donné un fils qui, à ce qu’on dit, est un fort beau jeune homme. Le vieux marquis refusa de voir ma sœur et son enfant ; mais il lui fit savoir que, sous condition de ne jamais entendre parler d’elle, il lui assignerait une petite pension, et lui permettrait de vivre dans un vieux château qu’il possédait en Murcie. Ce château avait été l’habitation favorite de son fils aîné ; mais, depuis que ce fils s’était enfui d’Espagne, le vieux marquis ne pouvait plus souffrir cette résidence, et la laissait tomber en ruine. Ma sœur accepta la proposition ; elle se retira en Murcie, et elle y est restée jusqu’au mois dernier.
– Et quel motif l’amène à Madrid ? s’informa don Lorenzo, qui admirait trop la jeune Antonia pour ne pas prendre un vif intérêt au récit de la vieille bavarde.
– Hélas ! señor, son beau-père vient de mourir, et l’intendant du domaine de Murcie a refusé de lui payer plus longtemps sa pension. Elle vient à Madrid dans l’intention de supplier le nouvel héritier de la lui continuer ; mais je crois qu’elle aurait bien pu s’épargner cette peine. Vous autres jeunes seigneurs, vous savez toujours que faire de votre argent, et vous êtes rarement disposés à vous en priver pour de vieilles femmes. J’avais conseillé à ma sœur d’envoyer Antonia avec sa pétition : mais elle n’a pas voulu m’écouter. Elle est si obstinée ! L’enfant a un joli minois, et peut-être bien qu’elle aurait obtenu beaucoup.
– Ah ! señora ! interrompit don Christoval prenant un air passionné, s’il faut un joli minois, pourquoi votre sœur n’a-t-elle pas recours à vous ?
– Oh ! Jésus ! señor, je vous jure que je suis tout accablée de vos galanteries. Mais je connais trop bien le danger de pareilles commissions, pour me mettre à la merci d’un jeune gentilhomme.
– Oh ! pour cela, señora, je n’en doute nullement. Mais, permettez-moi de vous le demander, vous avez donc de l’aversion pour le mariage ?
– Voilà une question un peu personnelle. Je ne puis pourtant m’empêcher d’avouer que s’il se présentait un aimable cavalier…
Ici elle voulut lancer à don Christoval un regard tendre et significatif ; mais comme malheureusement elle louchait abominablement, l’œillade tomba sur Lorenzo qui prit le compliment pour lui, et y répondit par un profond salut.
– Puis-je vous demander, dit-il, le nom du marquis ?
– Le marquis de Las Cisternas.
– Je le connais intimement. Il n’est point à Madrid pour le moment, mais on l’attend de jour en jour. C’est le meilleur des hommes, et si l’aimable Antonia veut me permettre d’être son avocat auprès de lui, je me flatte d’être en état de lui faire gagner sa cause.
Antonia leva ses yeux bleus, et le remercia silencieusement de cette offre par un sourire d’une douceur inexprimable. La satisfaction de Léonella fut beaucoup plus bruyante.
– Oh ! señor ! s’écria-t-elle, toute notre famille vous en aura les plus grandes obligations ! J’accepte votre offre avec toute la reconnaissance possible, et je vous rends mille grâces de votre générosité. Antonia, pourquoi ne parlez-vous pas, ma chère ? Monsieur vous dit toutes sortes de choses civiles.
– Ma chère tante, je sens que…
– Fi donc ! ma nièce, que de fois je vous ai dit qu’il ne fallait jamais interrompre une personne qui parle ! Quand m’avez-vous vue faire une pareille chose ? Sont-ce là vos manières de Murcie ? Mais je vous prie, señor, continua-t-elle en s’adressant à don Christoval, apprenez-moi pourquoi il y a tant de monde aujourd’hui dans la cathédrale.
– Est-il possible que vous ignoriez qu’Ambrosio, le prieur de ce monastère, prononce ici un sermon tous les jeudis ? Madrid entier retentit de ses louanges. Il n’a encore prêché que trois fois ; mais tous ceux qui l’ont entendu sont tellement ravis de son éloquence, qu’il est aussi difficile de se procurer des places à l’église qu’à la première représentation d’une nouvelle comédie.
– Hélas ! señor, jusqu’à hier je n’avais pas eu le bonheur de voir Madrid ; et à Cordoue nous sommes si peu informés de ce qui se passe dans le reste du monde, que jamais le nom d’Ambrosio n’a été prononcé dans ses murs.
– Vous le trouverez ici dans toutes les bouches. Ce moine semble avoir fasciné tous les habitants ; et n’ayant point même assisté à ses sermons, je suis étonné de l’enthousiasme qu’il excite. Jeune et vieux, homme et femme, c’est une adoration générale et sans exemple. Nos grands l’accablent de présents ; leurs femmes refusent tout autre confesseur, et il est connu par toute la ville sous le nom de l’homme de Dieu.
– Je ne vous demande pas, señor, s’il est de noble origine ?
– On l’ignore jusqu’à présent. Le dernier prieur des capucins le trouva, encore enfant, à la porte du monastère ; toutes les recherches que l’on a faites pour découvrir qui l’avait laissé là ont été inutiles, et lui-même n’a pu donner aucun indice sur ses parents. Il a été élevé dans le couvent, et il y est resté depuis. Il a montré de bonne heure un goût décidé pour l’étude et pour la retraite, et aussitôt qu’il a été en âge, il a prononcé ses vœux. Personne ne s’est jamais présenté pour le réclamer, ou pour éclaircir le mystère qui couvre sa naissance ; et les moines, qui y trouvent leur compte à cause de la vogue qu’il procure à leur maison, n’ont pas hésité à publier que c’est un présent que leur a fait la Vierge. En vérité, la singulière austérité de sa vie prête quelque appui à cette version. Il est maintenant âgé de trente ans, et chacune de ses heures s’est passée dans l’étude, dans un isolement absolu du monde, et dans la mortification de la chair. Avant d’être nommé supérieur de sa communauté, il y a de cela trois semaines, il n’était jamais sorti des murs du couvent ; même à présent il ne les quitte que le jeudi, lorsqu’il vient dans cette cathédrale prononcer un sermon qui attire tout Madrid. Il passe pour observer si strictement son vœu de chasteté, qu’il ne sait pas en quoi consiste la différence qu’il y a entre l’homme et la femme. Aussi les gens du peuple le regardent comme un saint.
– Un saint pour cela ? dit Antonia. Alors je suis donc une sainte ?
– Bienheureuse Barbara, s’écria Léonella, quelle question ! fi donc, petite fille, fi donc ! ce ne sont pas là des sujets convenables pour de jeunes personnes. Vous ne devriez pas avoir l’air de vous souvenir qu’il existe sur la terre rien de semblable à un homme.
L’ignorance d’Antonia aurait été bientôt dissipée par la leçon de sa tante ; mais heureusement un murmure général dans l’église annonça l’arrivée du prédicateur.
C’était un homme d’un port noble et d’un aspect imposant. Sa taille était haute, et sa figure remarquablement belle ; il avait un nez aquilin, de grands yeux noirs et étincelants, et d’épais sourcils qui se touchaient presque ; son teint était d’un brun foncé, mais transparent ; l’étude et les veilles avaient entièrement décoloré ses joues ; la tranquillité régnait sur son front sans rides ; et le contentement exprimé dans chacun de ses traits annonçait une âme exempte de soucis comme de crimes. Il salua humblement l’assemblée ; pourtant, même alors, il y avait dans sa physionomie et dans sa contenance une certaine sévérité qui imposait généralement, et peu de regards étaient capables de soutenir le feu des siens. Tel était Ambrosio, prieur des capucins, et surnommé l’Homme de Dieu.
Antonia, qui le considérait avidement, sentit son cœur troublé d’un plaisir inconnu, et dont elle chercha vainement à se rendre compte. Elle attendait avec impatience que le sermon commençât ; et lorsque enfin le moine parla, le son de sa voix sembla la pénétrer jusqu’au fond de l’âme. Quoique aucun des assistants n’éprouvât d’aussi violentes sensations que la jeune Antonia, ils écoutaient tous avec intérêt et émotion.
Dans un langage nerveux, clair et simple, le moine développa les beautés de la religion. Il donna de certains passages des saintes écritures une explication qui entraîna la conviction générale. Sa voix, distincte à la fois et grave, sembla chargée de toutes les menaces de la tempête, lorsqu’il déclama contre les vices de l’humanité et décrivit les châtiments qui les attendaient dans la vie future. Chacun des auditeurs fit un retour sur ses offenses passées, et trembla ; mais lorsque Ambrosio, changeant de thème, célébra les mérites d’une conscience sans tache, le glorieux avenir promis aux âmes exemptes de reproches, et la récompense qui lui était réservée dans les régions de la gloire infinie, les assistants sentirent peu à peu se relever leurs esprits abattus.
Le sermon était fort étendu ; cependant, lorsqu’il fut terminé, les auditeurs regrettèrent qu’il n’eût pas duré plus longtemps. Quoique le moine eût cessé de parler, un silence d’admiration régnait encore dans l’église. À la fin, le charme s’étant dissipé par degrés, l’enthousiasme se manifesta hautement. Ambrosio descendait de la chaire : on l’entoura, on le combla de bénédictions, on tomba à ses pieds, on baisa le bord de sa robe. Il passa lentement, les mains dévotement croisées sur sa poitrine, jusqu’à la porte qui donnait dans la chapelle du couvent, et où ses moines attendaient son retour. L’humilité était sur tous ses traits : était-elle aussi dans son cœur ?
Antonia le suivit des yeux avec anxiété.
Il lui sembla, quand la porte se referma sur lui, qu’elle venait de perdre quelque chose d’essentiel à son bonheur ; une larme roula en silence sur sa joue.
– Il est séparé du monde ! se dit-elle ; peut-être ne le verrai-je plus !
Comme elle essuyait cette larme, Lorenzo remarqua son mouvement.
– Êtes-vous contente de notre prédicateur ? dit-il ; ou pensez-vous que Madrid élève trop haut son talent ?
Le cœur d’Antonia était si plein d’admiration pour le moine, qu’elle saisit avidement l’occasion de parler de lui : d’ailleurs, ne considérant plus Lorenzo précisément comme un étranger, elle se sentait moins embarrassée par son extrême timidité.
– Oh ! il dépasse de beaucoup mon attente, répondit-elle ; jusqu’ici, je n’avais aucune idée du pouvoir de l’éloquence ; mais tandis qu’il parlait, sa voix m’a inspiré tant d’intérêt, tant d’estime, je dirais presque tant d’affection pour lui, que je suis moi-même étonnée de la vivacité de mes sentiments.
Lorenzo sourit de la force de ces expressions.
– Vous êtes jeune, et vous débutez dans la vie, dit-il ; votre cœur, neuf au monde, et plein de chaleur et de sensibilité, reçoit avidement ses premières impressions ; sans artifice vous-même, vous ne soupçonnez pas les autres d’imposture ; et, voyant le monde à travers le prisme de votre innocence et de votre sincérité, vous vous imaginez que tout ce qui vous entoure mérite votre confiance et votre estime. Quel malheur que de si riantes visions doivent bientôt se dissiper !
– Hélas ! señor, répondit Antonia, les infortunes de mes parents ne m’ont déjà fourni que trop d’exemples attristants de la perfidie du monde ! mais assurément cette fois la chaleur de la sympathie ne peut m’avoir trompée.
– Cette fois, je reconnais que non. La réputation d’Ambrosio est tout à fait sans reproche ; et un homme qui a passé toute sa vie entre les murs d’un couvent ne peut avoir trouvé l’occasion de mal faire, quand même son penchant l’y pousserait. Mais à présent que les devoirs de sa position vont l’obliger d’entrer de temps à autre dans le monde, et le jeter sur la voie de la tentation, c’est à présent qu’il aura à montrer sa vertu dans tout son éclat. L’épreuve est dangereuse ; il est précisément à cette époque de la vie où les passions sont les plus violentes, les plus indomptées, les plus despotiques. Sa réputation le désignera aux séductions comme une victime illustre ; la nouveauté ajoutera ses charmes aux entraînements du plaisir ; et les talents mêmes dont la nature l’a doué contribueront à sa ruine, en lui facilitant les moyens de satisfaire ses désirs. Bien peu de gens reviendraient vainqueurs d’une lutte si périlleuse.
– Oh ! si restreint qu’en soit le nombre, Ambrosio en sera certainement.
– Je n’en doute pas non plus : sous tous les rapports, il fait exception parmi les hommes, et l’envie chercherait en vain une tache sur sa réputation.
– Vous me ravissez, señor, en me donnant cette assurance ! elle m’encourage à m’abandonner à la prévention favorable qu’il m’inspire, et vous ne savez pas quelle peine j’aurais eue à réprimer ce sentiment ! Ah ! très chère tante, engagez ma mère à le choisir pour notre confesseur.
– Moi, l’y engager ! répliqua Léonella ; je vous promets que je n’en ferai rien. Je ne l’aime pas du tout, votre Ambrosio ; il a une mine sévère qui m’a fait trembler de la tête aux pieds.
– Vous avez raison, señora, repartit don Christoval ; trop de sévérité est, dit-on, le seul défaut d’Ambrosio. Exempt lui-même des humaines faiblesses, il n’est point assez indulgent pour celles des autres. Mais la foule est presque dissipée : voulez-vous nous permettre de vous accompagner jusqu’à votre demeure ?
– Ô Jésus ! señor, s’écria Léonella, feignant de rougir, je ne voudrais pas le souffrir pour tout au monde ! Si je rentrais escortée d’un si galant cavalier, ma sœur est si scrupuleuse, qu’elle me ferait de la morale pendant une heure ; ce serait à n’en pas voir la fin. D’ailleurs, je préfère que vous différiez quelque peu vos propositions.
– Mes propositions ? Je vous proteste, señora…
– Oh ! señor, je ne doute pas de votre impatience ni de la sincérité de vos protestations ; mais réellement j’ai besoin d’un peu de répit ; ce ne serait point agir avec toute la délicatesse dont je me pique, que d’accepter votre main à première vue.
– Accepter ma main !
– Oh ! cher señor, ne me pressez pas davantage, si vous m’aimez. Je considérerai votre obéissance comme une preuve de votre affection. Vous recevrez demain de mes nouvelles : adieu donc. Mais, cavaliers, ne puis-je vous demander vos noms ?
– Mon ami est le comte d’Ossorio ; moi, je suis Lorenzo de Médina.
– Il suffit. Eh bien ! don Lorenzo, je ferai part à ma sœur de votre offre obligeante, et je vous instruirai sans retard de sa réponse. Où puis-je vous l’adresser ?
– On peut toujours me trouver au palais Médina.
– Vous aurez de mes nouvelles ; vous pouvez y compter. Adieu, cavaliers. Señor comte, modérez, je vous en conjure, l’excessive ardeur de votre passion. Cependant, pour vous prouver que je ne m’en offense point, et pour vous empêcher de vous abandonner au désespoir, recevez cette marque de mon affection.
En disant cela, elle lui tendit une main sèche et ridée, que son amoureux supposé baisa de si mauvaise grâce et d’un air de contrainte si évident, que Lorenzo eut peine à retenir son envie de rire. Léonella alors se hâta de quitter l’église : l’aimable Antonia la suivit en silence ; mais quand elle atteignit le portail elle se tourna involontairement, et ses yeux se reportèrent sur Lorenzo. Il la salua en signe d’adieu : elle rendit la politesse, et se retira précipitamment.
– Eh bien ! Lorenzo, dit don Christoval aussitôt qu’ils furent seuls, vous m’avez procuré une aimable intrigue ! Pour favoriser vos projets sur Antonia, je fais obligeamment quelques honnêtetés insignifiantes à sa tante, et en une heure, me voilà à la veille d’un mariage ! Comment me récompenserez-vous de tout ce que j’ai souffert pour vous ?
– Je confesse, mon pauvre comte, répliqua Lorenzo, que votre service n’a pas été sans danger. Pourtant, je vous prierai probablement de ne pas renoncer si tôt à vos amours.
– Je conclus de cette demande que la petite Antonia a fait quelque impression sur vous.
– Je ne puis vous exprimer à quel point elle m’a charmé. Depuis la mort de mon père, mon oncle, le duc de Médina, m’a témoigné son désir de me voir marié ; jusqu’ici j’ai fermé l’oreille à toutes ses suggestions, et j’ai refusé de les comprendre ; mais ce que j’ai vu ce soir…
– Eh bien ! qu’avez-vous vu ce soir ? Sérieusement, don Lorenzo, vous n’êtes pas assez fou pour songer à faire votre femme de la petite fille du cordonnier le plus honnête et le plus laborieux de Cordoue ?
– Vous oubliez qu’elle est aussi la petite-fille de feu le marquis de Las Cisternas ; mais, sans discuter la naissance et les titres, je puis vous assurer que je n’ai jamais vu de femme aussi intéressante qu’Antonia.
– C’est fort possible ; mais vous ne pouvez pas avoir l’intention de l’épouser ?
– Pourquoi non, mon cher comte ? J’aurai assez de fortune pour nous deux, et vous savez que mon oncle est sans préjugés sur cet article. D’après ce que je sais de Raymond de Las Cisternas, je suis certain qu’il reconnaîtra sans difficulté Antonia pour sa nièce. Je serais un misérable si je songeais à la séduire.
– Je vous rends les armes ! Si nous allions à la Comédie ?
– Cela m’est impossible. Je ne suis arrivé que d’hier soir à Madrid, et je n’ai pas encore vu ma sœur. Vous savez que son couvent est dans cette rue, et je m’y rendais lorsque j’ai été détourné par la curiosité de savoir la cause de l’affluence qui se portait vers l’église.
– Votre sœur est dans un couvent, dites-vous ? Oh ! c’est vrai, je l’avais oublié. Et comment va doña Agnès ? Je m’étonne, don Lorenzo, que vous ayez pu penser à claquemurer dans un cloître une si charmante fille ?
– Moi, don Christoval ? Pouvez-vous me soupçonner d’une telle barbarie ? Vous savez que c’est de son propre gré qu’elle a pris le voile, et que des circonstances particulières lui ont fait désirer de se retirer du monde. J’ai usé de tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour la détourner de cette résolution.
– Vous ne vous en êtes pas trouvé plus mal : il me semble, Lorenzo, que vous avez dû considérablement gagner à cette perte ; si j’ai bonne mémoire, doña Agnès avait pour sa part dix mille piastres, dont la moitié a dû revenir à votre seigneurie.
– Comment, comte ? dit Lorenzo irrité. Vous supposez que l’ignoble désir de me rendre maître de sa fortune a pu…
– Admirable ! courage, don Lorenzo ! le voilà tout en feu ! Dieu veuille qu’Antonia calme ce bouillant caractère, ou certainement nous nous couperons la gorge avant la fin du mois ! Modérez cette disposition inflammable, et rappelez-vous que toutes les fois qu’il sera nécessaire que je fasse la cour à votre vieille coquine, vous pouvez compter sur moi.
Il dit, et s’élança hors de la cathédrale.
Lorenzo se leva, et se prépara à tourner ses pas vers le couvent de sa sœur. Il approchait du portail, lorsque son attention fut attirée par une ombre qu’il vit se mouvoir sur la muraille opposée. Il se hâta de regarder alentour, et bientôt il découvrit un homme enveloppé dans un manteau, et qui semblait examiner soigneusement si ses actions étaient observées. Il est peu de personnes qui sachent résister aux tentations de la curiosité ; l’inconnu semblait fort désireux de cacher ce qu’il venait faire dans la cathédrale, et ce fut précisément ce qui donna à Lorenzo l’envie de savoir ce que ce pouvait être.
L’ombre projetée par la colonne dérobait sa présence à l’étranger, qui continua de s’avancer avec précaution. À la fin, il tira une lettre de son manteau, et la plaça vite au-dessous d’une statue colossale de saint François ; puis, se retirant précipitamment, il s’enfonça dans une partie de l’église très éloignée de celle où était l’image du saint.
– C’est cela ! se dit Lorenzo ; quelque folle affaire d’amour. Je crois que je ferais aussi bien de partir, car je n’y peux rien.
La vérité est que jusqu’alors il ne lui était pas venu en tête qu’il y pût rien faire ; mais c’était une petite excuse qu’il croyait devoir se présenter à lui-même pour se justifier d’avoir cédé à sa curiosité. Comme il descendait les marches qui conduisent à la rue, un cavalier le heurta avec une violence telle, qu’ils faillirent l’un et l’autre être renversés du coup. Lorenzo mit la main à son épée.
– Ah çà ! dit-il, que signifie cette brutalité ?
– Ah ! est-ce vous, Médina ? reprit le nouveau venu, que Lorenzo à sa voix reconnut pour don Christoval. Vous êtes le plus heureux des mortels de n’avoir pas quitté l’église avant mon retour. Dedans, dedans ! mon cher garçon ! elles seront ici dans une minute !
– Qui est-ce qui sera ici ?
– La vieille poule avec tous ses jolis petits poussins ; entrons, vous dis-je.
Lorenzo le suivit dans la cathédrale et ils se cachèrent derrière la statue de saint François.
– Eh bien ! dit notre héros, puis-je prendre la liberté de demander ce que veulent dire cet empressement et ces transports ?
– Oh ! Lorenzo, nous allons avoir un si merveilleux coup d’œil ! L’abbesse de Sainte-Claire et toute sa suite de nonnes arrivent ici. Il faut que vous sachiez que le pieux père Ambrosio (le Seigneur l’en récompense !) ne consent sous aucun prétexte à dépasser l’enceinte de son abbaye. Comme il est absolument nécessaire que tout couvent à la mode l’ait pour confesseur, les nonnes, en conséquence, sont obligées de lui rendre visite à son monastère. Or, l’abbesse de Sainte-Claire, pour échapper à tous les regards impurs, tels que les vôtres et ceux de votre humble serviteur, juge à propos d’attendre la brune pour mener à la confession son troupeau béni : elle va être introduite dans la chapelle de l’abbaye par cette porte particulière. La portière de Sainte-Claire, qui est une digne vieille âme, et une amie intime à moi, vient de m’assurer qu’elles seraient ici dans un instant. Voilà des nouvelles pour vous, mauvais sujet !
– La vérité est, Christoval, que nous ne verrons rien ; les nonnes sont toujours voilées.
– Non ! non ! je suis mieux au fait. Quand elles entrent dans un lieu consacré, elles ôtent toujours leur voile, par respect pour le saint auquel il est dédié.
À peine Christoval avait cessé de parler, que l’abbesse de Sainte-Claire parut, suivie d’une longue file de nonnes. Chacune, en entrant dans l’église, retira son voile : la supérieure croisa ses mains sur sa poitrine, et fit une profonde révérence lorsqu’elle passa devant la statue de saint François, patron de cette cathédrale. Les nonnes imitèrent son exemple, et se remirent en marche sans avoir satisfait la curiosité de Lorenzo. Il commençait presque à désespérer d’éclaircir ce mystère, lorsque, en saluant saint François, une d’elles laissa tomber son rosaire. Au moment où elle se baissa pour le ramasser, la lumière frappait en plein sur son visage ; elle retira adroitement la lettre qui était au-dessous de la statue, elle la mit dans son sein, et s’empressa de reprendre son rang dans la file.
– Agnès ! par le ciel ! s’écria Lorenzo.
– Quoi ! votre sœur ? Diavolo ! je prévois que votre curiosité coûtera cher à quelqu’un.
– Oui, il me le paiera cher, sans délai.
La pieuse procession était entrée dans le monastère, et la porte s’était refermée sur elle. L’inconnu quitta aussitôt sa cachette, et se hâta de sortir de l’église ; mais avant d’effectuer son projet, il aperçut Médina qui était placé sur son passage. L’étranger recula promptement, et abaissa son chapeau sur ses yeux.
– N’essayez pas de m’échapper ! s’écria Lorenzo ; je saurai qui vous êtes, et ce que contient cette lettre.
– Cette lettre ! répéta l’inconnu. Et quel droit avez-vous de me faire cette question ?
– Un droit dont je rougis maintenant ; mais vous n’en avez aucun de m’interroger. Ou répondez en détail à mes demandes, ou que votre épée réponde pour vous.
– Ce dernier mode sera le plus court ! répliqua l’autre tirant sa rapière. Allons, seigneur bravo ! je suis prêt.
Brûlant de rage, Lorenzo fondit sur lui, et déjà les antagonistes avaient échangé plusieurs passes avant que Christoval, qui en ce moment avait plus de raison qu’aucun d’eux, eût pu se jeter entre leurs armes.
– Arrêtez ! arrêtez ! Médina ! s’écria-t-il ; songez aux conséquences de verser du sang dans un lieu consacré.
L’étranger aussitôt abaissa son épée.
– Médina ! s’écria-t-il. Grand Dieu ! est-il possible ! Lorenzo, avez-vous tout à fait oublié Raymond de Las Cisternas ?
Chaque instant augmentait l’étonnement de Lorenzo. Raymond s’avança vers lui ; mais avec un regard méfiant, Lorenzo retira sa main que l’autre s’apprêtait à prendre.
– Vous, en ces lieux, marquis ? Que veut dire tout ceci ? Vous engagé dans une correspondance clandestine avec ma sœur, dont l’affection…
– M’a toujours été et m’est encore acquise. Mais l’endroit n’est pas convenable pour une explication. Accompagnez-moi à mon hôtel, et vous saurez tout. Qui est avec vous ?
– Quelqu’un que vous avez déjà vu, je pense, repartit don Christoval ; mais non à l’église vraisemblablement.
– Le comte d’Ossorio ?
– Précisément, marquis.
– Je n’ai aucune objection à vous confier mon secret, car je suis sûr que je puis compter sur votre silence.
– Alors vous avez de moi meilleure opinion que je n’en ai moi-même, et je vous demande la permission d’éviter cette confidence. Allez de votre côté, et j’irai du mien. Marquis, où vous trouve-t-on ?
– Comme de coutume, à l’hôtel de Las Cisternas ; mais rappelez-vous que je suis incognito, et que, si vous désirez me voir, vous devez demander Alphonso d’Alvarada.
– Bon ! bon ! Adieu, cavaliers, dit don Christoval ; et il partit à l’instant même.
– Vous, marquis ! dit Lorenzo avec l’accent de la surprise ; vous, Alphonso d’Alvarada !
– Moi-même, Lorenzo ; mais à moins que vous n’ayez jamais su mon histoire par votre sœur, j’ai à vous raconter bien des choses qui vous étonneront. Suivez-moi donc à mon hôtel sans délai.
En ce moment le portier des Capucins entra dans la cathédrale afin d’en fermer les portes pour la nuit. Les deux gentilshommes se retirèrent immédiatement, et se rendirent en toute hâte au palais de Las Cisternas.
– Eh bien, Antonia, dit la tante aussitôt qu’elle eut quitté l’église, que pensez-vous de nos galants ? Réellement don Lorenzo paraît être un bon et obligeant jeune homme : il a fait quelque attention à vous, et personne ne sait ce qui peut en advenir. Mais quant à don Christoval, je vous proteste que c’est un phénix de politesse. Si galant ! Si bien élevé ! Si spirituel et si tendre ! Ah ! si jamais homme peut me décider à rompre le vœu que j’ai fait de ne point me marier, ce sera ce don Christoval.
Antonia avait observé de quel air don Christoval avait baisé cette main ; mais comme elle en avait tiré des conclusions quelque peu différentes de celles de sa tante, elle eut la prudence de se taire. Comme c’est le seul exemple connu qu’une femme ait jamais tenu sa langue, on l’a jugé digne d’être cité ici.
La vieille dame continua de parler à Antonia sur le même ton, jusqu’à ce qu’elles eussent gagné la rue où était leur logement. Là une foule assemblée devant leur porte ne leur permit pas d’en approcher. Antonia aperçut au milieu une femme d’une taille extraordinaire qui tournait, tournait sur elle-même, en faisant toutes sortes de gestes extravagants. Son costume se composait de morceaux de soie et de toile de diverses couleurs, arrangés d’une manière fantastique, mais qui n’était pas entièrement dénuée de goût. Sa tête était couverte d’une espèce de turban, orné de feuilles de vigne et de fleurs des champs. Elle avait l’air d’être toute brûlée par le soleil, et son teint était olivâtre ; son regard était farouche et étrange ; et dans sa main elle portait une longue baguette noire, avec laquelle, par intervalles, elle traçait sur la terre quantité de figures singulières, autour desquelles elle dansait dans toutes les attitudes bizarres de la folie et du délire. Tout à coup elle interrompit sa danse, tourna trois fois sur elle-même avec rapidité, et après une pause d’un moment, elle chanta une ballade de magie.
– Chère tante, dit Antonia quand l’étrangère eut fini, n’est-ce pas une folle ?
– Une folle ? Non pas ma fille ; c’est seulement une réprouvée. C’est une bohémienne, espèce d’aventurière, dont la seule occupation est de courir le pays, en disant des mensonges, et en escamotant honnêtement l’argent de ceux qui l’approchent. Fi d’une telle vermine ! si j’étais roi d’Espagne, toutes celles qui ne seraient pas sorties de mes états dans un délai de trois semaines, je les ferais brûler vives.
Ces paroles furent prononcées si haut, qu’elles parvinrent aux oreilles de la bohémienne. Elle perça immédiatement la foule, et s’avança vers les deux dames. Elle les salua trois fois à la manière orientale, puis elle s’adressa à Antonia.
– Dame, gentille Dame ! sachez que je puis vous apprendre votre future destinée ; donnez votre main, et ne craignez rien ; dame, gentille dame ! écoutez !
– Très chère tante ! dit Antonia, accordez-le-moi pour cette fois ! laissez-moi entendre ma bonne aventure !
– Sottise, enfant ! elle ne vous dira que des faussetés.
– C’est égal, laissez-moi du moins entendre ce qu’elle a à dire ; je vous en prie, ma chère tante, faites-moi ce plaisir.
– Bien, bien ! Antonia, puisque vous l’avez si fort à cœur. Ici, bonne femme ; voyez nos mains à toutes deux. Voici de l’argent pour vous, et maintenant, tirez-moi mon horoscope.
À ces mots, elle ôta son gant, et lui tendit sa main : la bohémienne y fixa les yeux un moment, puis elle fit cette réponse :
– Votre horoscope ? Vous êtes à présent si vieille, ma brave dame, qu’il est déjà tout tiré : cependant, pour votre argent, je vais tout de suite vous donner un avis. Surpris de votre vanité puérile, vos amis vous taxent tous de démence, et gémissent de vous voir user d’artifice pour attraper le cœur de quelque jeune amant. Croyez-moi, dame, vous avez beau faire, vous n’en avez pas moins cinquante et un ans, et les hommes s’éprennent rarement d’amour pour deux yeux gris qui louchent. Suivez donc mes conseils ; laissez de côté votre rouge et vos mouches, la luxure et l’orgueil, et distribuez aux pauvres l’argent que vous dépensez en toilette inutile. Pensez à votre créateur et non aux amants ; pensez à vos fautes passées et non à l’avenir ; pensez que la faux du temps moissonnera promptement le peu de cheveux roux qui ornent votre front.
L’auditoire éclatait de rire pendant le discours de la bohémienne. Léonella faillit étouffer de colère, et accabla la maligne donneuse d’avis des plus amers reproches. La prophétesse basanée l’écouta quelque temps avec un sourire dédaigneux ; enfin elle fit une courte réponse, et puis elle se tourna vers Antonia.
– Paix, dame ! ce que j’ai dit est vrai ; et maintenant à vous, mon aimable fille : donnez-moi votre main, et laissez-moi voir votre sort futur, et le décret du ciel.
À l’exemple de Léonella, Antonia retira son gant et présenta sa blanche main à la bohémienne, qui, l’ayant contemplée quelque temps avec une expression de pitié et d’étonnement, prononça son oracle en ces termes :
– Jésus ! quelle main vois-je là ! Chaste et douce, jeune et belle, accomplie de corps et d’esprit, vous feriez le bonheur de quelque honnête homme ; mais, hélas ! cette ligne me découvre que la destruction plane sur vous : un homme libertin et un démon rusé travailleront de concert à vous perdre ; et, chassée de la terre par les chagrins, bientôt votre âme prendra son vol vers les cieux. Cependant, pour différer vos souffrances, retenez bien ce que je dis. Quand vous verrez quelqu’un de plus vertueux qu’il n’appartient à l’homme de l’être, quelqu’un qui, exempt de crimes, n’aura point pitié des faiblesses de son prochain, rappelez-vous les paroles de la bohémienne : quoiqu’il paraisse bon et aimable, de belles apparences cachent souvent des cœurs gonflés de luxure et d’orgueil.
Charmante fille, je vous quitte les larmes aux yeux ! Que ma prédiction ne vous afflige pas : courbez plutôt une tête soumise ; attendez avec calme le malheur qui vous menace, et espérez le bonheur éternel dans un monde meilleur que celui-ci.
Ayant dit, la bohémienne tourna de nouveau trois fois sur elle-même, et quitta la rue en courant avec des gestes frénétiques.
Chapitre 2
Reconduit par les moines jusqu’à la porte de sa cellule, le prieur les congédia en homme convaincu de sa supériorité, d’un air où l’apparence de l’humilité luttait contre la réalité de l’orgueil.
Il ne fut pas plus tôt seul, qu’il se livra sans contrainte aux enivrements de sa vanité ; en se rappelant l’enthousiasme que son sermon avait excité, son cœur s’enfla de joie, et son imagination lui présenta de splendides visions d’agrandissement.
– Quel autre que moi, pensait-il, a subi l’épreuve de la jeunesse, et n’a pas une seule tache sur la conscience ? Quel autre a dompté de violentes passions, un tempérament impétueux, et s’est soumis, dès l’aube de la vie, à une réclusion volontaire ? Je cherche en vain un tel homme ; je ne connais que moi qui sois capable d’une telle résolution. La religion ne peut pas se vanter d’un autre Ambrosio ! Maintenant que me reste-t-il à faire ? rien, que de veiller aussi soigneusement sur la conduite de mes frères que j’ai veillé sur la mienne. Mais quoi ! ne puis-je être détourné de ces sentiers que j’ai suivis jusqu’ici sans m’égarer un instant ? Ne suis-je pas un homme, et comme tel, de nature fragile, et enclin à l’erreur ? Il faut à présent que j’abandonne la solitude de ma retraite ; les plus nobles et les plus belles dames de Madrid se présentent continuellement au monastère, et ne veulent pas d’autre confesseur ; je dois habituer mes yeux à des objets de tentation, et m’exposer aux tentations des sens. Si, dans ce monde où je suis forcé d’entrer, je rencontrais une femme adorable – adorable comme vous – belle madone !…
En parlant, il fixa les yeux sur un portrait de la Vierge, qui était suspendu en face de lui : ce portrait, depuis deux ans, était pour lui l’objet d’un culte de plus en plus fervent. Il s’arrêta, et le contempla avec ravissement.
– Que cette figure est belle ! poursuivit-il, après un silence de quelques minutes ; que la pose de cette tête est gracieuse ! quelle douceur, et pourtant quelle majesté dans ces yeux divins ! Comme sa joue repose mollement sur sa main ! la rose peut-elle rivaliser avec cette joue ? le lis a-t-il la blancheur de cette main ? Oh ! s’il existait une telle créature, et qu’elle n’existât que pour moi ! S’il m’était permis de rouler sur mes doigts ces boucles dorées, et de presser sur mes lèvres les trésors de ce sein de neige ! Dieu de bonté, résisterais-je alors à la tentation ? Est-ce que je ne troquerais pas contre un seul embrassement le prix de trente années de souffrance ? n’abandonnerais-je pas… Insensé que je suis ! où me laissé-je entraîner par l’admiration de ce tableau ? Arrière, idées impures ! souvenons-nous que la femme est à jamais perdue pour moi. Jamais il n’a existé de mortelle aussi parfaite que cette peinture ; et quand même il en existerait, l’épreuve pourrait être trop forte pour une vertu ordinaire ; mais Ambrosio est à l’abri de la tentation. La tentation, ai-je dit ? pour moi, ce n’en serait point une. Ce qui me charme, considéré comme un être idéal et supérieur, me dégoûterait, devenu femme et souillé de toutes les imperfections de la nature mortelle. Sois sans crainte, Ambrosio !
Sa rêverie fut interrompue par trois coups légers à la porte de sa cellule. Le prieur avait peine à s’éveiller de son délire.
On frappa de nouveau.
– Qui est là ? dit enfin Ambrosio.
– Ce n’est que Rosario, répondit une voix douce.
– Entrez ! entrez, mon fils.
La porte s’ouvrit aussitôt, et Rosario parut, une petite corbeille à la main. Rosario était un jeune novice, qui devait prononcer ses vœux dans trois mois. Ce jeune homme s’enveloppait d’une sorte de mystère qui le rendait à la fois un objet d’intérêt et de curiosité. Son aversion pour la société, sa profonde mélancolie, sa rigoureuse observation des devoirs de son ordre, et son éloignement volontaire du monde, toutes ces dispositions, si rares à son âge, attiraient l’attention de la communauté. Il semblait craindre d’être reconnu, et personne n’avait jamais vu son visage. Sa tête était toujours enfermée dans son capuchon ; cependant, ce que l’on voyait par hasard de ses traits paraissait beau et noble. Rosario était le seul nom sous lequel il fût connu dans le monastère. Nul ne savait d’où il venait, et lorsqu’on le questionnait sur ce sujet, il gardait un profond silence. Un étranger, dont le riche habit et l’équipage magnifique trahissaient le rang distingué, avait engagé les moines à recevoir le novice, et il avait déposé la somme nécessaire. Le jour suivant il était revenu avec Rosario, et depuis cette époque on n’avait plus entendu parler de lui.
Le jeune homme avait soigneusement évité la compagnie des moines : il répondait à leurs civilités avec douceur, mais avec réserve, et laissait voir une inclination marquée pour la solitude. Le supérieur était seul excepté de cette règle générale. Rosario avait pour lui un respect qui approchait de l’idolâtrie ; il recherchait sa société avec l’assiduité la plus attentive, et saisissait avidement tous les moyens d’obtenir ses bonnes grâces. Lorsqu’il était avec le prieur, son cœur semblait à l’aise, et un air de gaieté se répandait sur son maintien et sur ses paroles. Ambrosio, de son côté, ne se sentait pas moins attiré vers ce jeune homme ; pour lui seul, il mettait de côté sa sévérité habituelle. Quand il lui parlait, il prenait insensiblement un ton plus indulgent que d’ordinaire, et nulle voix ne retentissait si douce à son oreille que celle de Rosario. Il reconnaissait les attentions du novice en lui enseignant différentes sciences ; celui-ci recevait ses leçons avec docilité : chaque jour Ambrosio était charmé davantage de la vivacité de son esprit, de la simplicité de ses manières et de la rectitude de son cœur ; en un mot, il l’aimait avec toute l’affection d’un père. Il ne pouvait parfois s’empêcher d’éprouver un désir secret de voir la figure de son élève ; mais sa loi d’abstinence s’étendait jusqu’à la curiosité, et l’empêchait de communiquer son désir.
– Père, excusez mon indiscrétion, dit Rosario, tout en plaçant sa corbeille sur la table ; je viens à vous en suppliant. J’ai appris qu’un de mes chers amis est dangereusement malade, et je viens vous demander de prier pour son rétablissement. Si le ciel l’accorde à des prières, assurément ce sera aux vôtres.
– Vous savez, mon fils, que vous pouvez disposer entièrement de moi. Quel est le nom de votre ami ?
– Vincentio della Ronda.
– Il suffit, je ne l’oublierai pas dans mes oraisons, et puisse mon intervention trouver notre trois fois bienheureux saint François favorable ! Qu’avez-vous dans votre corbeille, Rosario ?
– Quelques fleurs, révérend père, de celles que j’ai observé que vous préfériez. Voulez-vous me permettre de les arranger dans votre chambre ?
– Vos attentions me charment, mon fils.
Tandis que Rosario répartissait le contenu de sa corbeille dans de petits vases placés pour cet usage dans diverses parties de la cellule, le prieur continua ainsi la conversation.
– Je ne vous ai pas vu à l’église ce soir, Rosario.
– Cependant j’y étais, mon père ; je suis trop reconnaissant de votre protection pour perdre une occasion d’être témoin de votre triomphe.
– Hélas ! Rosario, j’ai bien peu de droits à ce triomphe : le saint a parlé par ma bouche, c’est à lui qu’appartient tout le mérite. Il paraît donc que vous avez été content de mon sermon ?
– Content, dites-vous ? Oh ! vous vous êtes surpassé ! Jamais je n’ai entendu une telle éloquence… excepté un jour.
Ici le novice laissa échapper un soupir.
– Quel était ce jour ? demanda le prieur.
– Celui où notre ancien supérieur, s’étant trouvé subitement indisposé, vous l’avez remplacé dans la chaire.
– Je m’en souviens : il y a de cela plus de deux ans. Et étiez-vous présent ? Je ne vous connaissais pas à cette époque, Rosario.
– Il est vrai, mon père ; et plût à Dieu que je fusse mort avant d’avoir vu ce jour ! quelles souffrances, quels chagrins j’aurais évités !
– Des souffrances à votre âge, Rosario !
– Oui, mon père ; des souffrances qui, si elles vous étaient connues, exciteraient également votre courroux et votre compassion ! des souffrances qui font tout à la fois le tourment et le plaisir de mon existence ! Toutefois, dans cette retraite, mon cœur est tranquille, n’étaient les tortures de l’appréhension.
J’ai abandonné le monde et ses joies pour toujours ; rien ne me reste à présent, rien à présent n’a plus pour moi de charmes, que votre amitié, que votre affection ; si je perds cela, oh ! si je perds cela, craignez tout de mon désespoir !
– Vous appréhendez la perte de mon amitié ? En quoi ma conduite a-t-elle justifié cette crainte ? Connaissez-moi mieux, Rosario, et jugez-moi digne de votre confiance. Quelles sont vos souffrances ?
– Vous me haïriez pour mon aveu ! vous me chasseriez de votre présence avec mépris.
– Mon fils, je vous demande instamment, je vous conjure…
– Par pitié, ne me faites plus de question ! je ne le dois pas, je ne l’ose pas. Écoutez ! la cloche sonne vêpres ! Mon père, votre bénédiction, et je vous quitte.
À ces mots, il se jeta à genoux et reçut la bénédiction qu’il avait demandée. Puis, pressant la main du prieur sur ses lèvres, il se leva de terre, et sortit précipitamment. Bientôt après, Ambrosio, plein d’étonnement de la conduite singulière de ce jeune homme, descendit pour assister aux vêpres, qui se célébraient dans une petite chapelle dépendante du monastère.
Les vêpres dites, les moines se retirèrent dans leurs cellules respectives. Le prieur resta seul dans la chapelle pour recevoir les nonnes de Sainte-Claire. Il n’y avait pas longtemps qu’il était dans le confessionnal, lorsque l’abbesse parut ; chacune des nonnes fut entendue à son tour, tandis que les autres attendaient avec l’abbesse dans la sacristie. Ambrosio écouta attentivement les confessions, fit maintes exhortations, enjoignit des pénitences proportionnées aux péchés ; et pendant quelque temps tout se passa comme d’ordinaire, jusqu’à ce qu’enfin une des nonnes, remarquable par la noblesse de son air et par l’élégance de sa démarche, laissât par mégarde tomber une lettre de son sein. Elle se retirait sans s’apercevoir de sa perte, Ambrosio supposa que cette lettre était celle d’un de ses parents, et la ramassa dans l’intention de la lui rendre.
– Attendez, ma fille, dit-il, vous avez laissé tomber…
En ce moment, le papier étant déjà ouvert, son œil involontairement lut les premiers mots. Il recula de surprise. La nonne, à sa voix, avait retourné la tête ; elle aperçut la lettre dans sa main, et poussant un cri de terreur, elle s’élança pour la reprendre.
– Arrêtez ! dit le moine, d’un ton sévère ; ma fille, je dois lire cette lettre.
– Alors, je suis perdue ! s’écria-t-elle, en joignant ses mains d’un air égaré.
Aussitôt son visage se décolora ; elle trembla d’agitation, et fut obligée d’entourer de ses bras un des piliers de la chapelle pour s’empêcher de tomber à terre. Le prieur, cependant, lisait les lignes suivantes : « Tout est prêt pour votre fuite, ma chère Agnès ! Demain à minuit, j’espère vous trouver à la porte du jardin : je m’en suis procuré la clef et peu d’heures suffiront pour vous mettre en lieu sûr. Qu’aucun scrupule malentendu ne vous pousse à rejeter ce moyen infaillible de vous sauver ainsi que l’innocente créature que vous portez dans votre sein. Rappelez-vous que vous aviez promis d’être à moi longtemps avant de vous engager à l’Église, que votre état ne pourra bientôt plus échapper aux regards inquisitifs de vos compagnes, et que la fuite est la seule manière d’éviter les effets de leur ressentiment malveillant. Adieu, mon Agnès ! ma chère femme ! ne manquez pas d’être à minuit à la porte du jardin. »
Aussitôt qu’il eut fini, Ambrosio fixa un œil sévère et courroucé sur l’imprudente.
– Cette lettre doit être remise à l’abbesse, dit-il.
Ces mots résonnèrent comme la foudre aux oreilles de la nonne ; elle ne s’éveilla de sa torpeur que pour sentir les dangers de sa situation. Elle le suivit à la hâte, et le retint par sa robe.
– Arrêtez ! oh ! arrêtez ! cria-t-elle, avec l’accent du désespoir ; et elle s’était jetée aux pieds du moine, et elle les baignait de larmes. – Mon père, ayez pitié de ma jeunesse ; regardez d’un œil indulgent la faiblesse d’une femme, et daignez cacher ma faute ! Le reste de ma vie sera employé à expier ce seul péché, et votre indulgence ramènera une âme au ciel !
– Incroyable espérance ! Quoi ! le couvent de Sainte-Claire deviendra-t-il l’asile des prostituées ? laisserai-je l’église du Christ nourrir dans son sein la débauche et l’opprobre ? Indigne malheureuse ! une telle indulgence me rendrait votre complice. Laissez-moi, ne me retenez pas plus longtemps. Où est la dame abbesse ? ajouta-t-il, élevant la voix.
– Arrêtez ! mon père, arrêtez ! écoutez-moi un seul instant ! ne m’accusez pas d’impureté, et ne pensez pas que j’aie été égarée par l’ardeur des sens. Longtemps avant que je ne prisse le voile, Raymond était maître de mon cœur ; il m’avait inspiré la plus pure, la plus irréprochable passion, et il était sur le point de devenir mon légitime époux ; une horrible aventure et la traîtrise d’une de mes parentes nous ont séparés l’un et l’autre. Je l’ai cru à jamais perdu pour moi, et de désespoir je me suis jetée dans un couvent. Le hasard nous a rapprochés ; je n’ai pu me refuser le triste plaisir de mêler mes larmes aux siennes ; nous nous sommes donné rendez-vous dans les jardins de Sainte-Claire, et, dans un moment d’oubli, j’ai violé mes vœux de chasteté. Bientôt je serai mère. Respectable Ambrosio, prenez pitié de moi ; prenez pitié de l’innocente créature dont l’existence est attachée à la mienne. Nous sommes perdues toutes deux si vous découvrez mon imprudence à la supérieure.