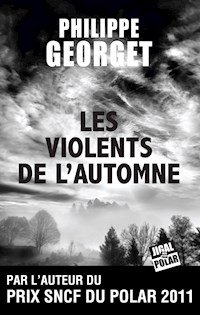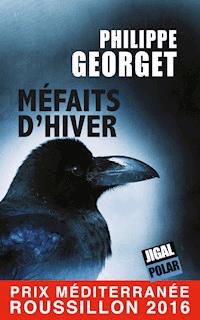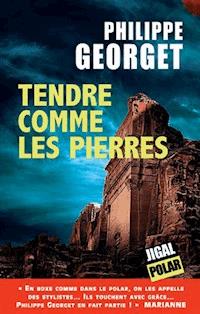9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Éditions Jigal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Retrait du titre par le distributeur numérique, à la demande de l'éditeur.
Das E-Book Le paradoxe du cerf-volant wird angeboten von Jigal (new) und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Avertissement
À une exception près, les personnages de ce roman sont issus de l’imagination de l’auteur. Toute ressemblance avec des personnes ayant réellement existé serait donc fortuite.
L’exception a pour nom Ante Gotovina. Ce général de l’armée croate existe réellement et les éléments de sa biographie dont il est fait état dans ce roman ont été tirés d’articles de presse. Sont-ils tous vrais pour autant ? La question mérite d’être posée tant les péripéties de la vie de ce personnage sulfureux et controversé semblent parfois rocambolesques. Après deux ans et demi de procédure devant le tribunal pénal international, les procureurs ont réclamé que le général Gotovina soit condamné à 27 ans de prison pour persécutions, déportations, actes inhumains et destructions lors de la contre-offensive lancée à l’été 1995 par les forces croates contre les séparatistes serbes de la Krajina. Mais au moment de la publication de ce livre, le T.P.I. n’avait pas encore rendu son verdict.
Pourquoi pas ?
Il se pencha par-dessus la rambarde et se demanda :
Pourquoi pas ?
Il ne trouvait pas de réponse alors il sauta.
PREMIÈRE RENCONTRE
Round 1
— Tout va bien, fils, ne te fais pas de mouron.
La voix se veut rassurante mais je ne suis pas inquiet.
— T’as perdu conscience pendant quelques instants, c’est pas grave. Tu devrais récupérer rapidement.
J’ai les yeux fermés, je souris. Je me sens reposé.
L’été chante et j’émerge lentement d’une sieste trop profonde. J’entends, au loin, les cigales engueuler les grillons.
— Ne bouge pas, prends ton temps. Respire tranquille.
Je ne suis pas pressé de me lever. Tout à l’heure, à la tombée du jour, j’emmènerai Laurette dans les collines. Nous irons respirer la lavande et la bruyère, la menthe poivrée et le genêt d’Espagne. C’est fou comme la tiédeur d’un soir peut réveiller les odeurs. Elle les soulève, les détache, les fait roter de bonheur. Les parfums, c’est comme le vin, il faut qu’ils soient chambrés pour exhaler leur âme.
— Tu m’as foutu la trouille, tu sais.
Je ne veux pas bouger. Peut-être je ne peux pas. Pas envie de savoir. Pas maintenant.
— J’avais bien compris que tu n’étais pas dans ton assiette aujourd’hui mais je pensais que tu pourrais t’en tirer quand même.
J’essaie d’inspirer une bonne bouffée d’air. Raté. Mon nez est aussi bouché que l’anus d’une bigote constipée. À défaut, j’avale un peu de salive. J’ai comme des grumeaux dans la bouche. C’est âpre et chaud.
Les grumeaux ont le goût du sang.
— Je ne sais pas ce qui t’a pris ce soir. Combattre comme ça, c’était du suicide.
La voix perce ma nuit. Plus obsédante qu’un réveil-matin.
Un soleil me brûle le visage et me maintient dans une torpeur confortable. Je ne veux pas me réveiller. Pas encore. Je suis dans du coton, je suis dans un cocon. Mon esprit n’habite plus mon corps. Il flotte au-dessus. Loin. Très loin. Enfin débarrassé de ce tas d’os et de chair, de cet amas de muscles douloureux. C’est peut-être ça, la mort. Oui, c’est ça, je suis mort.
Enfin heureux.
Je sais que j’ai rêvé. Je ne me souviens pas mais je le sais. Toujours le même rêve.
La voix cassée, cette voix familière, me ramène à la vie.
— Y’a pas idée d’agir ainsi. T’es vraiment le roi des cons, par moments.
Je garde les yeux fermés mais j’essaye de bouger. Je me soulève doucement. Aussitôt, les fourmis me picorent les jambes et le dos. Les siestes dans l’herbe, c’est toujours comme ça. Au début, on s’étonne du confort et on s’endort tranquillement. Puis, au bout de quelques minutes, on réalise que, si l’herbe est douce, la terre, elle, est bien dure.
Mon corps revient envahir mon esprit. Je remue difficilement mes doigts. Je suis engourdi. Le sang circule de nouveau dans mes veines. J’ai mal.
Le réveil continue de sonner.
— Le toubib va certainement repasser bientôt. Si ça va mieux, il faudrait que tu commences à te secouer les miches maintenant.
Où ai-je mal exactement ? Pas facile à dire. Aux mains, au visage ? Assurément. Au ventre et au bras ? Sans aucun doute. Et puis aux jambes et au dos. Je ne suis plus mort, c’est évident. Je viens de me réincarner en quatre-vingts kilos de steak haché.
Un peu d’air parvient à se glisser entre les caillots de mes narines. Il me transmet une odeur aigre et entêtante bien éloignée des parfums du soir qui m’attiraient tout à l’heure. Un curieux mélange de sueur, de pieds sales et de pisse froide. Et par-dessus tout, les relents obstinés d’une pommade décontractante. Un « baume du tigre », un truc à la graisse de marmotte des Alpes.
Mes doigts caressent le sol. Pas d’herbe mais une surface rêche. Je repose sur des planches grossièrement rabotées. Une table. Ou une ébauche de table.
— Tu verrais ta tronche, fils… Ravagée ! Mais tu l’as bien cherché, non ?
Émile… La voix d’Émile. Il me gonfle, le Vieux.
J’ouvre les yeux. Une lumière jaune et nue dégringole du plafond et pénètre mes rétines. À sec. Je referme les lampions. Trop tard. La migraine se répand dans mon crâne.
— Attends, je vais éteindre. On y verra bien assez avec la lumière de la douche.
Le soleil disparaît et je rouvre les yeux. On dirait un tableau de Seurat. Le pointillisme poussé à l’extrême. Des masses de couleurs aux contours incertains. Un ovale sombre couronné de blanc qui se penche sur moi.
— Bienvenu aux pays des vivants et des cons.
Avec les chicots qui déforment sa bouche, Émile a toujours l’air de ricaner. Mais cette fois-ci son regard semble grave, avec une pincée d’anxiété dans l’œil droit et un soupçon de pitié dans l’œil gauche. À moins que ce ne soit l’inverse.
— Combien j’ai de doigts ? demande-t-il en me montrant son poing fermé.
— Les deux, mon commandant.
— Et combien j’ai de dents ?
— Aussi noires que tes yeux, mon chéri.
— C’est bon, je vois que tu commences à récupérer.
Pas sûr… La migraine m’empêche de penser. Et puis, je n’ai pas envie de faire des efforts. Je ne suis pas pressé de reprendre contact avec la sombre réalité. Sombre, vraiment ? Je ne sais pas, je ne sais plus, je devine.
Le Vieux me le confirme.
— Il y a des moments difficiles dans une vie, et là, j’crois bien qu’t’as les deux pieds dedans.
Le Vieux a raison. D’ailleurs, il a toujours raison. Dans son genre, c’est un crack. Mais de quoi parle-t-il ? Dans ma tête, c’est toujours le trou noir.
— Tu peux pas dire que je t’avais pas prévenu. Ce job ne pardonne pas.
Péniblement, je me redresse. Je m’assieds sur le bord de la table, les pieds dans le vide, et j’attends que le vertige cesse. Putain, c’est haut un mètre parfois.
Mon rêve me revient. Une image, une impression, un frisson. Le vide. L’attirance. La tentation. Et cette question qui revient toujours, lancinante.
Pourquoi pas ?
Les murs vérolés du vestiaire tremblent encore un instant puis s’apaisent. Les lieux me sont familiers, aucun doute là-dessus. Je reconnais cette peinture grise qui se barre par endroits sous l’action de l’humidité, ce lino bon marché qui gondole dans les coins, ces placards cabossés par les coups mais souriants de femmes nues aux seins lourds.
Émile s’approche et me passe un gant de toilette humide sur le visage. Ses grosses pognes de cogneur ne l’empêchent pas d’agir avec délicatesse. Une vraie mère poule.
— Je ne t’ai jamais vu dans un tel état. Qu’est-ce qui t’a pris, bon dieu ? Rien ne t’obligeait à faire ça.
Une petite loupiote s’allume dans ma tête. Oh, pas grand-chose… Une veilleuse d’enfant au fond d’une mine de charbon. Il me revient des bruits et des cris. Une foule. Une enivrante clameur.
Émile va jusqu’au lavabo, plonge le gant sous l’eau froide et me le met dans les mains. Le Vieux porte une culotte de survêt bleue et un polo vert étriqué. De profil, son ventre a gagné la course depuis quelques années mais les pectoraux restent puissants, les épaules massives. Sur le biceps droit, un tatouage défraîchi proclame encore son amour filial.
— Ca va mieux ? Tu connectes de nouveau ?
Je fais oui de la tête même si ce n’est pas vrai. Je n’aime pas décevoir Émile. Pourtant, je ne fais que ça depuis des années.
— Je te l’avais dit pourtant que c’était un coriace. Mais vous êtes tous les mêmes. Quelques succès faciles et on prend la grosse tête. Et Mimile, lui, il peut toujours causer, hein ? Y’a que l’écho qui lui répond.
Je dois avoir meilleure mine pour que le Vieux laisse enfin libre cours à sa colère. Quand il s’énerve, Émile, il ne prend même plus le temps de respirer. Il termine ses diatribes à l’agonie, sa voix s’envolant dénicher des aigus improbables. Le vieux Parigot a des courroux cataclysmiques à faire pâlir d’envie un Méridional d’ascendance pied-noir. Maintenant qu’il est rassuré sur mon sort, il va s’la jouer, sa colère. Tout seul. Comme un grand. J’attends, je ne dis rien : pas besoin de lui fournir de marchepied.
— Tu croyais que je m’inquiétais pour rien, hein ? Tu te disais, il est trop vieux, Mimile, dépassé, sénile, bon pour l’hospice, mais ce soir, c’est toi qu’as l’air con.
— ‘Ais pas ‘ier…
— Pardon ? J’ai pas rêvé là, t’as parlé ?
J’articule avec précaution et lenteur pour faire comprendre à mes lèvres enflées qu’elles doivent m’obéir.
— Fais pas chier, s’il te plaît.
— Attends, mon gars, tu crois tout d’même pas que tu vas t’en tirer comme ça ? continue-t-il un ton en dessous malgré tout. Ça fait deux mois que j’te tanne pour que tu prennes les choses enfin au sérieux, deux mois que j’te pousse au cul pour qu’tu t’appliques un peu et deux mois que monsieur me prend de haut. Et qui qu’avait raison, hein, qui don’?
Une violente douleur au ventre me plie en deux. J’en rajoute dans les grimaces, histoire de lui fermer son clapet, au Vieux. Ça marche. Le Père Fouettard redevient Mère Poule.
— Ça va, petit, t’as pas trop mal ?
Je me passe le gant de toilette sur le visage. Mes mains sont encore entourées de bandages.
Ça me revient par bribes.
Cette douleur au ventre : un crochet au foie. Terrible. Dès le début de la troisième reprise, j’ai dû mettre un genou à terre. Je n’ai jamais pu revenir après.
Émile m’offre un verre d’eau. Je le bois avec maladresse. De l’eau coule de ma bouche éclatée sur mon menton puis sur mes cuisses.
— Ce qui devait arriver arriva, philosophe le Vieux. Manque de rigueur, manque de travail. On voit le résultat : trop lent, trop lourd, tu t’en es pris plein la gueule.
Je lui tends mon verre pour le faire taire. Mais le lavabo n’est qu’à deux pas et le sursis est de courte durée.
— Ose me dire, ose seulement me dire, que je ne t’avais pas prévenu…
Je prends le verre d’eau, en avale une gorgée et verse le reste du contenu sur ma tête malade. L’eau glisse sur mes cheveux, ruisselle sur mon visage et sur ma nuque. La veilleuse au fond de la mine se met à briller plus fort.
Dès les premiers engagements, j’avais senti que je n’étais pas dans le coup. Pas de souffle, pas de jambes, du fromage blanc dans les bras.
Et ce maudit crochet que je prends dans le buffet.
Malgré mon allonge, je ne parvenais pas à le toucher. Il était agile et vif, se dérobait sans cesse sous mes attaques téléphonées.
J’ai compris très vite que je ne pourrais pas gagner.
— Pas d’initiative, pas de pêche, quelques automatismes à contretemps, aucun enchaînement. Dans le genre fonctionnaire en préretraite, tu as été parfait.
Je lui mets mes mains sous les yeux. Il déroule les bandes l’une après l’autre puis contemple mes phalanges. Il hoche la tête avec tristesse. Elles ne sont même pas rouges. En frappant le vide, je ne risquais pas de les abîmer.
Je respire un grand coup et je me lève. Le vestiaire se met à danser et je dois rester un moment immobile, les yeux mi-clos. Sous mon crâne, c’est Pearl Harbour un soir de décembre 41.
— Lui, il a bien géré. Il ne s’est pas précipité. Il s’est d’abord contenté de te contrer avant de prendre le combat en main.
Les mains plaquées sur les tempes, je marche à petits pas convalescents vers le lavabo ébréché. Dans la glace, je peine à reconnaître cette face de nègre blanc aux pommettes saillantes, au nez talé et aux lèvres dilatées.
Je m’adresse un clin d’œil complice.
— Salut, gueule d’amour…
À mon arcade gauche fendue durant le combat perle une goutte de sang.
La première droite au visage, je ne l’ai pas vue venir. Logique. Je redoutais tellement les crochets au foie que j’avais baissé ma garde. Une erreur de débutant. J’étais resté dans les cordes le temps qu’il m’avait fallu pour comprendre. Bras serrés le long du corps, poings de chaque côté de la tête. Me protéger au maximum.
Les élancements dans le bas de mon dos datent de cet instant. La brûlure des cordes.
J’ouvre l’armoire à pharmacie et j’attrape une boîte de paracétamol. Je jette deux comprimés effervescents au fond du verre que je remplis à nouveau. Les bulles de gaz éclatent à la surface comme un chapelet de pets timides. J’approche mon visage tuméfié. C’est frais, c’est agréable. Je fais toujours ainsi, intimement convaincu que le médicament agit également de manière externe. Quand les cachets sont dissous, j’avale le breuvage d’une seule traite.
Émile me propose deux tranches de pain d’épices.
— Colle-toi ça dans le buffet, ça te fera du bien.
— Merci, maman.
Je dévore le gâteau aussi vite que mes mâchoires endolories me le permettent. En mangeant, je découvre ma fringale.
Un filet de sang glisse maintenant sur ma paupière. Mes efforts pour mâcher ont tiré la peau du visage et rouvert l’arcade blessée.
Il n’a pas mégoté, le gars. Il me l’a labourée, cette arcade. Sa droite, une belle frappe propre et sèche, y revenait avec délectation. Elle n’avait aucun mal à trouver le chemin. Moi, je voyais juste le gant rouge traverser ma garde et s’écraser pile au-dessus de mon œil gauche. Je n’avais jamais le temps de réagir. Je suivais l’action en gros plan mais c’est du ralenti dont j’aurais eu besoin.
Émile approche ses gros doigts de la plaie béante et l’emplit d’une grosse pâte blanchâtre. Sa pommade miracle. Fabrication maison à partir d’une solution d’adrénaline à 1 pour 1 000. Je n’en sais pas plus. Le Vieux protège ses secrets.
— J’ai voulu arrêter le massacre. Mais c’est toi qui as insisté. On aurait dit que tu prenais ton pied à rester sur le ring. À jouer les punching-balls.
L’hémorragie s’est arrêtée. Émile prend un pansement dans la pharmacie et le pose avec douceur sur la plaie.
— Au moins, y’a une chose de sûre ce soir, c’est que tu sais encaisser, mon cochon !
Quand j’ai compris que je ne pourrais pas prendre le dessus, je me suis dit que la victoire n’était pas le seul enjeu d’un combat. J’ai pensé qu’il y avait d’autres choses à gagner.
— « On continue », tu ne savais dire que ça. On aurait dit que le seul truc que tu craignais, c’était que je jette l’éponge pour toi.
— Perdu pour perdu, il fallait bien faire un peu de spectacle, non ?
— T’appelles ça du spectacle, toi ! Du grand n’importe quoi, oui… Faut aimer les jeux du cirque pour apprécier.
Un sourire au coin de sa bouche dément ses critiques. Cela me suffit. Je récupère une serviette propre dans mon placard. J’ôte mon peignoir puis mon short et je file à la douche. L’eau froide achève de me rincer la mémoire.
Le gong retentit annonçant la fin de la pause. Ce doit être la sixième ou la septième reprise. J’ai perdu le compte depuis longtemps mais ça n’a plus d’importance. Je vais perdre, tout le monde l’a compris. Moi, l’Autre, le public. Émile a été le premier à piger mais il persiste à faire comme si. C’est son job, il est pro. Il continue à m’abreuver de conseils inutiles.
— Varie tes attaques. Essaye d’enchaîner ta droite derrière ton crochet du gauche. Tu peux l’avoir, il commence à fatiguer…
Tu parles ! Il est frais comme un gardon, il sourit. On dirait qu’il pose déjà pour les photographes. Moi, j’ai les jambes lourdes et mes gants pèsent des tonnes. Je baisse constamment ma garde sans même m’en rendre compte.
— Tes bras, me serine Émile depuis le coin du ring, remonte tes bras, bordel, tu vas t’en prendre une dans la gueule !
Émile a toujours raison, la leçon me rentre dans le crâne à coups de droites meurtrières. Pute borgne ! Il sait parfaitement préparer son coup, le salaud. Je sais qu’elle va revenir cette droite, je l’attends, je la redoute, et pourtant, je ne la vois jamais arriver. Cinq sur cinq, je la reçois. Plein cadre sur l’arcade.
Un filet chaud coule sur ma joue. L’arbitre suspend le combat, examine la blessure et laisse monter Émile. Un coup d’éponge, quelques secondes de compression, un peu de pommade. Et puis beaucoup de vaseline pour faire glisser les prochains coups.
— Protège-toi, merde, me dit Émile. Si t’en prends d’autres, je te préviens, j’arrête tout.
Je lui lance un regard noir mais il est déjà reparti. Même le Vieux, ce soir, est trop rapide pour moi.
L’arbitre m’observe. Il jauge ma capacité à reprendre, je le sens perplexe. Il crache toutefois le mot magique.
— Boxe !
Je n’ai même pas eu le temps de retrouver mon souffle. J’ai dû le laisser quelque part. Au vestiaire peut-être. Ou chez moi. Ma bouche ouverte avale tout l’air qu’elle peut mais sans trouver l’oxygène nécessaire à mes poumons brûlants. Je lance mes bras en avant, je balaie l’espace entre nous espérant le tenir à distance. L’Autre sourit. Il est patient, le bougre. Vicelard peut-être. Il savoure. Mais le public est pressé qu’on en finisse. Il y a du KO dans l’air, la foule le sent, la foule le veut.
Elle a raison.
Et moi j’en ai assez de tout ce cirque.
La meute a senti l’odeur du sang, elle en redemande. Pas de problème ! La foule en aura. Mais je ne serai pas le seul à y laisser des plumes. Ton KO, mon pote, il va falloir venir le chercher…
Je serre les dents et parviens à enchaîner une série de crochets. L’Autre recule. Plus surpris que touché.
Je me redresse.
— Aujourd’hui, c’est le taureau qui agite la muleta.
J’ai pensé à mi-voix et il m’a entendu. Ses yeux posent des questions, son cerveau de brute cherche à comprendre. J’en profite pour lui glisser un petit swing sur la pommette. Oh, c’est plutôt gentil. À bout de course, à bout de souffle. Une pichenette qui lui remet les idées en place.
Je baisse ma garde et je me mets à sautiller. J’ose quelques moulinets dans le vide, je le défie. J’ai vu dans de vieilles images noir et blanc Mohamed Ali agir ainsi. Sublime provocateur.
J’entends des cris dans le public, quelques applaudissements. Je ne suis pas Mohamed Ali. Tout le monde le sait, ici.
L’Autre s’avance vers moi. Ricanant. Résolu.
C’est une nouvelle danse qui commence. Il est précis, il frappe lourd et moi j’évolue trop lentement sur la piste. Ses coups me donnent le tempo. J’encaisse. Le bal vire au ball-trap.
« Les coups sonnent ! On aime ça !»
À travers le brouillard me revient l’écho d’une chanson de Lavilliers. Des paroles incroyables pour qui ne connaît pas la boxe. Et pourtant, il faut aimer les coups – aimer en donner, aimer en recevoir – pour grimper sur un ring et y rester sous la tempête.
Très vite, je suis acculé dans un angle. Pas moyen d’en sortir. À droite, je tombe sur sa gauche ; à gauche, je rencontre sa droite. Crochet, direct, uppercut, tout y passe et j’encaisse. Je suis comme un immeuble qu’on démolit. À chaque coup, un pan de mur fout le camp. Mais les fondations sont solides.
Un instant, la pluie se fait moins drue. Il doit être essoufflé. Je risque ma chance et j’envoie mes gants en avant, au jugé. Je ne relève pas la tête, je frappe au corps. Parfois, je touche. Il recule de deux pas. J’enchaîne une série au visage et je fais mouche. Lui qui n’a plus l’habitude de se défendre déguste en plein. Malheureusement, mon punch a depuis longtemps déserté la partie. J’aurais pu lui faire mal, il frémit à peine. D’un revers de gant, il s’essuie le nez. Aucune trace de sang, un peu de morve seulement.
Le public exulte. Des connards scandent mon nom. La foule n’y connaît rien. Elle croit au réveil, ce n’est que le chant du cygne.
Un crochet au foie les rappelle à la triste réalité. C’est moi qui trinque, c’est eux qui crient. Je mets un genou à terre, instant de faiblesse vite maîtrisé. L’arbitre compte néanmoins jusqu’à sept. Il me fixe intensément. Hésite. Je plisse le front, je serre les dents et rassemble ma volonté pour lancer un regard mauvais. Mon bluff marche, il relance la partie.
— Boxe !
Je balance mes poings avec ce qu’il me reste d’énergie. Sans ordre. Sans but. Le style, on en reparlera une autre fois. L’efficacité aussi. Mes bras lancent des SOS, « On aurait dit des sémaphores, Les copains d’abord ». Ce n’est plus du Lavilliers, c’est du Brassens. La tête me tourne, je suis ivre.
Je reprendrais bien une droite. Voilà. Merci. Mes jambes flageolent. L’arcade éclate et le sang me brouille la vue. Je ne recule pas, je ne recule plus.
Jamais.
J’avance.
Je sens du mou sous mon gant. Il était là, tout près de moi. Trop près. J’ai eu son pif. J’enchaîne mais il est parti. Je regarde à droite, personne. Je regarde à gauche, bing, sa droite.
Je me retrouve dans les cordes, il me rejoint et on s’la joue distribution des prix. Front contre front, on balance. À bout portant. Ça tombe comme à Gravelotte. Tiens, ça vient d’où cette expression, je me demande. Un coup plus ajusté que les autres me répond que ça n’a pas d’importance. Je réplique au sternum. Ses poings se font moins lourds. Il doute ou il fatigue. Il effectue un repli stratégique vers le centre du ring.
Il me regarde. Il est furieux. Il pensait que ce serait plus facile.
Je continue de marcher sur lui. Ou plutôt je titube, je tangue, je chaloupe. Je frappe le vide devant moi. Je suis à bout. À bout de forces. À bout de vie.
L’Autre recule sagement. Il en a marre de prendre des coups. Je relève les poings une fois encore. La dernière.
Je brasse du vent. Il attend.
Puis soudain, il réagit.
C’est propre, net, précis. Un artiste. Je reçois l’estocade. Crochet du gauche à la pommette, uppercut du droit au menton et enfin un direct venu de je ne sais où, d’un troisième bras peut-être. Je m’en fous.
Un imbécile vient de couper la lumière.
Lavé, rincé, purifié, je ferme le robinet de la douche. L’eau ruisselle sur mon corps, caressant mes muscles fatigués. Je m’essuie puis j’accroche la serviette autour de ma taille.
— J’espère au moins qu’ils ont apprécié le spectacle ? je demande en regagnant le vestiaire.
Émile ne peut s’empêcher de sourire.
— Pas de problème de ce côté-là, tu l’emportes à l’unanimité. Y’a pas photo. Il faisait la gueule, l’Autre : il gagne le combat par KO et c’est pas lui qu’on acclame le plus.
Je rigole. Infime compensation. Je me souviens vaguement de l’instant. Quelque part. Très loin. Très flou.
— Je suis sorti comment ? Sur un brancard ?
— Tu ne t’en souviens pas ?
— Pas vraiment, non.
Émile fronce les sourcils. Il me scrute quelques secondes, inquiet.
— T’es sûr que ça va ?
— Ouais, la forme olympique, j’t’assure. J’ai juste besoin de reconstituer le puzzle.
— T’es sorti debout, tout simplement. Je t’ai soutenu un peu. Le petit Kamel m’a aidé.
Il me semble en effet entendre de nouveau la foule. Je me rappelle un visage surtout. Une femme. Entre deux âges, comme on dit quand on est poli. Des lèvres fines autour d’une bouche entrouverte, des yeux sombres bordés de rides élégantes. Des yeux effrayés qui semblaient me plaindre. Une mère inquiète a probablement ce regard, m’étais-je fait la réflexion.
Je dis ça, mais j’en sais rien…
Je parle de ce que je ne connais pas.
Elle était belle, cette dame, distinguée. Pas du tout à sa place dans cette salle surchauffée et bruyante. Elle applaudissait mécaniquement, comme prisonnière du mouvement de la foule. C’était son premier KO à elle aussi, son premier match de boxe, peut-être.
Ce souvenir est étrangement précis. Trop. Mon cerveau cabossé l’a sans doute inventé mais tant pis ! Je veux y croire car ce visage me fait du bien.
Je m’habille avec une extrême lenteur. Gestes prudents, ankylosés par la douleur. Je suis vieux. J’ai cent ans.
— À quel moment exactement j’ai perdu connaissance ?
— Après le passage du toubib de la fédé. J’dirais pas qu’t’étais vraiment lucide avant mais tu parlais. T’as répondu sans peine à toutes les questions du médecin.
Je n’ai pas de souvenir de ce moment. Impossible de me remémorer le visage du doc. Ni ses questions, ni mes réponses. Je me souviens seulement d’une odeur. Une puanteur d’ail.
— Dis donc, il fouettait pas un peu du bec, le toubib ?
Émile se gondole.
— Je constate que tu n’as pas tout oublié. C’est déjà ça !
J’essaye de m’accrocher à cette odeur pour reconstituer une image. Mais rien à faire. Ça ira mieux demain.
Je renonce à me faufiler dans mon jean moulant et j’opte pour le pantalon de survêtement. Je m’assieds pour enfiler mes baskets.
— Tu n’attends pas le toubib ? me demande le Vieux. Il a dit qu’il allait repasser.
— Ah bon ? Je me casse vite fait, alors.
— …
— Il va me réexaminer, va trouver un truc qui cloche et j’suis bon pour passer la nuit aux urgences. Très peu pour moi, j’suis vanné. J’ai surtout besoin de pioncer une bonne douzaine d’heures.
— T’es sûr ?
— Sûr et certain.
— Tu repars comment ?
— J’ai ma caisse garée pas loin.
— C’est pas très prudent…
— Tu plaisantes, j’habite à deux pas ! Et puis tu sais, j’ai l’habitude de conduire bourré, alors là…
Émile secoue la tête.
— T’es vraiment le roi des cons !
— J’ai été à bonne école.
Le Vieux ne sourit pas, il s’interroge. Il n’aime pas trop me voir partir comme ça mais il sait lui aussi que j’ai surtout besoin de dormir. Finalement, il me donne son feu vert.
— OK, vas-y. J’m’arrangerai avec le toubib.
— Tu lui diras que j’étais attendu en boîte de nuit.
— C’est ça, ouais… Mais tu m’promets que si demain, tu ressens des vertiges, des nausées ou n’importe quoi d’autre, tu vas te faire examiner.
Je fais mine de cracher dans ma main.
— Promis, ma poule !
Je range mes affaires dans mon vieux sac de sports noir : short, chaussons, protège-dents, coquille, gants, jean et peignoir. Je bourre le sac au max. Il est plein à craquer. Il craque.
— Et merde !
— Y’a des jours avec…, constate Émile.
— Et y’a des jours sans, je sais.
J’enfile mon blouson et prends mon sac sous le bras et je me retrouve devant Émile. On s’en serre deux. D’habitude, on s’fait la bise mais là, c’est plus solennel. Mon vieux prof garde ma main dans la sienne et maintient la pression. Il cherche à capter mon regard. Je lui offre.
— Sacré combat tout de même, fils. Grandiose, d’une certaine façon. Si tu avais gagné avec la même classe, ç’aurait été super.
Je me racle la gorge.
— Merci.
Après quelques secondes, on se lâche la pogne. Avec toute la gravité nécessaire. « Un singe en hiver », un vieux film de Verneuil, je crois. Émile est parfait en Gabin grisonnant. Moi, je m’trouve plutôt pas mal en Belmondo jeune, turbulent mais respectueux. Dans le lointain, je crois entendre résonner des trompettes.
Ce n’est qu’une alarme de voiture qui hurle dans la nuit.
Round 2
Dehors, les rues du quartier ont retrouvé leur calme. Devant la porte du gymnase, il n’y a plus qu’un petit groupe à profiter de la douceur étonnante de cette nuit de fin septembre pour prolonger la discussion. Ces gens parlent-ils du combat ? Je préfère ne pas savoir.
Ma voiture m’attend au coin de la rue. En rangeant mon sac éventré dans le coffre, je sens une présence derrière moi. Je me retourne et vois deux ombres disparaître sous une porte cochère. Elles me semblaient vêtues de longs manteaux. Deux silhouettes à la Sergio Leone. Je trouve ça louche mais cela ne m’émeut guère. Je n’ai rien sur moi digne d’être volé. Des vêtements imbibés de sueur et de sang, un téléphone portable passé de mode et une carte bleue sur un compte dans le rouge depuis longtemps. Et si c’est à moi qu’ils en veulent, qu’ils y viennent ! Je ne suis plus à quelques coups près.
Je mets la clé dans la serrure et reste sur mes gardes. Rien ne se passe. Je me glisse avec douleurs dans l’habitacle puis je démarre. La voiture toussote. J’enclenche la première et j’extirpe ma vieille Clio de son emplacement. Quand les deux ombres réapparaissent, je suis déjà au bout de la rue.
Je roule doucement dans les rues désertes de Paris. Le moteur souffreteux de ma voiture déchire la tranquillité de la nuit. Depuis plusieurs mois, le starter automatique se maintient – automatiquement – en marche. Rien à faire. Aux feux rouges, ma vieille guimbarde trépide comme une McLaren en pole position du Grand Prix de Monaco. Elle m’attire des regards ironiques souvent, hostiles parfois. Je comptais sur une victoire ce soir pour la faire réparer. C’est raté. La bourse prévue pour le perdant me permettra juste de payer pendant quelques semaines la surconsommation de carburant occasionnée par ce dysfonctionnement.
J’atteins sans encombre le boulevard d’Algérie situé dans le 19e arrondissement, entre la porte de Pantin et la porte des Lilas. Je trouve une place de stationnement juste en face de mon immeuble. Une main sur la portière, une autre sur le toit, je m’extrais de la voiture. Mes muscles se sont refroidis et, à la douleur des coups, s’ajoute déjà celle des courbatures.
L’ascenseur me conduit sans heurt jusqu’au huitième étage. J’habite un F1 d’une vingtaine de mètres carrés avec une vue plongeante, bruyante mais fascinante sur le périphérique.
Dans la cuisine, je me serre un verre d’eau que je bois sans respirer. J’ouvre le frigo. J’y trouve un fond de jus d’orange dans une bouteille et un reste de macaronis dans un Tupperware. Dans l’évier, je déniche des couverts sous une pile d’assiettes sales et je les passe sous l’eau. Je mange les pâtes froides à même la boîte. Elles sont caoutchouteuses, assez pénibles à mastiquer, mais ça passe. Avec le jus de fruits, c’est presque bon. Je conclus mon repas par un rogaton de fromage sec sur un morceau de biscotte.
Je balance les couverts et la boîte dans l’évier. Puis j’essuie la table d’un revers de main et balance les miettes dans le vide-ordures, merveilleuse invention des années soixante-dix pour faciliter l’accès des cafards dans les appartements.
Il est deux heures du matin.
Je rêve quelques minutes à la fenêtre, contemplant les voitures qui glissent sur le périphérique. Le reflet des phares jaunes et rouges trace des arabesques sur l’asphalte sombre. Les jours de pluie et de brouillard, le spectacle peut se révéler féerique. Avant de dormir, certains lisent, d’autres font l’amour, les veinards embrassent leurs enfants, moi je regarde un défilé ininterrompu de voitures.
Je trouve cela apaisant.
De toute façon, la vie ne m’a pas donné le choix.
Cette nuit, je vais pouvoir dormir la fenêtre ouverte : demain, c’est dimanche et le bruit de la circulation ne devrait pas troubler ma grasse matinée. Je glisse toutefois une boule Quies dans chaque oreille. Mon voisin du dessus est un fan de Johnny Hallyday. Surtout le week-end à partir de huit heures.
Je me couche.
Je m’appelle Pierre. J’ai 27 ans.
J’aimerais pleurer, la tête enfouie dans le giron d’une femme. Mais la seule femme que j’ai aimée m’a quitté il y a deux ans, ma sœur n’a pas eu le temps de grandir et ma mère… Ma mère m’a tué lorsque j’avais dix ans.
Round 3
— Deux cafés, s’il vous plaît, nous sommes pressés.
— Tout de suite, madame.
Le plus dur dans le métier de serveur, c’est le sourire professionnel. La politesse de façade. L’amabilité forcée. Tu te dois de faire bonne figure même les jours où t’aurais envie de bouffer la Terre entière. Aujourd’hui, un bout de chanson tourne sans cesse dans ma tête :
« J’aurais voulu leur dire “Merde !”
Et je leur disais : “Oui, Monsieur”. »
C’est de Leny Escudéro. Mon père adorait. Il le mettait en boucle dans la voiture. Il l’écoutait sûrement, le soir où il a raté son virage sur une route du Roussillon.
— Ça fait 4,30 euros, s’il vous plaît.
La politesse, on ne l’apprend pas sur les rings ou dans les foyers d’accueil. La politesse, Josy et René me l’ont enseignée patiemment, ici, au Café de la Poste.
La cliente me tend un billet de cinquante.
— Vous n’auriez pas l’appoint, s’il vous plaît ? Ou 4,50 euros ? Cinq ? Dix ? Non, vraiment ? Vingt ? J’peux garder la monnaie alors ?
Le couple assis à la quatre me gratifie d’un regard de mépris en guise de pourboire. Je respire un grand coup. Surtout ne pas les foutre dehors à coups de pied dans l’cul. Y paraît que ça ne se fait pas.
Je me demande bien pourquoi.
À la caisse devant mon gros billet, Josy aussi fait la tronche. Je hausse les épaules et j’empoche la ferraille. Puis je vais pisser. Au retour, je prends le temps de passer un coup de torchon humide sur les tables libérées.
Je sens dans mon dos des regards impatients.
Je m’arrête pour caresser Pasqua, avachi sur le carrelage. Pasqua, c’est le chien des patrons. Un shar-peï. Il est trapu avec une tête d’hippopotame. Il a une truffe charnue, la peau plissée et les bajoues tombantes. Quand il pose sur vous ses yeux las et suintants, il achève de vous convaincre de la pertinence de son nom. Ou plutôt de son surnom. Car autrefois, Pasqua s’appelait Sultan.
Je le laisse se reposer des fatigues qu’il n’aura jamais et je m’en retourne à mes clients. Je leur rends leur monnaie, pièce après pièce en prenant soin de me gourer plusieurs fois. Puis je repars en fredonnant Escudéro.
La salle du Café de la Poste se vide peu à peu. La pause déjeuner est terminée, les employés retournent au turbin.
René et Josy Prévot ont ouvert leur bistrot il y a vingt ans à côté d’une importante agence des PTT, comme on disait à l’époque, paraît-il. Ils faisaient alors café-restaurant et leur commerce prospérait grâce aux nombreux fonctionnaires voisins. Puis l’agence a fermé pour cause de restructuration. Les patrons ont cessé la restauration sans regrets, trop de fatigue, ils approchaient déjà tous les deux de la soixantaine. Depuis, ils ont mis à disposition des clients un micro-ondes pour réchauffer des gamelles. La pratique est plutôt rare, bienvenue en ces temps de crise et la nouvelle s’est vite répandue dans le quartier. Ce qui fait qu’il y a toujours beaucoup de monde finalement dans le troquet à l’heure de table.
Mes horaires sont assez souples. Compatibles avec mon entraînement. René et Josy m’ont pris sous leur aile. On s’efforce de garder nos distances mais il y a beaucoup de tendresse entre nous.
Ils n’ont pas d’enfants, je n’ai plus de famille.
Je tape une clope à René et je sors la fumer.
Ce matin – on est lundi –, je me suis pointé vers 11 heures au bistrot. Si les habitués n’avaient pas été informés de ma déculottée du week-end, la tronche que j’avais et la gueule que je tirais les auraient vite renseignés. Les gens m’ont parlé avec douceur mais sans savoir quoi me dire. On m’a serré la main, Josy m’a fait la bise ; personne n’a osé affronter mon regard. Comme si j’avais perdu un proche. Ça m’a rappelé des mauvais souvenirs. C’était hier, il y a dix-sept ans.
J’ai demandé à René de me servir un jaune. D’habitude, il refuse car j’ai déjà eu par le passé quelques tendances à picoler plus qu’il ne faudrait pour un sportif de mon niveau. Cette fois-ci, il m’en a mis un double. Je l’ai sifflé lentement. Histoire de ne pas trop l’inquiéter.
Le temps est à l’orage aujourd’hui. De gros nuages noirs planent dans le ciel de Paris. Il fait trop chaud pour ce début d’automne. J’allume ma cigarette et tire une première bouffée.
— Tu fumes de nouveau ?
Je me retourne. Sergueï. Je n’avais pas reconnu son accent, c’est normal : il roule les « r » et y’en avait pas dans sa phrase.
Sa remarque m’agace. J’ai toujours détesté ce genre de questions bêtes. Par exemple, je sors de chez le coiffeur et y’a un gonze qui me demande :
— Tiens, tu t’es fait couper les cheveux ?
La dernière fois que cela m’est arrivé, j’ai répondu :
— Non, je commence une chimio.
Le mec a verdi. Puis il a répliqué :
— Bienvenu au club.
Il est mort six mois plus tard d’une tumeur au cerveau. Je n’ai pas osé assister à son enterrement.
Depuis je fais gaffe mais quand on m’agace, je mords.
— Faut pas se fier aux apparences, Sergueï. Tu vois, j’ai mes chaussures aux pieds et, pourtant, j’marche pas !
Le gars est étonné mais ne s’offusque pas. Sergueï, c’est mon pote. Il pose sa main sur mon épaule avant de rentrer dans le café.
Le tonnerre gronde et de grosses gouttes commencent à tomber. Je me replie sous l’auvent de la terrasse. Je lis les petites annonces accrochées à la porte vitrée. Toujours les mêmes choses. Une voisine qui a perdu son chat, une autre qui recherche une aide ménagère. Le club du troisième âge annonce son prochain tournoi de scrabble. Un prof de français souhaite arrondir ses fins de mois en donnant des cours du soir. D’ordinaire, après un combat, y’a toujours une photo ou un article de journal pour raconter mes exploits aux clients. Aujourd’hui, nibe, nada, rien.
J’aime autant.
Sergueï est installé dans un angle du bar. Il ne tourne jamais le dos à la porte. Une vieille habitude des années sombres, m’a-t-il confié un jour. Il boit une bière au comptoir en bavardant avec René.
Sergueï s’affirme toujours Yougoslave même si son pays natal a sombré il y a près de vingt ans. De père croate et de mère serbe, il a refusé de choisir un camp durant le conflit et il s’est retrouvé avec tout le monde sur le dos. Sa femme et sa fille ont été tuées par les Serbes. Il a fait de la prison dans un camp croate mais il a réussi à s’échapper. Il a traversé la moitié de l’Europe pour retrouver le pavé parisien qu’il avait connu durant ses études. Il a galéré au début, vaguement SDF, avant d’obtenir son statut de réfugié. Puis il a dégoté ce job de taxi. Par chance ou par magouille, il n’a jamais été très bavard sur le sujet.
— Ça roule aujourd’hui ? je questionne avec mon sens de l’à-propos.
— J’en ai ma claque ! Je bois un coup et je vais me faire une toile.
— Tu vas voir quoi ?
— Je ne sais pas, j’hésite encore entre le dernier Bruce Willis et le Ken Loach…
Sergueï n’est pas cinéphile mais cinéphage. Un boulimique, un vrai fondu, un obsédé du septième art. Il va voir tout ce qui sort. Il aime le cinéma de Allen à Zulawski et d’À bout de souffle à Zorba le Grec. Tout ce que je sais sur le cinéma, c’est avec lui que je l’ai découvert.
Sergueï a 47 ans, j’en ai vingt de moins mais c’est mon frangin, mon poteau. La première fois qu’il est entré dans le bistrot, on a causé et on s’est tout de suite plus. Le coup de foudre, ça existe aussi pour les amis. On n’a pas le même accent, pas le même vocabulaire non plus mais on jacte la même langue. Les femmes, la vie, le sport… Lui aussi a fait de la boxe dans le temps. Il a participé aux jeux Olympiques. Los Angeles, 1984. C’est son titre de gloire et je le laisse me chambrer là-dessus même si un soir de beuverie, il m’a avoué qu’il s’était fait éliminer dès le premier tour.
Je n’ai pas vu Sergueï depuis mon combat. Je sais qu’il ne va pas hésiter à mettre les pieds dans le plat. Les autres ont évité le sujet mais lui, il se lance sans détour.
— Ça fait mal ?
— Pire qu’une gueule de bois. Sans le plaisir de la cuite.
René s’est éloigné pour nous laisser causer mais je sais qu’à distance, il tend l’oreille.
— Et le moral ?
— J’ai connu mieux mais j’ai vu pire.
— Ton analyse du combat ?
— Il était plus rapide, il cognait plus juste et plus lourd. Mais sinon… j’étais le meilleur. Et toi, ton analyse, c’est quoi ?
— Il était plus jeune et plus frais. Il voulait davantage la victoire. À part ça, je suis d’accord avec toi : tu étais le meilleur.
Satisfait, je m’offre un verre d’eau du robinet. Sergueï boit une gorgée de sa pression.
— Tu comptes continuer ?
— Continuer quoi ?
— Ben, la boxe, c’te question.
Ce coup-là, je n’y étais pas préparé. Une droite en pleine gueule alors que j’avais baissé ma garde. Pas cool. Je respire avec peine mais parviens à articuler ma surprise.
— Pourquoi j’arrêterais ?
Sergueï me fixe intensément.
— Parce que t’as plus la forme, plus la foi et que 27 ans, c’est un âge raisonnable pour raccrocher les gants.
Arrêter la boxe pour moi, c’est un peu comme… mourir. Je sais depuis le début que cela arrivera un jour mais j’ai toujours évité soigneusement de me poser la question du quand et du comment. Avec tapie au fond de moi, au-delà de la raison, la conviction que je ne suis pas concerné. Même après ma dernière déculottée, l’idée d’arrêter ne m’a pas traversé l’esprit. Y penser, là maintenant, me donne le vertige. Je m’appuie sur le bar et aspire un bol d’air.
— Mais bon… enfin… c’est… Tu ne crois pas que tu vas un peu vite en besogne. Plus la forme, oui peut-être. Je… J’ai pris une raclée, d’accord, mais bon, y’a pas le feu au lac.
Sergueï me sourit. Son front soucieux se plisse de profondes vallées. Il a dit ce qu’il avait à dire, maintenant il me laisse cogiter. Je balbutie encore :
— Bon d’accord, ce n’était pas ma première défaite, mais bon… jusqu’ici, je n’avais jamais été KO. C’est pas si grave. J’ai déjà bien récupéré depuis samedi et puis je peux me reprendre, j’en suis sûr, repartir sur de bonnes bases. Je… euh, bon ! Et puis arrêter pour faire quoi ?
Mon pote hoche la tête.
— Un vrai boulot, comme tout le monde.
Je grimace.
— Et c’est quoi un vrai boulot, selon toi ?
Il écarte les bras pour désigner le bar.
— Y’en a des pires que celui-là, non ?
Je contemple la salle du Café de la Poste presque vide en ce début d’après-midi. Il y a deux types en imper sombre qui regardent tomber la pluie à travers la vitre à une table du fond, il y a le vieux Maurice qui sirote son blanc à côté de la porte des chiottes et puis Rosy à la caisse qui compte la recette de la mi-journée. Elle s’aperçoit que je l’observe et me sourit gentiment.
René s’est rapproché discrètement de nous.
Je ne sais pas quoi répondre à Sergueï. Je suis bien dans ce bar, OK, j’y fais mes quatre heures par jour avant d’aller m’entraîner, d’accord, mais je n’ai jamais imaginé y passer ma vie. J’ai toujours vu ça en complément de la boxe, pas comme une fin en soi. Je viens gagner ici de quoi faire bouillir ma petite marmite de célibataire en attendant…
En attendant quoi d’ailleurs ? De toucher le jackpot à la grande loterie du ring ?
Je réalise soudain que je cours encore après mes rêves de gosse. La nuit, je m’invente des combats improbables, des KO. magnifiques. Un titre européen. Une ceinture mondiale. Des gros titres à la Une des journaux sportifs.
À 22 ans, je suis devenu champion de France. J’avais un palmarès appréciable et apprécié : rien que des victoires dont une grande majorité avant la limite. Le monde m’appartenait. J’ai commencé à pointer dans la liste des prétendants à un championnat d’Europe. Je gagnais correctement ma vie. Et puis…
Et puis plus rien. Aucun combat sérieux pendant quinze mois. Je crois que je faisais peur.
J’ai commencé à lever le pied à l’entraînement. J’ai pris ce boulot au bar. J’ai rencontré Sarah. La boxe a cessé un temps d’être le centre de mon univers et comme c’est une maîtresse exigeante, j’ai essuyé mes premiers revers.
Sarah est partie. J’ai gardé le boulot et poursuivi la boxe. J’avais vieilli, pris du poids. J’ai dû changer de catégorie. Je suis reparti de zéro. Mes rêves ne m’avaient pas quitté.
Mes rêves ? Mes illusions, oui.
À mon âge, beaucoup de champions ont déjà raccroché. Et moi j’suis toujours là, ébloui comme un môme par les étoiles qui pleuvent des projecteurs.
Je me revois pénétrant dans une salle surchauffée. Le public est dans le noir, il n’a d’yeux que pour moi, un moi sublimé par la lumière blanche d’une poursuite. Je me suis échauffé pendant une heure dans le vestiaire. Des semaines d’entraînement, de souffrance et de sacrifices m’ont affûté. Je suis prêt. La sueur fait briller mes muscles saillants. Je suis fort. Comme un fauve. Je vais rugir et mordre. Tuer. Sous les acclamations de la foule, on est invincible.
J’aime la boxe. J’aime le spectacle.
J’en veux encore.
— À ton avis, il faut que j’arrête ?
— Tu devrais au moins y réfléchir.
— On n’a jamais évoqué cette question, avec Émile.
— Toi, tu n’en as jamais parlé, non, mais, lui, il a essayé plus d’une fois.
J’ouvre de grands yeux.
— Il sait combien la boxe compte pour toi, m’explique Sergueï. Alors, il n’a jamais osé aborder la question de front mais il t’a souvent tendu des perches. Tu ne les as jamais saisies.
Je tombe des nues. Décidément. J’essaye de me rappeler mes dernières conversations avec mon entraîneur. Je n’ai souvenir que de conseils en vue du combat de samedi dernier. Merde alors !
— Vous en avez souvent causé dans mon dos, avec Émile ?
— Souvent, non ! Mais le sujet le préoccupe. Il a peur d’évoquer franchement la question. T’es tellement têtu par moments. Il sait que s’il te braque, t’es capable de boxer jusqu’à ta mort.
Un refrain de Dalida roucoule dans ma tête.
« Moi je veux mourir sur scène
Devant les projecteurs.
Oui je veux mourir sur scène
Le cœur ouvert tout en couleurs. »
J’ai fredonné. Sergueï glousse.
— Finalement, c’est par hasard que t’es monté sur un ring, non ? Tu cherchais une scène avec des projecteurs. Si t’avais eu de la voix, t’aurais fait chanteur, pas boxeur.
— C’est pas vrai, j’ai de la voix…
Je prends un timbre haut perché et un ton sirupeux.
— « Ma vie a brûlé sous trop de lumières, je ne peux pas partir dans l’ombre. Moi je veux mourir fusillé de lasers. Devant une salle comble. »
— Pitié, gémit Sergueï en se bouchant les oreilles.
René passe derrière moi et me donne une claque dans le dos.
— Finalement, continue encore un peu la boxe, fiston. Si le sport français ne t’en est pas reconnaissant, la chanson le sera sûrement.
Puis il s’éloigne vers la caisse poser une bise dans le cou de Josy. Le vieux Maurice se lève et m’apporte son verre vide. Sa bouche édentée est fendue jusqu’aux oreilles.
— Entre deux couplets, tu pourras m’en remettre un petit. « Ah !Le petit vin blanc, qu’on boit sous la tonnelle… »
Je lui remplis son ballon de blanc et il repart en chantonnant.
— « Quand les filles sont belles…
» — On devrait peut-être faire karaoké, ici, le samedi soir. Si je dois bosser à plein-temps, j’ai intérêt à mettre un peu d’animation sinon je vais me faire chier.
— J’ai jamais bien compris la passion que tu as pour la vieille chanson française, ce n’est pas de ton âge !
Je lui souris. Je ne vais pas lui raconter maintenant, comment les refrains de mon père ont habillé de satin clair, la part heureuse de mon enfance et comment, depuis son départ, ils me guident et me soutiennent.
Sergueï jette un œil soucieux autour de lui. Son regard s’arrête sur les deux bruns en imper. Il perd un instant le fil de ses pensées puis il se retourne vers moi et chuchote :
— Si tu cherches de l’animation, j’ai peut-être un job qui peut t’intéresser.
— Pour mon éventuelle retraite ou pour dès maintenant ?
— Quand tu voudras.
Il a encore regardé autour de lui. Je m’inquiète.
— Et c’est légal, ton truc ?
— Disons que c’est bien payé…
J’ai toujours soupçonné Sergueï de tremper dans des combines.
— Tu peux m’en dire plus ?
Il me fait signe de me rapprocher. Je me penche au-dessus du bar.
— J’ai un copain, Lazlo, qui a un peu d’argent de côté et comme il est plutôt sympa, il en prête à des petites entreprises en difficulté. Quand les banques font la sourde oreille, Lazlo, lui, il est là.
— Un philanthrope, quoi !
— Je cherchais le mot… Seulement, comme tout cela se passe entre amis, sans paperasse quoi, eh bien, certains oublient parfois de rembourser. Or, Lazlo, pour continuer à prêter à des gens dans le besoin, il faut quand même qu’il fasse rentrer de l’oseille de temps en temps.
— Les gens abusent de sa gentillesse, en quelque sorte ?
— Et de sa faiblesse aussi. Il est plus tout jeune, Lazlo, il est pas très costaud… Il a parfois besoin d’un peu d’aide.
— Pour un coup de main.
— Voilà !
— Ou un coup de poing.
Sergueï jette un nouveau regard autour de lui.
— Ça va rarement jusque-là. Quand on est bien persuasif, les gens se laissent facilement… comment dirais-je ?
— Persuader.
— Exactement !
Je passe un coup de torchon humide sur le zinc déjà propre.
— Et tu dis que ça paye bien ?
— Faudrait que je lui redemande mais je crois que c’est 100 euros par visite. Le triple, s’il y a de l’action. En ce moment, y’a du boulot, c’est la crise, les gens ont du mal à rembourser.
— Et la philanthropie a ses limites…
— Forcément !
Il a le sourire matois du maquignon, mon poteau. M’est avis qu’il ne se contente pas de jouer les VRP dans cette combine. Je fais la moue.
— Ce ne sont pas les gros bras qui manquent pourtant…
— Non mais tu sais, en général : gros bras, petit cerveau. Le plus important dans ce job, c’est la psychologie.
— Donc tu cherches un psychologue, en fait.
— C’est ça… mais avec des gros bras quand même.
— Et de préférence, deux ?
— Deux psychologues ?
— Non, deux gros bras !
— Ah oui, deux bras, c’est mieux effectivement.
On se marre. Ça me fait un putain de mal aux côtes mais Dieu que c’est bon.
Je sors faire une course. Mon rendez-vous mensuel chez le fleuriste. Une jeune fille que je ne connais pas m’accueille. Sans doute une stagiaire. Depuis la porte de l’arrière-boutique, la patronne me fait signe de l’attendre.
Elle termine un bouquet et vient me faire la bise.
— Bonjour, Pierre. Dites donc, vous vous êtes mis dans un état…
Je hausse les épaules. Elle comprend qu’il n’est pas utile de s’étendre sur le sujet.
— Ce mois-ci, je vous propose un bouquet d’hortensias. J’en ai des bleus et des rouges. Je viens juste de les recevoir. Regardez comme ils sont beaux. C’est une plante sans odeur et dans le langage des fleurs, l’hortensia signifie un amour profond pour une personne indifférente.
Valérie est la seule à connaître mon secret. Je ne sais pas pourquoi je me suis confié à elle un jour. Il y a longtemps déjà. Huit ou neuf ans peut-être. Mais je n’ai jamais eu à le regretter.
— Je suis sûre qu’elle va adorer.
Sergueï est reparti. Les deux types en imper se lèvent de concert et sortent également. Dans le café, il ne reste plus comme client que Maurice qui ronfle sur les mêmes harmoniques que le chien Pasqua. Josy a quitté sa caisse et me rejoint derrière le bar.
— Tu ne les as pas trouvés bizarres, ces deux gars ?
— Qui ça ? Les deux types en imper ?
— Ouais.
Je réfléchis. J’ai servi les deux gars sans leur prêter une grande attention. Ils avaient les cheveux bruns coupés courts, le teint basané et les visages fermés. L’un deux avait une barre unique de poils drus au-dessus des yeux. Ils ont parlé avec un accent étranger. Ils roulaient les « r » un peu comme Sergueï mais je n’y connais rien en accent. J’ai une curieuse association d’idées en pensant à ces deux types. Je revois les silhouettes à la Sergio Leone disparaissant sous un porche l’autre soir près du gymnase. Je demande à Josy :
— Qu’est-ce que tu leur reproches exactement ?
— Rien, c’est juste une impression. Je les trouve bizarres avec leurs impers.
René se joint à notre discussion.
— Il pleut, ils ont des impers, j’vois pas ce qu’il y a de curieux.
— Il ne pleut pas à l’intérieur, il fait même plutôt chaud et ils ne les ont pas quittés. Et puis les autres jours, il ne pleuvait pas !
— Ils sont déjà venus ? je questionne.
— Deux ou trois fois, confirme René. Et c’est vrai qu’ils avaient déjà leurs impers.
Je me moque gentiment.
— Eh ben, vous ne vous arrangez pas en vieillissant. Vous devenez paranos. Ou racistes…
— Oh, je t’en prie ! se vexe Josy. C’est pas ça, tu sais bien. Juste une impression étrange. Ils s’installent au fond de la salle devant la vitrine et observent : la rue, la salle, les clients, je ne sais pas… Et ils ne se parlent jamais. Moi, des types qui viennent dans un café boire un verre et qui n’ont rien à se dire, je trouve ça bizarre, c’est tout.
— C’est souvent comme ça, les vieux couples, je ricane.
— Vieux couple ? intervient René, ils n’ont pourtant pas le genre « homo » ces deux-là.
— Et c’est quoi pour toi le genre « homo » ironise Josy.
— Oh ça va, tu vois bien ce que je veux dire…
Je réfléchis quelques secondes et j’avance une autre hypothèse.
— En fait, moi je trouve qu’ils ressemblent plutôt à des flics, tes deux lascars.
— Ah ouais, tu crois ? demande René soudain méfiant. Des flics étrangers alors…
Le bistrotier retrouve ses réflexes de vieil anar pour conclure, presque agressif :
— Finalement, j’aimerais mieux que ce soit des pédés.
Étouffant.
Dans la salle de boxe, l’air est étouffant. Vicié, humide, aigre.
Depuis une demi-heure, une vingtaine de boxeurs transpirent dans la pièce sans fenêtre. Une cage aux fauves en climat tropical. Des gouttelettes de sueur giclent dans l’air. L’atmosphère est lourde et l’odeur, forte et dense, en devient palpable. Un nez délicat trouverait que ça pue, moi j’aime. Mélange de sueur et de cuir. Un parfum d’hommes.
Les boxeurs s’activent chacun à leur rythme. Certains s’échauffent encore. Assouplissements : bien étirer les muscles, les avertir des efforts à venir ; d’autres travaillent leur ceinture abdominale : corvée des corvées, grimaces et gémissements pour accompagner ; d’autres encore travaillent au sac, se défoulant sur cet adversaire manchot et placide, ce rival inoffensif mais invincible.
Au centre de la salle, sur le ring, deux jeunes gantés et casqués se donnent la réplique sous l’œil vigilant d’Émile.
— Du calme, les garçons, de la maîtrise. On n’appuie pas les coups ce soir, on touche seulement.
Émile possède une autorité naturelle, un mélange de confiance, d’expérience et de générosité qui force le respect. Il n’élève jamais la voix. Les jeunes rouspètent souvent, écoutent toujours.
— Je vous demande juste de la rapidité et de la technique. Le punch viendra après. À quoi ça sert de savoir frapper fort si vous ne touchez pas.
Le Vieux ressemble à un père de famille veillant sur sa progéniture. Un père qui n’aurait eu que des fils. Ici, tout le monde se ressemble. Une dent cassée, un nez large et de guingois, des pommettes saillantes, des arcades gonflées : notre air de famille, on se l’est taillé nous-même, à grands coups de poings dans la gueule.
Émile dirige la salle – sa salle – depuis vingt ans. Modeste boxeur dans sa jeunesse, il a abandonné la compétition passée la trentaine pour s’improviser restaurateur dans le Berry. Située en bordure d’une nationale, sa gargote tournait à plein régime quand ces Messieurs de l’Équipement ont décidé de faire passer l’autoroute juste au bout de son jardin. Les clients ont déserté l’établissement et la bicoque s’est révélée invendable. Émile a heureusement fini par dénicher des locataires : un couple de Bretons à qui le bruit de la circulation rappelait vaguement celui de la mer à marée haute.
Grâce à ses économies, Émile s’est offert, dans le 20e arrondissement de Paris, une petite salle de gym qu’il a transformée en salle de boxe. Il s’est mis en cheville avec les services sociaux de la ville et vivote depuis en tant qu’éducateur sportif. On lui confie les « p’tits durs » en difficulté d’insertion.
C’est ainsi que je l’avais rencontré. J’avais treize ans.
Les meilleurs éléments, Émile les inscrit dans son club et les pousse vers la compétition. Il remplit ainsi le seul rôle que ses moyens financiers lui permettent : découvrir et former des champions. Mais dès qu’ils remportent leurs premiers succès, ses poulains l’abandonnent pour aller courir leur chance dans de plus riches écuries. Émile les laisse partir. Tel un père regardant ses fils quitter le nid. Avec un peu de tristesse et beaucoup de fierté.
Moi, j’étais resté.
— Allez plus vite, crie Émile aux deux gars qui s’échinent sur le ring. Il reste moins d’une minute… On accélère et on continue de retenir ses coups. Attention, Bobby, tu baisses trop ta garde, là.
Je croise le regard d’Émile. Il me sourit mais j’ai eu le temps de percevoir de la surprise. Comme une déception également.
Une sonnerie retentit : trente secondes de récré pour tout le monde. Un silence relatif s’installe, on n’entend plus que les mouches voler et les boxeurs tenter de retrouver une respiration normale. Émile dénoue les gants et les casques des deux boxeurs.
— C’est bien, Bobby, très bien, mais t’as toujours un problème de placement. Résultat : tu t’es fait coincer plusieurs fois dans les coins. En compétition, c’est dangereux, ça.
Ayant libéré le premier boxeur, l’entraîneur s’attaque au second. Un petit beur, sec et nerveux.
— Toi, Kamel, tu ne progresses plus. Bobby s’est montré souvent plus rapide. Tu ne t’en es sorti qu’en trichant.
— Moi j’ai triché ? s’indigne Kamel.
— Tatata, fais pas ton malin avec moi, s’il te plaît. Chaque fois que Bobby a réussi un enchaînement, tu t’es mis à appuyer tes coups pour lui faire peur. C’était pas les règles que j’avais fixées, ça.
Kamel baisse la tête et n’insiste pas. Il devine la sanction. Elle tombe.
— Tu feras vingt minutes de corde. Exécution.
La sonnerie donne le signal. Les trente secondes de pause sont terminées. C’est reparti pour trois minutes. Émile descend du ring et vient me faire la bise.
— Déjà de retour, constate-t-il. Tu te languissais de nous ?
— Un peu, ouais.
— Comment tu t’sens ?
— Ça va. Un peu mal au crâne par moments.
— T’es allé voir le médecin ?
— Penses-tu… Je vais aussi bien que possible.
Un silence s’installe entre nous, meublé seulement par les bruits de la salle. Trois jours sans venir à la salle, je n’y tenais plus. Et puis je crois qu’entre Émile et moi, il faut crever l’abcès. Le Vieux reluque mon survêtement et mes baskets.
— Rassure-moi, t’as pas l’intention de reprendre dès maintenant ?
— Non, j’suis pas fou quand même. Mais qu’est-ce que tu veux, depuis le temps, j’ai pris goût à la tenue : y’a que comme ça que j’me sens à l’aise.