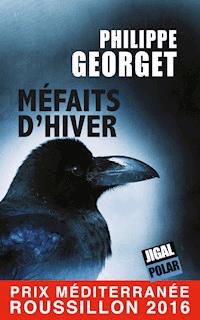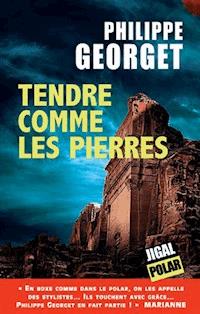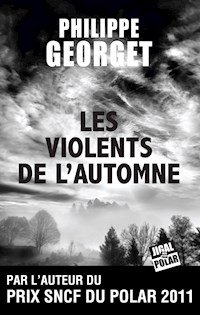
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Jigal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lieutenant Sebag
- Sprache: Französisch
Le lieutenant Sebag mène une nouvelle enquête qui le pousse à faire ressurgir le passé d'une époque bien précise, celle de la guerre d'Algérie !
À Perpignan, l’automne est une saison tumultueuse. Le vent violent le dispute à la pluie diluvienne. Un temps à ne pas mettre un flic dehors. Pourtant un retraité pied-noir est retrouvé dans son appartement, assassiné d’une balle dans la tête… Le sigle OAS laissé près du cadavre, la destruction quelques jours plus tard d’une stèle controversée et la découverte d’un autre ancien Français d’Algérie abattu au volant de sa voiture sèment la panique dans la communauté.
Le lieutenant Sebag, qui a par ailleurs promis à sa fille de faire toute la lumière sur l’accident mortel survenu à un de ses amis, est officiellement chargé de l’enquête. Flic réputé et intuitif, il va, en traquant le tueur avec son équipe, faire ressurgir du passé un mystérieux commando ayant sévi, il y a bien longtemps, du côté d’Alger. C’est dans ce contexte que les derniers mois de poudre et de sang de la guerre d’Algérie, ses horreurs, ses espoirs, ses trahisons et ses errances vont remonter à la surface jusqu’à la nausée…
Cinquante ans plus tard, il est temps de régler l’addition…
Découvrez sans attendre le troisième roman de Philippe Georget, l'auteur de L'été tous les chats s'ennuient, prix SNCF du Polar 2011 !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"En boxe comme dans le polar, on les appelle des stylistes… Ils touchent avec grâce… Philippe Georget en fait partie !" - Olivier Maison, Marianne
"Une écriture maîtrisée, fluide, des dialogues franchement captivants. Beaucoup de valeurs sur la nature humaine… On n'en ressort pas indemne." - Pascal K., Passion Romans
"C'est une version intime de la guerre d'Algérie, une vision de l'intérieur, en passant la parole à ceux qui ont vécu dans leur chair la douleur de l'abandon et côtoyé les violences." - Dominique Baillon-Lalande, Encres Vagabondes
"J'aime quand l'intrigue d'un polar trouve ses racines dans l'Histoire. J'aime quand le travail des enquêteurs est un peu laborieux: [...] J'aime quand il y a des tensions dans l'équipe et une évolution des personnages. J'aime quand le style de l'auteur est fluide et agréable à lire. J'aime Les violents de l'automne pour toutes ces raisons." - Gridou, les Gridouillis
À PROPOS DE L'AUTEUR
Philippe Georget est né en 1963 en région parisienne. Après des études d'Histoire, il participe à une mission humanitaire au Nicaragua. Il voyage ensuite en Irlande du Nord, puis se rend à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. En 2001, il embarque sa femme et leurs trois enfants dans son camping-car et fait le tour de la Méditerranée en passant par l'Italie, la Grèce, la Jordanie, la Libye. Il opte ensuite pour le journalisme et poursuit sa carrière à France 3 comme journaliste-rédacteur, présentateur et caméraman (ce qui a sans doute influencé son écriture si originale ?). Il est également investi dans le sport, la course et la boxe entre autres.
Il est l'auteur de quatre romans, L'été tous les chats s'ennuient (Jigal, 2009), prix du Premier Roman policier et prix SNCF du polar, Le Paradoxe du cerf-volant (Jigal, 2011), Les Violents de l'automne (Jigal 2012) et Tendre comme les pierres (Jigal, 2014).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avertissement
« Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait totalement fortuite et involontaire. Cette mention traditionnelle souffre, dans ce livre, d’une seule exception : le lieutenant Degueldre, déserteur de l’armée française, membre actif de l’OAS, fusillé en 1962. Je me suis permis de lui prêter certaines paroles mais concernant les actes accomplis, je n’ai malheureusement rien inventé.
En revanche, toute ressemblance avec des lieux et des paysages du pays catalan est non seulement assumée mais revendiquée. »
CHAPITRE 1
Son vieux pouce noueux déformé par les rhumatismes lui envoya une violente décharge électrique lorsqu’il tira sur le chien de son arme. Avec sa main libre, il rajusta ses lunettes sur son nez. En face de lui, la cible roulait des yeux effrayés.
Sa main boursouflée se referma sur la culasse.
Il avait eu raison de s’attaquer au maillon faible du groupe. La peur rendait bavard. Il savait tout, maintenant. Les salopards allaient payer. Les uns après les autres.
Il posa avec peine son index tordu sur la détente.
La cible s’agitait désespérément sur sa chaise malgré les menottes qui lui maintenaient les bras derrière le dossier. Elle aurait voulu crier, hurler ou pleurer mais le bâillon qui déchirait sa bouche ne lui autorisait qu’une émission pénible de borborygmes inutiles.
Il ne comprenait pas cette vaine agitation. Quand l’heure était venue, il fallait savoir se résigner. Il y avait deux hommes dans cet appartement fermé à clé. L’un était attaché, l’autre tenait un Beretta 34. Il n’y aurait pas d’échappatoire, pas de fin heureuse, pas de rebondissement de dernière minute. On n’était pas au cinéma mais dans la vie. La vraie, la dure, l’impitoyable.
El-Mektoub… Le destin allait frapper.
Il trouvait le vieux, en face de lui, pathétique et laid. La peur déformait ses traits encore plus sûrement que les ans. Il peinait à le reconnaître.
Les souvenirs affluaient comme des vagues. Autrefois, c’était hier. Les années pouvaient être des passerelles, des murs ou simplement des parenthèses. Il n’avait rien oublié. Rien. La brûlure aveuglante du soleil sur la peau et dans les yeux au sortir d’une ruelle encore fraîche. Le bleu, du bleu partout, la mer et le ciel. Le bruit des vagues, le souffle des bateaux, les parfums mêlés d’anis, d’iode et d’épices. Des éclats de voix, les rires de l’insouciance, une joie de vivre sans pareille.
Il ne devait pas se laisser envahir par la nostalgie. Il le savait. Elle était plus forte que lui. Il avait réussi à l’oublier pendant plusieurs décennies avant qu’elle ne revienne s’emparer de son cœur et de son esprit. Il s’efforça de penser aux derniers mois de sa jeunesse, le paradis se changeant en enfer, le bruit des casseroles, les cris, les larmes et le sang. Et une odeur de poudre par-dessus tout, une odeur entêtante, enivrante, violente et sauvage.
Il grimaça. Sa main malade crispée sur l’arme le faisait souffrir.
L’homme qu’il avait en face lui renvoyait un reflet. Luimême était vieux et laid. Et tant mieux si sa Gabriella lui jurait le contraire.
Il était vieux et il avait mal.
Une polyarthrite rhumatoïde sévère avait déposé sur ses articulations un calcaire douloureux. Elle avait d’abord déformé ses doigts, imposant à leurs dernières phalanges des angles improbables. Puis elle avait cloqué ses mains. Des bosses avaient surgi ici et là au fil des ans et des nuits d’insomnie. Il sourit en songeant à Gabriella qui aimait faire glisser ses doigts de fée sur ses gibbosités.
Gibbosité… d’où lui remontait donc ce vocabulaire désuet ? Son français s’était figé au début des années soixante. Depuis, il ne parlait plus sa langue maternelle.
Son prisonnier, sur sa chaise, semblait s’être calmé. Résigné ? Peut-être… Ou alors il avait pris son sourire fugace pour une possible clémence. L’espoir est un phénix indomptable, il peut renaître d’un signe ou d’un souffle. Il peut mourir aussi dans un regard.
Leurs yeux se croisèrent et se fixèrent quelques secondes avant de partir d’un même mouvement vers les trois lettres écrites à la peinture noire sur la porte du salon.
Trois lettres maudites.
Trois lettres magiques.
Il n’y aurait pas de pardon. Impossible. Il n’avait pas réveillé en vain les chagrins, il n’avait pas fait tant de chemin, traversé la mer, pour reculer maintenant. Il irait jusqu’au bout de la mission qu’il s’était assignée.
La dernière.
Sa langue claqua dans sa bouche desséchée. Il avait soif. Il se leva lentement. Ses os craquèrent. Il s’efforça de retenir un soupir. La maladie s’était répandue de ses mains à son corps tout entier. Certains jours, vivre – simplement vivre – devenait une souffrance. Il pensait alors à sa grand-mère : elle aussi avait souffert le martyre. « Le jour où je n’aurai plus mal, lui disait-elle souvent, c’est que je serai morte. »
Il prit un verre propre sur la paillasse de l’évier et fit couler de l’eau au robinet. Il but quelques gorgées avant de reposer le verre. En revenant vers le vieil homme attaché à sa chaise, il s’empara de l’oreiller qu’il avait posé sur la table. Il l’avait pris tout à l’heure dans la chambre de sa cible.
Sa victime, bientôt.
Il retrouvait des sensations étranges et oubliées. Ce calme surprenant dans l’action, l’impression de ne plus habiter son corps, ce sentiment curieux de n’être que le témoin de ses actes.
Le son de la télévision des voisins traversait la cloison. On devinait les rires préfabriqués d’une série américaine. Il eut envie d’allumer également l’écran du salon pour couvrir le bruit de la détonation à venir mais il renonça très vite devant la complexité de la télécommande.
La cible ouvrait grand ses yeux chassieux. On y lisait comme dans un livre le désespoir et la peur. Mais le vieux tueur ne voyait plus rien, il n’entendait plus les gémissements, il était ailleurs. Là-bas. Cinquante ans plus tôt.
— C’est l’heure, fit-il.
Puis il contourna la chaise et appuya l’oreiller sur la nuque de son prisonnier. Il posa le Beretta sur la toile usée. Son index déformé caressa la détente. Il compta jusqu’à trois avant d’appuyer. L’onde de choc transmise par ses os gangrenés le fit crier de douleur.
CHAPITRE 2
Après plusieurs jours de colère, la tramontane venait de s’apaiser. Elle avait nettoyé le ciel de ses derniers nuages et un soleil d’automne encore vif séchait les flaques d’eau sur le goudron ainsi que les larmes sur les visages.
C’était une belle matinée pour enterrer un enfant.
La foule en noir se massait autour de la petite église de Passa. Une centaine de personnes n’avaient pu trouver place à l’intérieur et suivaient la cérémonie debout sur la place du village. Arrivé parmi les premiers, Gilles Sebag avait tenu à rester dehors. Dans l’église, le désespoir était trop fort, la peine trop intime.
Appuyé contre le mur d’une maison, il serra sa fille contre lui. Il sentit le jeune corps secoué par les sanglots. Il aurait aimé pouvoir l’aider davantage, prendre sur lui son tourment et préserver ainsi son insouciance. Son innocence. Mais Séverine avait treize ans et elle venait brutalement de comprendre que la mort était définitive. La vie ne ressemblait pas à un jeu vidéo. Après le « game over », on n’avait pas le droit de rejouer : Mathieu ne pourrait jamais recommencer sa partie.
La main de Claire caressait doucement les cheveux de Séverine. Gilles se tourna vers sa femme et lui sourit. C’était bon de la sentir à ses côtés, il avait eu si peur de la perdre, l’été dernier. Mais il chassa rapidement ces mauvais souvenirs, ce n’était vraiment pas le moment de repenser à tout ça. Claire répondit à son sourire. L’éclat de ses yeux verts se mouillait de tristesse.
De la foule compacte, la peine giclait çà et là par bouffées déchirantes. Pleurs, cris et gémissements composaient un chant funèbre que les adolescents entonnaient en canon. Certains de ces gamins avaient sans doute déjà côtoyé la mort : celle d’un grand-parent probablement. Ils avaient eu de la peine, ils avaient sincèrement pleuré, mais cette disparition-là ne les avait pas touchés au plus profond de leur être. La mort de leur copain de classe, en revanche, était aussi la leur. À la douleur se mêlait une sourde angoisse.
Pour ne pas se laisser submerger par la peine des enfants, Sebag se força à examiner les bâtiments autour de lui. L’église de Passa n’avait malheureusement aucun charme particulier. Sa façade, recouverte d’un enduit couleur béton, se décorait simplement d’un porche en marbre auquel conduisait une volée de marches en demi-cercle. L’église était emprisonnée dans une rangée de maisons de village sans attrait. Sur la gauche toutefois, le bureau de poste, avec son assemblage de briques et de galets typique du Roussillon, attirait l’œil mais sans le séduire tout à fait.
Les volets de l’agence étaient clos, la poste avait fermé ce samedi matin pour cause d’enterrement.
Mathieu était mort trois jours auparavant dans un accident de scooter. Une rue de Perpignan, une camionnette qui fait une soudaine embardée et Mathieu arrivant en sens inverse qui ne peut l’éviter. Le choc avait été violent mais le gamin s’était dans un premier temps relevé sans bobo apparent. Il avait puparler avec le chauffeur de la camionnette et d’un commun accord, ils avaient décidé d’appeler quand même les secours. Au cas, où. Avant l’arrivée du SAMU toutefois, Mathieu s’était brutalement effondré. Hémorragie interne. Tout était allé si vite. Les médecins n’avaient rien pu faire pour le sauver.
Mathieu… Un copain de Séverine. Élève de quatrième du collège de Saint-Estève. Un sportif, un rugbyman. Un gamin qui croyait que la vie lui souriait.
Putain de scooter !
La camionnette noire des pompes funèbres se fraya, en marche arrière, un chemin à travers la foule. La messe s’achevait. Les employés ouvrirent les portes du corbillard et commencèrent à ranger dans le véhicule les couronnes de fleurs. Un long cortège se forma sur la place pour aller saluer dans l’église les parents de Mathieu. Séverine se détacha de ses parents pour rejoindre un groupe de copines. Sebag fit un pas pour la suivre mais Claire l’arrêta. Séverine se retourna au même instant et lui confirma d’un regard qu’elle préférait y aller seule. Enfin… avec ses copines. Sans lui, quoi !
Sebag eut un pincement au cœur et s’en voulut aussitôt. Il souffrait de voir sa fille grandir trop vite mais de cela non plus, ce n’était ni le lieu ni le moment de se plaindre. Séverine était en vie. Rien d’autre ne pouvait compter. Les parents de Mathieu, eux, n’auraient jamais cette chance de voir leur fils devenir adulte.
Une cloche se mit à sonner. Un coup triste suivit d’un long écho plaintif. Les gens levèrent la tête. L’église de Passa se terminait par une tour carrée dotée de deux cloches au sommet. La plus petite des deux se balançait doucement. Son tintement s’envolait au-dessus du village pour porter ses lamentations très loin vers les collines striées de vignes.
L’église se vida lentement. Un frisson parcourut la foule quand sortirent les parents. Le père, droit comme un i, suivait le cercueil de son fils, la tête dodelinant sans contrôle, absent du monde tel un boxeur groggy. À ses côtés, la mère avançait péniblement, soutenue par une jeune fille. Sebag reconnut la grande sœur. Il l’avait aperçue deux ou trois fois ces dernières années lorsqu’il avait accompagné sa fille aux anniversaires de Mathieu. Séverine sortit à son tour au sein d’une grappe d’adolescents, garçons et filles se soutenant mutuellement. Son rimmel avait coulé et traçait un sillon pour les larmes sur ses joues rebondies.
Le cercueil fut installé dans le corbillard et le cortège s’ébranla en direction du cimetière. Le chant funèbre des sanglots adolescents se fit chœur. Claire prit la main de son mari et ils marchèrent trois rangs derrière leur fille. Gilles peinait à contenir son émotion et se mordit la lèvre jusqu’au sang. Il devait tenir et se montrer solide. Pour Séverine, pour ses copains et pour les autres aussi.
C’est vrai qu’il en avait vu d’autres dans son métier. Combien de fois avait-il annoncé brutalement à quelqu’un le décès d’un proche ? Un parent, une femme, un mari… un enfant. Il s’était longtemps reproché de ne pas savoir dire les mots qu’il faut pour atténuer la peine. Jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il ne les trouverait jamais. Parce que ces mots n’existaient pas. Tout simplement.
Le corbillard s’arrêta à la porte du cimetière. Les employés des pompes funèbres sortirent le cercueil, puis, suivis par la foule, ils le portèrent le long d’une rangée de caveaux. Gilles s’adossa au mur du cimetière et alluma une cigarette. Il ne fumait que rarement. Il avait acheté un paquet sur la route le matin même. Claire s’empara de sa cigarette, en tira une bouffée et lui rendit.
— Ça va ? lui demanda-t-il. Elle haussa les épaules.
— Et toi ?
— Pareil.
Il lui tendit de nouveau sa cigarette. En face du cimetière, les ouvriers d’un chantier fumaient eux aussi. Ils avaient cessé le travail au passage du cortège et attendaient la fin de la cérémonie pour reprendre le ballet des engins de terrassement. Avec les allées qu’ils avaient déjà tracées, on devinait les prémices ici d’un nouveau lotissement. Un de plus. Cinq mille habitants supplémentaires débarquaient chaque année dans les Pyrénées-Orientales : il fallait bien les loger.
Sebag aperçut Séverine qui revenait vers eux, accompagnée de deux amies. Les gamines se tenaient par la taille et leur démarche s’en trouvait chaloupée. Les vêtements de deuil les affinaient et les faisaient paraître plus âgées. De vraies petites femmes, se dit Sebag. Et puis, non ! Réflexion faite, les vêtements n’y étaient pour rien. C’était le deuil lui-même qui les avait mûries.
Quand elles furent devant lui, son cœur se serra à la vue de leurs yeux gonflés. Elles avaient le regard aussi halluciné que si elles avaient fumé un plant entier de cannabis. Là, c’est franchement con comme réflexion, s’engueula-t-il : il fallait être flic pour penser de telles choses dans un moment pareil.
— Papa, j’ai quelque chose d’important à te demander, fit Séverine.
Son visage entier semblait une prière.
— La sœur de Mathieu dit que tout n’est pas clair dans l’accident de son frère et que le chauffeur de la camionnette ne serait pas le seul responsable… Apparemment, les policiers jugent que l’affaire est close et ne veulent pas enquêter plus loin.
Sebag attendit la suite mais il avait déjà deviné.
— Je lui ai dit que toi tu pourrais essayer…
Un clignement des yeux fut sa première réponse. On était samedi, il reprenait le travail dans deux jours après une semaine de vacances, et selon ce qu’il savait par son collègue Molina, le calme régnait au commissariat : il aurait sans doute le temps de jeter un coup d’œil au dossier.
— Je verrai ce que je peux faire, promit-il.
Séverine lui sourit à travers sa tristesse et ajouta de sa douce voix de flûte :
— Je lui ai dit que s’il y avait quelque chose à trouver, tu le trouverais.
Sebag ressentit malgré la peine un bonheur profond. Le deuil, finalement, n’avait pas complètement métamorphosé sa fille : elle était bien encore une gamine de treize ans, une enfant qui voyait toujours en son père un faiseur de miracle…
— Je lui ai dit aussi que tu étais le meilleur policier de Perpignan, j’ai eu raison ?
Il acquiesça d’un mouvement de tête qui se voulait confiant puis déposa un bisou sur la joue fraîche et humide.
CHAPITRE 3
— Bonjour, lieutenant ! Vous avez passé de bonnes vacances ?
Gilles Sebag se retourna, avant de réaliser que la question s’adressait bien à lui. Lieutenant… Cela faisait plus de quinze ans déjà qu’un gouvernement avait prétendu moderniser la police rien qu’en américanisant les grades mais il avait encore du mal à s’y habituer. D’ailleurs, il était sûr maintenant qu’il ne s’y ferait jamais, les termes de « lieutenant » ou de « capitaine » auraient toujours pour lui le parfum exotique et crétin d’un feuilleton américain. « Lieutenant Colombo » ou « Lieutenant Horatio Caine », oui, ça, ça pouvait avoir de la gueule, mais « Lieutenant Sebag », quelle blague ! Il trouvait cela aussi ridicule que d’associer un prénom anglo-saxon à un patronyme bien de chez nous. Les hommes politiques se révélaient parfois aussi stupides que les Français moyens. Certains trouvaient cela rassurant. Pas lui.
Il se rendit enfin compte que Martine, la jeune fliquette chargée de l’accueil au commissariat de Perpignan, attendait une réponse.
— Les vacances se passent toujours bien. C’est quand elles sont passées que ça se complique.
Martine eut la gentillesse de sourire.
— Bonne journée et surtout bon courage, alors.
— Il en faudra…
— On dirait que vous allez à l’abattoir !
Sebag se contenta de lui adresser une risette polie. Il passa son badge devant le lecteur électronique. La porte de sécurité s’ouvrit et il entra dans la partie du commissariat interdite au public. Il y retrouva sans plaisir une odeur qui lui était familière, un mélange d’eau de javel et de sueur, de café froid et de rires gras. Il grimpa les marches de l’escalier quatre à quatre, non par impatience d’arriver à son bureau, mais parce qu’en bon marathonien, il ne négligeait aucun effort susceptible de participer à son entraînement.
Parvenu au deuxième étage, il retarda encore l’échéance en faisant une halte à la fontaine à eau installée au milieu du couloir. Il se servit un verre et le but avec lenteur. Depuis quelques années, son travail lui était devenu pénible. La routine, la violence, le manque de reconnaissance en interne et le mépris des citoyens. Il fallait encaisser tout cela et pour quel résultat ? En s’engageant dans la police, il s’était imaginé médecin d’une société malade. Il avait mis du temps à comprendre qu’il n’était qu’un petit infirmier condamné à panser des plaies purulentes avec des pommades aux dates de péremption dépassées. La criminalité ne cesserait jamais, elle ne pouvait cesser, elle était dans la nature de l’homme. Tout juste pouvaiton espérer faire baisser un peu la fièvre. Mais on n’avait pas encore réussi à inventer un thermomètre fiable.
Il but un second verre en s’appliquant à penser à Séverine et aux parents de Mathieu. Il ne changerait à lui seul ni la police, ni la société mais il pouvait tout de même apporter un peu de réconfort à quelques personnes. Il suffisait de se fixer des objectifs modestes et se remuer un peu les fesses. Il écrasa son gobelet et le jeta dans la poubelle. Puis il se dirigea d’un pas énergique vers son bureau.
Il en poussa la porte. À sa grande surprise, son collègue, Jacques Molina, était déjà arrivé.
— Tiens, t’es tombé du lit aujourd’hui, lui fit Sebag en posant son blouson sur le dossier de la chaise.
— On dit bonjour quand on est poli ! répliqua Molina.
— Bonjour- quand-on-est-poli.
— Toi, t’as pas la grande forme. La fin des vacances pour toi, c’est comme une gueule de bois…
— Un peu, oui. Je m’attendais à ce que ce soit difficile mais là, je crois que c’est pire.
— Heureusement que tu n’es parti qu’une semaine… Je t’offre un café ?
Sebag ne put réprimer un frisson de dégoût. Il était amateur de café, de vrai, pas de cette espèce de jus sombre que prodiguait pour quarante centimes le distributeur de la cafétéria du commissariat.
— Merci, non. La reprise est déjà une torture : je ne veux pas y ajouter un empoisonnement.
— Comme tu voudras.
Molina se leva de son fauteuil.
— Moi j’y vais, j’en ai besoin.
— On a rendez-vous avec le chef, ce matin ?
Chaque lundi, le commissaire Castello tenait une réunion générale pour faire le point des affaires en cours.
— Non, il a annulé. Je crois que ces réunions du lundi, ça l’emmerde autant que nous quand la mer est calme.
Molina quitta la pièce tandis que Sebag allumait son ordinateur. L’engin se réveilla lentement en émettant un son qui tenait davantage du chemin de fer des années trente que de l’informatique du troisième millénaire. Sebag retira du premier tiroir de son bureau trois photos qui égayaient son univers professionnel. Il posa tour à tour : le visage ensoleillé de Claire sur un fond bleu de piscine, le sourire de Séverine soufflant les treize bougies de son anniversaire et enfin la fierté de Léo, le fiston, chevauchant son scooter rutilant. Gilles ressentit un creux à l’estomac en repensant à l’accident de Mathieu. Pas Léo, non jamais, pas Léo… Il s’en voulait de n’avoir pas su résister au travail de sape de sa femme et de son fils. Il avait fini par dire oui et Léo circulait depuis un an sur cet engin de mort.
L’ordinateur acheva son réveil. Sebag renonça à ouvrir sa messagerie. Une semaine de vacances… Il y aurait trop de mails, des notes de service, des copies de procès-verbaux, des tracts syndicaux, des publicités et peut-être quelques messages personnels. Il savait que s’il plongeait dedans en se disant « cinq minutes seulement », il ne relèverait pas la tête avant une bonne demi-heure. Il alla donc directement à la banque de données du commissariat. Un mot de passe, un clic sur la rubrique accident, et il trouva sans difficulté le dossier de Mathieu. Il chercha la signature à la fin du document. Lieutenant Cardona. Le chef de la section himself. Un flic bourru et pas toujours très consciencieux. C’était à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Car s’il pouvait espérer découvrir des éléments qui auraient échappé à son collègue, Sebag savait aussi qu’il allait au-devant d’un certain nombre d’emmerdements. Tant pis. Pour Séverine, il était prêt à tout.
Il commençait la lecture du procès-verbal quand Molina poussa brusquement la porte du bureau.
— Arrête de jouer sur l’ordi et mets ton blouson, lui jeta-til essoufflé. On a du taf.
Sebag leva les yeux. Molina se dirigeait vers son propre bureau.
— Un cadavre, dans un appartement du Moulin-à-Vent, place de Montbolo. Découvert ce matin par une voisine.
Il s’empara d’un flacon de parfum et s’offrit une longue giclée sous sa chemise.
— Le type est mort depuis au moins trois jours. C’est l’odeur qui a donné l’alerte.
Sebag prit une boîte de mouchoirs en papier, il en sortit deux sur lesquels il versa quelques gouttes d’huile essentielle de lavande.
— Je suis paré, fit-il tout en lançant l’impression du dossier de Mathieu. Mort naturelle, suicide ou homicide, on a une idée ?
— D’après les pompiers, y’a de la cervelle partout sur les murs et la victime a une plaie bien nette à l’arrière du crâne.
Sebag se leva.
— Je vois. Il y a plus naturelle, comme mort, effectivement. Quant au suicide, à moins d’être contorsionniste…
— D’autant que la victime, un certain Bernard Martinez, était menottée sur une chaise.
— OK, ça réduit encore les hypothèses.
L’imprimante se mit à cracher les premières pages. Sebag enfila son blouson en se disant qu’il n’aurait probablement pas de temps à consacrer aujourd’hui à l’accident de Mathieu et qu’il devrait ramener le dossier à la maison pour le potasser ce soir après le dîner. Joli programme pour une journée de reprise.
— L’odeur est insupportable.
Le visage de Thierry Lambert, jeune flic au commissariat de Perpignan, s’affichait aussi blanc qu’une cuvette de chiotte dans un hôtel de luxe.
— Et pourtant, tu la supportes, répliqua Molina. C’est le métier qui rentre.
Sebag et Molina avaient rejoint Lambert dans l’appartement de la place Montbolo. Les trois flics patientaient dans le couloir, observant à distance les agents de la police scientifique qui, revêtus de leurs combinaisons intégrales, s’affairaient au salon autour du cadavre. Sebag agita devant lui son mouchoir parfumé et parvint à faire reculer quelques instants les relents âpres et sucrés de la mort. Arrivé le premier sur les lieux, Lambert avait pu observer rapidement la scène.
— C’est un homme plutôt âgé, je dirais, au moins soixante-dix ans. Mais il lui manque une partie du visage. La balle a fait du dégât en ressortant.
— Un crime crapuleux sans doute, hasarda Molina. Des cambrioleurs qui auront voulu faire avouer au vieux où il cachait ses économies…
— Mais pourquoi l’avoir tué ? demanda Lambert.
— Parce qu’il aura refusé de parler ou parce qu’il aurait pu les reconnaître.
— Tu crois ? s’indigna le jeune flic. Les salauds ! J’espère qu’on pourra les coffrer facilement.
Sebag écoutait distraitement en contemplant le couloir sombre. Un papier peint défraîchi, des photos noir et blanc, une moquette mauve usée et un guéridon doré sur lequel était posé un téléphone. Outre celle ouverte sur le salon, le couloir desservait trois autres portes
— Qu’est-ce que tu en penses toi ? le questionna Lambert.
— Moi ? Pour l’instant, rien. Je n’ai rien vu alors je ne pense rien.
Il s’approcha des photos. Elles représentaient toutes la même ville, une cité blanche au bord de la mer.
— Toujours aussi prudent, lui reprocha Molina. Tu ne te mouilles pas.
Sebag haussa les épaules.
— J’évite d’avoir des idées préconçues en arrivant sur une scène de crime. Autant d’idées, autant d’œillères. Un flic doit se méfier de son imagination.
— T’as bien noté, Thierry ? plaisanta Molina. C’était la leçon numéro un du lieutenant Sebag.
Gilles agita de nouveau son bouquet de lavande en papier.
— Leçon numéro deux : un bon flic est une éponge. Il doit s’imprégner de son environnement.
Il joignit ses mains au niveau de son ventre avant de les monter à hauteur de poitrine. Puis il écarta lentement les bras pour décrire un arc de cercle.
— On se tait, on observe, on écoute, on regarde, on respire. Tranquillou. Et on note tout. Ça servira plus tard.
D’un geste, il stoppa Lambert qui s’apprêtait déjà à suivre ses recommandations à la lettre.
— Quand je dis « on respire » c’est une façon de parler. Vas-y mollo quand même aujourd’hui. Je ne tiens pas à récupérer ton petit déj sur ma chemisette.
Pendant que Molina s’esclaffait, Sebag ouvrit les autres portes : une chambre à coucher, un WC et une salle de bains. Il repéra deux brosses à dents sur la tablette accrochée au-dessus du lavabo. Il se tourna vers Lambert :
— Je croyais qu’il vivait seul, M. Martinez.
— C’est ce que m’a dit la voisine lorsque je suis arrivé.
— Tu ne voudrais pas retourner la voir dès maintenant et recueillir son témoignage, qu’on en sache un peu plus sur la victime ? Et puis, tu peux interroger aussi les autres voisins. Quand on est arrivés, il y avait au moins une dizaine de curieux sur le palier, autant en profiter.
— OK, pas de problème.
Ravi d’échapper au calvaire olfactif, Lambert avait déjà la main sur la poignée de la porte d’entrée quand il se figea.
— Ah, au fait, je ne vous ai pas dit : y’avait un mot sur la porte.
— Quelle porte ? questionna Sebag.
— La porte du salon.
— Celle-ci ? fit Sebag en désignant la porte ouverte.
— Oui… enfin de l’autre côté, sinon tu le verrais.
— Et qu’est-ce qu’il y avait sur ce mot ?
— Je ne sais pas.
— Tu ne l’as pas lu ?
— Ben si, quand même… Y’avait que trois lettres. Mais j’ai rien compris : ça ne devait pas être du français.
Sebag n’était pas sûr de comprendre.
— Un mot de trois lettres… écrit sur une feuille accrochée à la porte ?
— Non, écrit sur la porte elle-même, en gros et à la peinture noire.
— À la peinture ? C’était quoi ce mot ?
— Je ne sais pas, je te dis, c’était pas en français…
— Mais trois lettres, tu peux t’en souvenir quand même !
— Hou là, j’ai pas fait attention. Ça commençait par un O, je crois.
Sebag entendait Molina pouffer derrière lui.
— C’est grave ? s’inquiéta Lambert.
— Pour l’enquête, non, on pourra voir ça tout à l’heure, mais pour toi, oui : ne pas réussir à mémoriser un mot de trois lettres…
— Moi, j’en connais un que tu pourras retenir facilement, intervint Molina. Y’a un O aussi dedans, mais plutôt au milieu.
— Ça va, j’ai compris. Je ne suis pas si…
Lambert s’interrompit brusquement, dévisagea ses collègues hilares et sortit en claqua la porte.
— Je crois que tu nous l’as fâché, constata Sebag.
— Ça aussi, c’est le métier qui rentre. Le problème, c’est qu’avec lui, il ressort aussitôt.
Molina consulta sa montre et grogna.
— Ça fait plus d’une heure qu’ils sont dans ce salon. J’ai l’impression que c’est plus long à chaque fois leurs conneries : tout ça pour mettre des poils de cul dans des éprouvettes…
— Belle conception de notre métier : c’est toujours sympa de se sentir apprécié !
Revêtu de sa classique combinaison blanche, Jean Pagès, le responsable de la police scientifique de Perpignan, avait surgi dans le couloir. Il regardait Molina avec un mépris non dissimulé. Sebag tenta de désamorcer le conflit naissant.
— Tu connais Jacques, il est de la vieille école.
— Oui, je sais, maugréa Pagès, celle des interrogatoires musclés et des erreurs judiciaires.
— Un bon coup d’annuaire sur le crâne apporte souvent plus de preuves que vos prélèvements ADN, répliqua aussitôt Molina qui affectionnait le rôle du flic obtus.
Sebag coupa court :
— Vous avez fini, on peut entrer ?
— Oui, c’est bon. Nous, on va bosser maintenant dans les autres pièces. J’espère que vous n’avez pas mis le souk partout.
— J’ai jeté un coup d’œil sans entrer, répondit Sebag.
— Si le pithécanthrope, lui, est resté sagement dans le couloir, ça me va.
Sebag poussa Molina dans le salon avant qu’il ne réplique. L’odeur de charogne s’épaissit davantage. Indifférente, Elsa Moulin, l’adjointe de Pagès, avait rangé son matériel et commençait à prendre des photos.
— Tu sais que t’es belle, toi, habillée comme ça, lança Molina en caressant la charlotte qui dissimulait la chevelure de la jeune femme. Cette tenue m’excite de plus en plus. Il faudra que tu m’invites un soir à dîner chez toi ou que tu me la prêtes pour une de mes amies…
Elsa Moulin abaissa son masque sur son menton et lui tira la langue avant de répondre :
— Je te la prête quand tu veux !
Le salon faisait une trentaine de mètres carrés séparé de la cuisine par un bar. Une porte-fenêtre donnait sur un balcon ensoleillé. Au milieu de la pièce trônait une table recouverte d’une toile cirée à petits carreaux blancs et rouges. Quatre chaises complétaient l’ameublement, deux étaient encore sagement rangées le long de la table, la troisième portait le corps, la dernière lui faisait face. Il n’était pas difficile de deviner que l’assassin s’était assis là pour contempler sa victime. Ou pour discuter avec elle.
— Tu peux nous résumer en deux mots ? demanda Sebag à la jeune femme. Molina nous a froissé ton boss.
Elsa Moulin s’approcha du cadavre retenu à la chaise par la chaîne des menottes qui entravaient ses mains. Ce qui lui restait de tête retombait sur l’épaule droite. La jeune femme désigna la plaie à l’arrière du crâne.
— La balle est entrée là pour ressortir en pleine face.
Elle releva la tête du cadavre. Il n’avait plus de nez et avait perdu une partie de la joue droite.
— Une balle tirée à bout touchant ? fit Molina.
— Pas tout à fait.
Elle désigna un oreiller emballé dans un sac plastique.
— L’assassin l’a utilisé pour atténuer le bruit de la détonation.
— Et ça a suffi ? s’étonna Molina.
— Il faut croire, puisque personne ne nous a alertés.
— À quand remonte le décès selon toi ? demanda Sebag à Elsa.
— La putréfaction du corps a largement commencé. Je dirais donc à vue de nez – et pour une fois, l’expression est vraiment justifiée – cinq jours, peut-être six.
— Non mais tu te rends compte ? reprit Molina. Six jours sans que personne ne se soucie de lui, c’est vraiment incroyable. Autrefois, ça n’aurait pas été possible mais de nos jours, putain, c’est vraiment le règne de l’égoïsme et de l’indifférence. Putain, dans quelle société on vit… Merde !
Sebag laissa son collègue étaler une colère qui lui semblait aussi pertinente que vaine. Il était facile d’user de grands mots et d’évoquer de nobles sentiments, beaucoup plus difficile en revanche de les mettre en application. Sebag n’avait jamais entendu Molina parler de ses voisins autrement que pour s’en plaindre. Lui-même avait toujours limité au strict minimum ses relations avec son entourage et il doutait d’être capable de s’en apercevoir si par malheur quelque chose de grave arrivait dans l’une des deux maisons qui jouxtaient la sienne. Alors pourquoi user sa bile si l’on n’était pas capable de changer son propre comportement ? Ce qui choquait le plus Sebag dans la France d’aujourd’hui, ce n’était pas l’indifférence ou l’égoïsme, c’était qu’on y trouve plus de donneurs de leçons que de donneurs d’exemples.
— Cinq jours, peut-être six, reprit-il à haute voix. Ça va être coton pour recueillir des témoignages fiables.
— Le légiste sera plus précis. La température dans l’appartement étant à peu près constante, ça ne lui posera pas de problème pour donner une fourchette à quelques heures près.
Sebag enregistra avec satisfaction cette bonne nouvelle.
— Quel âge selon toi, la victime ?
— 78 ans.
Les deux inspecteurs ne purent retenir leur surprise devant cette précision. Elsa Moulin sourit largement. D’un signe de tête, elle désigna la commode.
— Dans le tiroir de gauche, vous trouverez toute la paperasse utile. Carte d’identité, permis de conduire, carte de sécu, déclaration d’impôts, etc.
Sebag s’approcha du cadavre. Un petit vieux, inoffensif apparemment, vêtu d’un peignoir sale et élimé, largement ouvert sur un marcel d’où s’échappaient trois misérables poils blancs.
— D’après ses papiers, la victime s’appelait Bernard Martinez. Il est né en 1934 à Alger.
Alger… Bien sûr. La ville blanche sur les photos du couloir…
— Mais le plus intéressant est ici, poursuivit Elsa en s’approchant de la porte du salon.
Elle referma la porte et Sebag découvrit alors le fameux mot écrit à la peinture noire, ces trois lettres dont Lambert n’était pas parvenu à se souvenir. « Quel con, décidément, celui-là ! » se dit-il.
Même si elles n’étaient pas séparées par des points, les lettres ne formaient pas un mot mais un sigle. Et elles n’avaient rien d’étranger. Sans avoir de connaissance particulière en histoire, Sebag connaissait bien sûr ce sigle. Celui d’une organisation qui avait fait trembler les rues d’Alger cinquante ans plus tôt et semé la terreur parmi la population arabe.
OAS.
OAS comme Organisation armée secrète.
L’inscription figurait sur la porte telle une condamnation à mort. Molina s’approcha et l’aperçut à son tour. Il siffla longuement avant de laisser échapper un juron.
— Bordel de merde !
CHAPITRE 4
Le commissaire Castello leva la main pour établir le silence. Sa barbiche poivre et sel finement taillée ne masquait pas le sourire satisfait qui étirait ses lèvres. Malgré les évolutions récentes imposées à sa fonction par la haute hiérarchie, le patron du commissariat de Perpignan restait un homme de terrain plus que de statistiques : rien ne le faisait davantage vibrer que de réunir « ses flics » autour de lui pour plancher sur une affaire importante. En apprenant le meurtre du Moulin-à-Vent, il n’avait pas hésité une seconde et il avait mobilisé toute son équipe. Sept hommes au total. Llach et Ménard avaient dû abandonner leurs dossiers en cours dès la fin de matinée pour aider Sebag, Molina et Lambert. Quant à Raynaud et Moreno, les deux compères inséparables, on n’avait pas réussi à les contacter plus tôt et ils venaient juste de rejoindre leurs coéquipiers dans la salle de réunion du commissariat.
C’était l’heure de faire le point de la première journée d’enquête.
Castello distribua le rapport que Sebag et Molina venaient de rédiger ainsi que le compte-rendu de Jean Pagès.
— La victime s’appelle Bernard Martinez, résuma pour tous, le commissaire. C’est un pied-noir, né en Algérie en 1934. Arrivé en France en 1962, il s’est installé dans les Pyrénées-Orientales où il a exercé la profession de viticulteur. Depuis sa retraite, il vivait dans un appartement du quartier du Moulin-à-Vent. A priori, c’était un retraité sans histoires. Mais d’abord, les faits, Jean, droit au but s’il vous plaît : donnez-nous vos conclusions. Pour les détails, nous avons votre rapport.
Il tapota le paquet de feuillets qu’il avait sous la main.
— Et bravo pour votre célérité. Comme d’habitude, c’est parfait.
Le responsable de la police scientifique rougit. Malgré ses quarante années de services, et son air revêche, il n’était pas rassasié de compliments. Il s’éclaircit la voix avant de se lancer.
— Le meurtrier a agi seul et sans prendre aucune précaution. Nous avons recueilli d’excellentes séries d’empreintes digitales, sur les poignées de portes, les chaises ainsi que sur les menottes. Malheureusement, elles ne nous servent à rien pour l’instant car le meurtrier ne figure pas dans nos fichiers, ni dans ceux de la gendarmerie. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles il n’a pas pris de précaution.
— Elles nous serviront malgré tout plus tard, fit remarquer Castello avec un certain optimisme. Elles constitueront une preuve solide lorsqu’on lui aura mis le grappin dessus. Autre chose, Jean ?
— Notre homme a utilisé une arme de poing, d’un modèle assez ancien probablement, calibre 9 mm. La balle a été retrouvée dans une plinthe. Il a attaché sa victime à une chaise avec des menottes. Mais pas grand-chose à espérer de ce côté-là non plus pour l’instant, il s’agit d’un modèle courant que l’on peut trouver facilement sur Internet.
— On trouve des menottes sur Internet ? s’étonna le jeune Lambert.
— On trouve de tout sur Internet, lui répondit Llach.
— Oui, mais des menottes… Pour quoi faire ?
Des sourires apparurent sur quelques visages. Molina posa sa main sur le bras de son collègue.
— On en trouve aussi dans des sex-shops. Y’a des amateurs. Je t’expliquerai un jour, Thierry.
La digression n’était pas du goût de Castello qui recadra aussitôt la discussion.
— Comment le meurtrier est-il entré dans l’appartement ?
— Aucune trace d’effraction, il semblerait que ce soit la victime qui lui ait ouvert.
— On peut donc penser que Martinez connaissait son assassin ? supposa Llach toujours adepte des raisonnements simples pouvant conduire aux élucidations rapides.
Jean Pagès fit la moue. Son visage dévoré par des rides profondes se creusa encore davantage.
— C’est une hypothèse mais ce ne serait pas la première fois qu’une victime ouvrirait naïvement à son assassin sans qu’ils ne se soient jamais rencontrés auparavant.
Joan Llach fronça ses sourcils bruns et drus. Une barre obstinée se forma au-dessus de ses yeux noirs.
— Tout de même, de nos jours avec l’insécurité qui augmente, les vieux n’ouvrent plus facilement la porte à des inconnus…
— C’est sans doute vrai pour une majorité mais pas pour tous, répliqua Pagès. Certains restent même très crédules. Il suffit de leur présenter un calendrier des Postes ou des pompiers et ils te laissent entrer. Ils vont même sortir leur portefeuille et l’ouvrir devant toi.
— On n’est que fin octobre, c’est un peu tôt pour les calendriers, ergota Llach.
— C’était juste un exemple. Mais les gens ouvrent aussi facilement à un fonctionnaire EDF, à un agent recenseur ou mieux encore à un individu qui se prétend policier.
Castello s’adressa à Sebag :
— Gilles, votre avis ?
Sebag avait horreur d’être ainsi interpellé. Le considérant de fait comme le chef de l’équipe, Castello l’invitait souvent à donner son opinion lors des débats entre inspecteurs. Or, non seulement Gilles n’était le chef de rien ni de personne, mais il avait même refusé toutes les promotions qu’on lui avait récemment proposées. Il éluda la question :
— Les deux hypothèses sont plausibles…
Castello, contrarié, se retourna vers Pagès.
— Autre chose ?
— Il y a un élément qui a pu rassurer la victime et l’amener à ouvrir facilement à son meurtrier. Pour l’instant, je n’ai aucune certitude mais on ne peut pas écarter l’hypothèse que l’assassin soit lui aussi une personne âgée.
— Allons donc ! fit le commissaire.
— Un papy flingueur… plaisanta Molina.
Jean Pagès ignora la remarque.
— Sur le dossier de la chaise qui faisait face à la victime, j’ai retrouvé un cheveu blanc…
Un ricanement bruyant l’interrompit :
— Wouah, un cheveu blanc découvert chez un retraité, se moqua Molina, quel scoop !
Le responsable de la police scientifique ne détourna pas la tête et continua de s’adresser à Castello.
— Il m’a semblé d’un blanc et d’une longueur différents des cheveux de la victime.
— Un retraité qui recevrait parfois chez lui d’autres retraités, continua Molina, encore un scoop ! Je veux bien admettre que ton job consiste à couper les cheveux en quatre mais là, tu dépasses les bornes !
Jean Pagès se mordit les lèvres. Il avait du mal à se contenir et regrettait à cet instant d’avoir repoussé d’un an son départ à la retraite. Il aurait dû partir après l’été mais n’avait pu s’y résoudre.
— Je sais très bien, moi, qui dépasse les bornes, rétorqua Castello, se portant au secours de Pagès. Ce n’est pas avec ce type de réflexion sarcastique, voire agressive, que nous ferons avancer le débat.
Le commissaire lança un regard noir à Molina. Puis son visage s’adoucit et il adopta une voix plus douce, presque mielleuse.
— Il faut quand même reconnaître, Jean, que sur le fond – et seulement sur le fond – la remarque de Molina n’est pas tout à fait dénuée de fondement. J’ai confiance dans vos intuitions mais il conviendra de les confirmer. Sinon, vous avez relevé d’autres choses dans l’appartement ?
— Non, rien d’autre, grogna Pagès.
Castello se tourna vers Lambert.
— À votre tour, Thierry : que vous a appris l’enquête de voisinage, ça donne quoi ?
Le jeune inspecteur ouvrit de grands yeux surpris. Certes, c’était lui qui avait commencé l’enquête de voisinage mais il avait été rejoint très vite par Llach et ne s’attendait pas à se voir ainsi donner la parole en réunion. Dernière recrue de l’équipe, il avait intégré le commissariat de Perpignan un an auparavant à l’issue de son stage.
Il se redressa sur sa chaise et ce seul mouvement libéra dans la petite salle de réunion les effluves épicés d’un déodorant bon marché. Molina se pinça le nez en regardant Sebag. Lambert avait la phobie des odeurs corporelles et redoutait par-dessus tout de sentir mauvais. Son séjour auprès du cadavre avait dû le conduire à vider en une journée tout un flacon.
— Vous le disiez tout à l’heure, commissaire, c’était apparemment un retraité sans histoires. Ses voisins n’avaient pas à se plaindre de lui, à part qu’il écoutait parfois la télé un peu fort. D’après eux, ça faisait une quinzaine d’années qu’il vivait dans cet appart’. Martinez a été viticulteur, ça aussi vous le disiez, chef, viticulteur dans les Aspres, mais il a fait faillite et il a dû vendre ses terres. Pas de famille, pas d’enfants, juste une petite amie a priori. Enfin… je veux dire une vieille amie. Depuis son installation au Moulin-à-Vent, les principales occupations de Martinez, à part la télé, semblaient être les mots fléchés et la pétanque. Il faisait partie également d’une association de pieds-noirs.
— Hum, hum, fit Castello en hochant pensivement la tête. Les voisins n’ont rien remarqué d’anormal ces jours derniers ?
— Le meurtre remontant au moins à cinq jours, ils n’ont rien pu dire. Ils ne se souviennent de rien.
— Et la voisine qui a découvert le corps, vous l’avez vue ?
— Elle était sous le choc. Elle pleurait et elle tremblait de tous ses membres. Ça l’a secouée…
— Qu’est-ce qui l’a poussée à se préoccuper précisément ce matin de son voisin ?
— On a d’abord cru que c’était l’odeur qui lui avait mis la puce à l’oreille…
— Tu devrais plutôt dire à la narine, ricana Molina. Lambert gloussa mais le commissaire fit un mouvement sec et autoritaire du menton qui l’incita à reprendre son récit.
— En fait, c’est l’amie de Martinez, celle dont je parlais tout à l’heure, qui a demandé à cette voisine d’aller sonner chez lui. Elle est en ce moment en vacances chez sa fille à Barcelone. Martinez n’avait pas répondu à ses derniers messages téléphoniques et elle s’inquiétait.
François Ménard leva la main pour signifier qu’il allait intervenir.
— Ce ne serait pas Josette, son prénom ?
— Oui, je crois que c’est ça, fit Lambert en répandant devant lui ses notes prises à la volée sur des tickets de supermarché. Voilà, c’est là : Josette Vidal.
— J’ai trouvé une carte postale récente signée de cette Josette, expliqua Ménard.
— Puisque vous avez pris la parole, François, vous allez la garder, proposa le commissaire. Vous étiez chargé d’éplucher la paperasse qui se trouvait chez la victime.
Ménard étala à son tour ses notes, dépliant plusieurs feuilles de format A4 noircies d’une écriture serrée.
— Rien que de très banal en fait, ce que tout un chacun conserve dans ses tiroirs : relevés bancaires, facture de gaz et d’électricité, livret de famille, quelques photos – pas beaucoup –, un dossier d’assurance habitation, des lettres et des cartes postales, de cette Josette Vidal essentiellement. Bref, rien de fondamental mais j’ai pu glaner dans tous ces documents quelques infos qui précisent ce que nous venons de dire.
Il pencha son visage long sur ses feuilles.
— À savoir donc… que Bernard Martinez est le premier enfant de Jean Martinez, commerçant à Alger et de Odette Blanchard, couturière. Il a eu un frère cadet né en 1937 et décédé l’année suivante. Martinez est rentré en France comme la plupart des pieds-noirs à l’été 1962. Il a débarqué avec ses parents à Sète. Eux se sont installés à Marseille, lui à Perpignan. Ses parents sont morts dans les années quatrevingt.
Ménard s’offrit une courte respiration.
— En février 1963, il a acheté douze hectares de vignes à Terrats, près de Thuir. Il les a exploités jusqu’à la mise en liquidation judiciaire de son entreprise en 1997. Les primes à l’arrachage et la vente du terrain lui ont à peine permis de régler ses dettes. Depuis, il vit avec le minimum vieillesse.
Ménard survola ses notes, tournant et retournant ses feuilles.
— A priori, rien n’a été volé chez Martinez. Dans son portefeuille, il y avait même sa carte bleue et de l’argent liquide.
— Des objets de valeur peut-être ? suggéra le commissaire.
— Impossible à préciser pour l’instant, réfuta Ménard. Il faudra retrouver l’amie dont parlait Thierry. Elle pourra nous dire si quelque chose manque. Mais c’est peu probable vu qu’il n’était pas riche.
— Il y a peu de chances que ce soit un crime crapuleux alors ? s’inquiéta Llach.
— Peu de chances effectivement, répondit Castello.
Le commissaire s’accorda quelques secondes de réflexion avant d’aborder la question qui lui paraissait la plus préoccupante.
— Pour l’instant, l’inscription découverte sur une porte de l’appartement apparaît donc comme la seule piste possible.
Au fond de la pièce, Moreno et Raynaud, qui n’avaient pas encore manifesté d’intérêt pour cette affaire, s’agitèrent enfin. Après s’être raclé la gorge, Moreno fit entendre sa voix de basse :
— Autrement dit, ce serait un crime politique, quoi !
— Une vengeance contre l’OAS, compléta son compère. Castello leva les mains devant lui pour tempérer les ardeurs du binôme le plus incontrôlable de son équipe. Raynaud et Moreno ne se quittaient jamais d’une semelle. Ils ne se parlaient pas mais chuchotaient seulement, l’œil aux aguets, comme s’ils échangeaient de lourds secrets d’État. S’affirmant toujours à l’affût du gros coup qui boosterait leur carrière, ils traînaient pourtant dans les bars glauques et les lieux interlopes où il ne se passerait jamais rien. Bref, à l’image des soldats du Désert des Tartares, ils trompaient leur ennui par la routine.
— Doucement, messieurs, n’allons pas trop vite en besogne, conseilla Castello. À ce stade de l’enquête, je vous le concède, on peut tout imaginer. Et la presse, malheureusement s’en chargera bien assez vite. Nous, nous devons procéder parétapes. Et la première chose sera de vérifier les liens éventuels que Martinez a pu entretenir autrefois avec cette organisation. Justement que savons-nous à cette heure du passé lointain de la victime ?
La question s’adressait avant tout à Ménard et à Lambert.
— Je n’ai trouvé aucun document chez lui qui permette d’attester un lien quelconque avec l’OAS, répondit Ménard en premier. À part qu’il était abonné à des revues pieds-noirs qui ne figurent pas parmi les plus modérées.
Le commissaire se retourna vers Lambert.
— Qu’en disent les voisins, Thierry ?
Lambert se ratatina sur sa chaise et balbutia :
— Euh, je n’ai pas pensé à demander. Je ne savais pas à ce moment-là ce qu’était l’OA… l’OA truc, là !
Le commissaire soupira et dévisagea le jeune flic sans aménité. Sebag, en douce, consulta son téléphone. Il était déjà 19 h 00. Les mains sous la table, il rédigea discrètement un SMS pour avertir Claire de ne pas l’attendre pour le dîner.
Castello posa ses deux mains à plat et inspira longuement.
— Je crois qu’il n’est pas superflu de faire maintenant un petit rappel d’histoire. Je me doutais que vous n’étiez pas forcément des spécialistes de la guerre d’Algérie mais je croyais au moins que vous aviez tous entendu parler de l’OAS.
Molina donna un coup de coude à Lambert tandis que Castello commençait son exposé.
— L’OAS, c’est donc l’Organisation armée secrète, un mouvement clandestin créé en 1961 en réaction aux attentats du FLN.
Castello fixa de nouveau Lambert et prit la peine d’articuler avec soin.
— FLN pour Front de li-bé-ra-tion na-tion-ale, un mouvement indépendantiste qui avait débuté la lutte armée en 1954.
Le commissaire reprit pour tous les inspecteurs :
— L’OAS donc en réaction aux actions du FLN et à la politique d’autodétermination du général de Gaulle…
Il marqua une nouvelle pause.
— Autodétermination, Lambert, ça vous dit vaguement quelque chose ?
— Euh… vaguement, ouais, bredouilla le jeune inspecteur.
— Et le général de Gaulle ? questionna un Molina perfide.
— Ah oui, ça oui… le général… de Gaulle, ça, je connais…
— Au fait, comment va-t-il ?
La plaisanterie de Jacques fit rire les inspecteurs et parvint même à décrocher un vague rictus au commissaire qui reprit néanmoins son récit.
— Les Français d’Algérie hostiles à l’indépendance créèrent donc l’Organisation armée secrète qui effectua au total en moins de deux ans une bonne dizaine de milliers de plasticages sur le territoire algérien mais également ici en métropole. On lui attribue plus de 1 600 morts…
Le chiffre jeta un froid dans l’assistance.
— Oui, je sais, ça paraît incroyable de nos jours mais j’ai vérifié le chiffre. 1 600 morts. L’OAS s’en prenait essentiellement aux Arabes mais elle a exécuté également des policiers français en service.
Un murmure scandalisé se fit entendre.
— Certains chefs de l’OAS ont été fusillés après avoir été arrêtés. Beaucoup ont fait de la prison. Mais dans l’ensemble, ils ont été graciés dès la fin des années soixante.
Castello attendit quelques instants pour être sûr d’avoir toute l’attention de son équipe.
— Le mot OAS inscrit près du cadavre nous renvoie donc à cette époque troublée et encore très sensible, notamment dans la communauté des anciens Français d’Algérie, une communauté qui, je vous le rappelle en passant, compte encore dix mille personnes dans le département. De plus – et là je ne vous apprends rien, j’espère – les tensions ont été vives ces dernières années dans la ville entre les associations de pieds-noirs et leurs opposants à propos de plusieurs mémoriaux érigés dans des lieux publics. À chaque fois, il y a eu des manifestations, les pour et les contre, et on a évité de justesse les affrontements. Bref, nous marchons sur des œufs et je peux vous dire que beaucoup de gens par ici vont suivre de très près notre enquête.
Un silence de plomb lui succéda. Les inspecteurs restaient songeurs. Personne dans la police n’aimait travailler sous la pression des politiques et des médias.
— Nous n’écarterons toutefois aucune piste, poursuivit Castello. Y compris celle du règlement de compte personnel maquillé en affaire politique. Demain, Llach et Lambert rencontreront l’amie de Martinez. Ils l’accompagneront notamment dans l’appartement pour qu’elle nous confirme qu’il n’y a pas eu de vol. Raynaud et Moreno, de leur côté, se pencheront sur le passé professionnel de Martinez. Il faut voir s’il n’y a pas eu matière à contentieux dans sa faillite commerciale.
Sebag jeta un regard en coin à ses deux collègues et constata avec plaisir leur déception d’être écartés de la piste politique. Puis il se reconcentra sur les instructions du commissaire.
— Sebag et Molina enquêteront d’abord dans la communauté pied-noire de Perpignan et interrogeront en premier lieu les responsables de l’association dont faisait partie Martinez. Il faut très vite savoir si la victime a appartenu ou pas à l’OAS. Puis ils rencontreront ceux qui se sont opposés aux différents monuments de la mémoire pied-noir. Enfin, Ménard, lui, s’occupera plus particulièrement de l’aspect historique. Vous avez rendez-vous déjà, je crois, avec un professeur de l’Université ?
— Oui, c’est un spécialiste de la guerre d’Algérie. Plus du
FLN que de l’OAS malheureusement mais il pourra sans doute me diriger vers des collègues et vers des témoins de l’époque.
Castello regarda ses inspecteurs, l’un après l’autre, avant de conclure avec gravité :
— Messieurs, je compte sur vous pour être là demain à la première heure. Il faut aller vite car il y a un élément que nous n’avons pas encore abordé parce que c’est trop tôt et que, comme je l’ai répété tout à l’heure, je n’aime pas brûler les étapes. Mais je suis sûr que certains d’entre vous y ont déjà pensé.
Il regarda à nouveau les inspecteurs.
— Si nous avons affaire à une vieille vengeance contre l’OAS, on ne peut pas exclure que ce meurtre soit le premier d’une série. Vous pouvez disposer.
Molina passait un coup de fil pendant que Sebag récupérait les feuilles du dossier de l’accident de Mathieu qu’un courant d’air malencontreux avait éparpillées dans le bureau.
— Parfait, M. Albouker. À demain.
Molina raccrocha.
— Le président du Cercle pied-noir peut nous recevoir demain à 10 h 30. Il aurait préféré le soir parce qu’il veut que son trésorier soit là et que celui-ci n’était pas disponible le matin. Mais j’ai dit qu’on avait un autre rendez-vous dans la soirée.
— Tu as bien fait. Si on écoutait les gens, on travaillerait jour et nuit. Déjà qu’aujourd’hui pour ma rentrée, j’ai eu ma dose…
— Le trésorier, il est à la retraite alors il peut faire un effort. Moi aussi, j’ai eu ma dose. Et puis j’ai encore l’impression de traîner avec moi l’odeur du cadavre mêlée à celle de Lambert : un cocktail répulsif à faire fuir la plus avide des nymphomanes !
Molina se leva et enfila son blouson.
— J’ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. J’entrevois un sac d’embrouilles pas possible. On va être sous pression.
— C’est sûr. J’espère qu’on va avancer rapidement.
— Avec un peu de chance, c’est sa petite amie qui l’a tué et elle va nous l’avouer en pleurant sur l’épaule de Lambert. Un crime passionnel à soixante-dix balais, ça s’est déjà vu, non ?
— Ouais, sans doute, mais là, faut pas rêver.
— Tu ne le sens pas comme ça, n’est-ce pas ?
— Non. Comme toi, je miserais plutôt sur le sac d’embrouilles.
— C’est bien ce que je craignais.
Sebag avait terminé de rassembler et de classer toutes les feuilles du dossier. Il tapota le paquet pour en faire une pile bien nette qu’il glissa sous son bras. Il sortit ensuite du bureau sur les pas de Molina.
Claire et Séverine regardaient la télévision confortablement installées dans le canapé lorsque Sebag rentra à la maison. Il les embrassa et les vit grimacer. Il n’avait pas eu le temps de se changer depuis son séjour dans l’appartement de Martinez.
— Je sais, je vais prendre une douche.
Sans en dire davantage, il fila dans la salle de bains attenante à sa chambre. Il mit ses affaires dans le panier à linge sale avant de se glisser sous un jet brûlant. Il laissa couler l’eau cinq bonnes minutes pendant qu’il se récurait la peau et les cheveux.
Après s’être séché, il enfila un peignoir.
— Léo est là ? demanda-t-il aux filles, toujours scotchées devant leur écran.
— Dans sa chambre, répondit Claire.
Gilles traversa le séjour et s’engagea dans le couloir qui menait vers les chambres des enfants. Il frappa à la porte de son fils. Pas de réponse. Il entra. Un casque sur les oreilles, Léo était rivé à son ordinateur.
— Bonsoir, fit Sebag d’une voix forte.
Léo bougea à peine la tête.
— Salut, p’pa.
— Ta journée s’est bien passée ?
— Ça va.
— Pas trop de devoirs ?
— Non, ça va.
Sebag contempla quelques secondes la nuque de son fils. Il hésitait. Il avait prévu de rappeler une fois de plus Léo à la prudence sur son scooter mais il avait bien conscience que ce « une fois de plus » serait perçu comme « une fois de trop ». Il était préférable de ne pas insister. Ses relations avec son fils n’étaient pas conflictuelles – pas encore – mais leur ancienne complicité s’était effilochée au fil des ans et Gilles regrettait durement l’époque de leurs jeux en commun dans le jardin ou sur l’ordinateur et les longues discussions le soir avant de se coucher. C’était la vie, pourtant. Léo avait grandi. Il était devenu un adolescent de seize ans. Un gamin de son temps. Autiste vis-à-vis de ses parents mais capable de chater des journées entières avec ses copains sur Internet.
Sebag soupira, referma la porte et retourna dans le séjour. La pièce n’était séparée de la cuisine que par un bar. Sur le plan de travail, il trouva sous une cloche en verre une assiette avec des courgettes farcies et un peu de riz. Il la mit à réchauffer au micro-ondes. Pendant que le four tournait, il jeta un œil sur le film. Une série américaine, policière évidemment. Il n’y avait plus que cela à la télévision.
Le four sonna. Sebag récupéra son plat et s’installa sur un coin de table. Claire ne tarda pas à le rejoindre. Séverine avait mis un casque sur ses oreilles pour suivre tranquillement la suite de son programme télé.
— Ta journée s’est bien passée ? demanda Claire.
— Elle a sans doute ressemblé à ton feuilleton.
— Un meurtre ?
Il avala une grande bouchée et dut se contenter de le lui confirmer d’un signe de tête.
— C’était ça, l’odeur ?
Il lui expliqua les grandes lignes de l’affaire.
— Pour un retour de vacances, tu as été servi, commentat-elle.
— On peut le dire, oui. Mais tu ne regardes plus la télé ?
— J’ai vu un premier épisode et avec ce que tu viens de me raconter, je n’ai plus du tout envie de voir la suite.
— Comme on dit, la réalité dépasse souvent l’affliction.
— Tu ne me l’as pas déjà servie, celle-là ?
Gilles pratiquait avec délices le détournement de proverbes mais en vingt ans de vie commune avec Claire, il n’avait plus d’inédit en stock.
— C’est probable… Et toi, ta journée ?
Claire lui raconta sa routine de prof de français au collège de Rivesaltes, les tensions entre les enseignants et le nouveau principal, puis la difficulté à maintenir l’ordre dans les classes surchargées, surtout la 4ème C qui comptait dans ses rangs deux ou trois élèves un peu plus insolents que la moyenne. Elle lui parla aussi de son moment de détente à son cours de gym, le plaisir de se défouler physiquement avant de conclure la séance avec un hammam entre copines.
Sebag décrocha. Il ne parvenait plus à écouter. Un mot ou un geste suffisaient parfois pour faire sournoisement remonter en lui une nausée de jalousie, une onde mauvaise, un mal de cœur et de tripes qui persistait depuis l’été dernier. Gilles avait alors découvert par le plus cruel et douloureux des hasards que Claire lui mentait. À propos d’un cours de gym, justement auquel il savait qu’elle n’avait pas assisté. Un doute était né en lui mais il n’avait rien dit.
Les présomptions sur l’infidélité de son épouse avaient grandi les jours suivants, s’approchant peu à peu de la certitude.
Et il n’avait toujours rien dit.
Il aurait été pourtant facile au lieutenant Sebag d’user de son savoir-faire de flic pour connaître rapidement le fin mot de l’histoire. Il aurait pu aussi tout simplement en parler franchement avec Claire. Il la connaissait bien, s’il y avait eu quelque chose, elle lui aurait tout avoué sans détour. Il en était certain.
Mais il avait fini par décider qu’il ne voulait pas savoir. Devant les marques d’amour et de désir que Claire continuait de lui prodiguer, il avait considéré que la vérité n’avait pas d’intérêt. La seule chose qui comptait, c’était leur amour, leur amour commun, leur amour toujours. Là, était la seule sincérité importante. Et cet amour si fort pouvait bien s’accommoder d’une petite égratignure. D’autant qu’il ne constatait plus rien d’anormal dans le comportement de Claire depuis la rentrée. Si sa femme avait eu une « aventure », celle-ci était terminée.
De parvenir ainsi à prendre avec philosophie une si douloureuse et banale infortune capable de briser bien des couples, Sebag s’était vu beau et grand. Sublime et généreux. Magnanime. Et cette image positive avait posé un baume sur sa blessure d’orgueil.
Mais aujourd’hui, le baume ne faisait plus effet. Et c’était de lui-même qu’il doutait. Il se demandait de plus en plus souvent si sa belle grandeur d’âme ne cachait pas autre chose.
De la peur tout simplement.
La peur de savoir et de ne pas supporter la vérité.
Il avait laissé l’égratignure se refermer avec des gravillons restés cachés sous la peau. La blessure marquait son âme et se rappelait à lui de temps en temps. De plus en plus souvent. Comme une gangrène.
— Je n’aime pas quand tu me regardes avec ces yeux.
Il revint à lui. Il revint à elle. Claire le dévisageait tristement.
— Je n’aime pas quand tu me regardes avec ces yeux, répéta-t-elle avec douceur.
L’amorce d’un sourire étira les lèvres de Sebag.
— Ce sont mes yeux. Je n’en ai pas d’autres.
— Ce n’est pas vrai, réfuta-t-elle. Tes yeux sont amoureux et tendres. Ceux-là sont durs et froids. Et surtout ils sont loin. Trop loin de moi.