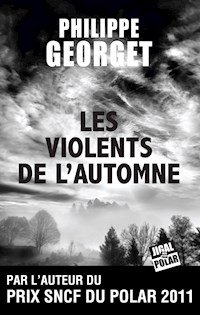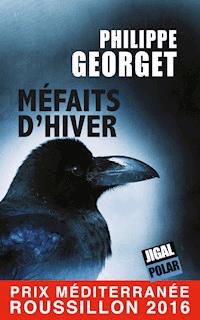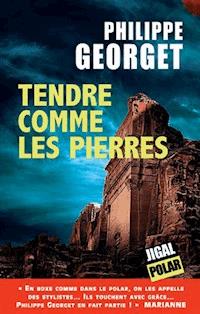
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Éditions Jigal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Retrait du titre par le distributeur numérique, à la demande de l'éditeur
Das E-Book Tendre comme les pierres wird angeboten von Jigal (new) und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
« Chaque hiver abrite en son cœur un printemps qui frissonne. »
Khalil Gibran, poète libanais (1883 - 1931).
Partie I Pétra
Chapitre 1
« La vie est un trésor qui chaque nuit s'épuise davantage. » Tarafa ibn al-Abd, poète arabe préislamique.
La rumeur de la rue envahissait peu à peu la chambre 124 du Comfort Hotel. Des éclats de voix, des coups de klaxon, le bruit mat de cartons qu'on empile devant l'épicerie voisine, parfois le carillon des sabots d'un cheval sur l'asphalte. Rodolphe Moreau ouvrit un œil. On lui avait proposé une chambre plus calme, à l'arrière sur la cour. Il avait refusé car il aimait ce réveil matinal en douceur. La vie s'ébrouait au dehors, elle coulait dans les rues de Wadi Musa, lente comme le sang dans ses veines, plus fluide et plus chaude de minute en minute.
Allongé sur le flanc droit dans son lit, le vieux professeur sentait son corps aussi raide qu'une branche, aussi cassant qu'un arbre mort. Il leva devant lui une main fine et parcheminée, agita un à un ses longs doigts secs pour chasser les insectes minuscules qui couraient sous sa peau. La vie réchauffa sa main puis son bras.
Chaque jour, sa carcasse exigeait plus de temps pour se ranimer. Les autres jours cependant, il s'éveillait l'esprit lucide. Ce matin, l'engourdissement emprisonnait également son cerveau. Il se trouvait las, il peinait même à rassembler ses idées. La vieillesse avait encore gagné du terrain, il lui faudrait lutter plus fort. C'était le prix à payer : l'homme sage doit accepter de son corps les douleurs contre lesquelles il ne peut rien. Quatre-vingt-deux ans dans quelques semaines. Le professeur Moreau savait bien qu'un jour prochain il lui faudrait s'avouer vaincu.
Il souleva le drap du lit, remua ses jambes blanches et sentit le sang circuler jusque dans ses doigts de pieds. Sa passion n'avait pas faibli malgré les années. Six décennies accroupi dans des fossés, tantôt humides tantôt noyés de poussières chaudes, à gratter la terre dans l'espoir d'éclairer, ne serait-ce que d'une faible étincelle, la connaissance du monde ; six décennies dans des hangars sombres à faire parler des pièces d'or ou de cuivre, des fragments d'os et des éclats de poterie. L'archéologie avait été sa plus fidèle maîtresse. Il ne l'avait jamais trahie, elle l'avait souvent remercié. Elle venait de lui faire un cadeau magnifique. Pour peu qu'il ait la force d'aller jusqu'au bout.
Il fit glisser jusqu'au vide ses maigres jambes, posa sa main droite sur le matelas pour faciliter la manœuvre et parvint à s'asseoir sur le rebord du lit. Il sourit. Le jour n'était pas encore venu de rester immobile.
Il caressa sa barbe blanche et clairsemée, fit remonter sa main sur l'arête de son long nez et s'attarda sur son front interminable qui commençait au-dessus de ses yeux sombres et s'achevait maintenant à l'arrière de son crâne dégarni. Sa peau était sèche et craquelée comme le lit d'un wadi en été.
Rodolphe Moreau patienta. Sans amertume. Le sang irriguait de nouveau la plaine aride de son dos. La cotte de maille tissée par les ans et durcie par la nuit lui accorderait bientôt son répit quotidien. Il attrapa ses lunettes qu'il laissait toujours sur la table de nuit, près de son livre de chevet, un recueil de poèmes arabes. Il en lisait un chaque soir, le récitait à haute voix, s'en imprégnait. La nuit ensuite se révélait plus douce.
Le livre n'était plus là. Il s'étonna, le chercha des yeux et l'aperçut par terre. La veille, il s'était endormi comme une masse. Il contempla l'ouvrage sans bouger. Il laisserait la femme de chambre le ramasser : le sol était trop bas pour lui le matin.
Il fit un geste pour prendre sa montre mais s'arrêta. À quoi bon ! Le soleil levant commençait à lécher la vitre derrière le lourd rideau de la chambre. On était fin octobre, il devait être 6 h 30. Guère plus. À son âge, on n'était plus à un quart d'heure près…
Il ferma les yeux. Il connaissait par cœur le paysage qui s'éclairait derrière la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Le soleil naissait derrière la colline du village de Wadi Musa, il allumait d'abord au loin le dôme blanc du mausolée sur le djebel Haroun, puis ses rayons déjà ardents découpaient sur le bleu du ciel les silhouettes vives des premières montagnes de Pétra.
Pétra… Sa dernière passion. De loin la plus belle. Le mariage du génie de la nature et du talent des hommes. D'immenses remparts de grès sculptés de gorges étroites et creusés de façades étonnantes. Bâtie à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ par les Nabatéens, redécouverte au début du XIXe par un aventurier suisse, la cité n'avait pas encore livré tous ses secrets. Elle avait eu la bonté de lui en offrir un et, grâce à son expérience, il saurait l'exploiter. La vieillesse ressemblait à l'escalade d'une montagne : plus on montait, plus on était fatigué mais plus notre vision s'élargissait.
Le professeur saisit la canne de bois qu'il avait coincée entre la table de nuit et le lit. Il appuya son menton sur le pommeau et referma les yeux.
Après un petit déjeuner frugal, il se rendrait comme tous les matins sur le site. Négligeant la route de service, il accéderait au chantier de fouilles par le Sîq. Il ne se lassait pas de parcourir ce somptueux défilé. Cent mètres de hauteur et par endroits moins de trois mètres de large. S'il ne traînait pas trop – si son vieux corps daignait se réveiller enfin –, il passerait avant la grande marée des touristes en short qui envahissaient chaque jour les lieux. Il se redressa avec précaution. Sa colonne vertébrale s'étira et il sentit une légère douleur glisser de sa nuque jusqu'au bas de son dos. Plus question de faire tout le chemin à pied. Trop éprouvant. Malgré la pente douce, il se ferait conduire en calèche jusqu'au premier tombeau. Après seulement, il marcherait.
Avec Mélanie, il commencerait par établir le programme de la journée en sirotant un thé brûlant parfumé à la sauge. Il laisserait les ouvriers creuser la terre – ce n'était décidément plus de son âge –, et il s'enfermerait dans son baraquement pour travailler sur sa dernière découverte. Lors d'un moment de calme, il lui confierait son secret.
Cette pensée dissipa enfin l'engourdissement de son esprit. Il y puisa une énergie nouvelle. Il respira un grand coup puis, en soufflant, appuya des deux mains sur sa canne, déplia ses genoux et força ses jambes fatiguées à trouver un équilibre.
Ça y est, il était debout. Une nouvelle journée – une nouvelle vie – pouvait commencer.
Le bruit d'un froissement de tissu derrière lui le fit sursauter. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un dans son lit. Il se retourna aussi vite que sa vieille carcasse le lui permit. Deux yeux noirs enfantins le fixaient en souriant naïvement. Deux yeux magnifiques. Un sourire enchanteur. Le visage du professeur Moreau rayonna devant cette douce apparition.
Des coups sourds secouèrent la porte de sa chambre d'hôtel et le vieil homme se sentit replonger des années en arrière. Il se figea, d'abord incrédule puis inquiet. Mais il n'eut pas le temps de se poser des questions. Le malheur, la violence et la honte entrèrent comme un coup de vent. Ils portaient les uniformes sombres de la police jordanienne.
Chapitre 2
« Si loin que nous portent nos pas, ils nous ramènent toujours à nous-même. »
Après deux heures de marche, je posai le pied sur la vaste esplanade encore déserte du Deir. Le soleil flemmardait derrière les flancs déchirés de la montagne jordanienne et le tombeau restait dans l'ombre. Ce n'était pas la meilleure heure pour découvrir cette façade parmi les plus célèbres de Pétra. Mais le profond silence qui régnait en ce lieu, si fréquenté d'ordinaire, compensait à mes sens cette mauvaise exposition.
Taillé dans l'épaule d'une montagne de grès jaune, le tombeau du Deir s'extirpait avec génie de la matière brute. La pureté de ses formes géométriques contrastait avec la masse incohérente de la falaise sur laquelle la pierre avait coulé comme de la cire. Ce décor arraché il y a deux mille ans à la nature par les hommes s'étalait sur cinquante mètres de large et presque autant de hauteur. Il se divisait en deux niveaux. Le premier étage, grignoté par les vents, se composait de six colonnes frissonnantes encadrant une monumentale entrée ; le deuxième se garnissait de deux niches coiffées d'un demi-chapiteau corinthien entourant une troisième couronnée au sommet par une urne gigantesque.
J'avançais d'un pas lent et respectueux sur l'esplanade naturelle.
Arrivé la veille en Jordanie, j'avais loué une voiture à l'aéroport Queen Alia d'Amman et j'étais descendu directement sur Pétra. Plutôt que de dormir dès la première nuit dans un des nombreux hôtels de Wadi Musa – le village qui jouxtait le site historique –, j'avais souhaité bivouaquer dans un camp bédouin à une dizaine de kilomètres de là.
Mais je n'y étais pas resté très longtemps.
Perdu au bout d'une piste chaotique, le Petra Camp n'était qu'un amuse-touristes. Le parking regorgeait de 4x4 rutilants et desservait une trentaine de tentes confortables. J'avais posé mon sac sur un lit aux draps blancs et rejoint le centre du campement où une longue file de vacanciers occidentaux patientait déjà devant un somptueux buffet en sirotant des bières fraîches. Agenouillée à côté de la table, une vieille Arabe en robe noire cuisait du pain sur un feu de bois.
D'un seul mouvement, le groupe avait soudain bifurqué vers un trou creusé dans le sable. Les Bédouins en avaient sorti, sous les exclamations de joie et les crépitements des flashs, un plat de plusieurs étages foisonnant de morceaux de poulet et de légumes juteux.
Malgré la douceur des mets, j'avais mangé en silence sans parvenir à me détendre.
Après une douche rapide, ma décision était prise. J'avais réglé ma note, confié ma caméra ainsi que le reste de mon matériel professionnel aux responsables du camp, emprunté une vieille couverture et j'étais parti dans le silence et la nuit noire. J'avais marché un bon kilomètre à la lumière de ma lampe frontale avant de trouver une alcôve naturelle dans la roche. La nuit, bien qu'un peu fraîche, avait été calme et céleste.
Aux premières lueurs du jour, j'avais suivi sans difficultés le chemin balisé par des cairns et atteint rapidement Le Deir.
Je m'adossai à un rocher et sortis une petite bouteille d'eau minérale d'une des nombreuses poches de mon pantalon de marche. Je bus deux longues gorgées avant de grignoter quelques gâteaux secs achetés la vieille sur la route. Ces deux heures de randonnée matinale m'avaient fait du bien. Elles m'avaient permis d'évacuer l'angoisse irraisonnée que je sentais monter en moi depuis l'atterrissage. Dix ans que je n'avais pas remis les pieds dans un pays arabe. La Jordanie était une contrée paisible et le reportage que je devais y réaliser ne comportait aucun risque. Pourtant, dès que j'avais débarqué de l'avion, j'avais retrouvé une ambiance, des parfums et des sons que je m'étais acharné à oublier.
Un bruit roulant de cailloux me fit sursauter. Je me retournai et aperçus un troupeau de chèvres qui approchait. Elles m'entourèrent rapidement, certaines gourmandes n'hésitaient pas à fureter du museau dans mon sac à dos. Je fis un geste pour les chasser, elles s'éloignèrent mais revinrent aussitôt. Un sifflement perçant se fit entendre et, cette fois-ci, les bêtes m'abandonnèrent. Une vieille femme s'avança d'une démarche traînante. Elle portait la longue tunique des Bédouines par-dessus un pantalon de flanelle rose. Un foulard coloré bordait son visage crevassé. Ses lèvres desséchées s'étirèrent en un sourire, affichant au soleil une rangée de dents d'un blanc éclatant. Sous sa bouche, un trait de henné divisait en deux son menton.
— Sabah al-kheir (Bonjour), me fit-elle.
— Sabah al-nur.
De la poche de ma chemise, je sortis un paquet de cigarettes écrasées. Les trois clopes qui me restaient n'avaient pas tenu le choc d'une nuit passée tout habillé. Je les fis glisser dans ma main et choisis la moins abîmée. Je portai le serpentin à ma bouche.
— Laa moumkine (pas possible), rigola la vieille Bédouine.
Elle plongea ses mains dans une ouverture de sa tunique au niveau de son ventre et en extirpa un paquet de Winston. Elle me tendit une cigarette impeccable avant d'en porter une autre à ses lèvres. Je lui offris la flamme de mon briquet. Elle tira une bouffée, je fis de même. La douceur du tabac emplit ma bouche et ma gorge. Je penchai la tête en arrière. Lentement, je laissai s'échapper la fumée par les narines. Elle s'envola en volutes légères, seule brume dans le matin bleu vif. Le bonheur intégral !
Je proposai un gâteau sec à la vieille. Elle déclina mon offre.
— From where ? demanda-t-elle.
— Faransa. (France)
— Ah… Fraransaa. Bien-ve-nu, com-ment-ça-va ?
— Mabsout (Très bien), répondis-je. Wa anta ? (Et toi ?)
— Quies (bien). Speak Arabic ?
— No, I'm sorry, just a few words. (Non, désolé, seulement quelques mots)
— Welcome, welcome.
— Choukran (Merci). And you, do you speak french ?
— Yes ! Bon-jour meu-ssieur. Just have a look. Viens voir. Pas cher, pas cher.
Elle m'entraîna vers une cabane malingre constituée de couvertures décolorées et poussiéreuses posées sur une armature de bois plantée dans le sable. Elle souleva une de ces loques, découvrant une échoppe et ses mille trésors de pacotille : des pendentifs et des bracelets multicolores, de fausses pièces nabatéennes, des théières dorées et de minuscules lampes à huile en cuivre.
— Pas cher, pas cher, répéta-t-elle. Bedouin arts. Un dinar seu-le-ment.
J'examinai une bague, une perle couleur turquoise sertie sur une monture en laiton. Je la reposai rapidement et demandai en faisant un clin d'œil à la vieille :
— Made in China ?
Elle éclata de rire mais ne répondit pas. Elle se mit à ramasser des brindilles pour faire un feu. C'était l'heure du thé. Au Moyen-Orient, chaque occasion, chaque instant, sonne l'heure du thé. Je la laissai à son occupation et me rapprochai de l'entrée du Deir.
Je ne sais s'il y avait un escalier durant l'Antiquité ou si le temps avait creusé le sable mais l'ouverture du tombeau se trouvait aujourd'hui à un bon mètre cinquante du sol. Trois cailloux entassés constituaient un marchepied incertain. Malgré mes cinquante ans révolus, j'escaladai l'obstacle sans difficulté.
L'intérieur se révélait décevant. Le tombeau n'était qu'un cube vide au plafond noir de suie et de goudron et aux murs couverts de graffitis de toutes les langues et de toutes les époques. Une tribune creusée dans le roc occupait le fond de la pièce. Je revins m'asseoir près de l'entrée, ressortis un serpentin de tabac et l'allumai. La fumée s'échappait par toutes les fissures du papier : je sentais le parfum du tabac, pas son goût !
Sur la gauche, en face du Monastère, une grotte accueillait un café. Un jeune Bédouin essuyait la poussière de sable qui s'était déposée sur les tables restées dehors durant la nuit. Le ronronnement d'un groupe électrogène vint troubler la paix du petit matin. Les premiers touristes n'allaient pas tarder à arriver. Il fallait se bouger.
La vieille Bédouine au loin me fit signe d'approcher. Un thé fumant m'attendait sur un plateau. Je le sirotai avec plaisir. Son velours caressa mon palais et sa chaleur se répandit dans mon corps.
— First time in Jordan ? m'interrogea-t-elle.
— Yes.
— Tourist ?
— No. Journalist.
Je mis mes mains à la hauteur de ma tête mimant une caméra imaginaire.
— TV, french TV.
La Bédouine hocha la tête avant de s'étonner de mes bras ballants.
— Where's your camera ?
— Tomorrow. I'll come back tomorrow with it. (Je reviendrai demain avec)
Elle remplit à nouveau mon verre. Son visage racorni avait pris la couleur du sable et ses yeux noirs soulignés de khôl brillaient de malice.
— You want to change money (Tu veux changer de l'argent) ? proposa la vieille. One dinar, one euro.
Elle me tendit une pièce française. Je savais que je perdais au change et je lui souris pour lui montrer que je n'étais pas dupe. Mais j'acceptai le troc. Ce n'était pas cher pour deux thés délicieux.
De fortes voix se firent entendre sur l'esplanade. Un premier groupe de touristes. Cinq têtes blondes. Trois hommes, deux femmes. Des accents germaniques : allemands ou hollandais. Ils étaient jeunes et sportifs et paraissaient ravis d'avoir grimpé en tête les huit cents marches qui conduisaient de la ville basse de Pétra au Deir. Je saluai ma vieille copine. Il était temps de partir.
J'étais entré sur le site de Pétra par un chemin inhabituel et j'allais devoir prendre à contresens l'itinéraire touristique.
Creusé dans la roche, l'escalier serpentait entre les lauriers roses et les genévriers. Il ménageait par endroits d'impressionnants points de vue sur une vallée profonde et verdoyante. De temps en temps, j'apercevais, sculptées dans la montagne, quelques marches incertaines, d'autres escaliers aux destinations forcément mystérieuses. Je croisai d'abord des groupes espacés de touristes, puis d'autres de plus en plus compacts. Tous les accents du monde sifflaient à mes oreilles. Chantants ou chuintants, nasillards ou roulants, saccadés ou coulants. Je descendais les marches d'une tour de Babel. Multiple dans ses langues, l'animal touristique revêtait en revanche une tenue uniforme. Bobs ou casquette, short et T-shirt, chaussures solides et lunettes de soleil. Sacs sur le dos ou bien en bandoulière, il tenait dans la main un téléphone, un appareil photo, parfois une encombrante tablette numérique.
À mi-pente, je rencontrai la première mule. L'animal avançait d'un pas assuré malgré son chargement, une Anglaise en surpoids coiffée d'une casquette jaune « I Love Jordan ». Tenant d'une main ferme les rênes de l'animal, le guide arabe marchait devant mais il se retournait sans cesse, ne pouvant se détacher bien longtemps de la vue hypnotique des deux grosses cuisses dont la blancheur rayonnait sur le cuir brun de l'animal.
J'arrivai bientôt dans la ville basse de Pétra. Regroupés sur le pont enjambant le lit asséché du wadi, une vingtaine de Bédouins vantaient aux touristes déjà fatigués les mérites de leur mule ou de leur âne. Je passai sans m'arrêter et marchai sur les premiers pavés d'une grande allée bordée de colonnes. J'avançai dans ce qui avait été le cœur de la cité antique de Pétra. Je touchai au but, le chantier de fouilles n'était plus très loin.
Après quinze ans autour du monde comme grand reporter, j'avais rangé mon passeport et, depuis une dizaine d'années, je partageais mon temps entre des CDD dans les stations régionales de France 3 – de préférence pas trop éloignées de Paris – et des collaborations avec ZêtaComTV, une société de production audiovisuelle spécialisée dans le documentaire d'entreprise. À Pétra, je devais réaliser un reportage sur les fouilles menées par une équipe d'archéologues français. Le chantier était sponsorisé par Vivéotuez, une multinationale française qui souhaitait par ce reportage faire sa propre pub tout autant que celle des fouilles. Le responsable de ZêtaComTV, Jules-Octave Bernès, surnommé Job, avait réussi à décrocher le contrat comme à son habitude, en sous-estimant grossièrement le devis. Sachant que j'aimais bosser seul – et que je le faisais plutôt bien – il m'avait confié la responsabilité du sujet avec pour principale mission de faire au moindre coût. Au début, j'avais refusé car je ne me sentais pas encore prêt à retourner au Proche-Orient. Mais comme par un fait exprès, un coup de fil le jour même de mon banquier m'avait convaincu qu'il y avait des luxes que je ne devais plus me permettre. Le temps où je choisissais entre deux reportages au bout du monde était bien révolu : aujourd'hui, pour éviter les queues interminables au guichet de Pôle Emploi, il me fallait accepter tout ce que l'on voulait bien proposer à un vieux journaliste aigri et mal embouché.
Je longeai les restes de quelques temples nabatéens mis au jour ces dernières années. Des murs plus ou moins hauts, des colonnes plus ou moins bien conservées, des dalles de pierre, un escalier… Rien de bien différent de ce que j'avais pu voir ailleurs, en Italie et en Grèce. Je n'avais jamais été fan de la caillasse antique.
Je m'arrêtai devant le panneau présentant le chantier de fouilles. Fixé au grillage qui ceinturait le site, il était rédigé en trois langues – anglais, arabe et français – tout comme les nombreux avertissements qui interdisaient l'accès au public. Derrière le grillage, des toiles de tente accrochées à des murs à demi enfouis dans la terre semblaient n'abriter aucune vie. Un cadenas solide fermait la barrière. Il était 10 heures, je trouvais ça étrange.
Je regardai autour de moi et aperçus trois ouvriers – pakistanais ou indiens – qui fumaient tranquillement à l'ombre d'un pistachier plusieurs fois centenaire. Je m'approchai d'eux. Ils m'avaient repéré et l'un des trois hommes s'adressa à moi dans un anglais aimable.
— C'est fermé aujourd'hui, m'informa-t-il.
— Je vois. Pourquoi ?
L'ouvrier hésita :
— Un accident…
— Où ça ? Sur le chantier ?
— Non… Pas ici… À Wadi Musa.
— Quel accident ?
Devant mon insistance, il se ferma. Ses sourcils noirs formèrent une barre drue au-dessus de ses yeux sombres. Il se leva.
— Qu'est-ce que vous voulez ?
— J'ai rendez-vous ici avec le professeur Moreau.
— Le professeur Moreau ? Pas possible !
— Pourquoi ? C'est lui qui a eu un accident ?
— Vous devez aller à Wadi Musa.
Il fit un geste du bras chassant l'air dans la direction du village.
— Wadi Musa, répéta-t-il.
J'allais m'éloigner lorsque j'entendis la grille du chantier glisser derrière moi. Je me retournai. Un Arabe d'une trentaine d'années refermait le cadenas. Il était vêtu à l'occidentale, d'un pantalon de lin clair et d'une chemise à carreaux. Une fine barbiche entourait sa bouche charnue. J'interrogeai l'ouvrier du regard : il acquiesça et je me présentai au jeune homme.
— Good Morning, sir. My name is Lionel Terras and I'm a french journalist. I'd like…
Il m'interrompit dans un français parfait.
— Je sais qui vous êtes. Rodolphe m'avait informé de votre venue.
Il me tendit la main.
— Je m'appelle Nacer Ousman. Je suis professeur d'histoire à l'université d'Amman et je collabore avec le professeur Moreau sur ce chantier.
Après avoir récupéré sa main, il la passa sur les poils de sa barbiche.
— Mais je crains qu'il y ait un problème.
Il rangea la clé du cadenas dans une poche de son pantalon et se baissa pour attraper une valise noire qu'il avait posée au sol.
— Vous commencez à m'inquiéter, avouai-je. Que se passe-t-il exactement ?
— Nous ferions mieux d'aller tout de suite à Wadi Musa. Mélanie est encore là-bas.
— Mélanie ?
— Mélanie Charles. L'adjointe du professeur.
Il se mit en marche dans une direction opposée à ce qui me semblait être la sortie du site. Je l'arrêtai.
— Où allez-vous ? La sortie de Pétra, c'est de l'autre côté, non ?
Il me sourit avec indulgence.
— La sortie par le défilé, c'est le passage des touristes. Nous avons une voie spéciale pour le service. Moins belle évidemment que le Sîq mais accessible en voiture. Venez, je vous expliquerai tout en chemin.
Chapitre 3
« Ne sois pas trop doux, on te dévorerait, ni trop amer, on te recracherait. »
Un bus déversait ses touristes sur le trottoir devant le Comfort Hotel. Suivant Nacer, je slalomais entre des gens indifférents et des valises envahissantes. Nous grimpâmes un escalier pour déboucher dans le hall heureusement désert. Nacer se renseigna à l'accueil puis me guida dans les couloirs. Un virage à gauche, trois marches, un autre virage à droite et nous arrivâmes dans une vaste pièce décorée de photos anciennes de Pétra. Une jeune femme blonde assise à une table nous tournait le dos. Elle parlait vivement, la main collée à son oreille. Nacer se planta devant elle et patienta.
Mélanie Charles conversait en arabe au téléphone. Je reconnus quelques mots-clés par-ci par-là, « enfant » et « police » par exemple, ainsi que le nom du professeur Moreau. Grâce à ce que m'avait raconté Nacer, il ne m'était pas difficile de reconstituer le puzzle : surpris par la police le matin même avec un jeune garçon dans son lit, le responsable du laboratoire d'études sémitiques anciennes du CNRS, Rodolphe Moreau, archéologue réputé, avait été arrêté et transféré immédiatement au siège de la police à Maan, capitale du gouvernorat dont Wadi Musa et Pétra dépendaient.
Mélanie Charles mit un terme à la conversation en sacrifiant aux salutations d'usage au Proche-Orient. Puis elle se leva. Sa silhouette me parut épaisse, avec des hanches larges, des fesses rebondies, des épaules rondes et une poitrine qu'on devinait lourde malgré un T-shirt très lâche. Sa bouche aux lèvres pleines sourit tristement à Nacer.
— Je viens de contacter un avocat à Amman, dit-elle en français. Il prendra la route en début d'après-midi pour descendre à Maan. Il espère être autorisé à voir le professeur ce soir ou demain.
— Vous avez eu l'ambassade de France ? questionna le Jordanien.
— Bien sûr. Je les ai appelés en premier. J'ai eu l'attaché culturel mais je l'ai senti sur la réserve : je crois que l'ambassade ne se mouillera pas beaucoup pour le professeur.
— On les comprend, intervins-je avec l'absence de tact qui me caractérisait trop souvent. Un enfant dans le lit d'un vieux monsieur, c'est chaud bouillant comme affaire !
Ses cheveux courts volèrent autour de ses joues lorsque Mélanie Charles se retourna brusquement vers moi. Ses yeux noisette s'assombrirent en me dévisageant :
— Pardon ? Vous êtes…
Nacer me présenta. Je lui tendis une main qu'elle serra sans chaleur.
— Ah oui, j'avais oublié cette histoire de reportage. Ça tombe plutôt mal. Je crois, monsieur Terras, que vous allez pouvoir reprendre l'avion très vite dans l'autre sens.
Sa réflexion me prit de court. Je n'avais pas encore eu le temps d'envisager les conséquences personnelles de cette trouble affaire. Dans les yeux de la jeune femme brilla une lueur de contentement qui m'aida à trouver une répartie.
— J'ai peut-être mieux sous la main comme reportage…
Sa bouche se crispa faisant gonfler les pommettes de son visage.
— Oh ! Il ne manquerait plus que ça !
— Les télés françaises vont s'arracher mes images.
Ses yeux clignèrent plusieurs fois mais elle ne laissa pas transparaître davantage son émotion.
— Les charognards sont déjà là. Je ne pensais pas que ce serait si rapide…
L'invective me cingla.
— Un archéologue, célèbre et apprécié, suspecté de pédophilie dans un pays musulman, que cela vous plaise ou non, c'est une information. Et même une sacrée information.
— Le scoop de l'année peut-être ?
— Pas loin.
— Ou celui de votre vie ?
— Je n'irais pas jusque-là, quand même…
— Vous en avez connu beaucoup d'aussi merveilleux dans votre carrière ? Le petit Grégory ? L'affaire Dutroux ? Les bébés congelés ? De bien belles affaires, comme les aiment les journalistes, n'est-ce pas ?
Je me retrouvais acculé à endosser le rôle du journaliste cynique et sans scrupule. J'avais l'habitude. Le costume m'allait bien. Une seconde peau. Je souris.
— J'ai un peu suivi l'affaire Grégory mais pas les autres. Je le regrette : c'étaient toutes des affaires passionnantes…
Sa bouche dessina une moue méprisante. Je poursuivis :
— J'ai surtout travaillé à l'étranger : j'étais reporter de guerre.
— Waouh… Et vous voici aujourd'hui parachuté envoyé spécial pour un film promotionnel sur un chantier de fouilles… Joli parcours professionnel ! Dites-moi : c'est à quel moment exactement que votre carrière a merdé ?
La colère agitait ses mamelles sous son T-shirt. La donzelle me chauffait les oreilles. Elle avait frappé juste. Si elle avait été un mec, je lui aurais brisé le nez.
— J'attendais une « belle affaire » justement pour me relancer, répliquai-je, la bouche acide. C'est bon, je suis servi.
Nacer tournait la tête de l'un à l'autre, désemparé par cette joute inattendue. Il posa ses deux mains sur les épaules de la jeune femme.
— Du calme, Mélanie, du calme, je vous en prie, implora-t-il. Nous avons d'autres choses plus importantes à faire que de nous disputer. Le professeur a besoin de nous. De vous surtout.
Il approcha son visage de celui de la jeune femme.
— Et nous, nous pouvons avoir besoin de la presse.
Elle me décocha un regard en coin.
— De celle-là, ça m'étonnerait !
— Peut-être que si. Écoutez-moi : nous savons tous les deux que le professeur n'a rien à se reprocher mais le sujet est sensible ici et les médias jordaniens risquent de suivre aveuglément les accusations de la police et même d'en rajouter. Nous aurons besoin de l'aide de la presse occidentale. Quelle qu'elle soit !
La jeune femme lui sourit mais, dans le même temps, dégagea ses mains de ses épaules. Elle recula son visage.
— C'est si grave que ça ? s'efforça-t-elle de plaisanter.
— Ça pourrait l'être.
— Vous avez sans doute raison, Nacer, vos conseils sont toujours sages…
— Et puis, je suis persuadé que Monsieur Terras n'est pas l'homme qu'il se plaît à vous faire croire.
Elle se tourna vers moi et me dévisagea pendant de longs instants. Elle grimaça avant de lâcher comme à regret :
— Le professeur Moreau est innocent. Il n'a rien fait.
Je m'appliquai à parler sur un ton calme et sobre :
— Comment expliquez-vous alors que ce garçon se soit retrouvé dans son lit ?
— Je ne me l'explique pas. Mais cela ne change rien : je sais qu'il est innocent, c'est tout.
Son nez charnu et sa bouche pulpeuse lui donnaient un air ingénu. Pourtant, elle venait de montrer qu'elle était une femme de tête, de forte tête même…
— Un reportage sur un Français injustement poursuivi dans un pays arabe, ça aurait de la gueule aussi, non ? avança-t-elle.
Elle était parvenue à adoucir son ton et son regard. Je n'étais pas dupe pour autant.
— Outreau, Patrick Dils, le jardinier Omar Raddad, ce sont aussi de belles affaires journalistiques, concédai-je. Vous pensez vraiment que Rodolphe Moreau est innocent ?
— J'en suis convaincue.
— Mais encore…
— Je ne l'imagine pas une seconde commettre une telle abomination. C'est un homme si délicat !
Elle baissa le ton le temps d'une phrase :
— Et puis, il a quatre-vingt-deux ans tout de même !
— Il faudra trouver d'autres arguments pour la police et la justice de ce pays.
Elle haussa les épaules :
— Ce n'est pas plutôt à eux de prouver sa culpabilité ?
— Ils ont trouvé un gamin dans son lit, ça peut leur suffire.
— Encore faut-il qu'il y ait eu viol !
Je la regardai sans rien ajouter. Je ne connaissais que le pitch de cette affaire, ignorais tout des détails, ne savais rien non plus des relations du prof avec la jeune Mélanie et encore moins des goûts éventuels du vieux bonhomme pour les petits garçons. Pas question d'avancer davantage sur des sables mouvants. L'assistante de Rodolphe Moreau avait décrété un armistice entre nous, je sentais qu'il était précaire et ne voulais rien faire, ni rien dire pour l'instant qui puisse le compromettre. Je ne croyais guère en l'innocence du vieux – et d'ailleurs je m'en foutais – mais je venais de réaliser que si le responsable du chantier de fouilles finissait aux galères, c'était probablement son adjointe qui prendrait sa suite. En me fâchant définitivement avec elle, je risquais de mettre en péril ce foutu reportage dont j'avais tant besoin.
Une eau à peine tiède coulait sur mon corps blanc. Le Comfort Hotel étant déserté par les touristes dans la journée, les responsables de l'établissement se permettaient, ni vu ni connu, de petites économies en coupant les chauffe-eau durant la matinée. Je m'en foutais, j'aimais bien l'eau froide et sa douce violence. Il paraît qu'une douche glacée raffermit la peau, améliore la circulation sanguine et renforce le cœur. Une copine qui écrivait des conneries dans un magazine féminin m'avait dit qu'elle stimulait aussi la libido et brûlait des calories, jusqu'à 120 par douche ! Pourtant je m’en moquais royalement. Pour la libido, le vieux célibataire que j'étais n'avait besoin d'aucun aiguillon supplémentaire et, quant aux calories, mon organisme avait trouvé depuis longtemps sa propre régulation. Le stress, les excès d'alcool, les nuits d'insomnie ou une rage intérieure, je n'aurais su dire ce qui était le plus efficace, mais je parvenais à conserver, en dépit d'une alimentation anarchique et aléatoire, la silhouette décharnée et déprimante d'un Iggy Pop neurasthénique. Sec comme un coup de trique, j'avais des muscles fins, saillants sous une peau tendue, et des flancs creux pouvant, selon l'éclairage, donner l'illusion d'une ceinture abdominale d'athlète.
Je sortis de la douche et me séchai.
J'avais récupéré en fin de matinée mes affaires et ma voiture au camp bédouin. Nacer m'y avait déposé avant d'emmener Mélanie Charles au siège de la police à Maan. J'étais maintenant installé dans ma chambre, réservée dans le même hôtel que celui des archéologues. Il était un peu cher pour mes frais de mission mais j'avais estimé que ce serait plus pratique au quotidien.
Reportage en stand-by pour l'instant. À peine arrivé, je me sentais donc désœuvré.
Dans la glace de la salle de bains, je découvris un homme fatigué. Deux fossés profonds se creusaient autour de mon long nez et de ma bouche aux lèvres sévères. Je passai ma main sur ma joue. Des poils blancs se mêlaient aux noirs, ils crissèrent sous la pulpe de mes doigts. La main glissa dans mon cou, juste à côté de la pomme d'Adam, pour masser doucement une bande de peau jeune et granuleuse.
Je pris mon rasoir dans ma trousse de toilette. Si je ne voulais pas paraître plus vieux de dix ans, je ne pouvais plus me permettre de laisser vivre une barbe, ne serait-ce que de quelques heures. Je me savonnai le bas du visage pour préparer ma peau mais me ravisai aussitôt. Qu'est-ce que ça pouvait bien me foutre de paraître plus que mon âge ? Je me rinçai, rangeai mon rasoir et m'habillai d'un jean et d'une chemisette verte.
Puis je m'assis sur mon lit.
Je repensai à ma dispute avec Mélanie Charles. J'avais parlé sans réfléchir mais ce que j'avais dit n'était pas si con. L'arrestation du professeur Moreau constituait une véritable information. Elle allait s'ébruiter rapidement et ce serait dommage de se faire griller par un confrère. J'avais encore quelques contacts dans la presse nationale, il me suffisait de les réactiver. D'abord vendre l'info à un grand quotidien, ensuite tourner quelques images, écrire un commentaire et balancer le tout à une chaîne de télévision.
J'allumai mon téléphone portable pour consulter mon carnet d'adresses. Mes amitiés me portaient davantage vers Libération et la télévision du service public mais mes intérêts financiers me commandaient de me rapprocher plutôt de mes relations au Parisien et dans une chaîne d'information continue. Ils payaient mieux et plus vite.
Le Comfort Hotel mettait trois ordinateurs et une liaison Internet à la disposition de ses clients dans une pièce au rez-de-chaussée. J'y descendis. Il aurait été évidemment plus simple d'appeler mes contacts depuis mon portable mais, pour économiser trois francs six sous, j'avais il y a longtemps déjà, résilié tout abonnement international. Avant de partir, je n'avais pas songé une seconde que je pouvais en avoir besoin ici. Qui aurait bien pu vouloir me joindre en Jordanie, si ce n'étaient mon banquier et les quelques huissiers aigris qui s'accrochaient à ma misère comme des morbacs à la toison défraîchie d'une vieille pute albanaise ?
Pascal Antoine, responsable du service Étranger au Parisien, me commanda un papier de deux feuillets pour l'édition du lendemain avec si possible une photo du siège de la police à Maan. N'importe quel cliché de policiers jordaniens en uniforme pouvait également faire l'affaire, l'essentiel étant d'accompagner l'article d'une illustration du jour depuis la Jordanie : cela crédibiliserait l'information. En ce qui concernait le professeur, le quotidien ressortirait un vieux portrait de ses archives.
La partie s'engageait à ma convenance. Après la parution du journal, tout le monde allait se précipiter sur le sujet. J'envoyai d'autres mails à mes différents contacts dans les chaînes de télévision pour les avertir que je serai en mesure de leur fournir des images dès le lendemain : il s'agissait maintenant de faire monter les enchères. Je savais qu'elles n'atteindraient pas des sommets mais je voulais en tirer le maximum tout de suite. Si la sauce prenait, tout le monde enverrait des équipes sur place et je deviendrais alors quantité négligeable. Et si elle ne prenait pas, il n'y aurait de toute façon plus rien à gagner les jours suivants.
Dans mon sac à dos de reportage, je glissai une carte mémoire d'avance, une batterie de rechange, un câble son et un micro. Puis je vérifiai les réglages de la caméra. Je quittai ensuite l'hôtel pour reprendre le chemin de Pétra : j'avais encore le temps de réaliser des images du chantier de fouilles avant de filer à Maan.
Juste après avoir franchi le portail d'entrée du site, je négociai le trajet avec le conducteur d'une calèche. Le cheval trottina allègrement jusqu'au Sîq, le spectaculaire défilé qui constitue la véritable porte d'entrée de Pétra. Je suivais maintenant le parcours classique du visiteur. Celui aussi qu'avaient emprunté il y a deux siècles les premiers explorateurs de Pétra.
Le cheval ralentit en pénétrant dans le Sîq. La foule jusqu'ici bruyante des touristes s'apaisa tout d'un coup. La montagne s'ouvrait pour nous et, entre les parois prodigieuses, ne montaient plus que des murmures admiratifs. Le ciel, cent mètres au-dessus de nos têtes dressées, se réduisait à une simple lézarde. Né d'une faille provoquée par un séisme, le Sîq avait été poli, crue après crue, par les eaux du wadi. Je commençais à comprendre pourquoi les guides touristiques prétendaient qu'avant d'être une merveille archéologique, Pétra constituait d'abord un prodige naturel.
Le chemin filait en pente douce comme s'il s'enfonçait toujours plus profondément. Le conducteur de la calèche ralentit encore son cheval. À certains endroits, nous passions tellement près de la muraille que j'aurais pu toucher la roche.
Soudain, un miracle rose apparut devant moi, là-bas, tout au bout de la faille. Je fis arrêter la calèche et descendis avec ma caméra et mon trépied. Cette image, je l'avais vue mille fois. Mieux encore que celle du Deir, la façade du Khazneh – appelée aussi le Trésor – symbolisait Pétra. Elle figurait sur la plupart des livres et des brochures de voyage et je me devais de la filmer. Même si le reportage que je réalisais pour l'instant n'avait rien de touristique, il faudrait y glisser ce plan à un moment ou à un autre.
Je posai la caméra sur le pied, effectuai mes réglages : l'obscurité de la paroi tapissait un premier plan mystérieux que déchirait au centre la lumineuse façade creusée dans la montagne de grès ferrugineux. Le Khazneh n'était pas seulement la vitrine de Pétra. Offert au visiteur après une vingtaine de minutes de marche dans le Sîq, il représentait la plus belle de ses promesses…
Suivi par la calèche, je parcourus à pied les derniers mètres. Le défilé s'ouvrait sur une clairière que la nature avait aménagée dans la montagne. Avec le Khazneh, les Nabatéens avaient donné libre cours à leur talent, révélant sur quarante mètres de haut leur fameux Trésor, ses colonnes et ses niches, ses statues équestres et son urne sommitale. Déployée en arc de cercle, bras levés et armés de téléphones et d'appareils photo, la horde des touristes s'acharnait à immortaliser l'instant.
Le parcours des calèches s'arrêtait ici. Commençait maintenant le circuit des chameaux et des mules. Trop lents. Je demandai au conducteur de la calèche d'attendre mon retour et je continuai à pied, mon matériel sur l'épaule. Après le tombeau, le passage s'élargissait. Je marchai d'un pas rapide dans ce que l'on appelle la rue des Façades, une succession de tombes et d'habitations qui décoraient les parois. J'arrivai bien-tôt devant le théâtre de Pétra. Creusé lui aussi dans la roche, il étalait sous le soleil d'automne des gradins roses aux lignes adoucies par l'érosion.
Deux cents mètres encore. Et les montagnes s'écartèrent pour me laisser découvrir la ville basse, une longue allée bordée de petites collines. J'arrivais enfin au chantier. Les ouvriers n'étaient plus là mais la grille qui protégeait les fouilles restait fermée. Ça me convenait ainsi. Je posai mon trépied dans le sable et filmai. Plans larges sur l'ensemble des fouilles ceinturées par la grille close. Gros plans sur les panneaux d'interdiction au public avec, passant devant, des silhouettes anonymes et furtives de touristes. Enfin, au zoom, je shootai quelques outils abandonnés çà et là parmi les vieilles pierres.
Il me fallait encore un plan de situation, une vue d'ensemble du site. Je remis mon matos sur l'épaule pour grimper la colline en face du chantier. Le soleil cognait dur et je sentis des gouttes de sueur couler sous mes aisselles. À mi-pente, je reposai le pied à côté des ruines d'une ancienne église byzantine. Je réalisai un panoramique depuis les tombes royales creusées dans le djebel Khubta – la plus belle succession de façades de Pétra – jusqu'au chantier. De gauche à droite puis de droite à gauche. Classique. C'est une règle de base, chaque mouvement de caméra doit s'effectuer dans les deux sens afin de permettre au monteur tous les raccords possibles.
Une fois le panoramique terminé, je n'éteignis pas tout de suite la caméra. Quelque chose ou plutôt quelqu'un avait retenu mon attention. Sur l'autre versant de la colline, un homme immobile regardait dans ma direction. Il portait une robe de Bédouin blanche et un keffieh. Je zoomai pour mieux le détailler. L'homme pointait effectivement ses jumelles sur moi. Il devait s'être aperçu que je le fixais à mon tour mais il ne broncha pas. Sous la paire de jumelles, une grosse moustache noire surplombait une bouche charnue et une mâchoire carrée. Je déclenchai la caméra et fis mine de m'intéresser à des éclats de poterie qui jonchaient le sol. Il y en avait partout. Je m'accroupis pour en ramasser quelques-uns et les fourrai dans la poche de mon pantalon. Quand je me relevai, l'homme avait disparu mais son image resterait dans la boîte.
Je redescendis la colline. Je retrouvai ma calèche devant le Khazneh. Nouvelle traversée du Sîq. Le détour m'avait demandé moins d'une heure.
Chapitre 4
« Les hommes sont comme le temps : moitié lumière, moitié ténèbres. » Abou l'Ala' Al-Maari, philosophe arabe (973- 1057).
Une femme flic faisait la circulation devant le siège de la police du gouvernorat de Maan. Elle portait un foulard blanc sous son calot et un gilet fluo jaune par-dessus son uniforme bleu-poulet. D'un mouvement de bras autoritaire, elle empêchait le flot anarchique des voitures de ralentir devant les grilles de l'austère bâtiment, un cube de parpaings gris simplement décoré au premier étage d'une rangée de balcons en béton. Son visage impassible ne se laissait pas troubler par les nombreux coups de klaxon des automobilistes.
Dissimulé par une énorme benne métallique servant de poubelle aux habitants du quartier, je déployai discrètement le trépied de ma caméra. Repoussant un vieux carton, quelques plastiques et des épluchures de légumes, je le posai sur l'asphalte taché de graisses. J'avais choisi de rester à une distance raisonnable du siège de la police et de travailler à fond de zoom pour ne pas prendre de risques inutiles : filmer un bâtiment officiel nécessitait ici des autorisations que je n'avais pas eu le loisir de demander. J'enregistrai donc vite fait bien fait quelques plans du bâtiment. Plans larges avec la rue et les voitures, plans serrés des balcons et des fenêtres ainsi que des pancartes « Police » en arabe et en anglais, puis un panoramique vertical depuis l'entrée jusqu'au toit constellé d'antennes paraboliques. Entre chaque prise de vue, je regardais dans la direction opposée en fumant négligemment une cigarette.
Une femme en tchador noir traversa le boulevard devant moi en direction du siège de la police. Je jetai ma clope et fis un réglage rapide de l'objectif. Zoom sur la fliquette, ouverture du diaphragme, mise au point. Parfait. J'appuyai discrètement sur la touche REC et reculai de deux pas, me contentant de surveiller à distance l'écran LCD de la caméra. J'y vis la musulmane en tchador entrer dans mon champ et passer devant la policière sans un salut, sans un regard. Yes, bingo ! Image symbole du choc de deux mondes, la femme soumise et celle qui travaille. J'avais bien conscience du caractère réducteur de ce cliché facile mais je savais qu'il plairait aux chaînes occidentales.
Je repérai ensuite dans une impasse voisine la voie de sortie des véhicules de police. J'attendis patiemment d'en voir un surgir pour le filmer. Puis je m'éloignai et enregistrai d'autres images dans les rues adjacentes, histoire de faire « couleur locale ». Des carcasses de viande à l'étal d'une boucherie, un vendeur de souvenirs et de jouets en plastique, des vieux en keffieh tirant sur le tuyau d'un narguilé. Je rangeai ensuite mon matériel dans la voiture et me rendis au siège de la police. Le planton à l'entrée regarda longuement mon passeport mais me laissa entrer sans autre formalité.
Dans le hall d'accueil, je retrouvai Nacer Ousman et Mélanie Charles conversant avec un homme en costume sombre que je supposai être l'avocat venu d'Amman. Nacer me sourit poliment. La discussion avec l'avocat se déroulait en arabe, pourtant il m'avait semblé en m'approchant reconnaître quelques mots de français. Ils avaient dû changer pour que je ne pige rien. C'était de bonne guerre. Je m'éloignai de quelques pas.
Derrière le guichet, un policier trop gras somnolait. Au-dessus de sa tête trônait le portrait du jeune roi Abdallah II. Jeune ? À la réflexion, il devait avoir déjà la cinquantaine. Le même âge que moi peut-être bien. Pourtant ses traits épais lui donnaient l'allure d'un adolescent attardé et je cherchai vainement sur son visage les traces du charisme de son défunt père, le roi Hussein. La photo le montrait déguisé d'un keffieh arabe, lui, le demi-Anglais ayant fait ses études en Occident et parlant mieux la langue de Shakespeare que celle de son peuple ! Par quel miracle la monarchie jordanienne avait-elle pu traverser le printemps arabe du début des années 2010 sans se faire éclabousser de sang ?
Nacer se planta devant moi et me résuma l'entretien avec l'avocat.
— Maître Mansour a pu voir le professeur. Il est très affligé par cette affaire mais il se porte plutôt bien malgré une grande fatigue. Comme nous le pensions, il ne reconnaît pas les faits qu'on lui reproche. Il ne comprend pas ce que l'enfant faisait dans son lit ce matin. C'est à son réveil seulement qu'il s'est aperçu de sa présence. Le garçon a neuf ans. Il n'a pas pu témoigner car il est muet. Un peu simplet aussi. C'est un petit Bedoul d'Umm Sahyoun…
— Un quoi ?
— Un Bedoul. C'est la tribu de Bédouins qui vivait sur Pétra. Ils ont été déplacés dans les années soixante-dix pour ouvrir le site au tourisme de masse. Le gouvernement leur a offert à tous une maison dans un village construit sur une colline juste à côté, Umm Sahyoun.
— Génial ! Et tous les Bedouls ont accepté ce déplacement ?
Nacer ajouta avec une mimique légèrement méprisante :
— Ils ont trouvé leur compte dans ces changements. Les hommes sont devenus guides, ils louent leurs mules et leurs chameaux ; les femmes, elles, ont toutes une échoppe. Les affaires sont prospères malgré la chute du tourisme liée à la situation politique dans la région.
Par ma faute, nous nous étions éloignés du sujet. Je recadrai l'entretien.
— Est-ce qu'un examen médical a été fait sur le gamin ?
— Pas encore.
— Votre avocat va le réclamer, je suppose ?
— Évidemment.
Mélanie Charles nous rejoignit. Elle s'adressa à Nacer :
— Les enquêteurs ne veulent pas que je voie le professeur.
— C'était prévisible, lui répondit-il doucement. Demain peut-être.
— Ils ne veulent pas non plus le libérer sous caution. Ils disent que c'est trop tôt.
— C'était prévisible également. Mais il fallait faire la demande tout de suite.
Pour la première fois, la jeune femme posa ses yeux sur moi.
— J'ai un service à vous demander, monsieur Terras.
J'avais déjà compris qu'elle allait me réclamer l'impossible.
— Il faudrait que vous attendiez quelques jours avant de publier l'information. Avec un peu de chance, les accusations vont s'effondrer d'elles-mêmes.
Je faillis m'étouffer. « Quelques jours… » ? Et pourquoi pas dix siècles pendant qu'elle y était ! Non, ce n'était pas possible, vraiment pas. Et puis cette « chance » qu'elle évoquait constituait pour moi un risque que je ne pouvais pas courir. L'abandon éventuel des poursuites signifierait la fin de tout projet d'article. Quel journal en effet accepterait un papier une fois l'affaire terminée et le professeur blanchi ? Devant mon visage fermé, Mélanie Charles réduisit sa demande.
— Quarante-huit heures déjà, ce serait bien.
— Si les accusations sont fausses, nous ferons un démenti après publication, proposai-je.
— Vous savez bien qu'une fois une réputation salie, il faut davantage qu'un démenti pour la rétablir…
Je sentis qu'elle peinait de plus en plus à masquer son mépris et à garder son calme.
— J'ai promis un papier pour demain matin à un journal parisien. Je dois l'envoyer dès ce soir.
— Il n'y a pas moyen de leur demander d'attendre un peu ? Vingt-quatre heures au moins ?
Comment expliquer à cette jeune archéologue – dont la notion du temps et de l'urgence n'avait rien à voir avec celle de mon métier – que l'information ressemblait aujourd'hui à une moto lancée à une allure démente sur une route cabossée ? Rien n'était prévu pour les arrêts d'urgence.
— Je ne peux pas revenir en arrière, ils publieront l'information quoi que je fasse.
Elle ouvrit deux yeux ronds effarés. Comme ceux d'un lapin piégé par les phares de cette folle moto.
— Alors moi ou un autre, c'est pareil, insistai-je.
Son regard se fit dur, son ton se colora de fiel et d'amertume.
— Autant que ce soit vous, c'est ça ?
Je haussai les épaules, jouant le fataliste alors que l'énervement lentement me gagnait. Après avoir survendu le sujet auprès de mes derniers contacts dans la presse nationale, je ne pouvais me déjuger et prendre le risque de me griller définitivement. Alors oui, autant que ce soit moi qui palpe un peu de fric avec cette histoire…
Comme je ne disais rien, elle poursuivit sur un ton plus dur :
— « Si ce n'est pas moi, de toute façon, ce sera un autre. » : l'éternelle rengaine. Vous savez que c'est avec ce type de phrases que les gens ont toujours justifié les pires exactions. « Si ce n'est pas moi, ce sera un autre », c'est ce que disaient aussi les flics français quand ils participaient à la déportation des juifs.
En trois phrases excessives, elle avait conduit mon sens de la diplomatie – assez faible au demeurant – à son point de rupture. Il ne me restait que l'humour pour ne pas exploser à mon tour :
— Je ne savais pas que le professeur Moreau était juif…
Mélanie Charles resta bouche bée. Elle n'avait pas saisi l'ironie et se demandait si j'étais vraiment aussi crétin que j'en avais l'air.
Décidément, entre cette dondon et moi, le courant ne passait pas. Ou plutôt il passait trop bien. Cent mille volts. Il suffisait d'un mot de trop pour provoquer un arc électrique dévastateur. J'avais accepté de calmer le jeu le matin à l'hôtel mais je ne me sentais pas obligé de baisser mon froc à chaque fois devant elle. Et tant pis si mon attitude compromettait l'avenir de ce putain de documentaire de merde !
— Je suppose que ce n'est pas la peine que je sollicite une interview de votre part, enchaînai-je. Tant pis, il n'y aura donc pas de contrepoint aux accusations de la police jordanienne !
Je tournai les talons sans un salut et sortis. Nacer m'emboîta le pas et me rattrapa sur le perron devant le bâtiment.
— Il ne faut pas en vouloir à Mélanie, monsieur Terras. Elle est à cran, elle a beaucoup d'estime pour le professeur, vous savez.
— J'avais compris…
Le jeune homme, gêné, caressa sa barbiche de l'index et du pouce.
— Oubliez ce qu'a dit Mélanie, elle ne le pensait pas. Nous vous faisons confiance, monsieur Terras.
— C'est ça, oui. Vous dites ça parce que vous n'avez plus le choix ! N'ayant pas réussi à retarder la divulgation de l'information, vous essayez maintenant de m'amadouer. Vous vous êtes réparti les rôles ou c'est spontané ?
Ma réplique le prit de court. Le français, soudain, lui devint difficile.
— Vous… Je… peut-être. Enfin…
Je mis tout de suite un terme à son embarras.
— Ne vous inquiétez pas, ça fait vingt-cinq ans que je fais ce métier et je n'ai pas pour habitude de laisser mes humeurs et mes inimitiés pervertir mon jugement. Mon article ne sera pas à charge contre le professeur. J'ai bien compris la sympathie qu'il suscitait autour de lui et j'ai conscience que, pour l'instant du moins, le dossier n'est pas très fourni.
Un chapelet de coups de klaxons m'interrompit quelques secondes.
— Mais il y a toujours la présence inexpliquée de cet enfant dans son lit et le fait qu'il a été placé en garde à vue par la police jordanienne. Ça, c'est un élément objectif contre lequel vous et moi ne pouvons rien.
Je lui fis un signe d'adieu et lâchai dans mon arabe de bazar :
— Marsalaama. (Au revoir)
— Marsalaama, sadiki. (Au revoir, mon ami)
Je saluai la femme-flic en passant devant elle. Elle ne me répondit pas.
Je rentrai dans le premier cybercafé que je trouvai et m'installai devant un ordinateur. Le gérant me servit un thé à la menthe pendant que je commençais à écrire mon article. Deux feuillets, ce n'était pas bien long et comme je ne croulais pas sous les informations, je n'eus pas de mal à faire le tri. J'enrichis le texte de quelques éléments sur le chantier de fouilles. J'y ajoutai une bonne louche de biographie. Là, j'avais le choix parmi les décorations et les honneurs reçus par Rodolphe Moreau – ordre national du Mérite, Légion d'honneur – ainsi que parmi ses titres et fonctions – docteur d'État en archéologie, ancien directeur de l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient, président de la Société européenne d'archéologie et membre du comité de rédaction de plusieurs revues spécialisées… En revanche, pas beaucoup de détails sur sa vie privée : le professeur Moreau était né en octobre 1931 à Nîmes dans une famille de la bourgeoisie protestante. Il était célibataire et sans enfant. Point. Toute sa vie semblait tourner autour de son métier-passion. Il avait mené de nombreuses missions au Proche-Orient, à Pétra évidemment, mais aussi dans un autre site nabatéen moins connu, celui d'Al-Hijr en Arabie Saoudite.
Une heure plus tard, j'avais pondu le papier. J'y joignis une photo du poste de police réalisée avec mon téléphone. J'envoyai le tout d'un seul clic et sortis fumer une clope en attendant un accusé de réception. J'avais pris le temps d'acheter un paquet neuf à Wadi Musa et j'allumai avec plaisir une Winston bien droite. La nuit était tombée, la fraîcheur du soir envahissait les rues de Maan.
Le fumet s'échappant d'une échoppe voisine troubla le parfum de ma cigarette. Ma nourriture du jour s'était limitée à quelques paquets de gâteaux secs arrosés de thé, si bien que la vision d'une pyramide de viande suintant de graisse chaude mit mon ventre au supplice. Je me commandai un shawarma que je dévorai sur le champ, en trois bouchées et en apnée complète.
Les doigts encore poisseux de jus, je m'installai à nouveau devant l'ordinateur. Pascal Antoine m'avait déjà répondu. Il avait lu mon article, effectué quelques corrections et me demandait mon accord avant publication. Je le lui donnai sans barguigner : passé entre ses mains, le texte gagnait en pertinence. Pascal était un pro, un vrai, un de ceux qui me donnaient des regrets d'avoir opté dans ma jeunesse pour l'audio-visuel plutôt que la presse écrite. Il avait même trouvé le temps de passer quelques coups de fil pour dénicher des infos inattendues sur Rodolphe Moreau. Du lourd, comme on dit dans le métier ! Ces nouvelles nous firent considérer avec plus d'attention les accusations de la police jordanienne mais nous estimâmes d'un commun accord que leur divulgation était prématurée. Nous verrions, avant d'exhumer de vieux fantômes, si « l'affaire » actuelle se confirmait.
Je pris encore le temps de consulter ma messagerie personnelle. J'y trouvai un flot de conneries sans importance, le mail d'une ancienne maîtresse souhaitant m'inviter à dîner et celui de ma sœur cadette qui s'inquiétait pour son frère unique et préféré. Je me promis de lui envoyer prochainement une carte postale de Pétra, ce serait toujours mieux qu'un mail rapide et impersonnel. Je fis glisser le message de l'ancienne amante dans le dossier des « éléments supprimés » et quittai le cybercafé.
Je m'offris un second shawarma en guise de dessert avant de reprendre la route pour Pétra. Je mis deux fois plus de temps qu'à l'aller car conduire de nuit en Jordanie relevait, au mieux de la roulette russe, au pire d'une tentative de suicide. Il fallait composer avec les véhicules peu, voire pas du tout éclairés, les piétons téméraires ou les animaux, une signalisation défectueuse et l'absence presque totale de bandes réfléchissantes sur les chaussées. Mais j'avais connu pire encore sous d'autres cieux.
Arrivé à bon port au Comfort Hotel de Wadi Musa, je trouvai un message dans mon casier : la chaîne de télévision à qui je devais envoyer mes images m'informait que cet envoi pour-rait se faire depuis Aqaba et que je n'étais pas obligé de me rendre le lendemain dans la capitale jordanienne. C'était une bonne et une mauvaise nouvelle : je troquai en effet quatre à cinq heures de trajet contre deux seulement. Mais la route pour Aqaba passait par Maan d'où je venais ! J'aurais pu m'y rendre directement dès ce soir…
Au lieu de regagner ma chambre tout de suite, je fis une halte par le bar de l'hôtel. Heureusement, on y vendait de l'alcool. Je snobai le whisky pour une boisson plus locale : de l'arak avec des glaçons. Un peu rude mais exotique. Je repensai à Mélanie Charles. Elle ferait moins la fière lorsque je lui balancerais le passé sulfureux de son idole. Pascal Antoine m'avait lu en diagonale un article paru au début des années soixante-dix dans L'Aurore. L'auteur avait trempé sa plume dans le vitriol. Le professeur en prenait pour son grade : le « pervers sodomite », c'est ainsi que le journaliste l'avait qualifié, entre autres gracieusetés.
La fatigue me tomba rapidement dessus. Après une nuit dans l'avion puis une autre dans un bivouac inconfortable, j'avais besoin de récupérer. Il me fallait dormir au moins huit heures. Je n'avais plus vingt ans et je devais gérer mes excès comme un sportif ses exploits.
Chapitre 5
« Crois si tu veux que des montagnes ont changé de place, mais ne crois pas que des hommes puissent changer de caractère. »