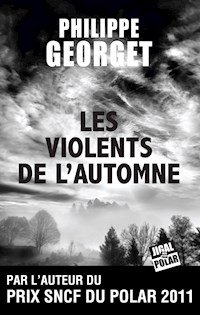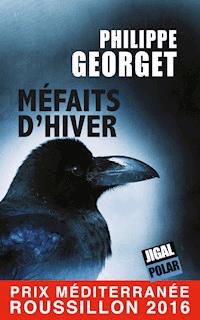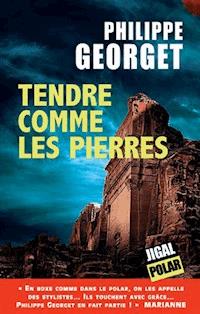Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Jigal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lieutenant Sebag
- Sprache: Französisch
Un pénitent est tué et une bijouterie braquée lors de la procession de la Sanch à Perpignan...
Un Vendredi Saint à Perpignan. Comme chaque année depuis cinq siècles, la procession de la Sanch se met en marche. Sept cents pénitents défilent dissimulés sous leur traditionnelle caparutxe – longue robe de bure et cagoule. Soudain, quelques pétards brisent le silence et la panique gagne la procession. Quand le calme revient, un pénitent ensanglanté reste étendu à terre, poignardé. Au même moment un violent hold-up se produit, non loin de là, dans une bijouterie… L'enquête conduit très vite le lieutenant Sebag des ruelles encombrées du quartier gitan de Saint-Jacques aux appartements feutrés de la bonne société catholique catalane. Mais y a-t-il un lien entre ces affaires alors que plane ici, l'ombre aussi poétique qu’ambiguë du Fou chantant, qui, ado, arpentait déjà ces mêmes ruelles…
Suivez le lieutenant Sebag dans cette enquête qui vous mènera dans les recoins les plus mystérieux de la ville, avec ce roman policier régional haletant !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Un auteur remarquable avec un « touché d'écriture […] Finesse et subtilité sont deux des piliers de ce roman. Ici on prend le temps de ne négliger aucun détail et on prend aussi le temps de vivre, de manger et de se sourire. Philippe Georget mérite mon coup de cœur pour ces 264 pages menées de façon formidable !" - Bruno Delaroque, Whoozone
"Les personnages sont bien campés, les éléments relevant de l'enquête policière et de la vie personnelle de Sebag savamment dosés. Vraiment rien à redire à ce récit envoûtant. C'est pourquoi je remercie du fond du coeur Babelio et les éditions Jigal pour cette madeleine de Proust qui plaira aussi bien aux Catalans qu'aux Parisiens (petit clin d'oeil) !" - dedanso, Babelio
"Un excellent moment de lecture pour qui veut mieux comprendre les dessous de cette région."- Lalitote, L'atelier de Litote
"Deux belles énigmes, embrouillées à souhait, deux enquêtes dans des milieux fermés peu propices aux confidences. Philippe Georget écrit bien, il écrit juste et maîtrise ses histoires de bout en bout. Un excellent polar à suivre patiemment afin de découvrir ce qui se cache sous les cagoules, les caparutxe, les rouages d'une machination diabolique en pleine fête rédemptrice et l'obstination d'un flic attachant." - Psycho-Pat, Quatre sans quatre
À PROPOS DE L'AUTEUR
Philippe Georget est né en 1963 quelques jours après la mort de Kennedy, mais ne cherchez pas, il a un bon alibi ! Il a 20 ans quand il découvre la solidarité en participant à la construction d’une école au Nicaragua. De retour en France, il reprend des études qui le conduiront à une licence d’histoire puis une maîtrise de journalisme en 1988. Il travaille d’abord pour Radio France et Le Guide du Routard avant de se lancer dans la télévision régionale du côté d’Orléans. Il y travaille comme journaliste rédacteur, cameraman et présentateur. En 2001, il embarque femme et enfants dans son camping-car et fait le tour de la Méditerranée de Marseille à Marseille en passant par l’Italie, la Grèce, la Turquie, la Syrie, la Jordanie, la Libye et la Tunisie…. À son retour, il pose ses valises dans les environs de Perpignan. Et c’est là, en pays catalan, qu’il situe la plupart des intrigues de ses romans. Une terre qu’il apprécie tout particulièrement et dont il arpente en courant — et probablement pour se défouler entre deux chapitres de son prochain roman — les sentiers sauvages. Il compte d’ailleurs trois marathons à son actif sans compter celui dont il a un jour raté le départ, ayant malencontreusement pris celui de la course d’à côté ! Un écrivain marathonien… ceci explique sans doute cela !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CHAPITRE 1
L’homme de tête portait une longue robe rouge. Posée sur sa tête, la caparutxa, une cagoule haute et conique, dissimulait son visage. Deux trous découpés dans le tissu laissaient entrevoir des yeux sombres, un regard attentif.
Le regidor agita la cloche de fer qu’il tenait au bout de son bras. Quatre tintements inquiétants. Des tambours voilés d’un crêpe noir lui répondirent. Quatre roulements lugubres.
La procession de la Sanch se mit en rang, sept cents personnes y prirent place. Derrière le groupe des tambours, un pénitent s’avança pieds nus. Un baudrier accroché à ses flancs soutenait une croix de trois mètres de haut. Pesante. Imposante. La Creu dels Improperis symbolisait les outrages endurés par le Christ durant la Passion. Sur son bois s’accrochaient des clous, une lance, un marteau… Treize outrages au total. Après la croix se rangea le premier misteri. Il y en aurait une trentaine. Portés sur les épaules des pénitents, ils reconstituaient les scènes du Calvaire. Le plus ancien datait du XVIIe siècle. Le plus lourd pesait 250 kg et nécessitait douze personnes pour le déplacer.
Tous les hommes étaient masqués, cachés sous la traditionnelle caparutxa qui, contrairement à celle du regidor, brillait pour eux d’un noir profond. À l’origine, le terme caparutxa ne désignait que la coiffe mais, par extension, on nommait aujourd’hui ainsi toute la tenue du pénitent, une longue robe de bure descendant jusqu’aux pieds. Unique parure sur ce vêtement sévère : une cordelière dont la couleur distinguait la paroisse d’origine. Dans la procession, seules les femmes défilaient à visage découvert. Jupe droite et stricte, veste noire, une mantille emprisonnant les chevelures, elles portaient le deuil de Jésus.
La Sanch, le Précieux Sang du Seigneur.
Les haut-parleurs crachotèrent et le silence se fit parmi la foule massée autour de l’église Saint-Jacques. Dans un court sermon, l’évêque de Perpignan rendit hommage aux victimes d’attentats récents, assurant qu’il voyait leurs visages de martyrs chaque fois qu’il contemplait le « corps torturé et douloureux du Christ sur sa croix ». Il eut ensuite quelques mots pour remercier les forces de l’ordre sécurisant la cérémonie. Le public applaudit.
— Ça nous fait une belle jambe, marmonna le lieutenant de police Jacques Molina à l’oreille de son collègue. Comme si on n’avait pas autre chose à foutre que d’être là.
Face aux menaces terroristes, la protection de la procession pascale exigeait chaque année davantage de moyens. Une cinquantaine de policiers municipaux que renforçaient une trentaine d’hommes du commissariat de Perpignan, une unité de soldats de l’opération Sentinelle et quelques agents de la Direction générale de la sécurité intérieure disséminés en civil parmi la foule.
— Ne râle pas. Pour l’instant, il fait beau.
Le lieutenant Gilles Sebag réajusta le brassard « Police » fixé à la manche de son blouson. Lui était plutôt ravi d’être là. Né il y a quarante-deux ans en banlieue parisienne, il avait émigré en pays catalan une dizaine d’années auparavant et c’était avec un étonnement toujours renouvelé qu’il assistait chaque Vendredi Saint à la procession de la Sanch. Même si elle attirait aujourd’hui plus de touristes et de curieux que de croyants, cette tradition vieille de plus de six cents ans diffusait dans les rues de Perpignan un parfum de spiritualité qu’il trouvait exotique. Unique en France, elle n’avait son équivalent qu’à Séville en Espagne.
Des rires roulants de gamins troublèrent les derniers mots de l’évêque. Indifférents aux regards noirs que leur jetaient les fidèles, des petits gitans jouaient à s’attraper.
— Allez vous amuser ailleurs, leur intima Molina.
— Pan, répliqua un môme d’à peine six ans en posant son doigt sur le fusil-mitrailleur que tenait le policier.
Des enfants plus âgés entraînèrent heureusement l’effronté loin de la colère naissante de Molina. Ils s’égayèrent dans la foule comme une volée de moineaux.
Après son homélie, l’évêque entonna une prière. Notre Dame des douleurs. Dans la foule, quelques personnes se signèrent. Trois coups sonnèrent ensuite au clocher de l’église. La cloche de fer du regidor retentit à nouveau, suivie par les tambours. Quand un chant funèbre coula des haut-parleurs, le regidor avança d’un pas solennel. Derrière lui, le cortège s’ébranla.
— Reculez, s’il vous plaît, reculez.
Marchant quelques pas devant l’homme en rouge, deux policiers de la brigade anti-criminalité maintenaient à distance la horde de photographes. La foule était compacte, la rue étroite et les consignes strictes. Trois mètres minimum.
Après un premier virage, le cortège déboucha place du Puig, au cœur du quartier le plus miséreux de la ville. Autour de cette place, dans une flopée d’immeubles délabrés voire insalubres, vivaient près de cinq mille Gitans. Sédentarisés depuis des siècles en pays catalan, la communauté avait investi ce quartier du centre ancien à partir des années cinquante lorsque ses habitants partirent chercher ailleurs des logements plus modernes et spacieux.
Évangélistes pour une grande majorité d’entre eux, les Gitans contemplaient la procession avec un intérêt non dénué de gourmandise. Quelques vieux avaient sorti leurs chaises pliantes et s’étaient installés comme au spectacle. À une époque pas si lointaine, il était arrivé que des œufs soient jetés sur son passage. Une sorte de revanche sociale pour les Gitans quand toute la bonne société catalane défilait, en pleine contrition, sous leurs fenêtres.
Encore quelques zigzags dans le quartier Saint-Jacques et la procession enfila la rue Rabelais pour une lente descente vers le centre-ville.
***
Protégé de la curiosité de la foule par sa caparutxa, il avançait pieds nus sur le bitume. Malgré son épuisement, il avait cette année encore trouvé dans la pénitence un réconfort. Dieu ne lui refusait pas ce fugitif repos.
Durant son enfance, Christian avait participé chaque Vendredi Saint à la Sanch mais il s’en était échappé à l’adolescence. Il n’y était revenu que sur le tard. Et après les cinq années réglementaires de probation, il avait été admis au sein de l’Archiconfrérie.
Mais Dieu lisait dans son âme. Et, malgré sa clémence, il avait décidé de le punir.
Il ferma un instant les yeux. Les goigs résonnaient dans la rue. Quelle grâce que celle de ces chants religieux catalans !
Une aspérité sur la chaussée rugueuse lui arracha une grimace qu’heureusement personne ne put voir. La pénitence pour lui n’était pas un vain mot.
Hier, il s’était brûlé la plante des pieds afin de rendre sa peau plus sensible. La souffrance le connectait directement à Dieu. Une ivresse, une extase. Avant, il se donnait plutôt de petits coups de rasoir mais les plaies trop visibles attiraient l’attention. Les responsables de l’Archiconfrérie avaient menacé de l’exclure, on ne plaisantait plus de nos jours avec les excès de ferveur… Mauvais pour l’image. Vis-à-vis des touristes comme de l’Église.
À travers les trous de sa caparutxa, ses yeux glissèrent sur la foule. Regards étonnés voire goguenards, appareils photo et téléphones brandis. Les images de la procession se retrouveraient très vite sur les réseaux sociaux. Il en imaginait les commentaires. Certains ne comprendraient jamais et ne verraient que du folklore dans cette expression de la foi et de la tradition catalanes. D’autres bloquaient sur la tenue qui leur rappelait le Ku Klux Klan.
La Sanch n’avait rien à voir avec ça.
À l’origine, en 1416, une des missions de l’Archiconfrérie était d’accompagner les condamnés à mort jusqu’au gibet. Et si tout le monde cheminait masqué, c’était pour éviter que la foule ne lynche les prisonniers. Après l’exécution, les confrères assuraient aux suppliciés une sépulture chrétienne.
Non, vraiment, la Sanch n’avait rien à voir avec les exactions monstrueuses des racistes américains.
Il tourna la tête. À droite. À gauche. Ses confrères pénitents marchaient d’un pas serein et confiant sans réaliser que, depuis le jour de leur naissance, ils étaient tous condamnés à mourir. Vivre ne consistait finalement qu’à s’efforcer d’oublier chaque jour et chaque minute l’inéluctable échéance. Une crise cardiaque ou un cancer, une voiture, un assassin… La mort les frapperait tôt ou tard. Quels que soient leurs péchés ou leurs bonnes actions.
Dans cette procession et dans les rangs de ceux qui la regardaient passer en souriant, il ne voyait plus rien d’autre que des condamnés à mort en sursis. Et lui était en première ligne.
***
Le regidor balançait lentement sa longue silhouette dans les rues piétonnes du centre. De son pas mesuré, il réglait le rythme du cortège. C’est lui également qui indiquait les pauses. Des arrêts brefs mais fréquents. Les porteurs de misteris soulageaient alors leurs épaules en posant les bras de leurs divins brancards sur une forqueta, un bâton surmonté d’un demi-cercle métallique. Pour chaque misteri, un pénitent dirigeait la manœuvre. Un coup de forqueta sur le bitume signalait la pause, deux coups la reprise.
Sebag et Molina marchaient une trentaine de mètres en avant de la procession. Ils observaient les spectateurs, à l’affût du moindre geste suspect.
— Il a l’air louche, ce type, non ? fit Jacques en désignant du menton un jeune homme qui se tenait à l’écart de la foule.
L’individu avait posé un pied sur une borne métallique et se grattait vigoureusement le mollet à travers le pantalon.
— Qu’est-ce que tu lui reproches ? questionna Sebag.
— On dirait qu’il fait semblant de se gratter et qu’il en profite pour observer les alentours.
Sebag détailla l’homme quelques secondes supplémentaires.
— Moi je dirais plutôt qu’il fait semblant de s’intéresser à ce qui se passe autour de lui en espérant dissimuler ce besoin furieux qu’il a de se gratter.
— Ah bon ? Tu as peut-être raison. Je vais finir par voir des terroristes partout, moi…
Sebag posa la main sur l’HK-G39 que Molina tenait contre lui.
— La parano, c’est pas bon quand on trimballe un fusil-mitrailleur…
— T’inquiète… On me l’a collé dans les mains juste avant de partir mais je ne suis pas sûr que je saurais m’en servir.
— Et c’est censé me rassurer ?
***
Le chant poignant du miserere des pendus flottait au-dessus de leurs têtes. Les lèvres de Christian récitèrent une prière à voix basse. Sur certaines syllabes, elles caressaient le tissu rêche et rassurant de la caparutxa. Elles s’abreuvaient aussi de la sueur dégoulinant de son visage. Le soleil sans pitié braquait ses rayons vifs sur la cagoule noire.
Tout à l’heure, pendant qu’ils mettaient leurs tenues, Douce France l’avait regardé bizarrement. Un curieux sourire sur ses lèvres douces.
Le chant religieux s’interrompit. Après quelques crépitements commença le récit de la vie de sant Vicenç Ferrer, le moine dominicain initiateur de la Sanch. Le récitant avait cette belle voix grave et traînante des acteurs d’autrefois. La bande-son devait dater des années cinquante lorsque la procession avait cessé d’être confinée dans la cathédrale et qu’on avait enfin autorisé les pénitents à investir de nouveau les rues de la ville. Christian connaissait l’enregistrement par cœur, il n’en écoutait plus le sens mais simplement la mélodie des mots.
Il ferma les yeux quelques secondes. Il pouvait marcher sans regarder, la procession le portait. C’était sans doute la dernière fois qu’il défilait ainsi.
— Regardez-le lui ! Il a les pieds nus !
Il rouvrit les yeux. Des gamins le montraient du doigt. Un petit groupe d’une vingtaine, une classe, garçons et filles mélangés, à peine une dizaine d’années. La Sanch constituait l’un des symboles de l’attachement des Catalans à leurs traditions et certaines écoles en transmettaient l’histoire. Et tant pis pour les laïcards, qu’ils aillent se faire pendre ! La procession du Vendredi Saint appartenait à cette terre au même titre que les feux de la Saint-Jean, les castellers*, l’USAP et la sardane.
Christian tourna la tête pour contempler avec émoi les gamins. Pourquoi parlait-on toujours de têtes blondes ? Celles-ci étaient brunes et, il n’empêche, ravissantes. Qu’auraient dit ces enfants si la Sanch avait encore intégré dans ses rangs des flagellants, ces pénitents qui marchaient en fouettant leur dos nu avec vigueur ? Des pratiques extrêmes qui avaient conduit l’Église et l’administration civile à limiter puis interdire la procession à la fin du XVIIIe siècle. Extrêmes vraiment ? Ne serait-ce pas plutôt le caractère baroque et trop espagnol de la Sanch qui avait suscité l’hostilité des autorités françaises de l’époque ?
Ah… Sentir la morsure du cuir sur la peau de son dos ensanglanté… L’image le fit frissonner. C’est ce qu’il lui aurait fallu pour que la pénitence calme plus longuement ses désirs…
Il repensa au curieux sourire de Douce France. Un sourire dur et distant qu’il ne lui connaissait pas. Un signe sans doute. Un adieu peut-être. Il y avait bien un condamné dans cette procession. Christian ressentit d’abord une angoisse. Puis un espoir.
***
Sebag et Molina arrivèrent rue Fontaine Froide. Devant la vitrine d’un bistrot, les tables débordaient sur la chaussée. Lorsque le cortège passerait ici, rien ne séparerait les pénitents des buveurs, des touristes ou d’un éventuel terroriste.
— Comment veux-tu sécuriser un tel bordel ? bougonna Molina. Sur les tronçons les plus denses du parcours, des barrières métalliques séparaient les badauds du cortège. Mais partout ailleurs, l’accès à la procession était facile. Sebag haussa les épaules.
— De toute façon, les pénitents ne sont pas les seules cibles possibles. En tout, il y a au moins dix mille personnes. Pas très difficile de faire un carton.
Ils débouchèrent place de la Cathédrale où la foule était à nouveau canalisée par les barrières. On aurait même pu croire à l’arrivée d’une étape du Tour de France. Ou plutôt un sprint intermédiaire. Car la Sanch, sur ces lieux, ne ferait qu’une courte pause.
Cinq militaires stationnaient à l’entrée de la place. Leur sergent s’approcha des deux policiers.
— Restez ici pendant le discours. Nous, nous prendrons position devant la cathédrale, là où il y a des gradins avec le préfet, le maire, des élus…
— Depuis quand tu commandes, ici ? grogna Molina. Et puis qu’est-ce que tu insinues ? Qu’ils seront mieux protégés avec vous ?
Le militaire loucha sur le pistolet-mitrailleur. Sentant qu’il allait faire une remarque désagréable sur la façon dont Jacques tenait son arme, Sebag prit les devants. Ce n’était ni le lieu, ni l’heure pour une guéguerre des polices.
— L’opération Sentinelle, c’est fait surtout pour rassurer. Les élus seront contents de voir des soldats.
Le sergent le remercia d’un signe de tête avant d’entraîner ses hommes vers la cathédrale. Sebag posa sa main sur l’avant-bras de son collègue.
— Calme-toi un peu. Dans deux petites heures, c’est le week-end.
Les premiers pénitents s’arrêtèrent devant la fontaine médiévale face à la cathédrale. Sebag observa les pieds qui passaient devant lui, seules parties du corps que la longue robe laissait apercevoir. Certains pénitents portaient des vigatanes, des espadrilles catalanes, mais la plupart se contentaient de sobres chaussures noires. D’autres cheminaient les pieds nus, une survivance du passé qui fascinait les curieux.
***
La procession avait ralenti. Il savait qu’en tête, les premiers pénitents se mettaient déjà en rang devant la cathédrale. Il allait faire chaud, ce serait pénible.
Il s’en réjouissait à l’avance. Il ne pouvait y avoir pénitence sans souffrance.
Il sentait la présence de Douce France quelques mètres derrière lui. Comme une menace rassurante. Sous sa cagoule, il sourit à cette expression. Comment appelait-on cette figure de style déjà ? Ah oui, un oxymore. Il n’avait jamais été très fort en français. Lui, son domaine, c’était la musique. On ne pouvait être doué pour tout. Quoique… Le Poète, lui, avait eu en son temps tous les talents. Ses doigts se mirent à jouer sur sa robe comme sur le clavier d’un piano. Il se retint difficilement de fredonner.
L’Ange allait frapper. Il en était maintenant convaincu. L’Ange de la mort agirait sans faiblir. En pleine procession. Une chose cependant l’attristait. Il avait décrypté le sourire de Douce France et il y avait lu aussi de la haine.
N’était-ce pas normal après tout ?
***
— Per les obres de la Sanch, si us plau. Pour les œuvres de la Sanch, s’il vous plaît.
Sebag et Molina s’écartèrent pour laisser passer deux membres de l’Archiconfrérie qui, tête nue, longeaient les barrières de sécurité en tendant aux spectateurs leur caparutxa à l’envers. Molina lâcha :
— Vu la profondeur des cagoules, s’ils arrivent à les remplir de fric, ils vont pouvoir s’offrir la motorisation de leurs misteris pour l’année prochaine. Ce serait marrant, tous ces brancards avec un petit moteur électrique…
Perpignanais d’origine, Jacques avait un rapport ambigu avec ce coin de France où il était né. Catalan de tripes, il adorait pourtant se moquer de ceux qui portaient leur identité en bandoulière.
— En même temps, ils peuvent se montrer généreux, les touristes. C’est quand même un sacré spectacle qu’on leur offre.
Un misteri porté par des femmes passa devant eux. Il représentait une Vierge drapée de noir tendant devant elle un drap blanc immaculé. Sur sa poitrine, des glaives transperçaient son cœur d’argent. Aux pieds de la Vierge, des bouquets de quarantains déployaient leurs fleurs délicates et parfumées. Deux secouristes de la Sécurité civile suivaient de près. Ils avaient repéré que l’une des porteuses peinait sous la charge.
Une paire de chaussures attira le regard de Sebag. Des sneakers à la mode et certainement hors de prix. Sombres et sobres, elles respectaient le code vestimentaire mais certainement pas l’esprit de la procession. Gilles ne les aurait pas remarquées s’il n’avait pas dû ces derniers jours fréquenter des boutiques invraisemblables où l’on vendait à prix d’or ce qui ne serait toujours pour lui que de simples baskets. Son fils Léo allait avoir dix-huit ans et il n’avait pas émis d’autre désir pour son anniversaire. De la folie pure !
Sebag sentit son portable vibrer dans la poche de son pantalon mais il ne jugea pas opportun de répondre. Les pénitents continuaient de s’entasser sur la place. À l’autre bout, l’évêque entouré, d’un parterre d’enfants de chœur, attendait devant la porte de la cathédrale.
Nouvelle petite secousse dans sa poche. Un SMS suivait l’appel. Ce devait être sérieux. Le portable vibra encore. Nouvel appel. Il lut « Big Boss » sur son écran et prit la communication :
— J’ai besoin de vous, Gilles, fit le commissaire Castello. Un hold-up dans une bijouterie du boulevard Clemenceau. Je n’ai plus grand monde, allez-y vite. Ménard et Llach prendront votre place dans le cortège.
* Tours humaines.
CHAPITRE 2
Ça y est, il se passait quelque chose… Deux flics en civil s’étaient fait relayer par des collègues en tête de cortège avant de se faufiler dans la foule en direction du Castillet. Chemin le plus court pour se rendre boulevard Clemenceau. Il ne pouvait regarder sa montre mais il avait planifié que tout devait démarrer lorsque la procession arriverait place Gambetta. Et c’est ce qui était en train de se produire.
Parfait.
Le regidor s’avança vers l’entrée de la cathédrale. Il inclina sa longue silhouette devant le misteri du Dévot-Christ, un Jésus famélique allongé sur sa Croix et que la mort n’était pas encore parvenue à vaincre. Après d’autres gesticulations, le regidor rentra dans les rangs et l’évêque entama sa seconde homélie.
Que de chichis ! Que de blablas !
Planqué dans un kebab de l’avenue de la gare, il avait guetté le départ de la Crapule pour la Sanch. Il s’était ensuite glissé dans la maison, avait effectué du ménage, fouillé quelques tiroirs et récupéré le téléphone portable. Il l’avait trouvé à son emplacement habituel. Sur un guéridon à côté du piano. La Crapule ne sortait jamais avec, il ne s’en servait finalement que comme d’un fixe.
Le vieux con ! Il avait extrait la batterie et la carte SIM avant de balancer tous ces éléments dans des poubelles différentes. Enfin, il s’était dirigé à son tour vers l’église Saint-Jacques. Un peu en retard mais juste à temps pour informer Treize de ses projets. Putain, la tronche du gars ! Mais il était trop tard pour reculer.
Près de lui, un enfant pleurait à chaudes larmes. Pobret !* Plastron noir sur son aube de communiant, croix autour du cou, coupe de cheveux stricte et oreilles dégagées, il n’avait guère plus de sept ans et défilait en rangs serrés derrière ses copains d’infortune… Lui aussi avait vécu autrefois cela comme un calvaire ! Ah, ah, ah ! On ne pouvait trouver de mot plus juste…
Te fais pas de bile, Pitchoun. Avec ce qui va se passer tout à l’heure, pas sûr que tes parents t’obligent à défiler l’an prochain…
À quelques mètres devant lui, la silhouette voûtée de la Crapule paraissait résignée. Complètement BDR… Au bout du rouleau. Il était temps d’en finir. De tourner cette putain de page !
Il respira un grand coup. Il avait mis la barre très haut, sa revanche était à ce prix.
Mais il ne devait pas se rater.
Il rejoua dans sa tête le geste qu’il allait effectuer. Il l’avait répété mille fois dans le vide. Puis sur quelques chiens errants. Le grand moment était pour bientôt. Il exécuterait son plan sans faillir. À son grand étonnement, la chaleur qui coulait dans ses veines ne diffusait pas de tension mais un calme extrême jusque dans son cerveau.
Comme un champion avant une performance.
Il était un champion… Il tenait son exploit.
Enfin.
* Le pauvre !
CHAPITRE 3
Agenouillé sur le carrelage de la boutique, un médecin du SAMU prenait la tension du joaillier. Il lui posait en même temps des questions. Son nom, son âge, sa profession, la date du jour. Test habituel pour jauger la lucidité d’un individu en état de choc. Les jambes allongées au sol et le dos calé contre un présentoir de montres, Philippe Borell, soixante-deux ans, bijoutier, répondait avec lenteur mais fantaisie.
— Quelle année sommes-nous ? Euh… 1977.
Le toubib sursauta.
— L’année de mes… mes vingt ans, docteur… Si seulement nous pouvions… être revenus en… 1977.
Un filet de sang coulait de l’une de ses pommettes. Le médecin lui dégrafa le scratch autour de son bras.
— 14-7. Votre tension est un peu élevée.
Il rangea son appareil dans sa sacoche, en sortit une compresse et de l’alcool pour nettoyer la plaie. Ce faisant, il se tourna vers les deux policiers pour répondre à la question qu’ils n’avaient pas encore posée :
— Monsieur Borell a été frappé. Je dirais… avec un poing américain à deux doigts.
Molina se pencha sur le blessé. Fit la moue.
— Vous croyez ? La blessure n’a pas l’air profonde pour un poing américain… Il s’adressa au bijoutier :
— Vous avez vu l’arme ?
— Ça brillait aux doigts du type. J’ai cru que c’était une bague. Déformation professionnelle, je suppose…
Molina lui posa la main sur l’épaule en guise de félicitations pour son humour. Puis il se redressa et se plaça un pas en retrait, laissant la parole à son collègue. Sebag sortit son calepin.
— Racontez-nous ce qui s’est passé, s’il vous plaît.
Le bijoutier leva la tête vers eux. Son visage était épais, ses traits pâteux. Autour de sa bouche aux lèvres charnues, de profonds sillons dessinaient son âge. Mais sa chevelure soignée, encore abondante et frisée, donnait un peu de jeunesse et d’allant à l’ensemble.
— Ils sont rentrés par-derrière… Il y a une porte qui donne sur la cour… Les locataires de l’immeuble y garent leur voiture… Moi aussi.
L’esprit semblait clair, l’élocution néanmoins restait difficile.
— Ils étaient deux… Ils portaient des casquettes et des masques… Ils m’ont menacé avec des armes…
— Quel type d’armes ? Quelle sorte de masques ?
— Des armes de poing, c’est tout ce que je peux dire, je n’y connais rien. Les masques, eux, étaient en carton souple… à l’effigie de Carles Puigdemont.
Après le référendum sur l’indépendance de la Catalogne jugé illégal par Madrid, le président de la Generalitat de Barcelone avait été contraint de fuir afin d’éviter un emprisonnement pour rébellion et sédition. Alors que la police espagnole le recherchait partout, nombreux avaient été les manifestants indépendantistes à défiler dans les rues de Barcelone avec sur le visage un masque de leur leader.
— C’est pas les stocks qui manquent, commenta Molina.
— Quand ils sont entrés, qu’ont-ils dit ? poursuivit Sebag.
— Rien que de très banal… Un truc comme : « Bouge pas sinon t’es mort ! » Et puis : « Joue pas les héros, donne-nous les pierres ! »
— Les pierres ?
— Je venais de réceptionner de la matière première, des pierres précieuses ou semi-précieuses… Diamants, topaze, émeraude… de la citrine aussi… du métal bien sûr également, or, argent… platine. Je n’avais pas eu le temps de les mettre dans la chambre forte. Tout était encore dehors.
Il leva une main tremblante vers le comptoir du magasin. Un lourd stylo y maintenait une feuille.
— La liste complète est là… C’est le récépissé… Il y en avait pour 88 253 euros très précisément.
Molina siffla bruyamment. Sebag inscrivit ces précisions. Une évidence sautait aux yeux. Mais il était trop tôt pour en parler.
— Ils n’ont rien réclamé d’autre ?
— Non. Ils ne m’ont pas demandé d’ouvrir le coffre-fort, ni même un présentoir. Je pense que ça leur suffisait…
— Tu parles… Plus de 88 000 euros en quoi ? Même pas trente secondes ? commenta encore Molina.
— Quarante tout au plus, confirma le bijoutier. C’est toujours difficile d’estimer…
— « Toujours » ? Ce n’était pas votre premier braquage ?
— Non. Le troisième.
Pour Sebag, il s’agissait là d’une bonne nouvelle : il espérait que le témoignage du bijoutier n’en serait que plus précis.
— Vous avez parlé de deux individus. Même s’ils étaient masqués, vous pouvez sans doute m’en dire plus. Sur leur allure, leur silhouette.
Le bijoutier décrivit deux hommes plutôt jeunes d’après la souplesse de leur démarche. Le premier dépassait le mètre quatre-vingt, assez musclé, ses cheveux bruns lui tombaient sur la nuque. Le second était plus petit, à peine un mètre soixante-quinze, plus enrobé également et ses cheveux châtains étaient courts. Les deux malfaiteurs portaient des pulls et des pantalons noirs. Ils dissimulaient leurs mains sous des gants de cuir. Sebag nota ces descriptions en attribuant à l’un le prénom de Carles, à l’autre le nom de Puigdemont.
— C’est le grand qui a parlé, le petit se tenait plutôt en retrait, continua le bijoutier. Lui, il avait en plus un foulard autour de son cou.
Sebag inscrivit ce détail en majuscule car il pouvait se révéler important.
— Lequel vous a frappé ?
— Le petit.
— Et il a dit quelque chose en le faisant ?
— Euh oui… C’était juste avant de repartir… Un truc du genre : « Surtout ne nous suit pas. » Et bing, il a tapé. Comme je vous disais, j’ai pas eu le temps de voir le coup venir.
Sebag attendit mais le bijoutier n’ajouta rien. Il revint donc sur l’évidence qui lui avait sauté aux yeux quelques minutes auparavant.
— Ils étaient bien informés…
Borell grimaça mais Sebag ne sut dire si c’était à cause de son affirmation ou parce que le toubib était en train de rapprocher les deux bords de sa plaie pour coller des steri-strip. Le bijoutier tendit devant lui une main tremblante.
— C’est pas la grande forme.
Le médecin abandonna provisoirement la pommette pour observer la pupille. :
— Que ressentez-vous exactement ?
— J’ai mal au ventre et je me sens nauséeux.
— C’est le stress, le contrecoup. Je vous ordonnerai un calmant.
Pendant que le toubib plaçait un dernier pansement sur la plaie, Sebag tenta de récupérer l’attention du bijoutier.
— S’ils vous ont réclamé « les pierres », sans autre préalable, c’est qu’ils savaient que vous veniez de recevoir cette livraison, vous ne croyez pas ? Quelqu’un d’autre était au courant ? Un employé ?
— Je travaille seul.
— Des amis ? Des membres de votre famille ?
— Je n’en ai parlé à personne.
Sa voix s’éteignait peu à peu.
— Vous êtes sûr que ça va aller ? interrompit encore le médecin. Vous êtes tout pâle…
— Oui, oui, ça va aller, ânonna le bijoutier avant de s’adresser à nouveau aux policiers. Vous en avez encore pour longtemps ? J’aimerais fermer la boutique et rentrer chez moi.
Sur le boulevard, un véhicule d’urgence passa en trombe, sirène hurlante. Les pompiers. Sebag attendit que le bruit s’estompe avant d’insister :
— Deux trois questions encore, s’il vous plaît…
Un autre véhicule hurla dans la rue. Le SAMU, cette fois-ci.
Puis ce fut le téléphone de Sebag qui chanta sa complainte. Le commissaire une nouvelle fois :
— Il y a eu une bousculade durant la procession. Place de la Loge. Un mort…
Sebag allait protester qu’ils n’avaient pas fini et qu’il y avait bien assez de monde là-bas pour gérer l’incident mais Castello précisa :
— C’est un meurtre. Un pénitent a été tué. Molina reste avec le bijoutier. Vous rejoignez Ménard sur les lieux.
Jacques décrocha le fusil-mitrailleur qui battait encore sur ses flancs et l’appuya contre le socle d’un présentoir.
— Tu aurais des feuilles à me passer ? Je n’ai pas prévu la bonne panoplie pour prendre des notes.
Sebag arracha quelques pages de son carnet. Le médecin avait suivi leur conversation et appelait de son côté les urgences pour dire qu’il était de nouveau disponible. Ils sortirent en même temps.
Sebag remonta d’un pas vif le boulevard Clemenceau. Deux autres véhicules des pompiers le dépassèrent. Au pied d’un container à ordures, un sac-poubelle gisait éventré. Une rafale de tramontane souleva un film plastique et le fit tournoyer dans l’air. Sebag s’arrêta pour le suivre des yeux. Il avait l’impression d’être comme ce plastique : balayé par les circonstances…
CHAPITRE 4
Le navire en fer forgé scellé au sommet de la Loge de Mer semblait avoir été accroché là pour indiquer le lieu du drame. Pas très loin, une gargouille émoussée se moquait. À l’époque où Perpignan exportait ses draps au-delà de la Méditerranée, la Loge de Mer accueillait un consulat et un tribunal maritimes. Aujourd’hui, derrière ses arcades en ogives, le bâtiment gothique n’abritait plus que l’office municipal de tourisme mais c’était toujours mieux que le fast-food qui y avait prospéré au début des années 2000. Sebag n’avait pas connu cette époque mais les Perpignanais en parlaient encore comme d’une scandaleuse hérésie.
La pagaille régnait sur la place. Les barrières de sécurité et les tables d’une terrasse de café avaient été renversées. Entre les assiettes brisées et les éclats de verre, médecins et ambulanciers s’affairaient auprès des blessés. Sebag en compta une petite dizaine. Malgré les pleurs et les visages encore effrayés, il comprit qu’il n’y avait là que des plaies superficielles. Des coupures, des ecchymoses, rien de grave.
— Je te croyais sur un hold-up ?
Sebag se retourna et salua son collègue. François Ménard ne cachait pas son irritation : il avait compris que la venue de Gilles signifiait que le chef lui confiait la direction de l’enquête. Il lui désigna une forme étendue sur le pavé de la rue.
— C’est par là que ça se passe.
Le corps était dissimulé sous une nappe de bistrot. À ses côtés, la coiffe du pénitent se dressait comme un chandelier lors d’une veillée funèbre. Des flics en tenue protégeaient la zone. Sebag donna des instructions pour qu’ils élargissent le périmètre.
Puis il s’agenouilla auprès du corps et souleva la nappe.
La victime avait une soixantaine d’années. Ses cheveux blancs ondulaient jusqu’à sa nuque. Ses yeux d’un bleu délavé étaient encore ouverts. Une longue entaille trouait la robe du pénitent. Le sang avait taché le tissu mais il n’avait pas beaucoup coulé sur le pavé. La mort avait été rapide.
— Un coup de couteau accompagné d’un léger mouvement vers le haut qui perfore le cœur.
Joan Llach, un autre collègue du commissariat de Perpignan, se dévouait pour lui expliquer la situation. Et pour éviter cette mortification à Ménard.
— Un médecin qui assistait à la procession a constaté le décès. Il est parti rapidement mais il nous a laissé sa carte.
— Tu as une idée de ce qui s’est passé ?
— Pas précisément encore. On vous avait remplacés en tête de cortège, on était donc à une trentaine de mètres de l’action. D’après les premières infos recueillies, des pétards ont explosé dans la foule sur le passage de la Sanch. Des gens ont crié, ce sont les nines* surtout qui ont paniqué.
Il désigna un groupe de cinq adolescentes assises au pied d’une statue dénudée de Maillol.
— La panique s’est aussitôt répandue. Vu le contexte, c’est pas très étonnant.
De telles scènes s’étaient déjà produites ailleurs. À Nice, par exemple. Il avait suffi de quelques détonations d’un pistolet d’alarme pour déclencher un mouvement de foule. On avait relevé une dizaine de blessés légers.
— Des barrières se sont renversées et la bousculade a gagné la procession, poursuivit Llach. Un misteri est tombé…
Nouveau geste vers la statue de Maillol. Entouré d’une vingtaine de pénitents, un Jésus drapé de rouge attendait patiemment, la main droite levée au-dessus d’un calice qu’il tenait de la gauche.
— Quand on a réussi à rétablir le calme, on a constaté que l’un des caparutxes ne se relevait pas.
Sebag se souvint que le terme ne désignait pas que la coiffe et la robe, on l’utilisait aussi pour parler des hommes qui les portaient.
— On a gardé ici les gamines et les caparutxes qui défilaient près de la victime. Les dix qui étaient devant, les dix qui étaient derrière. Mais on a eu des instructions pour laisser repartir le reste de la Sanch.
Gilles tiqua. Des témoins précieux avaient sans doute quitté les lieux mais comment retenir plusieurs centaines de personnes à proximité d’un cadavre ?
— Les autres pénitents sont repartis en procession vers l’église Saint-Jacques. En silence bien sûr. Toutes les identités seront relevées là-bas. Julie est sur place et elle établira un schéma précis : on saura précisément qui était où durant le parcours jusqu’ici.
Sebag ne fit aucun commentaire. Il ne voulait pas donner le sentiment de juger, même en bien, le travail de ses collègues. Il avait conscience d’être le chouchou du commissaire. Il en était souvent gêné mais qu’y faire ? Il n’avait pas intrigué pour en arriver là et il avait même systématiquement refusé les promotions que son chef lui avait proposées. Au fond de lui, il savait qu’il ne devait ce statut qu’aux résultats qu’il avait obtenus dans ses enquêtes. François Ménard le savait aussi. Et c’est probablement cela qui l’agaçait le plus…
Il souleva un peu plus la nappe pour examiner le corps. Les pieds du pénitent étaient nus.
— Que sait-on de lui ?
— Il s’appelait Christian Aguilar. Né à Perpignan il y a soixante-trois ans. Si l’adresse de la carte d’identité qu’il avait sur lui est toujours la bonne, il habitait rue Galceran de Villaseca. Je crois que c’est dans le quartier de la gare.
Joan Llach avait prononcé « Villasec » à la catalane. Sans insister sur le « a » final.
Gilles se releva lentement. Son dos le faisait souffrir. Il avait dû lever le pied sur la course ces dernières semaines. Plus question avant longtemps de prendre le départ d’un nouveau marathon.
— On a retrouvé l’arme du crime ?
— Pas encore.
Llach désigna un avaloir à moins de dix mètres du corps.
— La première des choses sera de faire inspecter l’égout.
— Sans doute faudrait-il fouiller les pénitents qui sont là…
— C’est un peu délicat, non ?
— J’ai chargé un agent de les surveiller discrètement, intervint Ménard. Et j’ai passé la même consigne aux policiers qui escortent le reste de la procession.
Sebag mit le plus de chaleur et de considération possible dans le regard qu’il posa sur son collègue. François était un flic efficace et consciencieux. Il lui manquait juste un peu de baraka et de flair.
Sebag repéra une caméra urbaine accrochée à la façade de la mairie, vingt mètres plus loin. Ménard avait suivi son regard.
— La scène du crime est hors de son champ mais je peux appeler la police municipale pendant que tu interroges les témoins. Ils ont peut-être suivi l’événement en direct.
— Ce serait super…
À Perpignan, plus de deux cents caméras filmaient les rues vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elles étaient gérées par la municipale mais les policiers du commissariat y recouraient fréquemment pour leurs enquêtes. Pendant que Ménard s’éloignait pour téléphoner, Sebag alla s’entretenir avec les jeunes filles. Elles avaient autour de quinze ans. L’âge de sa fille Séverine.
Bouleversées par ce qu’il s’était passé, les gamines se bousculèrent pour en faire le récit. Gilles les stoppa d’un geste puis désigna une petite rousse qui paraissait plus calme. Chloé expliqua qu’elle et ses copines avaient décidé de faire des courses en ville ce vendredi et que c’était par hasard qu’elles s’étaient retrouvées face à la procession. Intriguées, elles étaient restées. Jusqu’à ce qu’elles entendent ces maudits pétards… qu’elles avaient pris pour des détonations d’armes.
— Un gamin près de nous a crié de la merde. Quelque chose comme : « Attention, il est armé ! » Une blague conne mais on a marché comme des truffes !
Après ces cris, un père de famille avait pris son fils sous le bras et s’était enfui en bousculant tout le monde. D’autres explosions s’étaient fait entendre un peu plus loin. Derrière la foule.
— On s’est mises à courir dans l’autre sens, c’est-à-dire vers les barrières. Et là, ça a été la grosse panique.
Ses copines tentèrent à nouveau toutes ensembles de raconter l’événement. Sebag laissa l’émotion s’exprimer et se contenta de noter des mots à la volée. Sous la pression de la foule, les barrières avaient basculé, les gamines étaient tombées et s’étaient retrouvées allongées sur des touristes anglais. D’autres spectateurs les avaient enjambées. La panique avait débordé sur la procession. Une des filles – une brunette aux joues mouchetées d’acné et qui se nommait Lisa – avait vu un jeune porteur de misteri lâcher précipitamment son fardeau pour s’enfuir en courant.
— Dans quelle direction ? demanda Sebag avec intérêt.
— Vers le Castillet.
L’intérêt de Sebag retomba, c’était dans le sens opposé à celui du drame. Un autre point l’intriguait.
— Il portait une cagoule, non ?
— Oui, pourquoi ?
— Comment sais-tu qu’il était jeune ?
Elle resta bouche béé. Ses copines la fixèrent, légèrement moqueuses.
— Je… Je ne sais pas… C’est l’idée que j’en ai eu…
Les gamines pouffèrent. Sebag, lui, nota ces précisions. Il savait que les informations qu’enregistrait le cerveau à notre insu se révélaient parfois plus pertinentes que les autres.
— Le garçon qui a crié « il est armé », tu peux me le décrire ?
— Petit, un peu gros, brun. Un gamin de Saint-Jacques, un Gitan, quoi !
— C’est lui qui a allumé les pétards ?
— J’en sais rien ! Il se tenait dans le même secteur en tout cas. Ils étaient trois, je crois.
— Quel âge ?
— Dix, douze ans pas plus.
Sebag s’intéressa ensuite aux pénitents. Au-dessus du groupe, la Vénus de Maillol étalait ses charmes et ses lèvres dessinaient un sourire facétieux. Regroupés autour de leur Christ figé dans son calvaire, les pénitents composaient un tableau insolite et anachronique. Tête inclinée, caparutxa sous le bras, on aurait pu croire que la plupart d’entre eux priaient mais ils ne faisaient que consulter leurs téléphones portables. Sebag demanda à Llach :
— La victime avait un téléphone sur elle ?
— Non. Il n’avait dans ses poches que sa carte d’identité, un sac plastique et des clés. Celles de sa maison probablement.
Les pénitents se montrèrent unanimes sur un point : aucun d’entre eux n’avait réalisé immédiatement l’intensité de la panique. Quelques-uns avaient perçu les explosions mais sans y prêter attention. La caparutxa les isolait du monde, ils défilaient pour prier et se recueillir, s’efforçant durant tout le périple de ne pas prêter attention aux attitudes et aux réflexions du public. Ce n’était que lorsque les premières barrières étaient tombées qu’ils avaient saisi, plus ou moins bien d’ailleurs, la situation.
— J’ignorais d’où venait cette panique et je crois que cette ignorance n’a fait que décupler ma propre peur, reconnut un homme d’une quarantaine d’années.
Une barbichette impeccablement taillée entourait sa bouche. Après ce premier aveu, il critiqua :
— Le dispositif policier nous a tous mis sous pression. Je n’avais jamais vu autant de personnes et d’armes. Il y avait même des mitraillettes !
Les autres pénitents approuvèrent mais Sebag se retint de tout commentaire. Fallait-il pour éviter ce type d’affolement ne plus protéger les manifestations publiques ?
Avec Llach, ils interrogèrent ensuite un à un les pénitents mais aucun n’avait vu le geste ultime du meurtrier. Certains étaient tombés, d’autres partis en courant. Daniel, le barbichu, s’était, lui, agenouillé pour prier. Impossible de savoir si ce meurtrier venait de la foule ou s’il était issu des rangs des pénitents.
De la victime, ils dressèrent un portrait cohérent mais sommaire. Un professeur de piano discret voire secret, célibataire sans enfant. Certains l’avaient trouvé fatigué au départ de la procession.
« Alors là… ! », « Jamais, je n’aurais pu imaginer ! », « Vraiment je ne vois pas… », tel fut le tiercé gagnant des réponses à la question de savoir si quelqu’un pouvait en vouloir à la victime au point de l’assassiner. Les policiers établirent un croquis des positions de chacun durant la procession et Sebag put constater que Lisa avait vu juste. Son cerveau avait enregistré à son insu une démarche souple, des épaules athlétiques et, peut-être même, ces sneakers à la mode, et avait perçu la présence d’un jeune homme sous l’anonyme caparutxa qui s’éloignait en courant.
— J’ai été surpris et je l’ai lâché, se justifia Guillem Batère. Je suis parti vers le Castillet. Mais ce n’est pas à cause de moi qu’il est tombé. Nous étions quatre porteurs. À trois, il ne tombe pas.
Sebag sourit devant ce plaidoyer aussi spontané qu’inutile. Il n’avait pas pour mission d’enquêter sur la chute d’un misteri, même si certains de ces objets de dévotion étaient classés au titre des monuments historiques. Il retourna ensuite vers la scène du crime. Des bandes plastiques délimitaient maintenant un large périmètre dans lequel s’activaient ses collègues de la police scientifique. Il embrassa Elsa Moulin, la responsable.
— Je ne sais pas ce qu’on va pouvoir retirer de tout ce bazar, prévint-elle.
Sebag ne se faisait pas d’illusions. La scène avait été tellement piétinée avant, pendant et après le meurtre que même si ses collègues parvenaient à isoler des éléments intéressants, ils ne tiendraient jamais la route devant les arguments d’un avocat.
— J’ai eu le siège de la police municipale, rapporta Ménard. Ils n’ont rien suivi en direct car, au moment du meurtre, ils cherchaient tous à retrouver la trace d’une Audi. Celle de ton braquage, justement. Mais ils ont pris le temps de vérifier et m’ont confirmé que la scène du crime était hors champ. Sinon, j’ai eu aussi les services de la voirie. Ils nous envoient du monde pour descendre dans l’égout.
Sebag approuva puis quitta la zone pour se diriger vers l’église Saint-Jacques. Il n’avait pas fait trois pas lorsqu’il fut interpellé par Daniel, le pénitent barbichu.
— Vous allez bientôt emporter le corps, je suppose. Qu’est-ce que vous allez faire de sa robe, après ?
— C’est important ? Comme toutes ses affaires, elle sera rendue à la famille si celle-ci la réclame.
— C’est que… justement… Depuis la mort de sa mère, Christian n’avait plus de famille… Je veux dire… de famille proche. C’est donc probablement la Sanch qui s’occupera de ses obsèques.
Il tendit le bras vers le corps de Christian Aguilar.
— Je ne sais pas si vous le savez mais les caparutxes ont une traîne à l’arrière. Autrefois, les gens riches la faisaient porter par des valets, aujourd’hui on la coince dans la cordelière ce qui fait qu’on ne la remarque plus.
— Où voulez-vous en venir ? s’impatienta Gille.
— Excusez-moi, inspecteur, je vous enquiquine avec tous mes détails. Tout ça pour vous dire que nous aurons besoin de la caparutxa pour les obsèques car ces traînes servent aussi de linceuls pour l’enterrement des pénitents.
* Jeunes filles.
CHAPITRE 5
Le capharnaüm régnait dans l’église Saint-Jacques. Les pénitents portaient encore leur tenue cérémonielle mais toute trace de recueillement avait disparu. On parlait haut et fort, on s’impatientait surtout. Les voix se cognaient sous les voûtes en pierre.
Sur son passage, Sebag entendit surtout du catalan. Il en connaissait quelques bribes, suffisamment pour avoir la confirmation que la police n’était plus ici en odeur de sainteté. On lui reprochait ses lenteurs et son formalisme, on lui attribuait également – comme l’avait fait le barbichu quelques minutes auparavant – la responsabilité de la panique qui avait uni dans une même transe badauds et pénitents.
D’une pièce voisine, un groupe d’une huitaine de personnes fit irruption dans l’église. Une femme, sept hommes, deux en robe rouge, les autres en noir. Tous avaient la mine sévère. Ils se répandirent dans la nef et y rétablirent un semblant de calme. Ils s’arrêtèrent ensuite devant une jeune femme portant un brassard de police. Sebag reconnut Julie Sadet. Lorsqu’il fut à sa hauteur, elle lui confia à l’oreille :
— Je suis contente de te voir. On a relevé les noms et les empreintes de tout le monde mais ils sont trop nombreux pour qu’on puisse les interroger maintenant. Alors j’ai fait un nouveau tri après celui de Ménard : il en avait gardé une vingtaine, j’ai élargi à une petite centaine et j’attendais ton accord pour autoriser les autres à partir.
— Tu l’as… Beau boulot.
— C’est vous qui dirigez l’enquête ?
Malgré sa petite taille, l’homme qui les avait interrompus les toisait. Dressé sur ses talons comme sur des ergots, il s’exprimait en lançant en avant son menton pointu.
— C’est ridicule de retenir tout le monde ici.
Sebag lui tendit la main.
— Lieutenant Gilles Sebag. À qui ai-je l’honneur ?
— Batère. Yves Batère. Je suis le secrétaire général de l’Archiconfrérie.
Les autres membres du groupe déclinèrent leur identité. Les policiers avaient devant eux la presque totalité du bureau de la Sanch et, en robe rouge, deux regidors de son conseil spirituel.
— Je suis effectivement l’officier qui dirige l’enquête et, avant d’être coupé, j’allais justement donner l’ordre de laisser partir la plupart des pénitents.
Batère sembla être le seul à ne pas percevoir son ton sarcastique.
— Ah tout de même…
Sebag se tourna vers celui qui s’était présenté comme le président du bureau, François Marty, un homme corpulent dont le goitre débordait du col de chemise.
— Pourrait-on s’entretenir dans un endroit tranquille ?
Tandis que Julie restait dans la nef pour transmettre les consignes, Gilles suivit les responsables de la Sanch dans les jardins jouxtant l’église. Rangés soigneusement le long de l’édifice médiéval, les misteris patientaient. Le petit groupe marcha jusqu’aux murs qui bordaient le jardin et constituaient les derniers vestiges des remparts dominant autrefois la ville.
En prenant soin de s’adresser principalement au président, Sebag reformula les questions qu’il avait déjà posées une bonne trentaine de fois. Et qu’il reposerait sans doute encore souvent avant de résoudre ce meurtre. Les scénaristes de séries télévisées, qu’elles soient françaises ou américaines avaient bien raison de ne pas montrer dans leurs fictions combien le métier de flic était d’abord un métier de rigueur et de routine. Interrogatoires systématiques, enquête de voisinage, visionnage fastidieux de vidéos urbaines et pour couronner le tout, rédaction laborieuse des procès-verbaux. En regardant certaines séries le soir avec Claire et Séverine, Gilles avait parfois l’impression de suivre des films de science-fiction plutôt que des polars.
Les réponses qu’il reçut dressèrent le même portrait d’un Aguilar sans histoires, humble et respectueux. On lui connaissait peu voire pas d’amis, aucune relation intime.
— Christian nous avait rejoints après la mort de son père, précisa Anna-Pilar Carbonnell, trésorière de l’Archiconfrérie et magistrate dans le civil. Mais on ne le voyait pas beaucoup : il ne participait pas très activement à nos œuvres caritatives.
— Qui aurait pu lui en vouloir au point de le tuer ?
La question fit passer un frisson dans les rangs.
— À notre connaissance, personne.
Le président Marty avait répondu d’une voix trop ferme. Sebag sentit un flottement parmi ses interlocuteurs. Mais Batère ne lui laissa pas le temps d’approfondir le sujet :
— Donc selon vous, c’est Christian qui était visé ?
Avec le dos de sa main, Batère tapota l’épaule du policier.
— Il ne vous serait pas venu à l’esprit que la Sanch ait pu être la cible…
Bien qu’aucun élément ne puisse encore l’accréditer, cette hypothèse hantait évidemment Sebag depuis le début. Ignorant Batère, il s’adressa au président :
— Vous avez reçu des menaces ?
— Non, non, pas de menaces… On ne peut pas dire cela.
François Marty tenta de faire passer un index boudiné entre le col de sa chemise et son cou goitreux.
— La Sanch est une tradition profondément ancrée dans la société catalane. Et pourtant, rien n’a jamais été simple pour notre confrérie.
Sebag hocha la tête. Il connaissait les grandes lignes de l’histoire. La procession n’avait pas toujours eu les faveurs d’une Église qui jugeait trop ostentatoire ses excès de piété. Pendant plus d’un siècle, elle avait été interdite et n’avait pu reprendre que dans les années cinquante.
— Aujourd’hui, nous subissons les assauts d’une laïcité revancharde, poursuivit Marty, et la question du maintien d’une procession religieuse sur la voie publique ressurgit constamment. En 2011, après le vote de la loi interdisant la dissimulation des visages, un journal local est même allé jusqu’à poser cette question en une : la Sanch est-elle légale ? Vous imaginez le choc que ce titre a provoqué chez nous…
Sa voix éraillée montait dans les aigus à la fin des phrases trop longues.
— En résumé, pas de menaces précises – ni lettres, ni coups de fil anonymes – mais nous avons bien conscience de ne pas plaire à tout le monde.
— Et aux islamistes ?