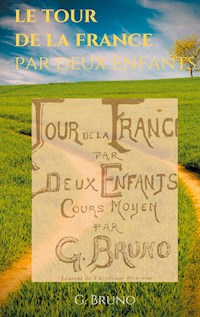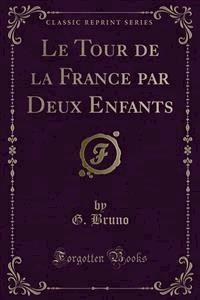Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: A verba futuroruM
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Après la guerre de 1870, deux enfants orphelins quittent les Vosges devenues allemandes et parcourent la France, rencontrent la population et les merveilles de leur pays perdu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.BRUNO
LE TOUR DE LA FRANCE PAR DEUX ENFANTS
Devoir et patrie
La connaissance de la patrie est le fondement de toute véritable instruction civique.
1. Le départ d’André et de Julien.
Rien ne soutient mieux notre courage que la pensée d’un devoir à remplir.
Par un épais brouillard du mois de septembre deux enfants, deux frères, sortaient de la ville de Phalsbourg en Lorraine. Ils venaient de franchir la grande porte fortifiée qu’on appelle porte de France. Chacun d’eux était chargé d’un petit paquet de voyageur, soigneusement attaché et retenu sur l’épaule par un bâton. Tous les deux marchaient rapidement, sans bruit ; ils avaient l’air inquiet. Malgré l’obscurité déjà grande, ils cherchèrent plus d’obscurité encore et s’en allèrent cheminant à l’écart le long des fossés.
Porte fortifiée.—Les portes des villes fortifiées sont munies de ponts-levis jetés sur les fossés qui entourent les remparts, le soir on lève ces ponts, on ferme les portes, et nul ennemi ne peut entrer dans la ville.—La petite ville de Phalsbourg été fortifiée par Vauban. Traversée par la route de Paris à Strasbourg, elle n’a que deux portes : la porte de France à l’ouest et la porte d’Allemagne au sud-est, qui sont des modèles d’architecture militaire.
L’aîné des deux frères, André, âgé de quatorze ans, était un robuste garçon, si grand et si fort pour son âge qu’il paraissait avoir au moins deux années de plus. Il tenait par la main son frère Julien, un joli enfant de sept ans, frêle et délicat comme une fille, malgré cela courageux et intelligent plus que ne le sont d’ordinaire les jeunes garçons de cet âge. A leurs vêtements de deuil, à l’air de tristesse répandu sur leur visage, on aurait pu deviner qu’ils étaient orphelins. Lorsqu’ils se furent un peu éloignés de la ville, le grand frère s’adressa à l’enfant et, à voix très basse, comme s’il avait eu crainte que les arbres mêmes de la route ne l’entendissent : —N’aie pas peur, mon petit Julien, dit-il ; personne ne nous a vus sortir. —Oh ! je n’ai pas peur, André, dit Julien ; nous faisons notre devoir, Dieu nous aidera. —Je sais que tu es courageux, mon Julien, mais, avant d’être arrivés, nous aurons à marcher pendant plusieurs nuits ; quand tu seras trop las, il faudra me le dire : je te porterai. —Non, non, répliqua l’enfant ; j’ai de bonnes jambes et je suis trop grand pour qu’on me porte. Tous les deux continuèrent à marcher résolument sous la pluie froide qui commençait à tomber. La nuit, qui était venue, se faisait de plus en plus noire. Pas une étoile au ciel ne se levait pour leur sourire ; le vent secouait les grands arbres en sifflant d’une voix lugubre et envoyait des rafales d’eau au visage des enfants. N’importe, ils allaient sans hésiter, la main dans la main. A un détour du chemin, des pas se firent entendre. Aussitôt, sans bruit, les enfants se glissèrent dans un fossé et se cachèrent sous les buissons. Immobiles, ils laissèrent les passants traverser. Peu à peu, le bruit lourd des pas s’éloigna, sur la grande route ; André et Julien reprirent alors leur marche avec une nouvelle ardeur. Après plusieurs heures de fatigue et d’anxiété ils virent enfin, tout au loin, à travers les arbres, une petite lumière se montrer, faible et tremblante comme une étoile dans un ciel d’orage. Prenant par un chemin de traverse, ils coururent vers la chaumière éclairée. Arrivés devant la porte, ils s’arrêtèrent interdits, n’osant frapper. Une timidité subite les retenait. Il était aisé de voir qu’ils n’avaient pas l’habitude de heurter aux portes pour demander quelque chose. Ils se serrèrent l’un contre l’autre, le cœur gros, tout tremblants. André rassembla son courage. —Julien, dit-il, cette maison est celle d’Étienne le sabotier, un vieil ami de notre père : nous ne devons pas craindre de lui demander un service. Prions Dieu afin qu’il permette qu’on nous fasse bon accueil. Et les deux enfants, frappant un coup timide, murmurèrent en leur cœur :
—Notre Père, qui êtes aux cieux, donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
2. Le souper chez Étienne le sabotier. L’hospitalité.
Le nom d’un père honoré de tous est une fortune pour les enfants.
—Qui est là ? fit du dedans une grosse voix rude. Au même instant, un aboiement formidable s’éleva d’une niche située non loin de la porte. André prononça son nom : —André Volden, dit-il d’un accent si mal assuré que les aboiements empêchèrent d’entendre cette réponse.
Le chien de montagne.—Ce chien est d’une taille très haute ; il a la tête grosse et la mâchoire armée de crocs énormes. Les poils de sa robe sont longs et soyeux. Dans la montagne, il garde les troupeaux et au besoin les défend contre les loups et les ours. Les plus beaux chiens de montagne sont ceux du mont Saint-Bernard, dans les Alpes, ceux des Pyrénées et ceux de l’Auvergne.
En même temps, le chien de montagne, sortant de sa niche et tirant sur sa chaîne, faisait mine de s’élancer sur les enfants. —Mais qui frappe là, à pareille heure ? reprit plus rudement la grosse voix. —André Volden, répéta l’enfant, et Julien mêla sa voix à celle de son frère pour mieux se faire entendre. Alors la porte s’ouvrit toute grande, et la lumière de la lampe, tombant d’à-plomb sur les petits voyageurs debout près du seuil, éclaira leurs vêtements trempés d’eau, leurs jeunes visages fatigués et interdits. L’homme qui avait ouvert la porte, le père Étienne, les contemplait avec une sorte de stupeur : —Mon Dieu ! qu’y a-t-il, mes enfants ? dit-il en adoucissant sa voix, d’où venez-vous ? où est le père ? Et, avant même que les orphelins eussent eu le temps de répondre, il avait soulevé de terre le petit Julien et le serrait paternellement dans ses bras. L’enfant, avec la vivacité de sentiment naturelle à son âge, embrassa de tout son cœur le vieil Étienne, et poussant un grand soupir :
—Le père est au ciel, dit-il. —Comment ! s’écria Étienne avec émotion, mon brave Michel est mort ? —Oui, répondit l’enfant. Depuis la guerre, sa jambe blessée au siège de Phalsbourg n’était plus solide : il est tombé d’un échafaudage en travaillant à son métier de charpentier, et il s’est tué. —Hélas ! pauvre Michel ! dit Étienne, qui avait des larmes aux yeux ; et vous, enfants, qu’allez-vous devenir ? André voulut reprendre le récit du malheur qui leur était arrivé, mais le brave Étienne l’interrompit. —Non, non, dit-il, je ne veux rien entendre maintenant, mes enfants ; vous êtes mouillés par la pluie, il faut vous sécher au feu ; vous devez avoir faim et soif, il faut manger. Étienne aussitôt, faisant suivre d’actions ses paroles, installa les enfants devant le poêle et ranima le feu. En un clin-d’œil une bonne odeur d’oignons frits emplit la chambre, et bientôt la soupe bouillante fuma dans la soupière. —Mangez, mes enfants, disait Étienne en fouettant les œufs pour l’omelette au lard. Pendant que les enfants savouraient l’excellente soupe qui les réchauffait, le père Étienne confectionnait son omelette, et la femme du sabotier, enlevant un matelas de son lit, préparait un bon coucher aux petits voyageurs. Le poêle ronflait gaîment. André, tout en mangeant, répondait aux questions du vieux camarade de son père et le mettait au courant de la situation. Quant au petit Julien, il avait tant marché que ses jambes demandaient grâce et qu’il avait plus sommeil que faim. Il lutta d’abord avec courage pour ne pas fermer les yeux, mais la lutte ne fut pas de longue durée, et il finit par s’endormir avec la dernière bouchée dans la bouche. Il dormait si profondément que la mère Étienne le déshabilla et le mit au lit sans réussir à l’éveiller.
3. La dernière parole de Michel Volden. L’amour fraternel et l’amour de la patrie.
O mon frère, marchons toujours la main dans la main, unis par un même amour pour nos parents, notre patrie et Dieu.
Pendant que Julien dormait, André s’était assis auprès du père Étienne. Il continuait le récit des événements qui les avaient obligés, lui et son frère, à quitter Phalsbourg où ils étaient nés. Revenons avec lui quelques mois en arrière. On se trouvait alors en 1871, peu de temps après la dernière guerre avec la Prusse. A la suite de cette guerre l’Alsace et une partie de la Lorraine, y compris la ville de Phalsbourg, étaient devenues allemandes ; les habitants qui voulaient rester Français étaient obligés de quitter leurs villes natales pour aller s’établir dans la vieille France. Le père d’André et de Julien, un brave charpentier veuf de bonne heure, qui avait élevé ses fils dans l’amour de la patrie, songea comme tant d’autres Alsaciens et Lorrains à émigrer en France. Il tâcha donc de réunir quelques économies pour les frais du voyage, et il se mit à travailler avec plus d’ardeur que jamais. André, de son côté, travaillait courageusement en apprentissage chez un serrurier. Tout était prêt pour le voyage, l’époque même du départ était fixée, lorsqu’un jour le charpentier vint à tomber d’un échafaudage. On le rapporta mourant chez lui. Pendant que les voisins couraient chercher du secours, les deux frères restèrent seuls auprès du lit où leur père demeurait immobile comme un cadavre. Le petit Julien avait pris dans sa main la main du mourant, et il la baisait doucement en répétant à travers ses larmes, de sa voix la plus tendre : Père !... Père !... Comme si cette voix si chère avait réveillé chez le blessé ce qui lui restait de vie, Michel Volden tressaillit, il essaya de parler, mais ce fut en vain ; ses lèvres remuèrent sans qu’un mot pût sortir de sa bouche. Alors une vive anxiété se peignit sur ses traits. Il sembla réfléchir, comme s’il cherchait avec angoisse le moyen de faire comprendre à ses deux enfants ses derniers désirs ; puis, après quelques instants, il fit un effort suprême et, soulevant la petite main caressante de Julien, il la posa dans celle de son frère aîné. Épuisé par cet effort, il regarda longuement ses deux fils d’une façon expressive, et son regard profond, et ses yeux tristes semblaient vouloir leur dire :
—Aimez-vous l’un l’autre, pauvres enfants qui allez désormais rester seuls ! Vivez toujours unis, sous l’œil de Dieu, comme vous voilà à cette heure devant moi, la main dans la main. André comprit le regard paternel, il se pencha vers le mourant : —Père, répondit-il, j’élèverai Julien et je veillerai sur lui comme vous l’eussiez fait vous-même. Je lui enseignerai, comme vous le faisiez, l’amour de Dieu et l’amour du devoir : tous les deux nous tâcherons de devenir bons et vertueux. Le père essaya un faible sourire, mais son œil, triste encore, semblait attendre d’André quelque autre chose. André le voyait inquiet et il cherchait à deviner ; il se pencha jusqu’auprès des lèvres du moribond, l’interrogeant du regard. Un mot plus léger qu’un souffle arriva à l’oreille d’André :
—France ! —Oh ! s’écria le fils aîné avec élan, soyez tranquille, cher père, je vous promets que nous demeurerons les enfants de la France ; nous quitterons Phalsbourg pour aller là-bas ; nous resterons Français, quelque peine qu’il faille souffrir pour cela. Un soupir de soulagement s’échappa des lèvres paternelles. La main froide de l’agonisant serra d’une faible étreinte les mains des deux enfants réunies dans la sienne, puis ses yeux se tournèrent vers la fenêtre ouverte par où se montrait un coin du grand ciel bleu : ses regards mourants s’éclairèrent d’une flamme plus pure ; il semblait vouloir à présent ne plus songer qu’à Dieu. Son âme s’élevait vers lui dans une ardente et dernière prière, remettant à sa garde suprême les deux orphelins agenouillés auprès du lit. Peu d’instants après, Michel Volden exhalait son dernier soupir. Toute cette scène n’avait duré que quelques minutes ; mais elle s’était imprimée en traits ineffaçables dans le cœur d’André et dans celui du petit Julien. Quelque temps après la mort de leur père, les deux enfants avaient songé à passer en France comme ils le lui avaient promis. Mais il ne leur restait plus d’autre parent qu’un oncle demeurant à Marseille, et celui-ci n’avait répondu à aucune de leurs lettres ; il n’y avait donc personne qui pût leur servir de tuteur. Dans ces circonstances, les Allemands refusaient aux jeunes gens orphelins la permission de partir, et les considéraient bon gré mal gré comme sujets de l’Allemagne. André et Julien n’avaient plus alors d’autre ressource, pour rester fidèles et à leur pays et au vœu de leur père, que de passer la frontière à l’insu des Allemands et de se diriger vers Marseille, où ils tâcheraient de retrouver leur oncle. Une fois qu’ils l’auraient retrouvé, ils le supplieraient de leur venir en aide et de régulariser leur situation en Alsace : car il restait encore une année entière accordée par la loi aux Alsaciens-Lorrains pour choisir leur patrie et déclarer s’ils voulaient demeurer Français ou devenir Allemands. Tels étaient les motifs pour lesquels les deux enfants s’étaient mis en marche et étaient venus demander au père Étienne l’hospitalité. Lorsque André eut achevé le récit des événements qu’on vient de lire, Étienne lui prit les deux mains avec émotion : —Ton frère et toi, lui dit-il, vous êtes deux braves enfants, dignes de votre père, dignes de la vieille terre d’Alsace-Lorraine, dignes de la patrie française ! Il y a bien des cœurs français en Alsace-Lorraine ! on vous aidera ; et pour commencer, André, tu as un protecteur dans l’ancien camarade de ton père.
4. Les soins de la mère Étienne. Les papiers d’André. Un don fait en secret. La charité du pauvre.
Ce qu’il y a de plus beau au monde, c’est la charité du pauvre.
Le lendemain, de bon matin, Mme Étienne était sur pied. En vraie mère de famille, elle visita les deux paquets de linge et d’habits que les deux voyageurs portaient sur l’épaule, et elle mit de bonnes pièces aux pantalons ou aux blouses qui en avaient besoin. En même temps elle avait allumé le poêle, ce meuble indispensable dans les pays froids du nord, qui sert tout à la fois à chauffer la maison et à préparer les aliments. Elle étendit tout autour les vêtements mouillés des enfants ; lorsqu’ils furent secs, elle les brossa et les répara de son mieux. Tandis qu’elle pliait avec soin le gilet d’André, un petit papier bien enveloppé tomba d’une des poches. —Oh ! se dit l’excellente femme, ce doit être là qu’est renfermée toute la fortune de ces deux enfants ; si, comme je le crains, la bourse est trop légère, on fera son possible pour y ajouter quelque chose. Et elle développa le petit paquet.—Dix, vingt, trente, quarante francs, se dit-elle ; que c’est peu pour aller si loin !... la route est bien longue d’ici à Marseille. Et les jours de pluie, et les jours de neige ! car l’hiver bientôt va venir... Les yeux de la mère Étienne étaient humides.
Le poele.—Le poêle est nécessaire dans les pays froids comme ceux de l’est et du nord ; car il donne plus de chaleur qu’une cheminée, mais cette chaleur est moins saine, elle rend l’air trop sec. Pour y remédier, il est bon de placer sur le poêle un vase rempli d’eau.
—Et dire qu’avec si peu de ressources ils n’ont point hésité à partir !... O pauvre France ! tu es bien malheureuse en ce moment, mais tu dois pourtant être fière de voir que, si jeunes, et pour rester tes fils, nos enfants montrent le courage des hommes... Seigneur Dieu, ajouta-t-elle, protège-les !... fais qu’ils rencontrent durant leur longue route des cœurs compatissants, et que pendant les froides soirées de l’hiver ils trouvent une petite place au foyer de nos maisons. Pendant qu’elle songeait ainsi en son cœur, elle s’était approchée de son armoire et elle atteignait sa petite réserve d’argent, bien petite, hélas ! car le père et la mère Étienne avaient cruellement souffert des malheurs de la guerre. Néanmoins, elle y prit deux pièces de cinq francs et les joignit à celles d’André : —Étienne sera content, dit-elle : il m’a recommandé de faire tout ce que je pourrais pour les enfants de son vieux camarade. Quand elle eut glissé dans la bourse les pièces d’argent : —Ce n’est pas le tout, dit-elle ; examinons ce petit rouleau qui enveloppait la bourse, et voyons si nos orphelins ont songé à se procurer de bons papiers, attestant qu’ils sont d’honnêtes enfants et non des vagabonds sans feu ni lieu... Ah ! voici d’abord le certificat du patron d’André :
«J’atteste que le jeune André Volden a travaillé chez moi dix-huit mois entiers sans que j’aie eu un seul reproche à lui faire. C’est un honnête garçon, laborieux et intelligent : je suis prêt à donner de lui tous les renseignements que l’on voudra. Voici mon adresse ; on peut m’écrire sans crainte. Pierre Hetman. maître serrurier, établi depuis trente ans à Phalsbourg.»
—Bien, cela ! dit Mme Étienne en repliant le certificat. Et ceci, qu’est-ce ? Ah ! c’est leur extrait d’âge, très bien. Enfin, voici une lettre de maître Hetman à son cousin, serrurier à Épinal, pour le prier d’occuper André un mois : André portera ensuite son livret d’ouvrier à la mairie d’Épinal et M. le maire y mettra sa signature. De mieux en mieux. Les chers enfants n’ont rien négligé : ils savent que tout ouvrier doit avoir un livret bien tenu et des certificats en règle. Allons, espérons en la Providence ! tout ira bien. Lorsque Julien et André s’éveillèrent, ils trouvèrent leurs habits en ordre et tout prêts à être mis ; et cela leur parut merveilleusement bon, car les pauvres enfants, ayant perdu leur mère de bonne heure, n’étaient plus accoutumés à ces soins et à ces douces attentions maternelles. Julien, dès qu’il fut habillé, peigné, le visage et les mains bien nets, courut avec reconnaissance embrasser Mme Étienne, et la remercia d’un si grand cœur qu’elle en fut tout émue. —Cela est bel et bon, répondit-elle gaîment, mais il faut déjeuner. Vite, les enfants, prenez ce pain et ce fromage, et mangez.
5. Les préparatifs d’Étienne le sabotier. Les adieux. Les enfants d’une même patrie.
Les enfants d’une même patrie doivent s’aimer et se soutenir comme les enfants d’une même mère.
Pendant qu’André et Julien mangeaient, Étienne entra. —Enfants, dit le sabotier en se frottant les mains, je n’ai pas perdu mon temps : j’ai travaillé pour vous depuis ce matin. D’abord, je vous ai trouvé deux places dans la charrette d’un camarade qui va chercher des foins tout près de Saint-Quirin, village voisin de la frontière, où vous coucherez ce soir. On vous descendra à un quart d’heure du village. Cela économisera les petites jambes de Julien et les tiennes, André. Ensuite j’ai écrit un mot de billet que voici, pour vous recommander à une vieille connaissance que j’ai aux environs de Saint-Quirin, Fritz, ancien garde forestier de la commune. Vous serez reçus là à bras ouverts, les enfants, et vous y dormirez une bonne nuit. Enfin, ce qui vaut mieux encore, Fritz vous servira de guide le lendemain dans la montagne, et vous mènera hors de la frontière par des chemins où vous ne rencontrerez personne qui puisse vous voir. C’est un vieux chasseur que l’ami Fritz, un chasseur qui connaît tous les sentiers de la montagne et de la forêt. Soyez tranquilles, dans quarante-huit heures vous serez en France. —Oh ! monsieur Étienne, s’écria André, vous êtes bon pour nous comme un second père ! —Mes enfants, répondit Étienne, vous êtes les fils de mon meilleur ami, il est juste que je vous vienne en aide. Et puis, est-ce que tous les Français ne doivent pas être prêts à se soutenir entre eux ? A votre tour, ajouta-t-il d’une voix grave, quand vous rencontrerez un enfant de la France en danger, vous l’aiderez comme je vous aide à cette heure, et ainsi vous aurez fait pour la patrie ce que nous faisons pour elle aujourd’hui.
Le sabotier des Vosges.—On fabrique surtout les sabots dans les pays de forêts et de montagnes, et on se sert principalement de bois de hêtre ou de noyer pour y creuser les sabots. Il y a beaucoup de sabotiers dans les Vosges, car ces montagnes sont très boisées.
En achevant ces paroles Étienne entra dans la pièce voisine, où était son atelier de sabotier, et, voulant réparer le temps perdu, il se mit à travailler avec activité. Le petit Julien l’avait suivi, et il prenait un grand plaisir à le voir creuser et façonner si lestement les bûches de hêtre de la montagne. Vers le milieu de l’après-midi, la carriole dont avait parlé le père Étienne s’arrêta sur la grande route ; le charretier, comme cela était convenu, siffla de tous ses poumons pour avertir les jeunes voyageurs. A ce signal, André et Julien saisirent rapidement leur paquet de voyage ; ils embrassèrent de tout leur cœur la mère Étienne, et aussitôt le sabotier les conduisit vers la carriole. Après une nouvelle accolade, après les dernières et paternelles recommandations du brave homme, les enfants se casèrent dans le fond de la carriole, le charretier fit claquer son fouet et le cheval se mit au petit trot. Le père Étienne, resté seul sur la grande route, suivait des yeux la voiture qui s’éloignait. Il se sentait à la fois tout triste et pourtant fier de voir les enfants partir. —Brave et chère jeunesse, murmurait-il, va, cours porter à la patrie des cœurs de plus pour la chérir ! Et lorsque la voiture eut disparu, il revint chez lui lentement, songeur, pensant au père des deux orphelins, à son vieil ami d’enfance qui dormait son dernier sommeil sous la terre de Lorraine, tandis que ses deux fils s’en allaient seuls désormais au grand hasard de la vie. Alors une larme glissa des yeux du vieillard :
—Juste Dieu, murmura-t-il, bénis et protège cette jeunesse innocente et sans appui !
6. Une déception. La persévérance.
Il n’est guère d’obstacle qu’on ne puisse surmonter avec de la persévérance.
Une déception attendait nos jeunes amis à leur arrivée dans la maison isolée du garde Fritz, située aux environs de la forêt. Fritz, grand vieillard à barbe grise, d’une figure énergique, était étendu sur son lit qu’il n’avait pas quitté depuis plusieurs jours. Le vieux chasseur était tombé en descendant la montagne et s’était fait une fracture à la jambe. —Voyez, mes enfants, dit-il après avoir lu la lettre ; je ne puis bouger de mon lit. Comment pourrais-je vous conduire ? Et je n’ai auprès de moi que ma vieille servante, qui ne marche pas beaucoup mieux que moi. André fut consterné, mais il n’en voulut rien faire voir pour ne point inquiéter le petit Julien. Toute la nuit il dormit peu. Le matin de bonne heure, avant même que Julien s’éveillât, il s’était levé pour réfléchir. Il se dirigea sans bruit vers le jardin du garde, voulant examiner le pays, qu’il n’avait vu que le soir à la brune.
Carte de la Lorraine et de l’Alsace, et chaine des Vosges.—La Lorraine, séparée de l’Alsace par la chaîne des Vosges, est une contrée montueuse, riche en forêts, en lacs, en étangs et en mines de métaux et de sel. Elle a de beaux pâturages. Outre le blé et la vigne, on y cultive le lin, le chanvre, le houblon qui sert à faire la bière ; l’agriculture y est, comme l’industrie, très perfectionnée. Une partie de la Lorraine et l’Alsace entière, sauf Belfort, ont été enlevées à la France par l’Allemagne en 1870.
Assis sur un banc au bord de la Sarre, qui coule le long du jardin entre deux haies de bouleaux et de saules, André se tourna vers le sud, et il regarda l’horizon borné par les prolongements de la chaîne des Vosges. —C’est là, se dit-il, que se trouve la France, là que je dois la nuit prochaine emmener mon petit Julien, là qu’il faut que je découvre, sans aucun secours, un sentier assez peu fréquenté pour n’y rencontrer personne et passer librement la frontière. Mon Dieu, comment ferai-je ? Et il continuait de regarder avec tristesse les montagnes qui le séparaient de la France, et qui se dressaient devant lui comme une muraille infranchissable. Des pensées de découragement lui venaient, mais André était persévérant : au lieu de se laisser accabler par les difficultés qui se présentaient, il ne songea qu’à les combattre. Tout à coup il se souvint d’avoir vu dans la chambre du garde forestier une grande carte du département, pendue à la muraille : c’était une de ces belles cartes dessinées par l’état-major de l’armée française, et où se trouvent indiqués jusqu’aux plus petits chemins. —Je vais toujours l’étudier, se dit André. A quoi me servirait d’avoir été jusqu’à treize ans le meilleur élève de l’école de Phalsbourg, si je ne parvenais à me reconnaître à l’aide d’une carte ? Allons ! du courage ! n’ai-je pas promis à mon père d’en avoir ? Je dois passer la frontière et je la passerai.
7. La carte tracée par André. Comment il tire parti de ce qu’il a appris a l’école.
Quand on apprend quelque chose, on ne sait jamais tout le profit qu’on en pourra retirer un jour.
Le garde Fritz approuva la résolution et la fermeté d’André.
—A la bonne heure ! dit-il. Quand on veut être un homme, il faut apprendre à se tirer d’affaire soi-même. Voyons, mon jeune ami, décrochez-moi la carte : si je ne puis marcher, du moins je puis parler. Vous avez si bonne volonté et je connais si bien le pays, que je pourrai vous expliquer votre chemin. Alors tous deux, penchés sur la carte, étudièrent le pays. Julien, de son côté, s’était assis sagement auprès d’eux, s’efforçant de retenir ce qu’il pourrait. Le garde parlait, montrant du doigt les routes, les sentiers, les raccourcis, faisant la description minutieuse de tous les détails du chemin. André écoutait ; puis il essaya de répéter les explications ; enfin il dessina lui-même tant bien que mal sa route sur un papier, avec les différents accidents de terrain qui lui serviraient comme de jalons pour s’y reconnaître. «Ici, écrivait-il, une fontaine ; là, un groupe de hêtres à travers les sapins ; plus loin, un torrent avec le gué pour le franchir, un roc à pic que contourne le sentier, une tour en ruines.» Enfin rien de ce qui pouvait aider le jeune voyageur ne fut négligé.
—Tout ira bien, lui disait Fritz, si vous ne vous hâtez pas trop. Rappelez-vous que, quand on se trompe de chemin dans les bois ou les montagnes, il faut revenir tranquillement sur ses pas, sans perdre la tête et sans se précipiter : c’est le moyen de retrouver bientôt le vrai sentier. Quand la brune fut venue, André et Julien se remirent en route, après avoir remercié de tout leur cœur le garde Fritz, qui de son lit leur répétait en guise d’adieu : «Courage, courage ! avec du courage et du sang-froid on vient à bout de tout.»
8. Le sentier à travers la foret. Les enseignements du frère ainé. La grande Ourse et l’étoile polaire.
Le frère aîné doit instruire le plus jeune par son exemple et, s’il le peut, par ses leçons.
A l’ouest, derrière les Vosges, le soleil venait de se coucher ; la campagne s’obscurcissait. Sur les hautes cimes de la montagne, au loin, brillaient les dernières lueurs du crépuscule, et les noirs sapins, agitant leurs bras au souffle du vent d’automne, s’assombrissaient de plus en plus. Les deux frères avançaient sur le sentier, se tenant par la main ; bientôt ils entrèrent au milieu des bois qui couvrent toute cette contrée. Julien marchait la tête penchée, d’un air sérieux, sans mot dire.
—A quoi songes-tu, mon Julien ? demanda André. —Je tâche de bien me rappeler tout ce que disait le garde, fit l’enfant, car j’ai écouté le mieux que j’ai pu. —Ne t’inquiète pas, Julien ; je sais bien la route, et nous ne nous égarerons pas. —D’ailleurs, reprit l’enfant de sa voix douce et résignée, si l’on s’égare, on reviendra tranquillement sur ses pas, sans avoir peur, comme le garde a dit de le faire, n’est-ce pas, André ? —Oui, oui, Julien, mais nous allons tâcher de ne pas nous égarer. —Pour cela, tu sais, André, il faut regarder les étoiles à chaque carrefour ; le garde l’a dit, je t’y ferai penser. —Bravo, Julien, répondit André, je vois que tu n’as rien perdu de la leçon du garde ; si nous sommes deux à nous souvenir, la route se fera plus facilement. —Oui, dit l’enfant ; mais je ne connais pas les étoiles par leur nom, et je n’ai pas compris ce que c’est que le grand Chariot. —Je te l’expliquerai quand nous nous arrêterons. Tout en devisant ainsi à voix basse, les deux frères avançaient et la nuit se faisait plus noire.
L’étoile polaire et la grande ourse.—Il est utile d’apprendre à connaître dans le ciel les étoiles qui forment la constellation du grand Chariot ou grande Ours. Près d’elles on aperçoit l’étoile polaire, qui marque exactement le nord et indique la nuit les points cardinaux.
André avait tant étudié le pays toute la journée, qu’il lui semblait le reconnaître comme s’il y avait déjà passé. Malgré cela, il ne pouvait se défendre d’une certaine émotion : c’était la première fois qu’il suivait ainsi les sentiers de la montagne, et cela dans l’obscurité du soir. Toutefois c’était un courageux enfant, et qui n’oubliait jamais sa tâche de frère aîné : songeant que le petit Julien devait être plus ému que lui encore en face des grands bois sombres, André s’efforçait de surmonter les impressions de son âge, afin d’enhardir son jeune frère par son exemple et d’accomplir courageusement avec lui son devoir. A un carrefour ils s’arrêtèrent. André regarda le ciel derrière lui. —Vois, dit-il à son frère, ces sept étoiles brillantes, dont quatre sont en carré comme les quatre roues d’un char, et trois autres par devant, comme le cocher et les chevaux : c’est ce qu’on appelle le grand Chariot ou encore la grande Ourse ; non loin se trouve une étoile assez brillante aussi, et qu’on voit toujours immobile exactement au nord : on l’appelle pour cela l’étoile polaire. Grâce à cette étoile, on peut toujours reconnaître sa route dans la nuit. La vois-tu bien ? Elle est juste derrière nous : cela prouve que nous sommes dans notre chemin ; nous marchons vers le sud, c’est-à-dire vers la France. André, qui ne négligeait point les occasions d’instruire son frère en causant, lui enseigna aussi vers quel point la lune se lèverait bientôt, et à la pensée qu’elle allait éclairer leur route, les enfants se réjouirent de tout leur cœur.
9. Le nuage sur la montagne. Inquiétude des deux enfants.
Le courage ne consiste pas à ne point être ému en face d’un danger, mais à surmonter son émotion : c’est pour cela qu’un enfant peut être aussi courageux qu’un homme.
Après un petit temps de repos ils se remirent en route. Mais tout à coup l’obscurité augmenta. Julien effrayé se serra plus près de son grand frère. Bientôt les étoiles qui les avaient guidés jusqu’alors disparurent. Un nuage s’était formé au sommet de la montagne, et, grossissant peu à peu, il l’avait enveloppée tout entière. Les enfants eux-mêmes se trouvèrent bientôt au milieu de ce nuage. Entourés de toutes parts d’un brouillard épais, ils ne voyaient plus devant eux. Ils s’arrêtèrent, bien inquiets ; mais tous deux, pour ne pas s’affliger l’un l’autre, n’osèrent se le dire.
Le nuage sur la montagne.—Les nuages sont formés de la vapeur d’eau qui s’échappe de la mer, des fleuves et de la terre : ils ne sont pas toujours très élevés en l’air ; fréquemment ils se traînent sur les montagnes et on les voit flotter sur leurs flancs. Les voyageurs qui gravissent une montagne entrent souvent dans les nuages ; ils se trouvent alors au milieu d’un épais brouillard et courent le danger de se perdre.
—Donne-moi ton paquet, dit André à Julien ; je le joindrai au mien ; ton bâton sera libre, il me servira à tâter la route comme font les aveugles, afin que nous ne nous heurtions pas aux racines ou aux pierres. J’irai devant ; tu tiendras ma blouse, car mes deux mains vont être embarrassées ; mais je t’avertirai, je te guiderai de mon mieux. N’aie pas peur, mon Julien. Tu ne vas plus avoir rien à porter, tu pourras marcher facilement. —Oui, dit l’enfant d’une voix tremblante qu’il s’efforçait de rendre calme. Ils se remirent en marche, lentement, avec précaution. Malgré cela, André à un moment se heurta contre une de ces grosses pierres qui couvrent les chemins de montagne ; il tomba, et faillit rouler du haut des rochers, entraînant avec lui le petit Julien. Les deux enfants comprirent alors le danger qu’ils couraient. —Asseyons-nous, dit André tout ému, en attirant Julien près de lui. —André, s’écria Julien, nous avons des allumettes et un bout de bougie. Le garde a dit de ne les allumer que dans un grand besoin ; crois-tu qu’il serait dangereux de les allumer maintenant ? —Non, mon Julien ; la brume est si épaisse que notre lumière ne risque pas d’être aperçue et d’attirer l’attention des soldats allemands qui gardent la frontière. André, en achevant ces mots, alluma sa petite bougie, et Julien fut bien étonné de voir quelle faible et tremblante lueur elle répandait au milieu de l’épais brouillard. Pourtant on se remit en marche aussitôt, car il fallait être en France avant le lever du soleil. Julien, qui n’était plus embarrassé de son paquet, prit la bougie d’une main, et la protégeant de l’autre contre le vent, il avança, non sans trébucher souvent sur le chemin pierreux. Ce qu’André craignait surtout, c’était de s’être égaré au milieu de la brume. Au bout de quelques instants il prit le papier sur lequel il avait marqué le plan de sa route, et, suivant du regard la ligne qui devait lui indiquer son chemin, il se demanda : «Est-ce bien cette ligne que je suis ?» Puis il dit à Julien :
—Si nous avons marché sans nous tromper, nous devons être assez près d’une vieille tour en ruines ; mais je ne la vois point. Toi qui as d’excellents yeux, regarde toi-même, Julien. Julien regarda, mais il ne vit rien non plus. Ils reprirent leur marche, cherchant avec anxiété à percer du regard les ténèbres. Mais ils n’apercevaient toujours point la vieille tour. De plus la bougie touchait à sa fin ; elle s’éteignit. Les deux enfants n’avaient plus qu’un parti à prendre : s’arrêter, attendre.
10. La halte sous le sapin. La prière avant le sommeil. André reprend courage.
Enfants, la vie entière pourrait être comparée à un voyage où l’on rencontre sans cesse des difficultés nouvelles.
André s’approcha d’un grand sapin dont les branches s’étendaient en parasol et pouvaient leur servir d’abri contre la rosée nocturne. —Viens, dit-il à son jeune frère, viens près de moi : nous serons bien là pour attendre. Julien s’approcha, silencieux ; André s’aperçut que, sous l’humidité glaciale du brouillard, l’enfant frissonnait ; ses petites mains étaient tout engourdies par le froid.
Le sapin des Vosges.—Les Vosges sont presque entièrement recouvertes de vastes forêts de pins et de sapins qui atteignent jusqu’à 40 et 50 mètres de hauteur. Ces arbres fournissent un bois excellent pour la charpente des maisons et les mâts des navires.
—Pauvre petit, murmura André, assieds-toi sur mes genoux : je vais te couvrir avec les vêtements renfermés dans notre paquet de voyage ; cela te réchauffera, et si tu peux dormir en attendant que le brouillard se lève, tu reprendras des forces pour la longue route qu’il nous reste à faire. L’enfant était si las qu’il ne fit aucune objection. Il passa un de ses bras autour du cou de son frère, et déjà ses yeux fatigués se fermaient lorsqu’il lui revint une pensée. —André, dit-il, puisque je vais dormir, je vais faire ma prière du soir. —Oui, mon Julien, nous la dirons ensemble. Et les deux orphelins, perdus au milieu de cette grande et triste solitude de la montagne, élevèrent dans une même prière leurs jeunes cœurs vers le ciel. Peu de temps après, Julien s’était endormi. Sa petite tête reposait confiante sur l’épaule d’André ; le frère aîné, de son mieux, protégeait l’enfant contre la fraîcheur de la nuit, et il écoutait sa respiration tranquille : ce bruit léger troublait seul le silence qui les enveloppait. André, malgré lui, sentit une grande tristesse lui monter au cœur.—Réussirons-nous jamais à arriver en France ? se disait-il. Quelquefois les brouillards dans la montagne durent plusieurs jours. Qu’allons-nous devenir si celui-ci tarde à se dissiper ? Une fatigue extrême s’était emparée de lui. La bise glaciale, qui faisait frissonner les pins, le faisait lui aussi trembler sur le sol où il était assis. Parfois le vent soulevait autour de lui les feuilles tombées à terre : inquiet, André dressait la tête, craignant que ce ne fût le bruit de pas ennemis et que quelqu’un tout à coup ne se dressât en face de lui pour lui dire en langue allemande :
—Que faites-vous ici ? Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Ainsi le découragement l’envahissait. Mais alors un cher souvenir s’éleva en son cœur et vint à son aide. Il se rappela le regard profond de son père mourant, lorsqu’il avait placé la main de Julien dans la sienne pour le lui confier ; il crut entendre encore ce mot plus faible qu’un souffle passer sur les lèvres paternelles : France. Et lui aussi le redit tout bas ce mot : France ! patrie !... Et il se sentit honteux de son découragement. —Enfant que je suis, s’écria-t-il, est-ce que la vie n’est pas faite tout entière d’obstacles à vaincre ? Comment donc enseignerai-je à mon petit Julien à devenir courageux, si moi-même je ne sais pas me conduire en homme ? Réconforté par ce souvenir plus puissant que tous les obstacles, priant l’âme de son père de leur venir en aide dans ce voyage vers la patrie perdue, il sut mettre à attendre le même courage qu’il avait mis à agir.
11. Le brouillard se dissipe. Arrivée d’André et de Julien sur la terre française.
Quand on a été séparé de sa patrie, on comprend mieux encore combien elle vous est chère.
Peu à peu la douce tranquillité du sommeil de Julien sembla gagner André, lui aussi. Dans l’immobilité qu’il gardait pour ne pas éveiller l’enfant, il sentit ses yeux s’appesantir par la fatigue. Il eut beau lutter avec fermeté contre le sommeil, malgré lui ses paupières se fermèrent à demi. Après un temps assez long, comme il était à moitié plongé dans une sorte de rêve, il lui sembla, à travers ses paupières demi-closes, apercevoir une faible clarté. Il tressaillit, secouant par un dernier effort le sommeil qui l’envahissait, il ouvrit les yeux tout grands. Le brouillard était encore autour de lui, mais il était devenu à demi lumineux. De pâles rayons pénétraient à travers la brume : la lune venait de se lever. Bientôt la brume elle-même devint moins épaisse, elle se dissipa comme un mauvais rêve. A travers chacune des branches du vieux sapin, les étoiles brillantes se montrèrent dans toute leur splendeur, et à peu de distance la vieille tour qu’André avait tant cherchée se dressa devant lui inondée de lumière. Le cœur d’André battit de joie. Il serra son jeune frère dans ses bras. —Réveille-toi, mon Julien, s’écria-t-il ; regarde ! le brouillard et l’obscurité sont dissipés ; nous allons pouvoir enfin repartir. Julien ouvrit les yeux ; en voyant ce ciel lumineux, il se mit à sourire naïvement, et frappant ses petites mains l’une contre l’autre, il sauta de plaisir. —Que Dieu est bon ! dit-il, et que la montagne est belle à présent que la voilà toute éclairée par ces jolis rayons de lune !... Ah ! voici la vieille tour ; André, nous n’avons pas perdu la bonne route, partons vite. Aussitôt on refit les paquets de voyage. Cette gaie lumière avait fait oublier les fatigues précédentes. Les deux enfants reprirent allègrement leur bâton ; tout en marchant, on mangea une petite croûte de pain, et on se rafraîchit en partageant une pomme que la mère Étienne avait mise dans la poche de Julien.
Col des Vosges.—Un col est un passage étroit entre deux montagnes. Quand on arrive en haut d’un col, on aperçoit derrière soi le versant de la montagne qu’on vient de gravir, et devant soi celui qu’on va redescendre.
Les enfants continuèrent à marcher courageusement tout le reste de la nuit, et aussi vite qu’ils pouvaient. Le ciel était si lumineux que la route était devenue facile à reconnaître. Leur seule préoccupation était à présent d’échapper aux surveillants de la frontière, jusqu’à ce qu’on eût franchi le col de la montagne qui sépare en cet endroit la France des pays devenus allemands. Les jeunes voyageurs s’avançaient avec attention, sans bruit, passant comme des ombres à travers ce pays boisé. Ce fut vers le matin qu’ils atteignirent enfin le col. Alors, se trouvant sur l’autre versant de la montagne, les deux enfants virent tout à coup s’étendre à leurs pieds les campagnes françaises, éclairées par les premières lueurs de l’aurore. C’était là ce pays aimé vers lequel ils s’étaient dirigés au prix de tant d’efforts. Le cœur ému, songeant qu’ils étaient enfin sur le sol de la France et que le vœu de leur père était accompli, ils s’agenouillèrent pieusement sur cette terre de la patrie qu’ils venaient de conquérir par leur courage et leur volonté persévérante ; ils élevèrent leur âme vers le ciel, et tout bas remerciant Dieu, ils murmurèrent : —France aimée, nous sommes tes fils, et nous voulons toute notre vie rester dignes de toi ! Lorsque le soleil parut, empourprant les cimes des Vosges, ils étaient déjà loin de la frontière, hors de tout danger ; et se tenant toujours par la main ils marchaient joyeusement sur une route française, marquant le pas comme de jeunes conscrits.
12. L’ordre dans les vêtements et la propreté. L’hospitalité de la fermière lorraine.
Voulez-vous qu’au premier coup d’œil on pense du bien de vous ? Soyez propres et décents, les plus pauvres peuvent toujours l’être.
Après plusieurs temps de repos suivis de marches courageuses, les deux enfants aperçurent enfin vers midi la petite pointe du clocher de Celles. Fritz leur avait laissé un mot de recommandation pour la veuve d’un cultivateur de ce village, et ils se réjouissaient d’arriver. Mais, avant de se présenter au village, André se souvint des conseils que Mme Étienne leur avait donnés. «Mes enfants, leur avait-elle dit, partout où vous allez passer, personne ne vous connaîtra ; ayez donc bien soin de vous tenir propres et décents, afin qu’on ne puisse vous prendre pour des mendiants ou des vagabonds. Si pauvre que l’on soit, on peut toujours être propre. L’eau ne manque pas en France, et rien n’excuse la malpropreté.» —Julien, dit André à son frère, n’oublions pas les conseils de la bonne mère Étienne ; mettons-nous bien propres avant de nous présenter chez les amis du garde. —Oui, dit l’enfant, courons au bord de cette jolie rivière qui coule près de la route ; nous nous laverons le visage et les mains. —Ensuite, répondit André, je brosserai tes habits avec mon mouchoir, nous rangerons bien nos cheveux, nous frotterons nos souliers avec de l’herbe pour les nettoyer, et comme cela nous n’aurons pas l’air de deux vagabonds. Aussitôt dit, aussitôt fait. En un clin d’œil ils eurent réparé le désordre causé par une nuit et une demi-journée de voyage dans les bois à travers la montagne.
Oies de Lorraine.—C’est une des races les plus répandues dans le nord et l’est de la France. Elles sont petites, mais robustes. Les oies de la plus haute taille se trouvent dans le Languedoc. Les oies aiment la propreté. Si elles ont de l’eau pour se baigner et une litière fréquemment renouvelée, elles rapportent davantage et dédommagent la fermière des soins qu’on leur donne.
Lorsqu’ils eurent fini leur toilette, André jeta un dernier coup d’œil sur son jeune frère, et il fut tout fier de voir la bonne mine de Julien, son air bien élevé et raisonnable. Tous les deux alors se présentèrent dans le village et cherchèrent la maison de la veuve dont ils avaient l’adresse. On leur indiqua une ferme située à l’extrémité du village. En entrant dans la cour, ils virent un grand troupeau de belles oies lorraines, qui se réveillèrent en sursaut au bruit de leurs pas et les saluèrent de leurs cris. Ils s’avancèrent vers la porte de la maison, suivis du troupeau et accompagnés d’un bruyant tapage. La fermière vint sur le pas de sa porte et regarda les enfants qui s’approchaient d’elle, chapeau à la main. Dès le premier coup d’œil la ménagère, femme d’ordre et de soin, fut bien prévenue en faveur des enfants qu’elle voyait si propres et si soigneux de leur personne. Aussi, lorsqu’elle eut lu le billet de Fritz, elle fut tout à fait gagnée à leur cause. «Quoi ! pensa-t-elle, ces enfants ont fait seuls et la nuit une route si longue dans la montagne ! Voilà de jeunes cœurs bien courageux et dignes qu’on leur vienne en aide.» Elle les accueillit aussitôt avec empressement, et comme on se mettait à table, elle les plaça auprès d’elle.
13. L’empressement à rendre service pour service. La pêche.
Vous a-t-on rendu un service, cherchez tout de suite ce que vous pourriez faire pour obliger à votre tour celui qui vous a obligé.
Tout en mangeant, André observait que la maison avait l’air fort pauvre. Sans la grande propreté qui faisait tout reluire autour d’eux, on eût deviné la misère. Après le dîner, chacun des membres de la famille se leva bien vite pour retourner à son travail, les jeunes enfants vers l’école, les aînés aux champs. Quoique André fût tout à fait las, il proposa ses services et ceux de Julien avec empressement, car il aurait bien voulu dédommager son hôtesse de l’hospitalité qu’elle leur offrait ; mais la fermière n’y voulut jamais consentir. —Reposez-vous, mes enfants, disait-elle ; sinon vous me fâcherez. Pendant que le débat avait lieu, le petit Julien n’en perdait pas un mot ; il devinait le sentiment d’André, et lui aussi aurait voulu être le moins possible à la charge de la fermière. Tout à coup l’enfant avisa deux lignes pendues à la muraille :
—Oh ! dit-il, regarde, André, quelles belles lignes ! Il faut nous reposer en pêchant. N’est-ce pas, madame, vous voulez bien nous permettre de pêcher ? Nous serions si contents si nous pouvions rapporter de quoi faire une bonne friture ! —Allons, mon enfant, dit la veuve, je le veux bien. Tenez, voici les lignes.
Un quart d’heure après, les deux enfants, munis d’appâts, se dirigeaient vers la rivière avec leurs lignes et un petit panier pour mettre le poisson si l’on en prenait.
Les principaux poissons d’eau douce.—La truite de montagne est une petite espèce de poisson, aux taches noires, rouges et argentées, à la chair délicate, qui vit dans les eaux froides des montagnes, dans les torrents et les lacs presque glacés.—La carpe devient très grosse en vieillissant ; on trouve des carpes qui ont plus d’un mètre de long. Sa chair est assez estimée, mais pleine d’arêtes.—Le brochet est un poisson vorace qu’on a surnommé le requin des rivières et qui avale toute espèce de proie. On en trouve dans certains fleuves qui atteignent 2 mètres de longueur et pèsent jusqu’à 20 kilogr.
André était bon pêcheur ; plus d’une fois, le dimanche, il avait en quelques heures pourvu au dîner du soir. Julien était moins habile, mais il faisait ce qu’il pouvait. On s’assit plein d’espoir à l’ombre des saules, dans une belle prairie comme il y en a beaucoup en Lorraine. Cependant carpes et brochets n’arrivaient guère, et Julien sentait le sommeil le prendre à rester ainsi immobile, la ligne à la main, après une nuit de marche et de fatigue. Il ne tarda pas à se lever. —André, dit-il, j’ai peur, si je reste assis sans rien dire, de m’endormir comme un paresseux qui n’est bon à rien ; je ne veux pas parler pour ne pas effrayer le poisson, mais je vais prendre mon couteau et aller chercher de la salade : cela me réveillera.
Pendant que l’enfant faisait une provision de salade sauvage, jeune et tendre, André continua de pêcher avec persévérance, tant et si bien que le panier commençait à s’emplir de truites et d’autres poissons lorsque Julien revint : le petit garçon était bien joyeux. —Quel bonheur ! André, disait-il, nous allons donc, nous aussi, pouvoir offrir quelque chose à la fermière.
Au moment où les enfants de la fermière revenaient de l’école, André et Julien entrèrent, apportant le panier presque rempli de poissons encore frétillants, et la salade bien nettoyée. On fit fête aux jeunes orphelins. La veuve était touchée des efforts d’André et de Julien pour la dédommager de l’hospitalité qu’elle leur offrait. —Chers enfants, leur dit-elle, il n’y a qu’une demi-journée que je vous connais ; mais je vous aime déjà de tout mon cœur. Cette nuit, vous vous êtes montrés courageux comme deux hommes, et aujourd’hui, quoique fatigués, vous avez tenu à me montrer votre reconnaissance de l’accueil que je vous faisais. Vous êtes de braves enfants, et si vous continuez ainsi, vous vous ferez aimer partout où vous irez ; car le courage et la reconnaissance gagnent tous les cœurs.
14. La vache. Le lait. La poignée de sel. Nécessité d’une bonne nourriture pour les animaux.
Des animaux bien soignés font la richesse de l’agriculture, et une riche agriculture fait la prospérité du pays.
Le reste de l’après-midi se passa gaîment.
—Puisque vous avez tant envie d’être utiles, dit la fermière lorraine aux deux orphelins, je vais vous occuper à présent. Vous, André, je vous prie, surveillez mes enfants : ils arrivent de la classe, et ils ont leurs devoirs à faire. Pendant que vous me remplacerez auprès d’eux, Julien va venir avec moi : nous soignerons la vache et nous ferons le beurre pour le marché de demain. —Oui, oui, dit le petit garçon, et il sautait de plaisir à l’idée de voir la vache, car il aimait beaucoup les animaux. —Prenez ce petit banc en bois et cette tasse, lui dit la fermière ; moi, j’emporte mon chaudron pour traire la vache. Julien prit le banc, et arriva tout sautant à l’étable. —Oh ! s’écria-t-il en entrant, qu’elle est jolie cette petite vache noire, avec ses taches blanches sur le front et sur le dos ! Comme son poil est lustré et ses cornes brillantes ! Et quels grands yeux aimables elle a ! Je voudrais bien savoir comment elle se nomme. —Nous l’appelons Bretonne, dit la fermière en atteignant une botte de ce foin aromatique qu’on recueille dans les montagnes, et qui donne au lait un goût si parfumé ; elle y ajouta de la paille. —Tenez, Julien, dit-elle, portez-lui cela ; elle est douce parce que nous l’avons toujours traitée doucement ; elle ne vous fera pas de mal. Julien prit le fourrage et l’étala devant le râtelier de Bretonne ; pendant ce temps la fermière s’était assise sur le petit banc, son chaudron à ses pieds, et elle commençait à traire la vache. Le lait tombait, blanc et écumeux, dans le chaudron en fer battu, brillant comme de l’argent. —Julien, dit la fermière, apportez votre tasse ; je veux que vous me disiez si le lait de Bretonne est à votre gré. L’enfant tendit sa tasse, et quand elle fut remplie, il la vida sans se faire prier.—Que cela est bon, le lait tout chaud et frais tiré ! dit-il. Voilà la première fois que j’en goûte. —Puisque vous êtes content du lait de Bretonne, cherchez dans la poche de mon tablier, dit la veuve sans s’interrompre de sa besogne ; ne trouvez-vous pas une poignée de sel, Julien ? —Oui, que faut-il donc en faire ? —Prenez-le dans votre main, et présentez-le à Bretonne, vous lui ferez grand plaisir. —Quoi ! fît l’enfant en voyant la vache passer sa langue avec gourmandise sur le sel qu’il lui présentait dans la main, elle aime le sel comme du sucre !
Vache bretonne.—La France possède un grand nombre d’excellentes vaches laitières, parmi lesquelles on compte la vache bretonne qui, lorsqu’elle est bien soignée, peut donner du lait tout en travaillant aux champs. Les vaches flamandes et normandes donnent une quantité de lait plus grande encore, mais à condition qu’on ne les fasse pas travailler.
—Oui, mon enfant, tous les animaux l’aiment, et le sel les entretient en bonne santé ; nous aussi nous avons besoin de sel pour vivre, et si nous en étions privés, nous tomberions malades. Vous admiriez tout à l’heure le poil lustré de Bretonne et ses yeux brillants. Eh bien, si elle a cette bonne mine, c’est qu’elle est bien nourrie, bien soignée, et qu’on lui donne tout ce qu’il lui faut. —Alors vous lui donnez du sel tous les jours ? —Pas à la main, ce serait trop long. Nous faisons fondre le sel dans l’eau, et nous arrosons le fourrage avec cette eau salée au moment de le lui présenter. —Qu’est-ce qu’on lui fait encore après cela pour qu’elle ait cette jolie mine ? —On la tient proprement, Julien. Voyez-vous comme sa litière est sèche et propre. Pour qu’une vache donne beaucoup de lait et qu’elle se porte bien, il lui faut une litière souvent renouvelée. Si je la laissais sur un fumier humide comme font bien des fermières, son lait diminuerait vite et serait plus clair. Voyez aussi comme l’étable est haute d’étage : elle a trois mètres du sol au plafond. Les fenêtres sont placées tout en haut et donnent de l’air aux bêtes sans les exposer au froid. Certes, Bretonne est bien logée. —Pourquoi l’appelle-t-on Bretonne ? dit Julien, qui s’intéressait de plus en plus à la bonne vache. —C’est qu’elle est de race bretonne en effet, dit la fermière en se levant, car elle avait fini de la traire. La Bretagne est bien loin, mais cette bonne petite race est répandue par toute la France. Voyez, Bretonne n’est pas grande ; aussi elle n’est pas coûteuse à nourrir, et nous, qui ne sommes pas riches, nous avons besoin de ne pas trop dépenser. Son lait contient aussi plus de beurre que celui des autres races, et j’ai des pratiques qui me prennent tout le beurre que je fais. Et puis, la race bretonne est robuste, très utile dans les pays montagneux ; au besoin je puis faire travailler ma petite vache sans qu’elle en souffre. Elle sait labourer ou traîner un char avec courage. —Bonne Bretonne ! dit Julien en caressant une dernière fois la vache. L’enfant prit le petit banc, et tandis que la laitière emportait le lourd chaudron de lait, on se dirigea vers la laiterie.
15. Une visite à la laiterie. La crème. Le beurre. Ce qu’une vache fournit de beurre par jour.
Un bon agriculteur doit se rendre compte de ce que chaque chose lui coûte et lui rapporte.
—Quel joli plancher, propre et bien carrelé ! dit Julien en entrant dans la laiterie. Tiens, les fenêtres et toutes les ouvertures sont garnies d’un treillis de fer, comme une prison ; pourquoi donc, madame ? —C’est pour que les mouches, les rats et les souris ne puissent entrer. Avant les malheurs de la guerre nous étions plus à l’aise : j’avais six vaches au lieu d’une, je faisais beaucoup de beurre ; aussi ma laiterie comme mon étable est soigneusement installée. Voyez, ce carrelage dont elle est recouverte permet de la laver à grande eau, et cette eau s’écoule par les rigoles que voici. Il faut au lait une grande propreté, et tout doit reluire chez une fermière qui sait son métier. —Comme il fait frais ici ! reprit Julien en s’avançant dans la salle un peu sombre, autour de laquelle étaient rangées des jattes de lait. —Mon enfant, il faut qu’il fasse frais dans une laiterie. S’il faisait chaud, le lait aigrirait, et la crème n’aurait pas le temps de monter à la surface. Regardez ces grands pots : ils sont tout couverts d’une épaisse croûte blanche que je vais enlever avec ma cuiller pour la mettre dans la baratte : c’est la crème. Passez le doigt sur ma cuiller, et goûtez.
La laiterie et la fabrication du beurre.—La France produit d’excellents beurres, principalement la Normandie et la Bretagne ; on les expédie jusqu’en Allemagne et en Angleterre. Nous en vendons à l’étranger pour 40,000,000 de francs par an.
Julien goûta. —C’est meilleur encore que le lait, cette bonne crème. —Je le crois bien, dit la fermière. Maintenant, avec cette crème, nous allons faire le beurre. Et versant dans la baratte toute la crème qu’elle avait recueillie, elle se mit à battre avec courage. Au bout de quelque temps, elle s’arrêta, et levant le couvercle : —Voyez, Julien, dit-elle. L’enfant regarda et vit flotter dans la baratte de légers flocons jaune paille, qui étaient déjà nombreux.
—Oh ! dit-il enchanté, voilà le beurre qui se fait. Pendant qu’on causait, le beurre s’acheva. La fermière l’égoutta et le lava avec soin, car le beurre bien égoutté et lavé se conserve mieux. Puis elle le mit en boules et chargea Julien de dessiner avec la pointe du couteau de petits losanges sur le dessus. Il s’appliqua consciencieusement à cette besogne, et le beurre avait bonne mine quand Julien eut achevé son dessin. —Mais, s’écria-t-il, toute la crème n’est pas devenue du beurre ; qu’est-ce que tout cela qui reste ? —C’est le petit-lait. On le donnera aux porcs délayé avec de la farine pour les engraisser. Au besoin, j’en fais aussi de la soupe quand nous n’avons pas grand’chose à manger. —Il faut donc bien du lait pour faire le beurre ? demanda Julien tout surpris. —Eh oui, cher enfant. Quinze litres de lait de Bretonne ne font qu’un kilogramme de beurre, et pourtant Bretonne, comme les vaches de sa race, est une merveille. Il y a d’autres vaches dont il faut jusqu’à vingt-cinq litres pour faire un kilogramme de beurre. Mais, Julien, vous allez devenir savant dans les choses de la ferme comme si vous vouliez être un jour fermier, vous aussi. L’enfant rougit de plaisir.
—Vrai, dit-il, c’est un métier que j’aimerais mieux que tous les autres. Mais, dites-moi encore, je vous prie, combien Bretonne vous donne-t-elle de lait par jour ? —Sept litres au plus, l’un dans l’autre. —Alors il faut donc plus de deux jours à Bretonne pour vous donner un kilogramme de beurre ? —Précisément. Mais comme vous comptez bien, mon enfant ! Il y a plaisir à causer avec vous. Un instant après, la fermière sortit de la laiterie avec le jeune garçon, et tous deux portaient à la main de belles boules de beurre, enveloppées dans des feuilles de vigne que Julien était allé cueillir.