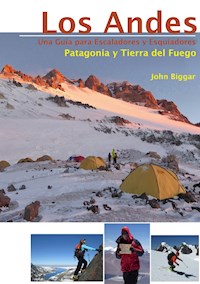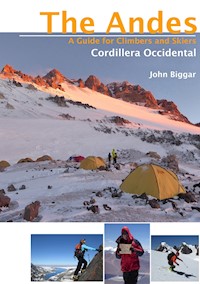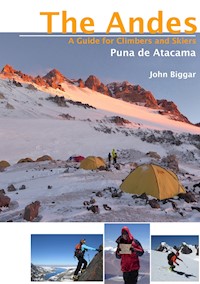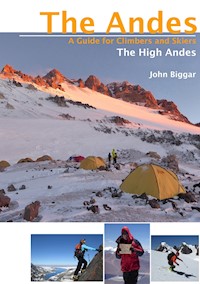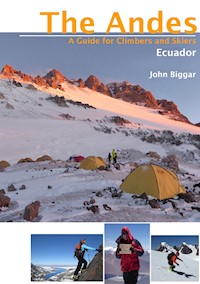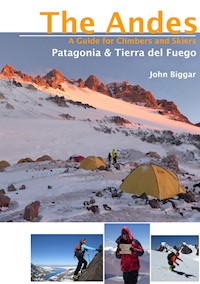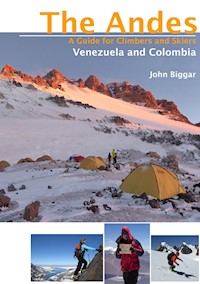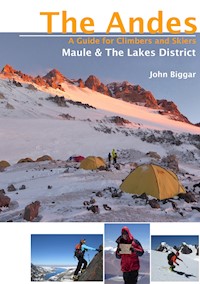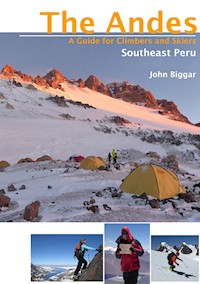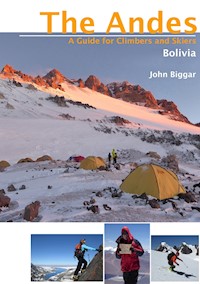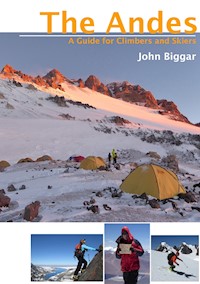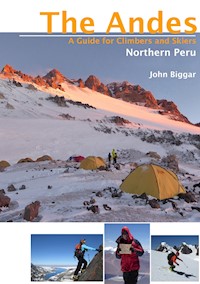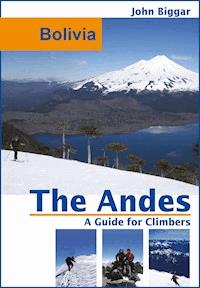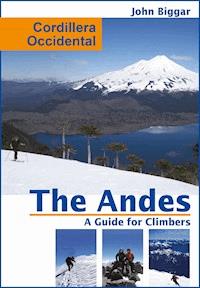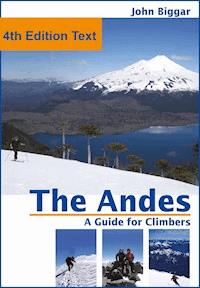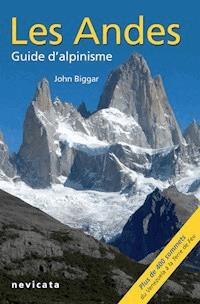
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Les Andes, guide d'alpinisme
- Sprache: Französisch
Le premier topo d’alpinisme couvrant l’ensemble de la cordillère des Andes, du Venezuela à la Patagonie et la Terre de Feu
Quel amateur de montagne n’a rêvé de découvrir un jour l’Amérique du Sud par ses plus belles montagnes?
Destiné aux alpinistes et aux randonneurs, ce guide complet reprend tous les sommets de plus de 6000 mètres d’altitude, les 5000 les plus importants et les principales montagnes de Patagonie et de Terre de Feu, sans oublier les principaux sites d’escalade et de bloc.
Au total, plus de 400 sommets décrits en détail, avec des milliers d’informations uniques ainsi que de nombreuses cartes et photos.
De l’océan Pacifique aux confins de l’Altiplano, des grandes parois aux volcans les plus faciles, de la montagne la plus proche à la cordillère la plus reculée, vous trouverez dans ce guide le sommet de vos rêves pour préparer et réaliser un voyage inoubliable !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Le premier ouvrage publié par cette nouvelle maison d’édition comble un vide dans les livres consacrés à la montagne." -
Voyages Voyages
"Un ouvrage incontournable à destination des alpinistes-baroudeurs francophones." -
Montagnes Magazine
"Les amateurs de montagnes lointaines trouveront leur compte de rêves et de projets dans ce guide." -
Les Alpes
À PROPOS DE L'AUTEUR
Instructeur de montagne professionnel, John Biggar grimpe régulièrement dans les Andes depuis une quinzaine d’années. Lorsqu’il n’est pas en Amérique du Sud, il vit à Castle Douglas en Écosse où il dirige ANDES, une agence de voyages spécialisée en trekking, alpinisme et ski dans les Andes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amérique du Sud
Introduction
La cordillère des Andes est l’une des plus hautes chaînes de montagne au monde – seul l’Himalaya compte des sommets plus élevés. Les Andes s’étendent sur toute la côte ouest de l’Amérique du Sud, s’élevant souvent directement depuis l’océan Pacifique. Une grande partie de la chaîne est constituée d’un haut plateau situé entre 3000 et 4500 mètres d’altitude, sur lequel s’élèvent des chaînes de montagne éparses et des volcans isolés jusqu’à plus de 6000m.
Les Andes offrent aux alpinistes des expériences qui se situent à bien des égards à mi-chemin entre ce que l’on peut retrouver dans les Alpes et en Himalaya. En termes d’altitude, de difficulté et d’accès, les Andes se situent quelque part entre les montagnes plutôt civilisées d’Europe ou d’Amérique du Nord et les sommets sauvages de l’Asie. Elles constituent la destination idéale pour les alpinistes expérimentés à la recherche de la haute altitude et de sommets isolés, tout en évitant les problèmes bureaucratiques et les coûts liés à une expédition en Himalaya.
Dans les Andes, l’alpiniste trouvera la gamme la plus large des expériences de montagne. Il y en a pour tous les goûts, des volcans faciles aux grandes faces glaciaires. Le Pérou et la Bolivie sont des pays où la culture inca est encore très présente, tandis que le Chili et l’Argentine sont des nations modernes aux modes de vie très proches de l’Europe. Les Andes du Venezuela et d’Équateur surgissent des forêts tropicales, celles du nord du Chili dominent le désert le plus aride au monde, tandis qu’en Patagonie les montagnes sont entourées des forêts tempérées les plus humides et des plus vastes calottes glaciaires au monde endehors des régions polaires.
À PROPOS DE CE GUIDE
Cette nouvelle édition, la seconde à paraître en français, couvre l’ensemble de la cordillère des Andes. Elle contient les informations nécessaires pour réaliser l’ascension de tous les sommets de plus de 6000m et des sommets de plus de 5000m les plus connus et les plus accessibles, ainsi qu’une sélection des principaux sommets de Patagonie.
Ce guide est destiné à l’alpiniste désireux d’escalader des sommets importants des Andes par des itinéraires de difficulté moyenne. Le plus souvent, seule la voie d’ascension la plus facile est décrite en détail, les voies plus difficiles n’étant détaillées que dans les cas où elles se parcourent assez fréquemment. Les voies techniques les plus difficiles ne sont pas décrites, mais des références pour trouver ces informations sont données.
L’utilisation de ce guide requiert des connaissances élémentaires et une certaine expérience de la montagne et de la recherche d’itinéraire. Les descriptions données sont en conséquence assez brèves. De nombreux croquis et cartes illustrent les itinéraires décrits. Les informations reprises sont aussi fiables et exactes que possible, mais comme cet ouvrage rassemble plus de dix mille éléments d’information provenant de sources multiples, une fiabilité totale ne peut être garantie. L’auteur ou des amis proches ont personnellement parcouru la grande majorité des itinéraires décrits, tandis que diverses sources de confiance ont été utilisées pour les autres descriptions. Cependant, afin de réaliser un guide aussi complet que possible, certains sommets ont été repris pour lesquels il n’existe que peu ou pas d’informations disponibles. Pour ces sommets, l’itinéraire décrit se base sur l’observation et l’analyse de photos et de cartes. Ainsi, un sommet de plus de 6000m repris dans l’édition précédente de ce guide a été gravi pour la première fois grâce à notre description ! Souhaitons que ce nouveau topo suscite encore davantage de curiosité. Faitesnous savoir ce que vous découvrez ! Ce guide est à utiliser avec un guide de voyage général sur les pays visités qui fournira davantage d’informations sur les transports publics, les logements, etc.
• MISES À JOUR
Si l’auteur a fait tout son possible pour que ce guide soit parfaitement à jour et le plus précis possible, il est inévitable qu’il y ait certaines informations qui soient dépassées. Ainsi certaines voies d’ascension, spécialement les voies glaciaires, connaissent des conditions fort changeantes, tandis que des lignes nouvelles font régulièrement leur apparition.
L’auteur demande aux utilisateurs de ce guide de lui faire parvenir toute information nouvelle ou mise à jour susceptible de figurer dans une prochaine édition. Toutes les collaborations importantes recevront un exemplaire gratuit de la prochaine édition. Veuillez envoyer vos informations à :
nevicata Editions Nevicata – 42, avenue du Général de Gaulle – 1050 Bruxelles – Belgique tél +32 26449396 – [email protected] – www.nevicata.be
Vous pouvez commander des exemplaires de ce guide directement à l’adresse cidessus si vous ne le trouvez pas chez votre libraire.
• GUIDE DE TREKKING DANS LES ANDES
Du même auteur, co-écrit avec sa sœur Cathy Biggar, Les Andes guide de trekking est un guide qui propose une sélection des plus beaux treks de la cordillère des Andes et de Patagonie. Une véritable mine d’informations destinées aux randonneurs, illustré de nombreuses photos et cartes en couleur. Vous pouvez commander cet ouvrage auprès de votre libraire ou directement chez l’éditeur via le site www.nevicata.be.
• L’AUTEUR
Instructeur de montagne professionnel, John Biggar grimpe régulièrement dans les Andes depuis une quinzaine d’années. Lorsqu’il n’est pas en Amérique du Sud, il vit à Castle Douglas en Écosse où il dirige ANDES, une agence spécialisée en alpinisme, ski et trekking dans les Andes. Pour obtenir davantage de détails ou une brochure complète sur ces expéditions, veuillez vous adresser à :
John Biggar – ANDES 37a St Andrew Street Castle Douglas DG7 1EH ÉCOSSE tél +44 1556 [email protected]
COMMENT UTILISER CE GUIDE
Les Andes sont décrites du nord au sud et divisées aussi logiquement que possible en chaînes et en régions. Une classification d’ouest en est a été utilisée là où c’était nécessaire. Chaque chapitre commence par une introduction présentant les conditions rencontrées dans la chaîne ou la région concernée. Les villes ou agglomérations de départ font également l’objet d’une brève description.
• HORAIRES
Le nombre de jours indiqué pour réaliser l’ascension d’un sommet est celui requis pour effectuer l’allerretour depuis le point de départ cité dans la rubrique « approche ». Gravir plusieurs sommets dans la même région permettra donc de gagner du temps sur les approches. Ces horaires supposent que les alpinistes sont déjà bien acclimatés à l’altitude du camp de base et en bonne condition physique, mais ils tiennent compte des jours nécessaires pour s’acclimater audelà de celui-ci. Comme la durée d’une bonne acclimatation varie considérablement d’une personne à l’autre, certains pourront trouver ces horaires trop longs ou trop courts. Ainsi par exemple, nous recommandons pour certains sommets élevés mais faciles comme le Pissis ou l’Ojos del Salado un horaire de 4 jours. Mais ils seront gravis en 2 jours par des gens super acclimatés et en 10 jours par d’autres… Ces horaires ne tiennent pas compte des retards pris lors de l’approche de la montagne, en raison de difficultés engendrées par la recherche d’itinéraire ou le mauvais temps. L’usage d’un 4x4 est envisagé chaque fois que possible. Pour assurer le succès d’une ascension, il est plus prudent de prévoir un ou plusieurs jours de réserve pour faire face à des retards dus à la météo, une approche difficile ou d’autres imprévus. S’il faut avoir recours à des transports publics, il est quasiment obligatoire de prévoir des jours supplémentaires. Les horaires donnés dans la rubrique « ascension » ne concernent que cette dernière et sont donnés en heures.
• NOMS DE LIEUX
Les noms de lieux utilisés sont généralement ceux que l’on retrouve sur la carte recommandée. Ceux-ci sont donnés selon les cas en espagnol, quechua, aymara ou mapuche, avec traduction française lorsque celle-ci est connue et possible.
• ALTITUDES
Les altitudes reprises dans ce guide sont à chaque fois celles de la source d’information la plus fiable. Ces sources varient suivant les pays (voir ci-dessous) et sont chaque fois recoupées.
Les principales informations proviennent de l’Instituto Geografico Militar de chaque pays (IGM).
La mission SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de la navette spatiale de la NASA en 2000 a permis d’obtenir de nombreuses données sur des sommets reculés et peu connus. Toutes les altitudes SRTM reprises dans ce livre ont une marge d’erreur d’environ 10 mètres. Mais en raison de certaines imprécisions, notamment pour les régions aux reliefs fort accidentés, ces relevés n’ont été retenus que dans deux cas de figure. Soit lorsque l’altitude SRTM est supérieure à celle précédemment connue (car on a ainsi une nouvelle altitude minimum), soit lorsque l’altitude SRTM est d’au moins 50 mètres inférieure à celle précédemment connue.
Le livre Mountaineering in the Andes de Jill Neate (1994) est utilisé en l’absence de toute information (et confirmé lorsque possible par les relevés SRTM).
Dans plusieurs régions des Andes, l’altitude exacte de certaines montagnes est encore sujette à débat. C’est le cas par exemple pour plusieurs sommets frontaliers entre le Chili et l’Argentine : les cartes argentines donnent parfois une altitude supérieure à celle reprise sur les cartes chiliennes. Les régions où le problème se pose le plus sont celle qui va du Mercedario au Tupungato dans les Hautes Andes et celle des Campos de Hielo en Patagonie. La préférence a été donnée aux cartes chiliennes vu que leurs relevés sont plus récents, plus détaillés et probablement plus exacts, même si ces incohérences ont tendance à diminuer.
Sources utilisées
– Venezuela et Colombie : livre de Neate et cartes IGMC (1: 100 000) lorsque possible.
– Équateur : cartes IGME (1: 50 000) les plus récentes.
– Pérou : cartes IGMP (1: 100 000) et cartes Alpenverein pour la Cordillera Blanca là où les cartes IGMP ne donnent pas d’altitude (NB : les altitudes Alpenverein sont en général 20-30m supérieures).
– Bolivie : cartes IGMB (1: 50 000 ou 1: 250 000) et cartes Alpenverein pour les régions de l’Illimani et de l’Ancohuma.
– Argentine : cartes IGMA (1: 250 000) et relevés SRTM, utilisés dans de nombreux cas pour confirmer ou corriger des altitudes.
– Chili (ainsi que les sommets frontaliers avec l’Argentine et la Bolivie) : cartes IGMCH (1: 50 000 et 1: 250 000), dont les relevés sont en général beaucoup plus récents.
– Patagonie et Terre de Feu : en général cartes IGMCH (1: 250 000), sinon cartes japonaises Andes Patagonicos pour les Campos de Hielo, la région du Fitz Roy et la Cordillera Darwin. Données confirmées par les relevés SRTM lorsque possible.
• DEGRÉS DE DIFFICULTÉ
Les degrés de difficulté utilisés pour décrire les itinéraires d’ascension en conditions « normales » sont ceux de l’UIAA (F, PD, AD, D, TD, ED). Mais en raison de la grande variété des terrains et des sources d’information, il peut y avoir de légères nuances dans l’attribution des degrés de difficulté entre certains massifs aux caractéristiques très différentes les uns des autres. Les demidegrés (AD+, D-, etc.) ne sont pas utilisés pour la description générale d’une ascension, car ils pourraient laisser penser à un niveau de difficulté précis qui ne reflèterait pas les conditions très variables que l’on peut rencontrer. L’abréviation NC est utilisée lorsque le degré de difficulté est « non connu », une estimation de celle-ci étant cependant chaque fois donnée.
Cotations selon les degrés UIAA
Des informations précises sont également données quant à la nature du terrain rencontré (rocher, neige, glace, mixte).
Cependant, il n’est pas tenu compte dans l’indication du degré de difficulté de la grande variété des efforts à consentir pour gravir un sommet (ainsi le Huayna Potosi est coté plus « facile » que l’Aconcagua). Un simple coup d’œil à l’altitude d’une montagne et au nombre de jours à prévoir pour en réaliser l’ascension permettra néanmoins de se faire une idée claire des efforts qui seront requis.
Ces cotations peuvent également faire l’objet de certaines nuances vu la variété des sources utilisées. Les longueurs d’escalade en rocher sont également cotées selon les degrés UIAA, comme l’indique le tableau de la page précédente. Le degré de pente décrit les longueurs en glace ou neige (40°, 50°, etc.).
• CHANGEMENTS DE CONDITIONS
Les cotations données dans ce guide sont celles d’ascensions réalisées par conditions dites « normales ». Des conditions plus dures en augmenteront nécessairement la difficulté. Ainsi, au Pérou, l’été 1997 fut marqué par d’importantes chutes de neige qui rendirent nombre de voies périlleuses, tandis que l’été 1998 fut à l’inverse pratiquement sans neige. Nombre d’ascensions furent alors rendues délicates par la glace apparente. L’auteur a gravi l’Illimani à trois reprises et estime que cette ascension fut AD en 1992, F en 1995 et PD en 1996. Le principal facteur de ces changements de conditions est l’importance des chutes de neige hors saison. Les données climatiques des quelques semaines précédant l’ascension jouent aussi leur rôle. Les phénomènes à grande échelle comme El Niño ont probablement influencé les conditions rencontrées en 1997 et 1998 et plus tard en 2002 et 2003. Le plus simple et le plus raisonnable est d’obtenir des informations locales récentes sur les conditions d’une montagne avant de s’y lancer.
• PHOTOS ET CROQUIS
Nous avons eu recours pour cette nouvelle édition à de nombreuses photos pour décrire les itinéraires d’ascension. Lorsqu’il n’y a pas d’itinéraire indiqué sur une photo d’une montagne, c’est en général soit parce que la montagne en question peut se gravir par presque tous les versants avec plus ou moins la même facilité, soit parce qu’aucune photo du bon versant n’a été trouvée.
• CARTES
Les cartes qui figurent dans ce guide ne sont destinées qu’à l’orientation générale et seront d’une utilité très limitée sur le terrain. De nombreux sommets, rivières, glaciers, etc. n’y figurent pas. Une route ou un chemin peuvent parfois n’être parcourus qu’en 4x4, un chemin pédestre n’implique pas qu’il y a un sentier et un emplacement de camp ne signifie pas qu’il y a de l’eau à proximité. Il faut se référer au texte pour des renseignements au cas par cas. Toutes les cartes sont orientées vers le nord.
OÙ ET QUAND ALLER GRIMPER DANS LES ANDES ?
Le tableau ci-contre donne quelques brèves indications par région sur la meilleure saison pour se rendre en montagne, sur la fiabilité de la météo et des conditions et sur les altitudes et accès. C’est évidemment aux meilleures saisons qu’il y aura le plus de monde en montagne... Une liste des sommets les plus fréquentés se trouve en fin de volume.
De ce tableau, il ressort que quelques éléments simples détermineront le choix de la saison et de la région :
– depuis la Puna de Atacama vers le sud, la meilleure saison pour grimper est l’été austral ;
– dans le reste des Andes, essentiellement constitué de régions tropicales, la meilleure période est la saison sèche. Celle-ci s’écoule pendant l’hiver de l’hémisphère concerné (p. ex. en juillet au Pérou ou en Bolivie et en janvier au Venezuela ou en Colombie);
– il y a deux régions intermédiaires : l’Équateur est humide la plus grande partie de l’année et l’Atacama est sèche toute l’année ;
– d’autres facteurs entrent en ligne de compte. Les volcans sont en général plus faciles techniquement que les sommets de type alpin. L’expérience culturelle recherchée joue également : si vous voulez voir lamas, costumes traditionnels et marchés pittoresques, optez pour le Pérou, la Bolivie ou l’Équateur. Si vous préférez un pays moderne, avec des bus à air conditionné et des supermarchés bien achalandés, allez au Chili ou en Argentine. Le Venezuela et la Colombie sont plus ou moins à mi-chemin entre ces deux pôles. Attention, ceci est une généralisation et chaque pays andin offre des aspects très divers alliant modernité et tradition !
CONSEILS GÉNÉRAUX POUR VOYAGER DANS LES ANDES
• VISAS
Actuellement la majorité des citoyens de l’Union Européenne, de Suisse, du Canada et des USA n’ont pas besoin de visa pour de courts séjours dans les pays andins (jusqu’à 60 ou 90 jours). Les Français, Espagnols et Portugais ont encore besoin de visas pour certains pays, tandis que les Australiens, Néo-Zélandais et Sud-Africains en ont besoin pour presque tous les pays. Les citoyens d’autres pays peuvent avoir besoin de visas pour certains ou tous pays. Comme ces réglementations sont appelées à encore changer régulièrement, il est préférable de se renseigner auprès de l’ambassade dans votre pays.
• VOLS VERS L’AMÉRIQUE DU SUD
Depuis l’Europe, il y a trois grandes options.
1. Voler avec une compagnie européenne à partir d’une capitale (par ex. Air France depuis Paris, KLM depuis Amsterdam, Iberia depuis Madrid, Lufthansa depuis Francfort). En principe le meilleur rapport qualitéprix.
2. Voler avec United, Continental, Delta ou American Airlines, via les USA. C’est un peu plus cher et plus long mais il y a des vols quotidiens vers pratiquement toutes les grandes villes sud-américaines.
3. Voler avec une compagnie sud-américaine. Vols directs ou via une autre ville sud-américaine. Ces vols sont généralement les plus économiques et il y a moyen de trouver de très bons billets avec ces compagnies si vous combinez avec un vol intérieur dans le pays concerné. Londres est desservie par la Varig, Avianca et Aerolineas Argentinas. Madrid, Paris, Francfort et Milan sont desservies par LanChile, Varig, Aerolineas Argentinas et Avianca.
Depuis l’Amérique du Nord, le meilleur choix consiste à partir de Miami qui est desservie quotidiennement par toutes les principales compagnies aériennes sud-américaines. United, Continental, Delta et American Airlines ont également des vols quotidiens depuis New York, Atlanta et Houston en direction des grandes villes sud-américaines. Il y a aussi des vols directs depuis Los Angeles et Toronto. Depuis l’Australie et la Nouvelle-Zélande, il y a des vols directs LanChile et Aerolineas Argentinas jusqu’en Amérique du Sud. Autrement par des compagnies nord-américaines via Los Angeles et/ou Miami.
• BUDGET ET DEVISES
L’Amérique du Sud n’est pas particulièrement bon marché. On ne peut pas dire non plus qu’elle soit chère, mais pour la plupart des services, il faut s’attendre à payer plus ou moins le même prix qu’en Europe ou aux USA, surtout dans des pays comme le Chili et l’Argentine. Pour les transports publics, il faut quasiment partout marchander. Pour économiser de l’argent, il est possible de dormir et de manger dans des auberges bon marché, mais en expédition et avec des objectifs de montagne bien précis, cela peut s’avérer contre-productif (maladie, vol de matériel).
Une expédition moyenne qui descend dans de bons petits hôtels propres et sûrs, mange dans des restaurants convenables, se déplace en véhicule de location et recourt plus loin à des mules pour le transport, devrait s’en sortir aux alentours de 20-30€ par personne et par jour. Mais cela coûtera sensiblement plus cher pour se rendre à l’Aconcagua, en Patagonie ou dans des régions très reculées de la Puna, et un peu moins cher en Équateur et en Bolivie.
Le mieux est de prévoir de l’argent à la fois en US$ cash, chèques de voyage en US$ et cartes de crédit (Visa et Mastercard à préférer à Amex). Dans de nombreux pays, les US$ cash sont acceptés en paiement et permettent parfois d’obtenir une remise. Ils peuvent de toute façon être utilisés en l’absence de devise locale. Changer des chèques de voyage est assez aisé dans toutes les villes reprises dans ce guide. Les cartes de crédit sont également largement acceptées et les distributeurs de monnaie sont de plus en plus répandus.
• ESPAGNOL
Plus vous connaissez l’espagnol, plus il vous sera facile de voyager en Amérique du Sud. Des connaissances élémentaires sont indispensables. Il n’y a qu’à Cuzco et dans quelques endroits touristiques que l’on parle anglais et exceptionnellement un peu de français. Dans les montagnes, il n’y a aucune chance de trouver quelqu’un qui parle anglais ou français. En outre, il est clair que les touristes ne maîtrisant pas un peu l’espagnol ont plus de chances de se faire rouler par un muletier ou un chauffeur. Il faut être capable de négocier et de se faire comprendre pour obtenir un bon service et un bon prix.
• LOGEMENT
Il n’y a pas dans ce guide de liste d’hôtels recommandés dans les différentes villes. Pour cela, il faut recourir à un guide de voyage général. Les prix des hôtels sont extrêmement variables et ne correspondent pas toujours à ce que l’on paie. Dans les villes, il faut compter 15-20€ pour une chambre double avec salle de bains. Le prix peut parfois descendre jusqu’à 10€ et rester très correct, mais les endroits vraiment bon marché sont sans surprise : sales, peu sûrs et presque sans service. Le camping n’est pas non plus recommandé dans les villes sud-américaines, car peu pratique et peu sûr.
• SÉCURITÉ
En quinze ans de voyage en Amérique du Sud, l’auteur n’a perdu qu’une vieille paire de baskets et une brosse à dents. La toute grande majorité des habitants des Andes sont aimables et honnêtes. Il ne faut pas faire une fixation sur les vols à l’arrachée, mais juste être vigilant. N’abusez pas de l’alcool, ne vous rendez pas dans des quartiers malfamés, ne vous promenez pas dans des ruelles désertes, ne vous baladez pas seul en pleine nuit. Autrement vous avez une bonne chance de vous faire voler quelque chose, surtout si vous combinez plusieurs de ces cas de figure.
Il faut être plus particulièrement vigilant dans les marchés ou aux stations de bus et plus généralement dans tous les endroits où les touristes se retrouvent en plus grand nombre. Prenez le taxi pour circuler en ville si vous arrivez très tôt ou très tard ou encore si vous avez beaucoup de bagages. Ne déposez jamais un sac à même le sol en rue. Cachez vos appareils photo.
Les vols et agressions à main armée, souvent liés au trafic de drogue, se produisent occasionnellement en Colombie, au Pérou, en Équateur et en Bolivie, mais sont extrêmement rares au Chili et en Argentine. Ce n’est certainement pas un problème qui devrait vous empêcher de partir en Amérique du Sud. Prendre quelques conseils sur la situation locale en arrivant est toujours bon.
Dans les montagnes, il arrive occasionnellement qu’il y ait du vol organisé de grandes quantités de matériel de montagne. Actuellement les régions avec la plus mauvaise réputation sont les sommets d’Équateur, les camps de base de l’Ishinca et de l’Alpamayo dans la Cordillera Blanca et le col Zongo en Bolivie. Dans ces régions, il vaut mieux louer les services d’un local pour garder les tentes. Cela ne coûtera que quelques dollars par jour et sera sans doute plus efficace qu’une police d’assurance. Au Chili, en Argentine, dans les coins plus reculés du Pérou et de Bolivie et partout au-dessus de la limite des neiges, il n’y a aucun problème.
Un problème moins grave dans certaines régions est celui du petit chapardage. Il vaut mieux ne pas laisser traîner de petits objets personnels autour de la tente, de jour comme de nuit. Le seul problème de ce type que l’auteur a connu en dix ans de montagne dans les Andes s’est produit en Bolivie lorsque des bergers locaux lui volèrent deux brosses à dents, des conserves de thon et une lampe de poche. Ils ne touchèrent cependant pas à un appareil photo d’un client d’une valeur de 500$!
Une bonne source d’informations à jour sur les problèmes de sécurité est le South American Explorers Club dont on peut visiter les locaux à Quito, Lima ou Cuzco ou encore le site www.samexplo.org.
• ACCLIMATATION ET ALTITUDE
Quiconque se rend dans les Andes se doit de connaître les symptômes et les caractéristiques du mal d’altitude. Il est conseillé de bien s’informer à ce sujet avant le départ.
D’une manière générale, il faut prévoir de passer au moins une semaine à l’altitude de 4000m avant de monter à 6000m. Une bonne idée est de commencer par trois ou quatre nuits vers 3000m – plusieurs villes ou camps de base dans les Andes se trouvent à cette altitude. Ensuite passer trois ou quatre nuits autour de 4000m, puis monter vers 5000m pour deux nuits et seulement alors tenter le 6000. À chaque étape, il faut passer au moins une journée au repos. Si à un moment donné un membre du groupe se sent mal, il faut arrêter la progression, et, si le problème persiste plus de 24 heures, redescendre au moins jusqu’au camp précédent.
Cette période d’acclimatation permettra de gravir l’un ou l’autre sommet moins élevé, de faire du trekking ou de visiter sites culturels et archéologiques, fort nombreux dans les pays andins. Après avoir passé quelque temps à 5000m, il est important de redescendre (p. ex. jusqu’à 3000m) pour se reposer et récupérer.
Une bonne condition physique au départ facilitera l’acclimatation. Cependant, les personnes en pleine forme sont tout autant que d’autres susceptibles de souffrir de l’altitude. L’expérience enseigne que le meilleur moyen d’éviter les problèmes d’altitude est d’être en bonne condition en arrivant et ensuite de nettement modérer ses efforts les premiers jours (c’est-à-dire faire bien moins d’exercice que ce que l’on ferait dans les Alpes). Cela implique parfois de rester un certain temps au camp de base et il est donc recommandé de prévoir un bon bouquin, un jeu de cartes ou une paire de jumelles.
• SANTÉ
Pour la plupart des pays concernés, les vaccins suivants sont recommandés : tétanos, typhus, polio et hépatite. Le vaccin contre le choléra n’est généralement pas très efficace. Se protéger de la fièvre jaune et de la malaria n’est nécessaire que si l’on passe du temps dans les forêts tropicales en-dessous de 2500m (Venezuela, Colombie, Équateur et le versant amazonien des Andes du Pérou et de Bolivie).
Ne pas perdre de vue les problèmes liés au froid, les gelures et les hypothermies. Au-delà de 6000m, le corps a du mal à produire suffisamment de chaleur, et donc il faut prévoir assez de couches de vêtements. La circulation aux extrémités du corps est également moins bonne en haute altitude, d’où l’importance d’avoir un excellent équipement (gants, chaussures et chaussettes).
Les morsures d’insectes sont très rares dans ces montagnes (occasionnellement au Pérou ou les taons dans certains coins de Patagonie). Les chiens peuvent être gênants, surtout au Pérou et en Bolivie, mais souvent il suffit de les menacer d’une pierre pour qu’ils s’éloignent.
L’eau doit être purifiée dans tous les camps fréquentés ainsi que dans tous les villages et lieux habités. L’idéal, le plus sûr et le plus économique est de la faire bouillir au moins deux minutes. L’iode en tablettes ou en gouttes est sans doute la seconde meilleure solution pour les alpinistes, les filtres étant en général lourds, encombrants, peu efficaces pour l’eau glaciaire et un peu pénibles à utiliser en altitude.
Une trousse de secours doit contenir au moins les éléments suivants : sparadraps, nécessaire pour ampoules, fil et aiguille, ciseaux, crème protectrice pour les lèvres, médicaments divers (diarrhée, maux de tête, maux d’altitude, antihistaminiques, antibiotiques, anti-douleurs, gouttes pour les yeux, anti-inflammatoires). Une trousse de réparation est également fort utile (cordelette, fil de fer, toile adhésive, colle forte, etc.).
PRÉPARER UNE EXPÉDITION EN MONTAGNE
• PERMIS
À la sortie de presse de ce guide, il n’y avait de permis à payer que pour l’Ojos del Salado et ses sommets avoisinants au Chili ainsi que pour l’Aconcagua en Argentine, où le coût pour les non-résidents grimpe à 300 US$ en haute saison (mais un hélico est à disposition pour les évacuations depuis les camps de base et la montagne est bien entretenue !). Dans certaines régions de Patagonie, il faut désormais un permis, qui sera délivré sur présentation d’une preuve que l’on est assuré pour les frais de recherche et de secours. Un droit d’entrée est à payer pour la plupart des parcs nationaux, n’excédant que rarement quelques US$ par jour par personne.
• SOMMETS FRONTALIERS
Il est très rare d’avoir des problèmes pour pouvoir gravir un sommet frontalier. Officiellement, au Chili, il faut un permis, mais cette règle ne semble réellement appliquée que dans la région de l’Ojos del Salado. Il est néanmoins conseillé de voyager à tout moment avec son passeport dans ces régions frontalières. Dans le cas d’une approche par route, il se peut qu’il faille traverser un poste frontière et que les douaniers demandent de garder les passeports.
• CARTES
L’Alpenverein autrichien publie quelques cartes de la Cordillera Blanca et de la Cordillera Real. Autrement, les meilleures cartes sont généralement celles publiées par l’Instituto Geografico Militar (IGM) du pays concerné. On ne peut en principe se les procurer qu’au bureau central dans la capitale du pays, mais certaines cartes sont désormais disponibles sur www.omnimap.com. Bien qu’elles soient utiles, ces cartes ne sont cependant pas totalement fiables. Ainsi, rivières, routes, lacs et névés sont souvent incorrectement repris.
Les meilleures cartes à grande échelle des Andes sont celles de ITMB (International Travel Maps) au 1:4000000 (www.itmb.com), que l’on trouve chez tout bon libraire de voyage. En Suisse romande, la meilleure adresse est la librairie Bauer, à Renens près de Lausanne (tél 021 6342712, www.bauer-renens.ch). En France, consulter la librairie Itinéraires à Paris (tél 0142361263, www.itineraires.com). En Belgique, s’adresser à la librairie Anticyclone des Açores à Bruxelles (tél 02 2175246, www.craenen.be).
Voici les adresses des IGM dans les différentes capitales sud-américaines. Les heures d’ouverture étant variables, il vaut mieux s’y rendre dans la matinée. Se munir de son passeport et de monnaie locale.
Venezuela : Edificio Camejo, 1er étage, Avenida Este 6 (côté sud), Caracas
Colombie : Agustin Codazzi, Carrera 30, #48-51, Bogota
Équateur : Avenida T. Paz y Miño, près Av. Colombia, Quito
Pérou : Avenida Aramburu 1190, San Isidro, Lima (s’y rendre en taxi)
Bolivie : Calle Juan XXIII, une petite ruelle près du croisement des Calles Rodriguez et Murillo, La Paz
Chili : Dieciocho 369, Santiago (station de métro Los Heroes)
Argentine : Cabildo 301, Casilla 1426, Buenos Aires (métro ligne D, station Ministero Carranza), Buenos Aires.
• AUTRES GUIDES
Comme dit précédemment, ce guide ne contient pas d’informations de voyage à caractère général, qui peuvent être obtenues dans de nombreux autres guides. Sont particulièrement recommandés les guides Footprint (dont l’excellent South American Handbook). Les autres guides intéressants sont mentionnés dans les chapitres concernés. Le principal critère dans le choix d’un guide doit être, outre son prix et sa réputation, sa date de parution : choisissez un guide récent !
Le livre Mountaineering in the Andes par Jill Neate (Royal Geographical Society, Londres, 1994) contient quantités d’informations et de références sur l’alpinisme dans les régions les plus reculées des Andes.
• OBTENIR DES INFORMATIONS SUR PLACE
Dans les principaux centres de montagne tels que Huaraz, La Paz, Mendoza ou Bariloche, il est relativement facile d’obtenir des renseignements sur les conditions et l’accès aux montagnes. Il suffit de demander aux nombreuses agences, les meilleures étant reprises dans ce guide. Dans des endroits comme Cuzco, l’on peut obtenir des informations auprès des nombreuses agences de trekking. Mais dans la plupart des autres régions des Andes, il sera difficile de s’informer car les gens savent peu de choses des montagnes et de l’alpinisme. Cependant, même dans les villages les plus isolés, certains locaux connaissent parfaitement bien la région alentour et, en discutant un peu, on arrive toujours à obtenir de bons tuyaux sur les conditions en montagne, les routes d’accès, ainsi que sur les moyens de transport, le logement, etc. L’auteur n’est jamais resté coincé longtemps en Amérique du Sud. Dans les endroits hors des sentiers battus, les gens sont toujours très aimables et sont toujours prêts à vous aider si vous leur parlez en espagnol et n’êtes pas trop pressé. En arrivant dans un village, si vous avez besoin de renseignements sur les moyens de transport ou le logement, essayez les magasins, le café, la mairie ou le poste de police.
• TRANSPORTS PUBLICS
Les transports publics permettent d’accéder assez aisément à la plupart des montagnes reprises dans ce guide. Les régions qui font exception sont surtout la Cordillera Occidental, la Puna de Atacama ainsi que certains massifs reculés du Pérou et de Bolivie. En revanche, si vous ne comptez que sur les transports publics, les bonnes régions où aller sont la Cordillera Blanca, la Cordillera Real, la région du Sajama dans la Cordillera Occidental, les alentours de Santiago et de Mendoza ainsi que l’Araucanie.
L’abréviation TP dans le texte indique le dernier point qui peut être atteint aisément par transport public régulier au cours de l’approche d’une montagne. Les détails précis de ces transports publics ne sont pas donnés car ils changent très fréquemment et sont par ailleurs disponibles dans les guides généraux.
• LOCATION DE VÉHICULES
Dans de nombreux endroits, le meilleur moyen d’approcher une montagne est de louer un véhicule 4x4 avec chauffeur. C’est un peu cher mais très pratique. Attendez-vous à payer environ 100€ pour parcourir une distance de 100km (rajouter 100€ pour être repris au retour). Quelques rudiments d’espagnol et une connaissance préalable du chemin à parcourir vous aideront à négocier un bon prix. En mettant par écrit votre accord ainsi que la date et l’heure du retour, la plupart des chauffeurs sont parfaitement fiables. Pour trouver un chauffeur dans des endroits reculés, essayez les agences touristiques ou de location de véhicules. Pour de courts trajets sur de bonnes routes, prenez le taxi.
Si vous projetez de gravir plusieurs sommets en quelques jours dans la même région (p. ex. en Araucanie, dans l’Atacama ou la Cordillera Occidental), la location d’un véhicule sans chauffeur est l’option la plus économique, surtout au Chili et en Argentine. Un véhicule ordinaire conviendra parfaitement en Araucanie, mais un 4x4 sera nécessaire en Atacama ou dans la Cordillera Occidental.
• SECOURS EN MONTAGNE
À l’exception de l’Aconcagua, il y a très peu de secours en montagne organisés et fiables en Amérique du Sud. Sur la plupart des hauts sommets, un sauvetage avant le décès est très improbable, voire impossible. Les expéditions doivent par conséquent être pleinement autonomes sur ce plan. Dans certaines régions où l’alpinisme est davantage développé, comme p. ex. dans la Cordillera Blanca, la Cordillera Real ou en Équateur, il existe un système informel où les guides locaux se porteront au secours d’alpinistes en difficulté, mais, quelque soit le cas de figure, une opération de secours prendrait au minimum plusieurs jours.
• ANIMAUX
Dans de nombreuses régions des Andes, des bêtes de somme (ânes, lamas, mules ou chevaux) peuvent venir en aide au transport. Elles seront toujours accompagnées d’un arriero (muletier) pour s’en occuper, mais ces derniers ne sont pas toujours fiables. Nombre d’expéditions se sont retrouvées coincées avec des charges trop lourdes à porter et des animaux qui n’arrivaient pas. Si le recours aux animaux est inévitable, p. ex. pour l’approche de voies plus techniques ou de montagnes reculées, veillez à parler en espagnol à l’arriero. Essayez si possible d’obtenir de lui un accord écrit (pour autant qu’il sache écrire). En passant par une agence dans une ville ou un village, le prix sera plus élevé, mais vous aurez moins de tracasseries.
Les lamas peuvent porter environ 20kg, les ânes 40kg et les mules et chevaux jusqu’à 60kg. Un arriero peut s’occuper de trois ou quatre animaux. Les prix sont très variables. Au Pérou et en Bolivie, il faut compter entre 6 et 8€ par animal par jour et 10€ pour l’arriero, mais en Argentine et plus particulièrement à l’Aconcagua, les prix sont de 15 à 20€ par animal et 30 à 40€ pour l’arriero. Au Pérou et en Bolivie, il faut prévoir de nourrir et abriter l’arriero pour la nuit, ou au moins lui payer sa nourriture.
Dans les endroits fréquentés, vous pouvez trouver arriero et animaux en 1/2 heure et vous mettre en route sans délai. Dans les endroits plus reculés, il faudra parfois attendre un ou deux jours, le temps que les locaux rassemblent des animaux et s’organisent.
• PORTEURS
Il n’y a que quelques endroits dans les Andes où l’on peut recourir aux services de porteurs, par exemple pour les sommets fréquentés du Pérou et de Bolivie. Mais dans beaucoup d’autres endroits, soit le niveau de vie est trop élevé pour que ce type de travail soit intéressant, soit il manque l’infrastructure. Un porteur coûte environ 10€ par jour au Pérou et en Bolivie, mais le prix montera à 25€ dans la Cordillera Blanca pour un porteur sachant progresser sur glacier. Ne louez pas les services d’enfants – aucune personne correcte ne devrait accepter de faire porter des charges de 20kg par des enfants ni de le justifier par un bon salaire.
• GUIDES
Des guides de haute montagne louent leurs services dans les principaux centres de montagne d’Amérique du Sud, surtout à Quito, Huaraz, La Paz, Mendoza et Bariloche. Au Pérou, en Bolivie et en Argentine (et prochainement au Chili), les guides font désormais partie de l’UIAGM*, garantissant un niveau de compétence et d’expérience comparable aux guides européens ou nord-américains. Par contre, dans certaines autres régions, les « guides » sont parfois nettement moins compétents. Il faut alors se renseigner au préalable et, en tout état de cause, ne pas s’attendre à trouver un guide bon marché sans prendre des risques.
Prendre un guide professionnel vaut cependant la peine car ceux-ci ont une excellente connaissance des massifs et des conditions, sont très à l’aise en haute altitude et s’organisent aisément avec arrieros et porteurs. Les tarifs varient de 40 à 80€ par jour au Pérou et en Bolivie, selon la taille du groupe et la difficulté technique de l’ascension projetée. Compter au moins 100€ par jour en Argentine.
*Union Internationale des Associations de Guides de Montagne
• NOURRITURE
La plupart des villes ont de bons supermarchés. La qualité et la variété de la nourriture est excellente au Chili et en Argentine. Les supermarchés sont un peu moins bien achalandés au Pérou, en Équateur et en Bolivie, sauf dans les grandes villes où ils sont souvent difficiles à trouver, car situés en banlieue. Prendre quelques vivres d’altitude de chez soi est une bonne idée. Dans les villes plus petites, comme Huaraz, il n’y a pas de bons supermarchés mais l’on trouve presque tout.
Les vivres de camping que l’on trouve facilement dans toutes les villes sont notamment : pain, farine, sucre, lait en poudre, thé et café, soupes en sachets, céréales, pâtes, chocolats, biscuits, jus de fruits en poudre, etc. Ce qui est difficile à trouver sont les repas lyophilisés et autres vivres déshydratés. Dans certains endroits comme Huaraz, Cuzco et La Paz, on peut louer les services d’un cuisinier pour le camp de base.
• CARBURANT
Le carburant à utiliser en Amérique du Sud est la bencina blanca, l’essence blanche (« BB » dans le texte), assez proche du fuel Coleman. En Argentine, on l’appelle solvente industrial. On en trouve assez facilement dans les drogueries (farmacias) ou les quincailleries (ferreterias). Elle s’allume facilement, brûle puissamment et est très propre. Le kérosène est le second choix de carburant et peut être utilisé sur les mêmes réchauds que le premier. Bon marché, il s’achète facilement à la pompe à essence et est plus propre et plus sûr que l’essence. Cette dernière est très dangereuse et peut provoquer des problèmes d’encrassement des réchauds. L’alcool à brûler est difficile à trouver et très peu pratique en raison des grandes quantités à transporter. La meilleure alternative à l’essence blanche (BB) ou au kérosène est le bon vieux réchaud à gaz. Mais les cartouches (« CG » dans le texte, pour « Cartouche de Gaz ») sont chères et parfois difficiles à trouver. Ne pas oublier qu’on ne peut embarquer de carburant ni de cartouches de gaz à bord d’un avion.
• ACHAT ET LOCATION DE MATÉRIEL EN AMÉRIQUE DU SUD
À éviter dans la mesure du possible. On peut parfois trouver du matériel à vendre ou à louer et même, dans des endroits comme Huaraz, Quito, Cuzco, La Paz et Bariloche, du matériel d’assez bonne qualité. Mais le choix est généralement très limité et l’origine un peu douteuse. Dans beaucoup d’endroits, trouver du matériel de camping sera fort difficile et du matériel d’alpinisme totalement impossible.
CONDITIONS D’ESCALADE ET RISQUES PROPRES AUX ANDES
• SOLEIL
Le rayonnement du soleil est beaucoup plus fort dans les Andes que dans les Alpes. Il est plus haut dans le ciel, l’air est plus fin, il y a moins de nuages et en général la couverture neigeuse est plus importante. Chapeau de soleil, protection de la nuque, lunettes de glacier, crème solaire à indice élevé et bonne protection des lèvres sont donc indispensables.
• ORAGES
Plutôt rares en comparaison avec les Alpes et les Rocheuses, des orages éclatent néanmoins de temps à autre, surtout au Pérou et en Bolivie.
• GLACIERS
Les véritables glaciers de vallée ne sont nombreux que dans les Andes de Patagonie où, gigantesques, ils dépassent parfois les 100km de long. Dans les hautes Andes, les glaciers se trouvent surtout sur les pentes les plus élevées des montagnes, bien qu’il y ait aussi quelques petits glaciers de vallée dans les Cordilleras Blanca et Vilcanota au Pérou ainsi que dans la région de Santiago. Aucun glacier de la Cordillera Blanca ne dépasse les 5km et le plus long glacier de la région de Santiago fait 15km.
Les glaciers sont partout en recul. Il faut en tenir compte dans l’appréciation des difficultés des itinéraires décrits dans ce guide, dont certains deviennent plus raides et/ou plus dangereux et/ou nettement plus difficiles.
Les séracs et les crevasses sont à aborder avec la même prudence que partout ailleurs. Les crevasses dans les régions tropicales ont cependant tendance à être plus imposantes que dans les régions tempérées des Alpes et des Rocheuses.
• NEIGE ET GLACE
Dans les montagnes des régions tropicales, de la Colombie à la Bolivie, il n’y a que les parois les plus raides qui ne soient pas recouvertes de neige et de glace. Les pentes raides chargées de séracs y sont nombreuses et donnent aux montagnes un aspect fort différent de celui des parois rocheuses sèches des Alpes. Dans certaines parties des Andes, la neige adhère à des parois de près de 70° en formant des cannelures de neige dont l’escalade s’avère très précaire.
Les cordillères péruviennes (Blanca, Huayhuash, Vilcabamba et Vilcanota) sont réputées pour ces formations neigeuses magnifiques mais dangereuses. Dans une grande partie du Pérou, les faces nord offrent généralement une glace de bonne qualité tandis que les faces sud, à l’ombre, sont gorgées de neige poudreuse instable. Les faces ouest et est sont un peu un mélange des deux. Plus au sud, en Bolivie, la Cordillera Real offre des conditions très stables et une neige et une glace dures d’excellente qualité sur tous les versants pendant les mois très froids de juin et juillet. Dans la Puna et la Cordillera Occidental, les petits glaciers et névés restent durs toute la journée.
Par contre, les conditions dans les montagnes autour de Mendoza et de Santiago sont proches de celles des Alpes en été, avec une fonte de neige le jour avant le regel la nuit. La neige ne tient pas sur les parois raides dans cette région des Andes et les faces rocheuses y sont donc plus nombreuses.
• AVALANCHES
La neige et la glace sont d’une grande stabilité dans les Andes pendant la bonne saison. Cela s’explique sans doute par les longues périodes sans précipitations, les nuits très fraîches et les formations de pénitents. Des avalanches se produisent comme partout ailleurs, mais paraissent rares en saison. C’est en Équateur, où le climat est tempétueux, qu’il y en a le plus (notamment des avalanches de plaques), ainsi qu’en Colombie. L’auteur a déjà vu quelques avalanches de poudreuse dans la Cordillera Blanca et à l’Aconcagua. Dans les régions les plus sèches des Andes, telles que la Puna, la Cordillera Occidental ou la Bolivie, les avalanches sont extrêmement rares.
• PÉNITENTS
Les pénitents sont des pointes de neige ou de glace verticales, que l’on retrouve communément dans certaines parties des Andes. Lorsqu’ils n’ont que quelques centimètres de haut, ils sont gênants, mais quand ils dépassent les 5 mètres, ils deviennent infranchissables. Formés par un phénomène d’évaporation dans un air extrêmement sec et/ou par des accumulations de poussières, c’est dans les régions les plus sèches qu’on les trouve en plus grand nombre (Puna de Atacama et Cordillera Occidental). On peut également en observer près de l’Aconcagua et au sud du Pérou et de la Bolivie. Ils ont tendance à se former en lignes et il est beaucoup moins pénible de suivre ces lignes que d’essayer de les traverser. Il est préférable de les repérer à l’aide de jumelles et de les éviter si possible. Dans la région de Santiago et Mendoza, c’est en février, à la fin de l’été, qu’ils sont les plus imposants.
Le bon côté des pénitents est qu’ils stabilisent les pentes de neige et diminuent d’autant le risque d’avalanche dans certaines régions. Parfois ils forment de jolis petits murs de glace au bord des crevasses, évitant ainsi aux montagnards distraits une chute dangereuse !
• ROCHER
À l’exception notable de la Patagonie, il y a peu de sites dans les Andes qui soient réputés pour la qualité de leur rocher. Dans les régions volcaniques comme la Puna, la Cordillera Occidental et l’Équateur, le rocher est extrêmement mauvais. La plus grande partie de la Cordillera Blanca, de la Cordillera Real et des Hautes Andes du Chili et d’Argentine ont un rocher très moyen, quoi qu’à certains endroits des sites granitiques offrent une bonne escalade.
La Patagonie, avec notamment les massifs du Fitz Roy et des Torres del Paine, compte par contre quelquesunes des plus belles parois de granit au monde.
• CHAMPS DE MINES
En espagnol zona de minas ou campo de minas. Les champs de mines sont un danger potentiel sur les cols sur ou à proximité des frontières du Chili avec la Bolivie et l’Argentine. En principe les mines sont anti-véhicules, mais il vaut mieux être prudent. Généralement clôturés, les champs de mines ne sont pas toujours clairement indiqués (et certainement pas repris sur les cartes). Toute clôture, même à terre, dans une zone frontalière, doit par conséquent être traîtée avec précaution.
• MANQUE D’EAU
Sur de nombreuses montagnes de la Puna de Atacama et de la Cordillera Occidental, le manque d’eau est un vrai problème. Il ne faut surtout pas sous-estimer le risque encouru à se retrouver sans eau sur une montagne désertique et reculée. Voici quelques idées pour résoudre ce problème logistique.
Comptez jusqu’à 5 litres d’eau par personne par jour et ne placez pas toutes les réserves d’eau dans un seul récipient. Une chute de neige récente permettra de gérer ce problème plus facilement. Dans certains cas, un groupe en forme et bien acclimaté peut arriver à la limite des neiges en un jour depuis la route la plus proche. Le climat sec et le côté techniquement facile des montagnes permet aussi de prévoir une expédition légère et rapide, ce qui évite de prendre trop de réserves d’eau. Une autre technique consiste à monter assez haut et de redescendre de la neige vers un camp en contrebas. C’est plus facile que de monter de l’eau depuis en bas, mais ne doit être tenté que si cela paraît facilement réalisable. Si aucune autre solution ne se profile, il faudra effectuer un portage pour amener suffisamment d’eau en haut.
ÉQUIPEMENT
• CAMPING
Les tentes utilisées en altitude doivent combiner légèreté et solidité, afin de résister aux vents tempétueux. Beaucoup de tentes (« quatre saisons » ou « d’expédition ») répondent aujourd’hui à ces critères. N’achetez pas de tentes bon marché. Ajoutez des cordelettes aux points d’attache de la tente pour pouvoir l’arrimer à des blocs de pierre. Entraînez-vous à installer votre tente par mauvaises conditions.
Les réchauds doivent être solides, capables de faire fondre rapidement la neige et faciles à entretenir sur le terrain. Un réchaud comme le XGK de la marque MSR fonctionne avec tout type de carburant et est en ce sens unique, mais la concurrence propose des alternatives très valables. En altitude un briquet sera plus facile à utiliser que des allumettes – les flammes sont faibles lorsque l’oxygène vient à manquer !
Les températures très basses la nuit requièrent l’usage d’un sac de couchage de type « 5 saisons » au-delà de 5500m, surtout pendant les mois froids de juin et juillet au sud du Pérou, en Bolivie et dans la Puna (voir aussi ci-après « Conseils pour les expéditions en haute altitude »).
• MATÉRIEL D’ALPINISME
La quasi-totalité des ascensions décrites dans ce guide étant glaciaires, piolet et crampons sont systématiquement requis ainsi que tout le matériel nécessaire pour progresser sur glacier (corde, baudrier, cordelettes, vis à glace, etc.). Une bonne expérience de la progression sur glacier est indispensable. Il peut être utile de bricoler un baudrier complet avec une cordelette lorsque l’on porte des sacs lourds.
Les voies cotées AD et plus nécessiteront davantage de matériel d’escalade, selon les cas.
Les pieux à neige et vis à glace sont le moyen d’assurage le plus courant au Pérou et en Bolivie, l’assurage sur rocher n’étant possible que sur les voies mixtes.
Les bâtons télescopiques sont très pratiques pour progresser sur des terrains instables (neige, éboulis) et en altitude avec des charges lourdes. On estime l’économie d’énergie à 20-30%, ce qui vaut largement le poids des bâtons. Ces derniers sont également utiles pour s’orienter, traverser des rivières, éloigner des chiens, monter une corde à linge ou marcher avec des ampoules. Dans le pire des cas, ils peuvent même servir à fabriquer un brancard de fortune !
Les raquettes à neige peuvent être utiles sur certains sommets peu fréquentés, avec de grands plateaux enneigés, notamment au Pérou (p. ex. Hualcan, Copa et Ausangate).
• VÊTEMENTS
Dans la plupart des cas, les vêtements utilisés pour gravir les plus hauts sommets des Alpes en été suffiront pour la plupart des 6000 andins, quoi qu’une couche supplémentaire (veste en duvet) soit préférable au-delà de 6500m.
En plein soleil, il peut faire étouffant sur un glacier à 6000m, mais, en cas de mauvais temps, les risques d’hypothermie et de gelures sont réels. Il faut donc être souple et jouer avec les couches. Prévoir pour n’importe quel sommet plusieurs couches en polaire et un coupevent complet, un bonnet chaud et des gants de montagne.
La nuit en altitude, les températures descendent plus bas que dans les Alpes. Il est donc essentiel d’avoir un très bon sac de couchage. Une couche de vêtements supplémentaires pour les matins froids peut être très utile. Le facteur éolien (sensation de froid accrue par le vent) joue, particulièrement dans la Puna de Atacama, en Patagonie et à l’Aconcagua.
• ALTIMÈTRES ET GPS
Un altimètre est particulièrement recommandé. Comme aucune des cartes IGM n’est tout à fait fiable, il complètera utilement la boussole pour rechercher son itinéraire dans le mauvais temps ou de nuit. Prendre des points de repère et noter leur altitude à la montée sera d’un grand secours en cas de descente par mauvaises conditions. Soyez attentifs au fait que presque tous les altimètres sont calibrés pour l’atmosphère tempérée de 40°N et indiqueront en conséquence dans les régions équatoriales une altitude plus basse de 100 mètres environ pour chaque 1000 mètres gravis.
Un GPS peut servir à enregistrer des waypoints à la montée afin de pouvoir redescendre en toute sécurité, mais il sera de peu d’utilité pour trouver son itinéraire à la montée.
CONSEILS POUR LES EXPÉDITIONS EN HAUTE ALTITUDE
Nombre d’alpinistes échouent au cours de leur première expédition en haute altitude, davantage en raison de leur manque d’expérience des expéditions qu’en raison de leur niveau technique. C’est particulièrement vrai à l’Aconcagua. Voici donc quelques conseils pour aider au bon déroulement d’une telle aventure, le premier étant de s’entraîner à camper dans de mauvaises conditions avant le départ.
• OBJECTIFS
Il ne faut pas se rendre dans les Andes en s’imaginant pouvoir réaliser autant d’ascensions que dans les Alpes. La plupart des sommets sont dans des coins plus reculés, se déplacer est plus compliqué et l’altitude plus élevée limitera à coup sûr le nombre de courses réalisables en un certain temps. Une expédition type de trois semaines peut parfaitement ne réaliser que deux ou trois 5000 suivis de deux 6000. Une excellente condition physique est indispensable avant de partir et facilitera l’acclimatation (bien qu’une personne en parfaite condition physique puisse aussi avoir des problèmes d’acclimatation).
• REPOS ET RÉCUPÉRATION
Ne pas perdre de vue que le corps ne récupère pas au-delà de 5000m d’altitude. Entre deux sommets, il est donc préférable, si possible, de redescendre à une altitude plus basse (p. ex. 3000m) et vers plus de confort (hôtels, restaurants) pour récupérer. L’éventuelle petite perte d’acclimatation sera insignifiante par rapport au repos ainsi gagné.
• TENTES
Il vous faudra probablement arrimer vos tentes avec des blocs de rocher. Prenez donc des tentes avec un pan de toile prévu à cet effet et/ou rajoutez des cordelettes aux points d’ancrage.
Si vous quittez votre tente par fort vent, placez avec précaution quelques blocs de pierre à l’intérieur – les tentes actuelles ont besoin de ce poids central pour leur stabilité. Si vous posez la tente sur la neige, utilisez des piquets pour neige (bien qu’ils plient facilement car pas assez solides) ou alors remplissez des sacs en plastique de neige, attachez-y les tendeurs et enterrez-les. Pour la nuit ou en cas de mauvais temps, vous pouvez renforcer l’arrimage de la tente avec piolets, pieux à neige ou vis à glace. Ne laissez jamais aucun objet traîner dehors la nuit car il pourrait être enseveli sous la neige. Entraînez-vous à monter vos tentes par grand vent et par mauvais temps avant de partir.
• RÉCHAUDS
Prenez une petite planche en bois pour déposer votre réchaud. Cela évitera qu’il ne se renverse en faisant fondre la neige sur laquelle il est posé ou alors protègera la végétation. Faites fondre suffisamment de neige la veille d’une course et stockez l’eau dans des sacs prévus à cet effet afin d’être plus rapidement en route le lendemain matin. La glace fond plus vite que la neige, les deux fondant plus rapidement lorsque immergés dans de l’eau. Exercez-vous au maniement du réchaud dans des conditions difficiles avant d’arriver à 5000m ! Calculez bien la consommation de carburant de votre réchaud avant votre départ. En principe, un litre de carburant (BB ou kérosène) devrait suffire pour deux personnes pour environ cinq jours, mais seulement la moitié de ce temps s’il faut faire fondre de la neige tous les jours.
• BÂTONS TÉLÉSCOPIQUES
Utilisez-les. Vous économiserez beaucoup d’énergie en haute altitude, dans les pierriers ou en neige profonde.
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Le comportement peu respectueux des expéditions des années passées n’est pas une excuse pour ne pas se montrer responsable aujourd’hui. N’oublions jamais que d’autres gens suivront notre passage et auront à subir les conséquences de notre comportement.
Voyagez en petit groupe léger. L’idéal semble être un groupe de quatre à six grimpeurs. Ce nombre augmentera les chances de succès et limitera l’impact sur l’environnement.
Emmenez le moins possible d’affaires en montagne et redescendez tous vos déchets.
Prenez garde aux endroits où vous vous rendez pour vos besoins naturels. Dans les régions fréquentées, essayez dans la mesure du possible de faire vos besoins avant d’arriver aux camps. Si vous êtes au camp, éloignez-vous suffisamment, vers l’aval, et enterrez vos fèces. Dans les endroits isolés, laissez-les exposées au vent et au soleil. Veillez à ne pas contaminer les réserves d’eau ou de neige.
N’allumez pas de feux. Utilisez toujours vos réchauds pour cuisiner.
Ne donnez jamais de cadeau sans raison, cela ne fera qu’encourager la manche, qui pourrait devenir agressive. Si vous donnez un cadeau en échange d’un service, tâchez de donner quelque chose d’utile ou de didactique (un bic à un enfant, un canif à un arriero).
Ne donnez pas de bonbons aux enfants, ils n’ont pas de dentiste.
Traitez guides, porteurs et arrieros avec respect et considération. Occupez-vous d’eux s’ils sont malades.
Soyez respectueux de la vie privée en prenant des photos.
SKI DE RANDONNÉE
Dans les Andes, il n’y a de chutes de neige significatives qu’au sud de 35° de latitude sud. Cette partie est la seule où les conditions d’enneigement en hiver (d’août à octobre) sont comparables à celles des Alpes. C’est également la seule région où la neige tombe plus bas que les glaciers, rendant possibles de longues randonnées à ski.
Dans tout le reste des Andes, le ski n’est possible que sur certaines montagnes, isolées les unes des autres, ce qui complique la randonnée puisqu’il faut se déplacer à pied sur de longues distances pour aller de l’une à l’autre. De plus, dans ces régions tropicales, les crevasses ne sont jamais aussi bien recouvertes que dans les Alpes au printemps, ce qui n’en rend le ski que plus dangereux. Les meilleures conditions de ski dans cette partie des Andes se rencontrent de mars à mai, à la fin de la saison humide.
• COLOMBIE
Le Nevado El Ruiz offre une belle sortie à ski, mais assez courte.
• ÉQUATEUR
Seuls les quatre principaux sommets – Chimborazo, Cotopaxi, Cayambe et Antisana – sont skiables. Ils sont tous fort crevassés et le danger d’avalanche y est plutôt marqué. L’accès à ces montagnes est très aisé grâce aux routes arrivant presque à la limite de la neige.
• CORDILLERA BLANCA
Plusieurs bonnes possibilités de ski dans ce massif. De belles traversées se font au Copa et au Hualcan, mais la montée jusqu’à la neige est longue. Le Huascaran a été skié plusieurs fois. Au sud, le ski est plus limité.
• BOLIVIE
Peu d’endroits pour du grand ski. C’est à l’Ancohuma dans le massif de Sorata que se trouvent les plus grands glaciers et les meilleures possibilités de ski. Chacaltaya, à plus de 5000m d’altitude, s’enorgueillit d’avoir le plus haut remonte-pente au monde, mais le ski n’y est d’aucun intérêt, surtout depuis la disparition récente de la neige suite au réchauffement climatique...
• CORDILLERA OCCIDENTAL
Le Sajama et le Parinacota ont tous deux été skiés et doivent être magnifiques lorsque la neige est au rendez-vous. La traversée de l’immense plateau du Coropuna (12km sans interruption à plus de 5900m d’altitude) doit être spectaculaire. Mais la présence de nombreux pénitents dans cette région nécessiteront un enneigement important.