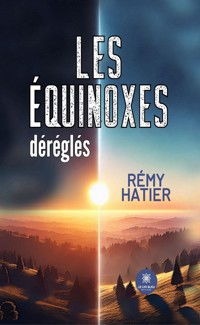
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Il est naturel de se questionner sur la part réelle de contrôle que nous exerçons sur nos vies. Peut-être existe-t-il une dimension cachée, au-delà de nos sens habituels, présente chez certains d’entre nous. Toutefois, tant qu’on ne l’a pas vécue, il est impossible d’en avoir la certitude. Les équinoxes déréglés s’insinue avec brio dans cet univers complexe, explorant les sentiments subtils qui traversent l’esprit humain face à l’inexplicable. Ce récit vous invite à franchir les frontières du connu, là où le paranormal et la réalité se confondent.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Une fois sa carrière professionnelle derrière lui,
Rémy Hatier se lance dans l’aventure de l’écriture. Les retours enthousiastes qu’il reçoit l’incitent à creuser plus profondément dans les thèmes qui le passionnent : le temps, le hasard, la liberté, la spiritualité, et les paradoxes qui tissent nos vies.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rémy Hatier
Les équinoxes déréglés
Roman
© Lys Bleu Éditions – Rémy Hatier
ISBN : 979-10-422-4754-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Note de l’auteur
L’ouvrage que vous avez en main, Les équinoxes déréglés, fait suite au roman Quand les ombress’ensoleillent, publié aux Lys Bleu Éditions.
Lire cette première partie s’avère indispensable afin que le vécu des personnages que vous allez ici rencontrer se déploie dans toute sa plénitude.
Vous arrive-t-il seulement d’y penser ? Ou bien cela fait-il partie de la myriade de choses qui constituent votre univers et qui s’imbriquent si parfaitement que les voir, les sentir, ou même simplement penser qu’elles existent n’a aucune chance d’effleurer les préoccupations de votre quotidien ? Oui, c’est cela, assurément… C’est une chose qui existe, une chose que l’on a enseignée à l’élève du primaire qu’alors vous étiez et que vous avez sagement rangée dans un coin, juste au cas où.
Pourtant, c’est un si bel instant dans la vie de notre Terre, un instant si rare et si fragile. Au cours de son inexorable promenade, captive autour du Soleil, deux fois par révolution, elle atteint ce point particulier : l’équinoxe.
***
Équinoxe : (nom masculin) Chacune des deux périodes de l’année où le jour a une durée égale à celle de la nuit, d’un cercle polaire à l’autre. Équinoxe de printemps, équinoxe d’automne.
Quant à savoir ce qu’est un équinoxe déréglé…
Ce matin, alors qu’elle montait dans le TGV à destination de Marseille, l’inhabituelle douceur de ces premières heures de décembre ne l’avait pas surprise. Elle n’y avait tout simplement pas prêté attention, tant son esprit était occupé à se demander en quoi la famille de Vincent Deniel, décédé six mois plus tôt, pouvait avoir besoin d’elle.
Mais ce soir, alors que sans parapluie pour s’abriter elle marchait à grandes enjambées sous une pluie torrentielle, elle se souvint des vagues d’air étrangement tiède qui berçaient l’atmosphère au lever du jour. Un épisode méditerranéen, un de plus, venait rappeler aux hommes que l’automne n’était pas encore achevé : accrocher les décorations de Noël dans les rues ne faisait pas arriver l’hiver.
Elle se jeta dans sa voiture et, enfin à l’abri, se démena dans l’habitacle étroit pour se défaire de sa veste trempée qu’elle lança sur la banquette arrière. Ses longs cheveux poivre et sel étaient ruisselants ; elle ouvrit la boîte à gants et se félicita de toujours y disposer d’un paquet de mouchoirs en papier.
Ainsi débarrassée de l’eau noyant son regard, elle put enfin prendre la route qui la ramènerait à son village niché sur les contreforts du Massif central, village qui, depuis bientôt trente ans, survivait grâce à la perfusion de sa présence et l’abnégation tissant l’âme de sa vocation de médecin.
Après une heure et demie de conduite sous ce qui n’était autre qu’un avant-goût du déluge, les gouttes n’éclatèrent plus, mais commencèrent à s’étaler sur le pare-brise en dessinant de petits motifs étoilés… Celles qui auparavant s’écrasaient brutalement au sol, se firent en l’espace de quelques minutes épais flocons de neige, tapissant moelleusement un paysage qui s’enfonçait dans la nuit. Dans le faisceau des phares, la route en lacets s’estompait lentement, comme gommée d’un décor se parant uniquement de blanc.
Instantanément soulagée, Mathilde aperçut enfin au loin la lueur des quelques vieux lampadaires qui éclairaient à grande peine la rue principale du village ; ou plus exactement ce qui était, il y a cinquante ans, la rue principale de ce que l’on ne pouvait décemment plus aujourd’hui appeler un village. Mais par quel mot désigner cette oasis de vie, s’asséchant lentement à l’aune des décès de ses habitants ? Hameau ? Certes non, car alors comment aurait-on nommé les îlots de quelques fermes et maisons souvent isolées qui gravitaient encore tout autour, dans un rayon de plusieurs kilomètres ? Sans s’être concertés, les habitants de ce territoire pas encore tout à fait oublié parlaient du « bourg », lorsqu’ils venaient deux fois par semaine sur la place du marché ou encore quand, après moult hésitations, ils finissaient par pousser la porte du cabinet médical de Mathilde.
Rassurée à la vue de ces lumières à l’agonie qu’un blanc linceul tentait d’effacer du paysage, elle se redressa sur son siège et respira profondément afin de ne pas se crisper sur le volant ; elle avait bien sûr l’habitude de conduire sous la neige, mais l’intensité de la journée vécue et la fatigue engendrée pesaient lourdement sur ses frêles épaules, rendant ses gestes saccadés. La moindre erreur la précipiterait dans l’invisible fossé qui, il y a quelques minutes encore, dessinait le bas-côté de la route. Il se ferait un plaisir de l’accueillir, mais pas forcément avec délicatesse, malgré le manteau neigeux dont l’épaisseur se faisait lentement mais sûrement conséquente.
***
Mathilde gara sa voiture sous l’abri, directement en marche avant, ce qui était contraire à son habitude de médecin de campagne qui, pour espérer gagner quelques précieuses secondes pouvant s’avérer vitales, préférait toujours stationner son véhicule en position « prêt à partir ».
Cette journée l’avait épuisée ; elle se sentait comme essorée et ne disposait plus de la moindre étincelle d’énergie. Elle était vide, elle était creuse, allant jusqu’à se demander où avait bien pu passer son âme. Alors qu’elle arrêtait le moteur, elle espérait que son smartphone ne sonnerait ni ce soir ni cette nuit pour l’amener au chevet d’un mourant ou encore, à la demande des pompiers, dans quelques virages des routes devenues uniformément blanches qui serpentaient aux alentours.
Dans un nouveau et profond soupir, elle se raidit, et se calant contre le dossier du siège, elle se passa les mains sur le visage, comme si elle avait cherché à l’en débarrasser d’un masque trop collant. Rejetant la tête en arrière, elle poursuivit le mouvement jusque dans son cou ; puis seule sa main droite glissa pour se poser sur le bonnet droit de son buste… Sous cette main ne rayonnait pas la chaleur d’un sein, mais un triste et inerte rembourrage de coton.
« Comment a-t-il su ? » fut la phrase qui résonna dans l’habitacle déjà prisonnier du froid.
Elle tourna le regard vers le siège passager : une pochette cartonnée, maintenue fermée par deux élastiques, y était posée. Une étiquette manuscrite indiquait : « À remettre à Mathilde ».
Pendant le voyage retour depuis Manosque, elle avait profité du trajet en train entre les gares d’Aix-en-Provence et de Valence pour entamer la lecture du manuscrit que Vincent lui avait légué. L’après-midi même, après qu’Arnaud, le fils de Vincent, lui eut ouvert le coffre et remis la pochette cartonnée, elle avait parcouru à la volée quelques feuillets et le peu qu’elle avait lu l’avait conduite au bord de l’abîme… Plus elle avançait dans ce roman, plus en elle un malaise grandissait, et elle se sentait maintenant comme dépossédée de toute substance, jusqu’au plus profond de son être. Comment cet homme, avec lequel elle n’avait parlé que quelques minutes quatorze mois plus tôt, comment avait-il pu savoir pratiquement tout de sa vie, s’infiltrant en elle jusqu’à l’intime ?
Elle n’avait pas encore lu le roman dans sa totalité, mais pressentait que Vincent savait tout d’elle… D’elle, mais aussi de ceux qui l’entouraient, de ceux qui avaient fait partie ou faisaient encore aujourd’hui partie de sa vie. Sans y avoir été invité, il avait visité son existence, et ce jusque dans ses moindres recoins : ses études de médecine, son amour de jeunesse avec Hugues, amour dont Marc fut le fruit ; la trahison d’Hugues qui l’abandonne pour une autre femme alors qu’elle s’apprête à lui annoncer sa grossesse ; puis le drame vécu par ce même Hugues quand, quelques années plus tard, sa femme est emportée par un cancer après avoir renoncé aux soins pour donner, dans les meilleures conditions, la vie à leur fils Maxence. Aujourd’hui, Hugues est prêtre, se fait appeler Charles et Maxence l’a suivi sur la voie du sacerdoce… Vincent connaissait également la vie de Marc, là aussi avec une proximité qui ne pouvait que laisser Mathilde stupéfaite, incrédule, voire angoissée…
Elle sollicita sa mémoire pour revivre ce premier jour d’octobre, l’année dernière, quand Vincent, cet homme dont elle ne savait rien, était passé devant sa maison alors qu’elle lisait, profitant de la douceur des premières heures de l’automne. Il partait pour une randonnée, un tour de France, lui avait-il dit. Il comptait marcher un an, et ayant peur de perdre les clés de sa maison, lui en avait confié la garde : un trousseau de quatre clés qui, étrangement, cachait en son milieu une bague en or, une alliance.
Quelques secondes durant, en lui posant les clés dans la main, cet homme au charme certain avait figé son regard dans le sien. C’est à cet instant très précisément, elle le ressentait maintenant, qu’il avait littéralement pris possession d’elle, de son vécu, de son âme… Un frisson l’avait alors parcourue, malgré les chauds rayons de soleil qui caressaient ses épaules… Puis Vincent, qu’elle alertait sur l’imminence d’un violent épisode pluvieux, l’incitant sans succès à retarder son départ, avait disparu, happé par la forêt. Elle ne l’avait plus jamais revu.
***
Le froid, cristallisant la buée sur les vitres, fit prendre conscience à Mathilde qu’elle était toujours figée dans sa voiture, sous l’abri, le regard hypnotisé par la pochette et son obsédante étiquette. Elle sortit péniblement de son véhicule, tira du coffre le petit sac de voyage qu’elle avait amené « au cas où » et se dirigea vers sa maison, cette vieille bâtisse, autrefois ferme, qui marquait la sortie du village. Dans le couloir, elle accrocha sa veste à une patère, posa son sac et la pochette sur la première marche de l’escalier qui desservait sa chambre. Elle avait quitté sa demeure aux aurores le matin même, prenant soin d’alimenter la vaste cheminée, mais dans la pièce principale, tout était sinistre. La maison était vide. Son fidèle Toga était mort l’hiver dernier, paisiblement, dans son sommeil, se laissant emporter par les douces vagues de chaleur qui ondulaient depuis le foyer devant lequel il passait ses journées. Le chat Pluche, dont l’abri préféré n’était autre que l’enclos formé par l’abdomen et les pattes du chien couché, avait alors cessé de s’alimenter et avait lui aussi disparu.
Mathilde n’eut pas la force de rallumer une flambée et décida, sans même avoir mangé, de rejoindre sa chambre et son lit pour se réfugier sous la large couette en duvet d’oie qui lui offrirait rapidement un peu de chaleur… Mais une chaleur qui jamais ne porterait en elle la tendresse d’une étreinte partagée.
S’installant confortablement en calant son gros oreiller dans le dos, elle reprit la lecture, abandonnée près de deux heures plus tôt alors que le TGV entrait en gare de Valence. Une lecture à laquelle elle consacrerait la nuit. Se réfugier dans le sommeil s’avérerait illusoire tant qu’elle n’aurait pas lu jusqu’au dernier mot le livre en devenir que Vincent venait de lui léguer.
***
Ce n’est que sur le matin que Mathilde, exténuée, referma la pochette, après avoir relu une ultime fois la lettre rédigée par Vincent et accompagnant le texte. Au milieu de toutes les interrogations que la nuit s’était chargée d’incruster en elle, se trouvaient gravés les mots contenus dans cette missive.
J’ai marché… Je ne vous ai pas écoutée parce que je ne voulais pas vous écouter… Parce que je savais déjà, ne me demandez pas comment ni pourquoi, qu’une autre voie s’écrirait un jour pour vous…
Dans son roman, Vincent était devenu son amant et avait émis le vœu de finir ses jours à ses côtés… Une relation amoureuse à la rencontre de laquelle il avait pourtant choisi délibérément de ne pas aller, dans ce que Mathilde s’obligeait maintenant à appeler « la vraie vie », tant elle avait, par moments, du mal à séparer le vécu de ce que Vincent avait écrit. Elle avait achevé la lecture et se trouvait aux prises d’un trouble si profond que distinguer une quelconque frontière entre le réel et l’imaginaire lui était impossible… Dans son esprit, tout était si flou, tout semblait vouloir se mélanger. Mathilde se ressaisit et se concentra ; seul leur amour était imaginaire et avait servi de trame à l’écriture du roman. Le reste, tout le reste était réel, car Vincent, le temps d’un regard, avait tout vu en elle ; lisant son passé et devinant peut-être son futur, il lui offrait ce dernier message posthume : une autre voie s’écrirait un jour pour elle, raison pour laquelle il avait choisi de s’effacer.
Il y avait enfin cette autre phrase, qui résumait à elle seule l’étrange épilogue de ce roman : Toute rocambolesque évasion a une fin… Je vous en propose deux ; à vous de finir l’histoire ; quant à moi, j’ai déjà choisi la mienne ! D’une façon assez surprenante, Vincent proposait effectivement deux fins aux lecteurs de son roman. Dans la première, il s’obligeait à quitter Mathilde pour se consacrer à Claire, sa femme adultère maintenant paralysée à l’issue d’une tentative de suicide… L’autre issue, tout aussi dramatique, voyait Vincent quitter accidentellement ce monde, n’ayant alors pas à choisir entre Mathilde et Claire ; lors de ses obsèques, Mathilde recroisait, pour la première fois depuis plus de trente années, le regard d’Hugues, père de son fils Marc.
Qui était vraiment Vincent Deniel, cet homme qu’elle connaissait si peu, cet inconnu qui terminait cette lettre par une belle, mais sibylline prémonition que Mathilde, après une nuit sans véritable sommeil, avait toutes les peines du monde à recevoir comme un cadeau : Je sais que vous avez eu votre part de ténèbres et qu’aujourd’hui, vous êtes sur le chemin de la lumière… Quand les ombres s’ensoleillent, Mathilde, il faut s’attendre à tout…
Un après-midi de novembre,
trente ans plus tôt, dans le ciel de Provence
Dans le casque du lieutenant Jean-Louis Vitali, surnommé « Luigi » par les autres pilotes de l’escadron, l’ordre transmis par la voix dure et assurée de son leader et instructeur, le capitaine Vincent Deniel, résonna comme un coup de canon. Il prit un quart de seconde pour inspirer une bouffée d’oxygène puis, d’une impulsion déterminée, mit virilement un coup de manche à droite ; la patrouille formée par les deux avions de combat encastrés aile dans aile sembla alors exploser quand l’avion ailier, se mettant pratiquement sur la tranche, dégagea puis s’évanouit dans les nuages.
Vincent Deniel lança à son tour son Mirage dans un large et souple virage à gauche. Si le jeune pilote dont il assurait l’instruction exécutait de son côté avec la même précision son virage à droite, dans deux minutes les deux appareils se rejoindraient et l’ailier n’aurait plus qu’à terminer la manœuvre de rassemblement en venant à nouveau se réfugier dans l’aile protectrice de son leader.
Peut-être devrais-je écourter la mission ? se demanda-t-il, tournant alors la tête à l’intérieur du virage ; mais les nuages commençaient à former des masses compactes, rendant vaines les tentatives de Vincent qui cherchait maintenant à retrouver son ailier afin de juger la précision de son rassemblement. Les deux appareils allaient s’apercevoir très certainement au dernier moment, risquant de ce fait l’abordage si leurs trajectoires ne se révélaient pas suffisamment précises.
Il faut l’entraîner à dépasser les limites ! fut la pensée suivante de Vincent, se remémorant cette nuit de janvier 1991 durant laquelle il avait dû, suivant l’expression consacrée, « s’asseoir » sur toutes les limites pour aller bombarder un site de missiles sol-air irakien mettant grandement en péril la survie de ses collègues. Alors que prêt à réagir pour un évitement à la dernière seconde il surveillait toujours l’arrivée imminente de son ailier, c’est la voix de ce dernier, rendue métallique et nasillarde par le système audio de l’avion, qui le ramena à l’exacte réalité du moment. Malgré un calme apparent, Vincent décela chez son jeune ailier une modulation porteuse de stress. Luigi l’informait que son avion était victime d’une panne totale de gyroscopes et n’était donc plus en mesure de voler seul dans les nuages.
***
L’esprit de Vincent tournait à toute vitesse. Lorsqu’ils avaient décollé une heure plus tôt, la météo se dégradait rapidement, et il avait déjà prévu de ramener son ailier en patrouille serrée jusqu’à l’atterrissage, avant de remettre les gaz pour se poser seul à son tour, la pluie et le vent de travers rendant impossible un atterrissage simultané des deux avions. Il entra en contact avec l’opérateur radar de l’approche1 qui allait se charger de ramener les deux Mirage sains et saufs sur la base.
Devant lui et légèrement sur sa droite, Vincent venait d’acquérir le visuel de son ailier. Il réduisit lentement sa vitesse, croisa par l’arrière et tourna pour se positionner de manière que ce dernier n’ait qu’un minimum de manœuvres à effectuer pour venir se placer en patrouille serrée dans son aile droite. Une fois l’ailier en sécurité, calé contre son leader, Vincent demanda le guidage radar pour le retour de la patrouille ; il pouvait maintenant faire totalement abstraction des nuages, son ailier collant à lui et n’ayant plus besoin de références visuelles extérieures jusqu’à l’atterrissage.
L’approche finale fut conduite avec une extrême précision. Connaissant l’avarie majeure de l’avion ailier, le chef de salle avait manifestement confié le guidage de la patrouille à son contrôleur le plus expérimenté. Si par maladresse Luigi venait à se retrouver dans les nuages et isolé de son leader avec un avion privé de gyroscope et donc de référence d’horizon, il ne lui resterait alors qu’une seule solution : l’éjection.
Malgré la pluie qui s’abattait violemment sur la piste et le vent de travers soufflant en rafales, la patrouille se présenta à la hauteur minimum dans des conditions favorables à un atterrissage en toute sécurité pour l’ailier. Vincent n’avait plus qu’à remettre les gaz pour se représenter cette fois-ci seul à l’atterrissage.
D’un geste ample et sec, il envoya la manette des gaz en secteur plein avant, demandant ainsi à son réacteur de fournir la poussée maximale. Il s’attendait à recevoir le classique « coup de pied au cul » qui lui confirmerait que son réacteur, délivrant alors sa pleine puissance, transformait en fusée Ariane l’avion qui, quelques secondes auparavant, était à deux doigts de toucher le sol… Mais rien ne venant, Vincent jeta un très bref coup d’œil sur ses instruments de contrôle et constata, impuissant, que la vitesse de rotation de son moteur était maintenant en diminution rapide. Une sourde mais puissante détonation lui confirma ce que sa fulgurante analyse de pilote de combat en pleine maîtrise de son art avait déjà anticipé : pour une raison qu’il n’avait de toute façon pas le temps d’investiguer, son réacteur venait de rendre son dernier souffle, et tel l’oiseau touché en plein cœur et en plein essor, l’avion sans vie s’enfonçait, inexorablement aimanté par la gravitation terrestre.
***
Le micro en main, le jeune sergent en poste à la vigie de la tour de contrôle n’en crut pas ses yeux ; comme prévu, alors que l’avion ailier venait de toucher le sol et débutait prudemment sa décélération sur la piste détrempée, il vit le leader entamer une remise de gaz puis brutalement commencer à s’enfoncer tout en gardant le nez toujours inutilement pointé vers le ciel.
Il resta tétanisé durant deux à trois interminables secondes, à la fois subjugué par la beauté et l’intensité dramatique de la scène qui se déroulait sous ses yeux, et perturbé par l’image que son cerveau généra instantanément : il se revit enfant, chassant le canard avec son grand-père, se préparant à applaudir lorsqu’après le fracas d’une double détonation, l’oiseau fauché en plein élan repliait ses ailes puis, sur sa lancée, retombait lourdement quelques dizaines de mètres plus loin dans l’étang, signant sa fin d’une funeste gerbe d’eau… Funeste, mais ô combien délectable pour l’enfant qu’il était. Il venait bien d’entendre une détonation, mais ce n’était pas celle émise par le fusil Verney-Carron de son aïeul… Quant au canard stoppé net dans son envol, il était maintenant fait de métal, pesait plus d’une dizaine de tonnes et l’explosion entendue ne pouvait venir que de l’ultime et lugubre soubresaut d’un réacteur à l’agonie ; l’oiseau métallique, quant à lui, n’allait pas tarder à percuter la terre ferme, et ce, dans une gerbe de flammes.
Sortant de sa bien involontaire léthargie, il écrasa vigoureusement le champignon rouge sur le pupitre et aussitôt une fête foraine se déploya sous ses yeux ; une sirène stridente retentit, et tels des diables, les camions rouges, déjà en alerte, jaillirent du pied de la tour de contrôle, rajoutant leurs gyrophares bleus et les modulations de leurs klaxons à l’ambiance de cette étrange kermesse. En guise de bouquet final, de l’avion en perdition, il vit le pilote s’éjecter. Moins d’une demi-seconde après avoir débuté la manœuvre d’abandon, Vincent se retrouva dégagé de la carcasse métallique qui s’apprêtait à impacter brutalement le sol et, soudainement, pris d’une violente douleur dans les vertèbres, perdit connaissance.
***
Luigi contrôlait précautionneusement la décélération de son avion, manœuvre rendue délicate par le vent de travers qui soufflait en rafales sur la piste détrempée ; jamais cette mission d’entraînement à son profit n’aurait dû être conduite, les conditions météorologiques étant notoirement insuffisantes. Comme par le fait du hasard, la panne totale de gyroscopes que venait de subir son avion lui rappelait combien tout cela avait été imprudent. Mais son instructeur, le Capitaine Vincent Deniel, lui avait fait comprendre que pilote de combat n’était pas un métier de fonctionnaire et qu’il fallait savoir « oublier » règlements et limites de toutes sortes si l’on voulait être prêt le jour J.
À l’escadron, Vincent Deniel avait une solide réputation, auréolée de faits d’armes accomplis pendant la guerre du Golfe et il n’était bien sûr pas question de contester ses décisions ; Luigi devait au contraire être fier d’avoir comme parrain et instructeur cet aviateur, ce guerrier qui avait su faire fi de multiples entraves pour mener, avec succès et au péril de sa vie, plusieurs missions de bombardement en territoire irakien.
Rassuré et enfin au sol, Luigi était fier ; mais sa fierté ne venait pas de cette mission plutôt réussie malgré les conditions, ni même de son retour rocambolesque aux commandes d’un chasseur gravement en panne. Sa fierté, c’était Paul, son fils, dont une petite photo « trônait » sous ses yeux, habilement coincée entre l’écran radar et le haut du tableau de bord.
Ces mots, sa compagne les avait écrits au verso de la photo après que Luigi lui eut raconté à plusieurs reprises dans quel état d’esprit se trouvait le Capitaine Deniel, son instructeur, ce pilote auquel personne n’osait dire non.
La vitesse atteinte allait permettre à Luigi de dégager la piste sans risque d’un quelconque dérapage dû à un éventuel aquaplaning. Il regarda la photo, pensa « Paul », puis « Limites » et enfin « Deniel », le Capitaine Deniel dont d’ailleurs il aurait dû, depuis quelques secondes déjà, voir l’avion s’éloigner en reprenant de l’altitude avant d’entrer à nouveau dans les nuages… Rassuré et fier, Luigi s’apprêtait à dégager la piste… Son dernier regard fut pour Paul et la photo dont on ne trouva nulle trace dans la carcasse carbonisée.
***
L’air vif et la pluie qui fouettait son visage réveillèrent Vincent ; il était accroché sous son parachute et voyait le sol se rapprocher beaucoup trop vite à son goût. Il avait atrocement mal dans les reins et tentait d’oublier cette douleur pour se concentrer au mieux sur ce qui allait être plus une brutale rejointe du sol qu’un atterrissage en douceur sur la terre ferme ; il trouva l’énergie pour faire un tour d’horizon et constata que, sans action de sa part, il allait bientôt « se vacher » dans la carcasse de son avion en flammes, pièce de métal inerte qui s’était finalement écrasée sur la piste. Furieusement, il tira sur les suspentes du parachute pour tenter de se soustraire autant que possible au vent qui sournoisement le conduisait vers le brasier… Mais était-il trop tard, ou bien le vent était-il trop fort ?
C’est peut-être à ça que servent les limites ? fut l’avant-dernière pensée lucide de Vincent qui, se préparant à mourir brûlé dans les flammes des restes de son avion, regarda en direction de la tour de contrôle pour juger de la rapidité de l’approche des pompiers. Son regard croisa le tarmac2 de son escadron, sur lequel le Lieutenant « Luigi » devait être en train de parquer son avion ; mais bizarrement, il ne vit rien, absolument aucun mouvement, aucun signe de vie.
Ses yeux revinrent alors vers la carcasse, les flammes qui la dévoraient et l’épaisse fumée noire que le vent peinait à dompter. Étrangement, il constata alors que son avion détruit possédait maintenant deux fuselages, deux dérives, quatre moignons d’ailes et deux cockpits… Dans l’un des deux, une forme humaine en proie aux flammes se débattait pour survivre.
C’est à ça que servent les limites ! fut la dernière pensée lucide du Capitaine Vincent Deniel, pilote instructeur sur Mirage et héros de la guerre du Golfe.
De nos jours, sur la base aérienne
d’Orange-Caritat
Harnaché dans son équipement complet, allant de la ceinture anti-G3 au blouson de vol surmonté d’un gilet de sauvetage, le capitaine « Pollux », ainsi affectueusement surnommé par ses collègues de l’escadron, ressemblait de fait plus au célèbre bonhomme Bibendum qu’à un fringant pilote de chasse. Il était assis sur un canapé, tuant le temps comme il le pouvait en regardant un film sur le lecteur DVD récemment mis en place dans la salle d’alerte ; à droite du poste de télévision, une porte ouverte donnait sur l’intérieur du hangar dans lequel il apercevait, fidèle au poste, sa fière monture.
Verrière ouverte, groupe électrique branché, préparation pré-vol effectuée, le Mirage était prêt à bondir du hangar en moins de deux minutes ; Pollux ne s’intéressait finalement que très peu au film, se laissant régulièrement distraire par l’observation de cette machine… Une machine que l’on aurait pu dire mâle par la puissance qu’elle se montrait capable de générer en un éclair, mais aussi délicatement et presque érotiquement femme, par son élégance toute en courbes, si gracieusement aérodynamiques.
Le klaxon virulent du déclenchement de l’alerte le tira brutalement de sa réflexion sur le genre à attribuer à sa machine de guerre. Il se doutait que cela devait se produire, car, bien que prenant régulièrement l’alerte comme chaque pilote de l’escadron, cela faisait maintenant plus d’un an qu’il n’avait pas décollé dans ces conditions particulières : visiblement, on cherchait ainsi à l’entraîner, voire à le tester.
Il bondit du canapé, franchit la porte en courant, posa son pied d’appel sur le premier barreau de l’échelle métallique accrochée au fuselage et l’étroit cockpit l’accueillit, telle une pièce de puzzle ayant trouvé sa place. Alors que le mécanicien qui le suivait sur l’échelle lui présentait les sécurités prestement retirées du siège éjectable, Pollux, de la main droite, finissait de boucler son harnais et de la main gauche lançait le cycle de démarrage automatique du réacteur. Il rabattit la verrière et lâcha les freins une demi-seconde après qu’un deuxième mécanicien lui eut fait signe que les cales ainsi que toutes les sécurités de l’armement embarqué, deux canons et quatre missiles, n’en interdisaient plus une funeste utilisation. Le Mirage commença à rouler bien que son réacteur n’eût pas encore atteint son régime de ralenti stabilisé.
Si planqué dans un coin du hangar, quelqu’un chronomètre ma performance, il va être bluffé ! pensa Pollux en actionnant les pédales de frein pour s’assurer du bon fonctionnement du système ; tel le pur-sang trop fougueux que l’on contraint brutalement d’une rêne ferme, le chasseur plongea du nez en écrasant son amortisseur avant puis relevant fièrement le museau, signifia en contrecoup qu’on ne le dompterait pas si facilement. Il balaya enfin d’un regard rapide, mais rigoureux, l’ensemble des instruments présents sous ses yeux, suivant un cheminement bien défini qu’il avait déjà exécuté des milliers de fois : aucun voyant orange ou rouge n’était allumé.
Une flamme plus longue que l’avion lui-même surgit de la tuyère lorsque d’un geste souple, mais déterminé, il poussa la manette des gaz en position « Post-combustion pleine charge » ; semblant enfin libéré de toutes les pesantes contraintes terrestres, le Mirage s’ébroua puis, prenant rapidement de la vitesse, s’éleva virilement dans l’azur.
Le contrôleur lui transmit alors des indications de cap, d’altitude et de vitesse, le tout dirigeant le chasseur directement au-dessus de la Méditerranée. Instinctivement, Pollux pensa « Interception d’un aéronef potentiellement hostile », et vérifia une nouvelle fois son système d’armes, canons et missiles, tout en repassant mentalement les étapes d’une mesure de police du ciel, étapes pouvant aboutir à un engagement en combat réel et à la destruction de l’intrus… Ou plus funestement, à sa propre destruction.
Ce n’était donc pas ce à quoi Pollux venait de se préparer, mais c’était du sérieux tout de même : P 104 était une zone interdite de pénétration dans laquelle les services de l’Armement effectuaient régulièrement et sans prévenir, des essais de tous types d’armes, allant du canon au missile anti-aérien. Si l’aéronef de tourisme, manifestement perdu, entrait dans la zone, il risquait de se transformer involontairement en cible potentielle. Le contrôleur poursuivit :
Pollux s’intéressait peu aux détails du : « Comment ? Pourquoi ? » Il avait maintenant une mission précise : intercepter cet avion avant que ses occupants ne soient tués par un tir de missile. Un avion de tourisme lent et de plus bleu au-dessus de la mer, voilà qui ne va pas être simple à trouver ! Son cerveau tournait à sa vitesse maximale pendant que le chasseur, ayant atteint sa vitesse aux limites du vol supersonique, parcourait de son côté dix-huit kilomètres par minute.
Un rapide calcul lui confirma que dans cinq minutes, il aurait dépassé la position présumée de l’imprudent. Soudain, un « Bip » retentit dans son casque et sur l’écran « tête basse » de son radar, un plot apparu, lui confirmant la position de D-KNAP. Le calculateur associé lui indiqua rapidement les éléments de vol du monomoteur : cap Nord ; altitude 500 pied ; vitesse 120 nœuds. En regardant plus haut dans le ciel, Pollux vit enfin sur sa droite, tel un moustique écrasé sur sa verrière, la silhouette du monomoteur se détacher. La manœuvre de rassemblement allait s’avérer délicate, car la vitesse maximale de l’avion de tourisme n’était pas loin d’être la vitesse minimale du chasseur…
***
Si le pilote allemand n’était pas un champion de la navigation, il connaissait parfaitement la réglementation et l’ensemble des signaux visuels relatifs à la procédure d’interception. Tout en assurant les contacts radio avec les contrôleurs et en pilotant son Mirage qui volait en limite de ses capacités en basse vitesse à quelques mètres du Cessna, Pollux continuait à s’adresser avec une voix ferme, mais calme, au pilote de l’avion léger ; pour une raison qu’il ne chercha pas à diagnostiquer, ce dernier entendait et exécutait les ordres, mais ne répondait jamais à ses messages.
Quarante minutes plus tard, une étrange patrouille s’offrit aux appareils photographiques des curieux stationnant régulièrement en bordure de la route longeant l’entrée de la piste 33 de la base d’Istres : un timide monomoteur se présentait à l’atterrissage sous le regard protecteur et vigilant d’un Mirage. Quelque peu chahuté par le Mistral qui venait de se lever, le frêle engin finit, après quelques rebonds chaotiques dignes d’un rodéo, par se coller au sol et dégagea la piste ; un véhicule militaire arborant le panneau clignotant « Follow me »5 lui ouvrit la route vers le parking tandis qu’un deuxième véhicule, de la Gendarmerie celui-là, fermait la marche de cet inhabituel cortège.
Le capitaine Pollux vola aux côtés du Cessna, à très basse hauteur et très basse vitesse, jusqu’à ce que l’atterrissage de ce dernier soit assuré. Puis d’un geste ample et sec, il renvoya vers l’avant la manette des gaz et de nouveau libéré, enfin délivré des entraves qui l’obligeaient à voler à si faible allure, le Mirage sembla hennir et, pressé de rejoindre son écurie, se lança au grand galop, déchirant furieusement les placides cumulus cotonneux qui ornaient le ciel de Provence.
Comme à chaque fois qu’il engageait une remise de gaz, une bouffée incontrôlable, faite d’un mélange détonant de désarroi et de colère, emplit l’âme de Pollux… Comme à chaque fois qu’il engageait une remise de gaz, le Capitaine Paul Vitali, affectueusement surnommé « Pollux » par ses collègues pilotes, repensait au père qu’il n’avait que trop peu connu, mort carbonisé trente ans plus tôt dans la carcasse de son chasseur.
***
Paul s’attendait à tout, connaissant le caractère facétieux et joueur de celui qui, âgé d’à peine trois ans de plus que lui, était son redouté Commandant d’escadron.
C’était bien là le style de son chef ! Quel remerciement ! Il s’attendait plutôt à être enfin désigné parmi les pilotes qui se rendraient au Brésil l’automne suivant pour démontrer les capacités des avions de chasse français.
Bizarrement, les traits du visage du chef n’affichaient pas ce petit sourire narquois qu’il ne pouvait cacher lorsqu’il faisait ce genre de blague à un de ses pilotes. Il semblait même plutôt peiné, expression nouvelle que Paul ne lui connaissait pas.
Paul ne dit mot, acquiesçant simplement d’un furtif mouvement de menton : il y a deux jours à peine, malgré les interdictions répétées qui lui avaient été signifiées, il avait une nouvelle fois survolé ce village et offert deux magnifiques tonneaux lents à un centenaire ému qui le regardait, admiratif, assis sur un banc devant une fontaine.
Paul était figé, s’attendant maintenant à ce que l’échange avec le patron se transforme en une véritable « remontée de bretelles ».
Paul sentait bizarrement que depuis quelques minutes, son chef tournait autour du pot, n’arrivant pas à dire ce qu’il avait à lui dire… Et cette attitude sonnait éminemment faux dans le personnage du guerrier accompli qu’il jouait ordinairement.
Paul restait tétanisé dans le couloir de l’escadron, devant la porte du bureau du chef… Marcel décédé ? Impossible… Il lui téléphonait régulièrement, pour le prévenir de son passage en avion, mais ne lui avait plus rendu visite depuis plusieurs années… Marcel était toujours là, fidèle au poste, s’émerveillant et vibrant comme un gamin lorsqu’une patrouille de deux Mirage faisait exploser le ciel au-dessus de Saint-Eules… Marcel était toujours là, avec ses conseils avisés d’ancien pilote de chasse, des conseils qui portaient la patine du vécu au combat et que Paul se faisait un devoir de transmettre aux jeunes pilotes arrivant à l’escadron ; il entendit résonner la voix de Marcel dans l’écouteur du téléphone, une voix qui lui répétait :
Marcel, lui, serait toujours là, planqué dans la lumière de sa mémoire.
Paul retrouvait bien là son chef ; il lui répondit du tac au tac :
Les deux hommes se jaugèrent pendant de longues secondes.
Paul rectifia la position, salua son chef d’un coup sec du menton tout en gardant les yeux fièrement vrillés dans ceux du commandant ; puis il fit demi-tour et s’éloigna, sentant sur lui le poids d’un regard qui le jaugeait toujours.
Deux semaines plus tôt, dans le Massif central
C’est un rayon de lumière, pointant à travers les persiennes des vieux volets de la chambre, qui tira Mathilde du sommeil. Elle ouvrit difficilement les yeux, mettant de longues secondes pour appréhender la réalité qui l’entourait : des feuillets imprimés recto verso étaient répandus sur la couette et sur le sol. Sur la table de nuit, pliée à côté d’un réveil électronique affichant 10 : 41, se trouvait la lettre accompagnant le manuscrit.
Elle se redressa, ramassa comme elle le put les feuilles heureusement numérotées et se souvint qu’il était quatre heures du matin passées lorsqu’elle avait achevé la lecture. Inquiète de s’être ainsi laissé emporter par un si profond sommeil, elle regarda son téléphone : l’écran lui renvoya l’image d’Inge et de Marc, rayonnants de bonheur, tenant Ingemar dans leurs bras ; soulagée, elle constata n’avoir manqué aucun appel d’urgence.
Encore déstabilisée par sa nuit de lecture, Mathilde fixait maintenant l’objet « téléphone » ; si elle le voulait, elle pouvait sur l’instant envoyer un message vers Inge et Marc leur réclamant ainsi une toute dernière photo d’Ingemar, photo qu’elle recevrait dans les secondes suivantes… Pourtant, ici, dans son village perdu du Massif central, les véhicules de secours mettaient plus de trente minutes pour arriver du fond de la vallée… Dans les cas les plus graves, l’hélicoptère de la Sécurité civile se déplaçait, à condition que la brume ou les nuages n’accrochent pas les collines… Mais dans ce monde où parfois l’infini semblait s’évanouir, seules quelques secondes suffisaient pour recevoir une photo expédiée depuis un autre pays, voire depuis un autre hémisphère… Il était peut-être aussi là, ce monde vacillant qui angoissait Vincent, au point de le conduire à commettre l’irréparable.
Elle relut alors le poème accompagnant la lettre qu’il lui avait écrite ; il s’y décrivait en funambule aveuglé, traversant sa vie sur un fil pointillé, ou encore errant sur une Terre basculant de solstices irradiés en équinoxes déréglés… Ce poème était lourd d’interrogations et Mathilde l’avait compris, il retraçait le chemin parcouru par Vincent, depuis le départ de Claire, sa femme, jusqu’à sa décision de mourir.
Car Vincent avait exercé son ultime et seule vraie liberté, celle de mettre fin à ses jours ; il avait choisi le moyen, l’heure, la date : celle de l’anniversaire de son accident d’avion et de son mariage avec Claire, l’infirmière qui s’était tant impliquée dans les soins au grand brûlé qu’il avait été quelques années auparavant.
Par ce geste, il envoyait un message à Claire qui ne lui était jamais revenue : un magnifique et ultime message d’amour. Malgré la trahison, il l’aimait toujours et ne pouvait continuer sans elle sur le chemin… Mais, et Mathilde le comprenait maintenant, c’était également un message pour elle ; Vincent avait choisi de mourir, indiquant ainsi quelle fin lui choisissait pour son roman : la deuxième, celle où Mathilde croisait Hugues, son amour de jeunesse… La phrase : Car je savais qu’une autrevoie s’écrirait un jour pour vous, prenait alors tout son sens… Si ce que Vincent avait écrit devait se réaliser, alors Mathilde allait voir une nouvelle lumière éclairer son existence.
Elle commença à se lever… Il était bientôt onze heures ; elle ne se souvenait pas avoir un jour quitté son lit si tardivement. Elle était assise sur sa couette, l’esprit encore embrumé, peu reposée par ce sommeil en heures trop décalées… Et alors que trop de choses se bousculaient encore dans sa tête, une nouvelle interrogation se fit jour, qui rajouta à son angoisse : quelle attitude devait-elle maintenant adopter ? Comment conduire ses choix de vie ? Une nouvelle lumière allait briller… Mais que devait-elle faire, ou ne pas faire, elle, Mathilde, pour que cela advienne ?
***
Une nouvelle lumière l’attendait, peut-être, mais pour Mathilde, sur l’instant, ce roman écrit par Vincent ne faisait que projeter d’immenses zones d’ombre sur son existence à venir ; jusqu’à présent, celle pour qui toute vie semblait faite d’une alternance plus ou moins régulière de joies et de peines, ne s’était jamais questionnée sur son futur. Elle avait vécu ce qu’elle avait à vivre, affrontant les épreuves avec courage et savourant avec délice les heures heureuses. Elle n’était pas croyante, mais viscéralement humaniste et n’avait pu s’empêcher de remarquer ce balancement de rires et de larmes qui rythme toute vie ; celles et ceux à qui elle tenait souvent la main à l’instant de leur dernier souffle le lui confiaient, en guise d’ultime message d’espoir. De leur vie qui s’achevait, il ne fallait retenir qu’une seule chose : l’équilibre, malgré tout, de l’ombre et de la lumière… Jour et nuit à parts égales, l’équinoxe.
Elle fut alors prise d’un terrible tremblement, car dans son esprit, elle eut soudainement conscience que ce que lui prédisait Vincent n’était autre qu’une vie faite uniquement de lumière, de bonheur… n’était autre qu’un équinoxe déréglé. Cela était-il seulement possible ?
Mathilde fermait la lourde porte de la ferme lorsque la sonnerie de son téléphone retentit ; il était huit heures et demie et le cabinet ouvrant à neuf heures les jours de marché, elle pensa qu’il devait s’agir d’une urgence. Elle extirpa difficilement son smartphone coincé au fond de l’ample besace faisant office de sac à main et décrocha sans prendre la peine de regarder l’écran présentant son interlocuteur.
Quelques secondes de silence s’installèrent pendant lesquelles elle comprit qu’Arnaud réfléchissait.
Mathilde, après quelques secondes de réflexion, décida d’inclure définitivement Arnaud dans sa quête de la vérité ; pour cela, il n’y avait qu’un seul chemin : l’honnêteté.
Quittant son cabinet après une journée de consultations durant laquelle elle avait eu le plus grand mal à faire le vide dans ses pensées, et ainsi consacrer toute son énergie uniquement à ses patients, Mathilde marchait vers sa maison, profitant de la lumière et du doux rayonnement du soleil couchant qui caressait sa joue. Jouant comme lorsqu’elle était enfant, elle déviait parfois de quelques mètres pour le simple plaisir d’entendre crisser ses pas dans la neige qui n’avait pas encore totalement fondu.
Elle marchait lentement, flânant presque, contrairement à son habitude ; elle réfléchissait. Cet autre message sibyllin, lorsque vous serez prête, venait renforcer l’état d’incrédulité dans lequel l’avait laissée la lecture du roman. Vincent lui promettait un chemin de lumière, mais souhaitait la faire revenir vers lui dès qu’elle serait prête, simplement pour qu’un notaire lui remette une nouvelle lettre… Mais prête à quoi ? Ou bien était-ce simplement une question de temps ? Mais dans ce cas, combien de temps attendre ? Un mois ? Un an ? Ou bien devait-elle choisir une date anniversaire, comme celle de leur rencontre, date dont Vincent avait fait la combinaison de son coffre ?
Et si je me déclarais prête dès maintenant ? se dit-elle… Après tout, puisqu’elle restait profondément sceptique quant aux supposées capacités paranormales dont Vincent se vantait, pourquoi devrait-elle jouer la comédie en attendant un moment précis, qu’elle ignorait d’ailleurs, avant de retourner à Manosque pour lire son ultime message ? En espérant de plus qu’il s’agirait bien de l’ultime message et que Vincent, jouant alors avec elle, ne la « promènerait » pas de message en message…
Mathilde ouvrait la porte de sa ferme et se surprit à dire cette phrase à haute voix, comme si elle avait voulu annoncer sa présence. Mais à ses oreilles, son ton sonna horriblement faux… car elle mentait… et Mathilde ne savait pas, ne voulait pas mentir. Elle ne savait pas quand, ni par quels moyens elle pourrait se déclarer prête, mais rien n’ayant changé dans sa vie depuis le passage de Vincent quatorze mois plus tôt, elle sentait intuitivement que se dire « prête » relevait du mensonge.
***
Plutôt que de préparer un repas qu’elle ne mangerait de toute façon qu’à contrecœur, elle s’affaira à relancer les flammes dans la cheminée où des cendres grisonnantes agonisaient. Elle ouvrit ensuite le bas du bahut et se trouva face à son impressionnante collection de disques et de CD. Elle prit le temps de choisir et sortit un album dont l’écoute l’accompagnerait dans une méditation par laquelle elle espérait trouver quelques éléments de réponse à la multitude de questions que la lecture du livre de Vincent avait semée en elle.
Elle posa le disque vinyle sur la platine et alors que la voix du chanteur de Supertramp déclarait « Good bye stranger, it’s been nice6 », elle rapprocha son fauteuil de l’âtre renaissant, éteignit toutes les lumières de la pièce et se laissa envelopper par la pénombre.
Comment répondre à toutes les questions que ce texte posait ? Elle avait un peu bluffé au téléphone, ce matin avec Arnaud, prenant une voix assurée, promettant de démasquer au plus vite la forfaiture supposée de Vincent. En utilisant les capacités quasi infinies d’Internet, elle pourrait trouver des réponses ; mais alors que son esprit cartésien tentait de la protéger de toute dérive mystique, elle sentait au fond d’elle-même qu’elle ne pourrait ni tout expliquer, ni tout comprendre… Elle décida alors de ranger au rayon « romanesque » ce qu’elle ne pourrait élucider : Vincent, qui n’était jamais entré dans sa maison, en faisait pourtant une description très fidèle… Peut-être avait-il vu une ferme identique ou était-ce là le fruit d’une coïncidence nourrie de l’imagination fertile du romancier ?
Elle repensa alors au tout début de cette aventure, lorsqu’après avoir rebroussé chemin, Vincent l’interrompait en pleine lecture… Elle lisait justement son premier roman, sans savoir que l’auteur se tenait debout, là, devant elle… Le paradoxe du verrou, un roman sentimental pétri de questionnements, et qui, maintenant qu’elle avait lu Quand les ombres s’ensoleillent, lui apparaissait comme porteur d’un message cher au cœur de Vincent : si nos choix nous construisent, nous déterminent, nous façonnent, ils impactent inéluctablement la vie des autres ; ces mêmes « autres » qui se construisent, se déterminent, se façonnent par des choix qui impactent alors inéluctablement nos vies.
Vincent avait fait deux choix ; le premier consistait à léguer un roman à Mathilde… Un roman et un poème supposé éclairer son deuxième choix, celui de mettre fin à ses jours… Et cela percutait aujourd’hui de plein fouet la vie de Mathilde, une vie dont la tranquille et rassurante monotonie venait d’exploser sous l’impact.
Exploser sous l’impact… Cette expression violente résonna brutalement dans son esprit épuisé et soudain, alors que les flammes s’envolèrent dans la cheminée, dévorant goulûment les bûches, son regard se figea et ses pupilles se dilatèrent ; elle se sentit comme aspirée et l’image des morceaux de bois consumés se fit floue, se transformant en un amas informe de ferrailles incandescentes en proie aux flammes… Dans ce brasier, dans lequel un homme accroché sous un parachute se préparait à atterrir, un autre homme se débattait pour ne pas mourir carbonisé… Un flot incontrôlé d’images défila alors sous ses yeux, que la lueur trop intense de ce début d’incendie lui avait fait clore : le regard de Vincent, un avion de chasse, une petite fille nouvellement née, une cérémonie à la mairie, Claire, une médaille gravée, un matin de marché à Saint-Eules, un carnet rose et violet, Marcel sur son lit de mort, le lac, Mélanie éclatant de rire et serrant dans ses bras Amélie, une jeune femme que Mathilde ne connaissait pas…
Comme mue par un instinct, elle se leva. De sa sacoche, elle tira son agenda, et méthodiquement, elle annula tous les rendez-vous de la semaine. Enfin, elle posa sur la table son ordinateur portable, ouvrit le logiciel de traitement de texte et commença à écrire.
Les équinoxes déréglés
I
Mathilde achevait de ranger la vaisselle ; seule dans sa maison, ce travail qu’elle faisait systématiquement après chaque repas ne lui prenait jamais plus de quelques minutes. Pour le reste de l’après-midi, elle avait prévu d’aller marcher une heure environ, en suivant le chemin de Compostelle qui traversait le village. Elle en profiterait pour se poser, pour s’aérer l’esprit en espérant que se calme le bouillonnement intérieur qui y régnait depuis que le manuscrit de Vincent l’avait investi. Un manuscrit dans lequel Vincent lui avait également laissé, comme une invitation, cette citation de Jean Giono : Si tu ne penses pas, marche ; si tu penses trop, marche encore. Et situ penses mal, marche toujours.





























