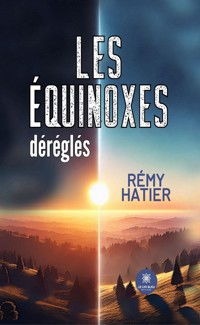Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Tout abandonner, partir… Vincent, écrivain en quête de renouveau, décide de tout quitter pour entreprendre un voyage vers l’inconnu. Son objectif : puiser dans ses dernières ressources pour stopper sa descente dans les ténèbres et renaître à la lumière. Alors que les ombres commencent à s’éclaircir, un sentiment d’excitation et d’incertitude l’envahit. Là, à l’horizon de son aventure, se profile Mathilde, un soleil au zénith, dont l’arrivée pourrait bien chambouler le cours de son destin. Qui sait, soleil et ténèbres ne sont peut-être pas forcément ennemis…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Rémy Hatier, après avoir terminé sa carrière professionnelle, se lance dans l’écriture. Il publie en auto-édition son premier roman "Le paradoxe du verrou" et un recueil de nouvelles intitulé "Le mâle des transports". Encouragé par les critiques positives, il décide de poursuivre l’exploration de thèmes qui le passionnent, tels que le temps, le hasard, la liberté, la spiritualité, et les contradictions de nos vies. "Quand les ombres s’ensoleillent…", son troisième livre, explore la dualité entre l’ombre et la lumière dans nos existences.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 1970
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rémy Hatier
Quand les ombres s’ensoleillent…
Roman
© Lys Bleu Éditions – Rémy Hatier
ISBN : 979-10-422-0842-4
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Le voyageur égaré
Il le savait, elles étaient là, tapies dans l’obscurité, attendant leur heure… Seul lui pouvait les voir, ces ombres de la nuit… Des ombres sans soleil…
La pénombre s’installait, comme une corde lentement serrée. S’insinuant inexorablement dans le salon, elle étranglait les phrases, étouffait les mots, rendant illusoire la poursuite de la lecture ; il referma le livre et dans un soupir rejeta la tête en arrière, se figeant dans l’attitude classique de celui qui veut méditer en fixant, les yeux grand ouverts, un simple plafond… Il frissonna, se disant qu’il pourrait bien sûr comme elle aimait le faire, insuffler la vie dans cette pièce à l’agonie, en éclairant les quelques lampes élégamment et si harmonieusement disposées sur les meubles ; « Faire s’aimer l’ombre et la lumière ! » avait-elle coutume de dire… Et comme elle avait également l’habitude de le faire à cette heure de la journée, il pourrait aussi monter le chauffage et ainsi chasser ces tremblements qui maintenant allaient jusqu’à le tétaniser.
Mais elle n’était plus là… Pourtant, par chaque objet dans cette pièce, par chaque bibelot, chaque meuble, chaque lampe, elle se révélait ; partout dans cette maison, dans chacune de ses pièces, jusque dans les tringles et dans le choix des rideaux qu’elles soutenaient, sa présence était prégnante, visible, palpable comme quasi matérielle et réaliser cela le conduisait immédiatement au bord de l’abîme.
Pour occuper son esprit, pour leurrer ses pensées et ne pas sombrer, lui restait alors la lecture et quand fatigué de faire semblant de s’enfuir il posait enfin son livre, seul s’offrait à lui ce plafond simplement blanc, peut-être le seul endroit de la maison ne portant pas son empreinte.
Péniblement, il revint vers le livre. Il faisait maintenant nuit ; par la fenêtre en arrondi derrière son fauteuil, une fenêtre qu’elle avait dessinée et fait ouvrir dans le mur, la pleine lune se voulait bienveillante et renvoyait une douce clarté, étrangement et délicatement bleutée… Devant lui sur le tapis se dessinait une ombre à la forme torturée… Son ombre, une ombre sans soleil, pensa-t-il.
Le poème qu’il venait de relire le laissait toujours dans un état de profonde introspection. Il le lisait à haute voix, cherchant à en apprécier la musicalité ; mais l’écho qui lui revenait portait mêlées toutes les interrogations, les frustrations et les souffrances qui, depuis le départ de Claire, étayaient les ruines de ce qui restait de son existence… Des questions qui resteraient sans réponses, comme une impossible quête de la vérité… Une vérité sur ce qu’il venait de vivre, une vérité qui, il le pressentait, se refuserait toujours à lui.
Elle n’était plus là ; alors oui, bien sûr, il y avait trop de vide sous ses pas ! C’était bien lui, ce funambule vacillant sur un fil incertain, improbable, parce que tendu en pointillés entre un passé qui se dissolvait et un futur qu’il ne désirait plus ; cet équilibriste tout juste toléré dans un monde qu’il ne comprenait plus, oui, c’était bien lui… Alors, il jetait un regard inquiet sur ceux qui l’entouraient ; pourquoi faisaient-ils semblant de rire, pour qui faisaient-ils semblant d’être heureux ? Pourquoi jouaient-ils cette comédie permanente du bonheur factice ?
Un regard angoissé, c’est ce qu’il posait maintenant sur ses contemporains. Étaient-ils bien conscients que leur unique destinée était tout simplement de ne plus être ? Avec cette pensée qui le taraudait en permanence depuis qu’elle était partie, il observait ses semblables barbotant lamentablement dans la vacuité de leur quotidien.
« Eh ! Toi ! Sais-tu qu’il y a une tombe au bout de ton chemin ? ». C’est ainsi qu’il avait envie de les ramener à la réalité de leur très exacte condition : obsolescents programmés.
Quant à lui, il l’avait touchée du doigt… Non, pas touchée, mais bel et bien reçue en pleine gueule, cette obsolescence programmée. Tout s’était effondré… Brutalement, il avait découvert que celle en laquelle il croyait, celle qui tissait jusque-là l’âme de son existence, venait de se changer en chimère ; tous les mots, toutes les phrases, tous les serments prononcés, tout cela s’achevait sur un point d’interrogation balayant sans scrupule ce qu’il pensait être les certitudes de sa vie. La vérité de l’Amour en lequel il croyait n’était plus que l’emballage cadeau d’un paquet de mensonges.
La trahison de Claire lui renvoyait les pires interrogations sur ce qu’avaient été les presque trente-cinq années de leur vie commune… En ai-je été l’acteur, le socle ? Ou bien n’ai-je été qu’un pantin manipulé par des mains virtuoses ? … Il avait suffi de deux jours, le temps d’un simple week-end, pour que les ombres le saisissent… Dans sa vie, le temps s’était soudainement accéléré et, en deux jours seulement, son monde avait basculé d’un solstice irradié à un équinoxe déréglé.
« Claire est partie… Claire est partie ! » répétait-il sans fin dans la pièce, une nouvelle fois à haute voix comme si crier sa souffrance pouvait la rendre plus supportable… Était-ce un effet pervers de la solitude, mais il réalisa que de plus en plus fréquemment dans cette confortable maison, dans ce qui fut pendant des années un cocon douillet devenu aujourd’hui froid et lugubre comme peut l’être un mausolée dans lequel trop de souvenirs vous emprisonnent, il s’adressait à lui-même croyant alors tromper le vide quasi cosmique qui imprégnait maintenant cet univers… Pervers oui, car voulant ainsi leurrer son désarroi, il ne recevait en réponse que l’écho de sa propre voix…
Il referma à nouveau le livre, se leva péniblement ; non parce que son corps ou encore ses muscles se montraient défaillants ; il se leva péniblement tout simplement parce qu’il quittait ce fauteuil sans destination exacte, ne sachant où aller ; la cuisine peut-être ? La chambre ? Mais quelle chambre ?
Plus jamais il n’était entré dans cette chambre, plus jamais il n’avait dormi dans ce lit désormais trop grand et trop froid, lit qui s’était fait le berceau de leurs étreintes ; cette chambre où l’âme maudite de Claire semblait aujourd’hui s’être emparée de tout… Parfois, il en entrouvrait simplement la porte, espérant la voir là, devant son armoire, hésitant entre un chemisier ou un pull léger, un manteau ou une veste, ou encore entre deux paires de bottes… Il espérait entendre sa voix lui demander un avis, un conseil ; mais rien ne venait et plusieurs fois dans le vide il avait lancé une réponse, s’excusant de ne pas savoir, lui disant que de toute façon et quoi qu’elle porte, elle serait toujours belle, elle serait toujours la plus belle. Seules s’échappaient alors par la porte entrebâillée les fragrances de son parfum, délicates senteurs épicées qui venaient cruellement le poignarder.
C’est finalement dans la cuisine qu’il s’échoua. Dans la cuisine, car malgré tout il fallait bien manger ou plus exactement avaler de quoi faire fonctionner son corps. Il ouvrit le réfrigérateur devenu lui aussi bien trop grand, n’en pouvant plus de contenir tout ce vide ; il attrapa quelques restes… Voilà qui serait bien suffisant pour aller jusqu’à demain… Il sentait en lui le besoin de partir, mais avait-il envie d’aller jusqu’à demain ?
Cela faisait deux heures qu’il ne dormait plus… Quelle heure pouvait-il être ? Peu importe ! Ces insomnies, autrefois simplement régulières, étaient maintenant devenues systématiques, systémiques, avait-il envie de dire ! « Elles font partie intégrante de ma nuit ; elles sont, elles font ma nuit… Comme si mon esprit avait peur, lui, de ne pas se réveiller au matin et que cette escale de deux ou trois heures au milieu de nulle part le rassurait ! ». Pour tenter d’effacer ces périodes de blanche obscurité qui irradiaient tout son être, il combattait comme il le pouvait à grand renfort de médications diverses, naturelles ou non, ou encore se fatiguait dans de longues marches forcées, par tous les temps ; mais aujourd’hui, il ne luttait plus, il avait compris : dormir, c’était mourir, juste pour quelques heures, et il aimait ça… Mais si lui attendait maintenant sans appréhension cette dernière échéance, il n’en était peut-être pas de même pour son esprit. Il ne s’étonnait donc plus que chaque nuit, un mot, une phrase lue ou encore une pensée viennent pendant quelques heures l’arracher à sa lente dérive.
La souffrance enfante les songes
Comme une ruche ses abeilles.
L’homme crie où son fer le ronge
Et sa plaie engendre un soleil
Plus beau que les anciens mensonges.
« L’homme crie où son fer le ronge et sa plaie engendre un soleil, plus beau que les anciens mensonges ». Cette nuit, ce sont justement ces vers d’un poème d’Aragon qui l’avaient tiré du sommeil et qui maintenant tournaient en boucle dans sa tête ; il récita plusieurs fois à haute voix la strophe complète, meublant ainsi le silence de la nuit, se disant que l’entendre, plutôt que l’intérioriser, l’aiderait à s’en imprégner… Sa plaie engendrerait-elle un soleil ?
Sa plaie ? Elle était bien réelle, non cicatrisée, purulente ; elle gangrenait sa vie et allait l’emporter… Son cri ? Il était sourd, mais si les digues qui le canalisaient s’effondraient, alors il déchirerait l’espace ; le temps et plus rien d’humain n’auraient de sens, comme il était écrit dans cet autre poème… Sa plaie guérirait-elle un jour ? Son cri se changerait-il en chant ? Oui, s’il en croyait le poète… Les ombres s’ensoleilleraient à nouveau, s’ensoleilleraient d’une nouvelle lumière, née de cette insupportable souffrance.
Et si sa tête, son esprit, son âme, il ne savait plus quel nom donner à cette chose qui le réveillait chaque nuit pour lui parler, si elle venait d’enfin lui ouvrir une porte vers un futur qui ne serait pas mort-né, vers un « après » qu’il pourrait désirer, dessiner et à nouveau emplir de projets ?
Pour cela, il fallait partir, quitter, fuir ce lieu, cette maison où tout était figé, cristallisé, embaumé… Il fallait engendrer, naître, renaître, vivre, revivre… Oui, pour cela il fallait impérativement partir, tout abandonner, tout lâcher, ne garder aucun fil, aucune corde, aucune chaîne… Il fallait entreprendre le voyage, aller jusqu’au bout de son âge afin d’avoir la réponse : où vais-je enfin arriver, moi le voyageur égaré ?
Partir donc… Tout abandonner, tout larguer, ne conserver aucun lien, aucune attache… Tout ? Absolument tout ? Était-ce seulement possible, au-delà de la simple volonté de le faire ? Il n’était pas vraiment seul ; il y avait les enfants et les petits-enfants qui jouaient à merveille leur rôle de bouée de sauvetage. Bien sûr, il les aimait ; bien sûr, il était reconnaissant pour tous les efforts qu’ils déployaient, jour après jour, pour l’empêcher de sombrer… Mais eux avaient leur vie et bientôt, petit à petit, lui n’en ferait plus partie ; il le sentait, mieux il le savait, tout simplement parce que c’était dans l’ordre naturel des choses. Et puisque lui avait maintenant du mal à vivre, ce n’était pas pour surnager dans cette espèce d’existence en trompe-l’œil, par procuration au travers de la vie de ses enfants… Il partirait donc, leur expliquerait pourquoi et ils comprendraient.
Partir et ne pas revenir ? Il ne l’envisageait pas vraiment, mais la vie venait de cruellement lui apprendre que l’on ne décidait pas tout, voire même pas grand-chose ; il devait donc se préparer « pour partir » sans oublier de se préparer « à partir », à mourir… s’évanouir, se diluer dans l’espace et le temps… Deux préparations différentes, mais complémentaires, la seconde n’étant là que pour étayer sa volonté de mener à bien la première.
Ce fut en fait la chose la plus facile ; deux rendez-vous, un avec le banquier, un autre chez le notaire pour partager et donner tout, absolument tout ce qui lui restait et déposer un testament. Seuls subsisteraient un compte bancaire, une retraite, une carte de paiement… Devant le magistrat qui s’étonnait : « À votre âge, il n’est pas prudent de s’appauvrir de la sorte ! », il répondit, sur un demi-sourire, qu’il voulait retrouver la légèreté et l’insouciance de ses jeunes années, se défaire de toutes les adhérences matérielles qui l’alourdissaient inutilement… Mais au fond de lui, il pensait surtout que pouvoir donner, et le faire était la première des richesses…
Préparer son périple enfin ; comment procéder ? Il n’avait jamais vraiment réfléchi à cela, tout au plus s’était-il poliment intéressé, il y a quelques années, aux préparatifs menés par une amie de Claire partant sur le chemin de Compostelle… Tout d’abord, où aller ? Il trouva facilement la réponse, se disant que la destination importait peu ; seul comptait le départ, l’envol… Sans grande originalité, il décida que ce serait un tour de France ; peut-être inconsciemment se souvenait-il des promesses de voyages qu’ils se faisaient, Claire et lui…
Il partirait à pied et ferait un tour de France, c’était décidé ! Pendant quelques jours, à l’aide d’un atlas routier, il construisit des étapes ; combien d’heures par jour peut-on marcher quand on envisage de durer et durer encore ? Quatre ? Cinq ou plus ? À quelle vitesse marcher ? Et donc, quelle distance journalière parcourir ? Vingt kilomètres ? Trente ? Puis vinrent les questions plus matérielles : où dormir, se laver, se raser, où laver son linge ?
Il se rendit rapidement compte qu’il faisait fausse route ; se préparer ainsi allait à l’encontre de ce qui forgeait sa démarche. Préparer minutieusement ce voyage, étape après étape, jour après jour, était certes très cohérent avec tout ce qu’il avait été autrefois dans sa vie professionnelle, faite de prévisions et d’anticipation… Et soudain, alors qu’il se demandait : dans quel sens faire ce tour de France ? Quand partir pour n’être, l’hiver prochain, ni dans les Alpes ni dans les Pyrénées ? il repensa à la fin de ce vers : « plus beau que les anciens mensonges ». Ils étaient bien là, sous ses yeux, les anciens mensonges, essayant subrepticement de reprendre possession de sa vie en lui laissant croire à nouveau que tout était prévisible, quantifiable, anticipable… Mensonges, oui, mensonges !
Il partirait donc sans ne rien préparer, s’offrant à l’aventure… Un simple billet de train lui permettrait de s’éloigner suffisamment afin de ne pas avoir la tentation de rebrousser chemin dès les premiers jours… Il ouvrit au hasard l’atlas routier et pointa un lieu du doigt : c’est donc de là qu’il partirait.
Signalant son arrivée par un puissant coup de klaxon se mêlant aux stridents grincements de ses freins, le train entra en gare. Son doigt s’étant posé sur un village du Massif Central oublié par le chemin de fer au siècle dernier, il devait transiter par la gare la plus proche puis emprunter un car qui l’amènerait très exactement au lieu que le sort avait désigné. Lentement, comme imprégné par l’étrange solennité de l’instant, il se saisit de son sac de montagne et descendit sur le quai, avec l’air un peu hagard de ceux qui débarquent en terre inconnue et cherchent le panneau « Sortie ». L’apercevant au bout du quai, il pensa que ce panneau indiquait plutôt pour lui « Entrée », l’entrée dans une nouvelle séquence de sa vie, peut-être la dernière.
Contrairement à ce qu’il avait imaginé, le premier départ ne s’était pas déroulé sans heurts. Il n’avait pas pu ou pas su expliquer à son fils les raisons profondes qui motivaient son geste. Il avait compris sa légitime inquiétude et avait tenté de l’apaiser ; oui, bien sûr, je vais revenir, non je ne suis pas gravement malade, oui vous allez me tous manquer… Lui qui souhaitait partir dans le plus total dénuement, lui qui voulait essayer de se débarrasser de tout ce qui lui collait à la peau, de toutes ces choses qui l’alourdissaient, dut tout de même transiger sur un point.
— Pars au moins avec un téléphone ! lui avait demandé son fils.
— Et où vais-je le recharger, ce téléphone ? avait-il répondu avec une évidente mauvaise foi, s’attendant bien sûr à la réponse qui ne pouvait que fuser.
— Tu le rechargeras là où tu vas te laver, dormir, manger, bien sûr ! Puisque tout cela ne t’inquiète pas, ce n’est quand même pas la recharge d’un téléphone qui va t’arrêter ? Et puis tiens, je t’installe l’application qui te permettra d’avoir toutes les cartes de randonnée de l’IGN, parce que, même quand on part sans but précis, c’est quand même pas mal de savoir où l’on va, non ?
Il avait donc cédé et descendant maintenant du car, il réalisait combien son fils avait eu raison ; sachant qu’il ne pourrait le dissuader d’entreprendre ce voyage, il avait fait en sorte d’accompagner à minima sa préparation et avait obtenu qu’il garde ce fil d’Ariane. Planté là sur la place de ce petit village, il devait enfin faire ce qu’il s’était refusé à faire jusque-là : décider d’une direction à prendre, d’un premier but à atteindre, d’une route à suivre.
Partir au hasard était ce qu’il souhaitait, ce afin de s’abandonner totalement aux aléas du destin ; mais comment être sûr de ne pas s’engager sur un chemin sans issue, comment être sûr de ne pas faire fausse route et de ne pas se décourager, à peine l’aventure entamée ? Une nouvelle fois, il transigea ; il était parti certes, mais il devait se fixer un but et conforta cette décision en se disant que cela lui éviterait certainement de s’épuiser en s’égarant, ce qui ne pourrait l’amener qu’à renoncer… Et renoncer, il n’en était tout simplement pas question.
« Les années heureuses de mon enfance ! » pensa-t-il soudainement ; il fut surpris par la rapidité avec laquelle il venait de forger cette décision et se dit que son subconscient avait dû travailler pour lui depuis quelque temps déjà. La place du village lui offrit un banc sur lequel il s’installa. Il sortit le téléphone qu’il avait pris soin de recharger dans le train ; puisqu’il n’était vraiment pas féru de nouvelles technologies, son fils lui avait fait faire des « exercices » afin de le familiariser avec l’application cartographique qui lui permettrait de se déplacer en toute sécurité et sans se perdre.
Sur le banc, un pépé semblant sorti d’une carte postale aux teintes sépia profitait des rayons du soleil, les deux mains appuyées devant lui sur une canne. En s’asseyant à ses côtés, il l’avait gratifié d’un très protocolaire « Bonjour monsieur », auquel l’ancien avait répondu par un hochement de tête suivi d’un geste furtif mimant le retrait de sa casquette. Puis, alors qu’il triturait maladroitement son smartphone pour essayer de se localiser, celui qui devait être le doyen de ce village entreprit la conversation.
Un peu surpris, il mit quelques secondes à réagir, puis mesura le manque de bienveillance qu’il y aurait eu à répondre de mauvaise grâce à cet homme qui ainsi l’accueillait.
Vincent imagina aussitôt une jeune femme, vêtue à la mode « Woodstock – Mai 1968 » faisant brûler des herbes et autres substances illicites tout en prononçant des incantations ésotériques pour soigner les vieux du village les nuits de pleine lune… Mais une jeune femme ayant déjà un fils prêtre ?
Un instant de silence se fit et curieusement sembla étouffer le village tout entier… Il n’y eut plus un bruissement dans les quelques platanes de la place, plus un chant d’oiseaux, même plus un de ces familiers bruits domestiques qui profitent de la douceur et des fenêtres entrebâillées pour participer à la symphonie de la vie du village. Après avoir évoqué la porte de l’église, Marcel s’était tu et le village, semblant l’accompagner, s’était figé. Vincent, qui jusqu’à présent était assis à ses côtés et l’écoutait sans vraiment le regarder, tourna la tête vers le vieil homme et plongea son regard dans le sien.
Marcel soutint ce regard, puis pris d’un frisson malgré les rayons du soleil qui dardaient dans son dos, posa sa canne et remonta sa veste sur les épaules… Après quelques secondes, un souffle léger bruissa dans les feuillages, les oiseaux recommencèrent à chanter et par les fenêtres ouvertes, la vie des maisons s’invita à nouveau sur la place.
Et comme pour donner de l’élan à Vincent, d’un ample balancement de canne, Marcel indiqua la route qui sortait du village, prenant effectivement un cap au Sud, comme la position du soleil en ce milieu d’après-midi pouvait l’attester.
Vincent était sur le point de se lever quand un sifflement commença à se faire entendre, devenant de plus en plus strident et rauque en se rapprochant du village.
Le ciel fut alors littéralement déchiré par le passage de deux avions de combat évoluant à très basse vitesse et à basse hauteur au-dessus du bourg. Les deux appareils tenaient une impeccable formation assez serrée et à la surprise de Vincent, à l’instant même où ils survolaient la place, ils engagèrent deux tonneaux lents successifs, tout en restant parfaitement synchronisés. Puis le tonnerre s’abattit sur les habitations lorsqu’à l’arrière de chaque avion, tel un dard, une flamme apparut ; toujours en formation, les deux machines pointèrent alors droit vers le ciel et effectuant un retournement, repartirent dans la direction qui les avait vus fondre sur le village quelques secondes auparavant… Vincent tenta de les suivre des yeux le plus longtemps possible, mais rapidement les deux chasseurs se réfugièrent dans le soleil.
Le silence enveloppa à nouveau le village et ce qui surprit le plus Vincent fut la réaction de Marcel ; alors qu’il s’attendait à entendre maugréer le pépé, il le vit se dresser comme mu par un ressort et agiter sa canne pour saluer la patrouille qui n’était déjà plus que deux minuscules points noirs se diluant dans la lumière.
Il n’en dit pas plus et Vincent comprit aisément que Marcel était resté volontairement silencieux, espérant les questions. Par égard pour celui qui l’avait accueilli dans le village, Vincent décida de consacrer encore quelques minutes à discuter… Après tout, ne s’était-il pas lancé dans cette aventure pour faire des rencontres, pour changer d’horizon ? Comment pourrait-il sérieusement le faire s’il refusait d’emblée les mains tendues ?
Pris dans le feu de l’action, Marcel refaisait les gestes qui lui avaient permis de réussir ce périlleux décollage… Vincent le regardait, maintenant quasiment ému aux larmes.
Vincent sentit qu’instantanément, l’excitation de Marcel venait de se transformer en l’expression d’une douleur si intense, que personne ne pourrait jamais l’apaiser.
Bizarrement, Vincent eut l’impression que planait à nouveau un silence de mort sur le village. Il posa sa main sur l’épaule de Marcel.
Marcel arrêta son récit, comme pour reprendre son souffle, mais Vincent sentit que pour cette dernière phrase, le son de sa voix venait de se moduler vers un ton plus mélancolique.
Le vieux pilote et son cadet d’au moins quarante ans restèrent encore silencieux de longues minutes assis sur le banc, regardant en l’air… L’air… L’air pur, cet azur aujourd’hui magnifiquement ensoleillé où ils avaient autrefois abandonné, contre leur réelle volonté, une partie de leur âme aux ténèbres humaines.
Vincent se leva et renfila son impressionnant sac. Marcel, par son geste vers la casquette, lui adressa ce qui se voulait être un au revoir.
Après Marcel, Mathilde fut la deuxième personne à pouvoir prétendre au statut de témoin ; elle prenait le soleil sur le pas de sa porte, assise sur une chaise en paille et profitait de la douceur baignant ce premier après-midi d’octobre. Le visage abrité par un large et élégant chapeau de paille décoré d’un ruban rose enserrant quelques discrètes fleurs séchées, elle lisait. À ses pieds un chien était lové, le museau confortablement calé sur deux larges pattes mollement croisées. Il émettait régulièrement de légers grognements, les accompagnant de vifs soubresauts des oreilles, destinés à chasser une mouche plus coriace que les autres l’empêchant de profiter pleinement de la surprenante tiédeur de l’instant.
En y regardant de plus près, l’observateur avisé aurait pu remarquer une anomalie dans le pelage brun clair de l’animal ; une touffe de poils se désolidarisa soudain du coussin protecteur formé par l’abdomen canin. Comme si elles cherchaient à jouer avec les rayons du soleil, quatre nouvelles pattes surgirent puis s’étirèrent et d’un bond, un chat blanc et noir s’enfuit vers le potager, sautillant à la poursuite d’un papillon. Trois poules, étrangères à cette brusque agitation, continuèrent à picorer mécaniquement, telles des machines mues par des ressorts que l’on aurait remontés à bloc quelques instants plus tôt. Mathilde abandonna sa lecture, autant pour observer la scène que pour s’obliger à relever régulièrement la tête ; malgré la générosité de l’astre du jour, les premiers froids s’emparant sournoisement des aubes et des crépuscules réveillaient chez elle des douleurs qui elles aussi, s’installaient sans prévenir.
Tournant la tête à droite puis à gauche, Mathilde aperçut un homme marchant en direction de la maison ; voir passer des randonneurs faisait partie de son quotidien, mais celui qu’elle vit arriver au bout de la route qui sortait du village ne ressemblait pas vraiment à ceux qu’elle avait coutume d’observer.
« En voilà un qui débute son périple ! » fut la première chose qui lui vint à l’esprit en voyant se rapprocher d’elle cet homme plutôt grand, apparemment dans la soixantaine, proprement vêtu, bien rasé à ce qu’elle put en juger et avançant d’un pas dynamique et décidé, malgré le poids apparent d’un sac de montagne d’un volume conséquent.
Comme à l’accoutumée, ce randonneur ne ferait pas différent des autres ; il ralentirait à sa hauteur, peut-être même s’arrêterait-il pour lui adresser un « bonjour ! » très cordial. Certains engageaient la conversation, et Mathilde, posant alors son livre, ne se dérobait jamais ; il s’agissait le plus souvent pour ces voyageurs de se faire confirmer leur route, ce à quoi Mathilde répondait qu’ils s’étaient très certainement fourvoyés : le chemin de Saint-Jacques traversait effectivement le village, mais une patte d’oie mal balisée à la sortie du bourg induisait régulièrement en erreur les marcheurs peu attentifs. Certains lui demandaient la possibilité de remplir une gourde ou même parfois, voyant les poules, de lui acheter des œufs. D’autres s’attardaient un peu plus, manifestement captivés par le magnétisme qui émanait du regard bleu de cette surprenante fermière, plutôt vêtue dans un style « chic et sport » et ressemblant de fait plus à l’épouse d’un « gentleman farmer » qu’à une habitante d’un village oublié au fin fond du Massif Central.
Enfin il arrivait, deux ou trois fois par an, que quelques-uns cherchent à s’attarder vraiment, tentant de pousser l’aventure jusqu’à essayer de s’en offrir une en compagnie de cette femme dont l’apparence ne pouvait laisser indifférent ; Mathilde était fine, de taille moyenne sans être petite et les longs et lumineux cheveux poivre et sel qu’elle laissait savamment retomber sur ses épaules rendaient illusoire toute tentative de lui donner un âge. De belles rides d’expression renforçaient le mystère qui émanait à la fois de la profondeur son regard et de l’imperceptible sourire qui éclairait son visage. Flattée et amusée, elle s’étonnait toujours qu’à bientôt soixante ans, des hommes parfois bien plus jeunes qu’elle, tentent encore de la séduire…
Mais celui qui passait devant elle cette fois-ci ne sacrifia pas à ce rituel ; au début de son voyage, il l’était assurément comme le trahissait la propreté de ses vêtements de randonnée… De plus, il était manifestement « très frais » comme le trahissait là encore l’impression de grande aisance qui se dégageait de sa démarche… Ceux qu’elle avait l’habitude de voir passer étaient généralement déjà bien affaissés sous le poids du sac et leurs foulées étaient déjà bien érodées par les nombreux kilomètres enjambés. L’homme passa devant elle sans ralentir et, se détournant à peine, lui adressa par un mouvement de tête très furtif, un signe qui voulait certainement dire « bonjour »…
« Il a la tête au moins aussi lourde que son sac ! » fut la pensée suivante qui germa dans l’esprit de Mathilde ; non qu’elle ait voulu dire par là qu’elle trouvait l’homme fier, mais le peu qu’elle avait vu dans les traits de son visage l’avait convaincue qu’il ne marchait pas uniquement pour son plaisir…
L’automne n’en était qu’à ses premiers jours et les rayons du soleil dessinaient encore sur le sol de belles et franches ombres… Mais celles qui obscurcissaient l’expression du regard de cet homme ne pouvaient être l’œuvre du soleil. « Ce sont les ombres de la nuit ! » pensa Mathilde, qui fut aussitôt parcourue d’un frisson qui l’obligea à poser son livre pour remonter un châle de laine sur ses épaules. Du regard elle suivit cet inconnu jusqu’à ce qu’il disparaisse, avalé par le virage suivant, dans lequel la route se diluait lentement en chemin vicinal puis en sentier forestier… Le soleil se fit alors plus chaud et se défaisant de son châle, elle reprit la lecture, tout en se demandant ce que cet homme pouvait bien porter de si lourd.
Mathilde sursauta. Toujours à se questionner au sujet de ce randonneur pas comme les autres, et malgré tout absorbée par sa lecture, elle ne l’avait pas vu réapparaître. Il avait fait demi-tour et se tenait maintenant là devant elle, dans le soleil et d’une façon telle, qu’éblouie, elle avait du mal à le distinguer nettement ; l’homme s’en aperçut et élégamment, se décala légèrement afin que son ombre vienne la protéger.
Et sans lui laisser le temps de répondre, il enchaîna.
Mathilde fut rassurée : il allait finalement, comme les autres, lui demander de l’eau, voire lui acheter de quoi manger, ce à quoi elle répondrait en lui offrant des œufs.
Plongeant la main dans la profonde poche latérale de son pantalon de randonnée, l’homme lui tendit un porte-clés assez lourd et de belle facture ; un « V », une initiale certainement, supportait un trousseau de quatre clés.
Elle hésita quelques secondes, jaugeant cette situation plus qu’inhabituelle et à laquelle elle ne s’était pas préparée. Que voulait exactement cet homme ? Était-ce là un nouveau stratagème pour se rapprocher d’elle ? Puis elle se souvint qu’à son premier passage, ce curieux randonneur avait à peine détourné le regard pour la saluer ! Ce n’était donc pas le remords d’être peut-être passé à côté d’une aventure qui l’avait conduit à rebrousser chemin. Elle choisit alors de manier un brin d’humour pour se protéger et tenter d’en savoir un peu plus.
Mathilde avait effectivement prononcé ces mots sur le ton de la douce plaisanterie, se disant que ce randonneur, vraiment pas comme les autres, devait être parti pour quelques jours, tout au plus. C’était aussi un moyen de le prévenir que malgré les apparences, elle n’avait plus l’âge des fougueuses aventures amoureuses.
Une nouvelle fois, Mathilde resta sans voix. Il émanait une réelle sincérité de l’expression de cet homme ; elle décida qu’il fallait maintenant avoir une conversation qui soit moins à fleurets mouchetés.
Un long silence s’installa. Mathilde n’arrivait pas à se décider ; elle avait envie d’aider cet homme, ce randonneur si différent, mais l’échéance d’un an lui semblait être une éternité à laquelle elle ne se sentait pas en mesure de se confronter.
Cette dernière phrase de Mathilde fit prendre conscience à Vincent qu’il venait d’être indélicat… Depuis le début de leur conversation, il était comme gêné par l’incapacité qu’il avait à donner un âge à la femme assise devant lui. La soixantaine, comme lui ? Mais peut-être cinquante-cinq ans, pensa-t-il… Voire même moins ! Mais pourquoi alors aurait-elle dit que voir le temps prendre son temps ne la dérangeait pas, bien au contraire ? Il repensa à ce vers d’Aragon, « Mettre des bottes de sept lieues en se disant que rien ne presse, voilà ce que c’est qu’être vieux », et d’autorité lui mit le porte-clés dans la main qu’il serra doucement.
Il plongea alors profondément son regard dans celui de Mathilde ; elle se sentit instantanément hypnotisée et pendant une fraction de seconde, fut prise d’une étrange sensation de vertige… Elle eut littéralement l’impression que cet homme aspirait sa vie, ses souvenirs, son âme, comme un buvard absorbe une tache d’encre… Puis il se détourna et sans autre cérémonial, se prépara à reprendre son chemin en remettant sur ses épaules le sac dont il s’était délesté, le temps de leur conversation.
Elle restait pétrifiée, comme sidérée par l’intensité émotionnelle de ce qu’elle venait de vivre, sans vraiment le réaliser. Hébétée, elle fixait sa main ouverte dans laquelle reposait le pesant trousseau. Il comportait quatre clés, et discrètement mêlé dans cet amas métallique, un anneau d’or assez épais lui renvoya furtivement l’éclat du soleil.
Sans vraiment le réaliser, Mathilde avait porté le bijou à hauteur de ses yeux et lut l’inscription qui figurait gravée à l’intérieur : « Claire mon soleil ». Prenant conscience de son manque de discrétion, elle reposa rapidement le trousseau.
Elle se ressaisit et décida cette fois-ci qu’elle allait retenir cet étrange voyageur, qui n’était certainement pas arrivé jusque-là pour la simple beauté des paysages automnaux du Massif Central.
Elle se rendit compte qu’elle venait, sans y avoir réfléchi, d’utiliser son prénom… Mais après tout, lui qui était certainement plus jeune qu’elle, s’était bien autorisé à l’appeler Mathilde à plusieurs reprises et sans qu’elle lui en eut donné son accord ! Finissant d’ajuster les réglages des bretelles de son sac, il répondit sur un ton qui voulait laisser transparaître une volonté affirmée :
Mais Mathilde sentit que cela ne sonnait pas tout à fait juste et vit immédiatement l’occasion, en utilisant cette destination plutôt lointaine, d’entamer enfin une réelle conversation.
Malgré cette réponse bravache, Vincent, l’air dubitatif, ressortit le smartphone de sa poche et consulta la carte dont il dilata l’échelle. Il restait muet.
Vincent était toujours figé, tournant et retournant son téléphone dans tous les sens, comme s’il espérait en faire sortir quelque chose… Mais la carte avec laquelle il avait, tout à l’heure dans le car, préparé sa première étape, lui indiquait toujours au départ du village un chemin vicinal plutôt facile à suivre et non un sentier version « Petit Poucet », destiné à le perdre dans la forêt ; son épopée débutait mal… Quant à la pluie, il n’y avait tout simplement pas pensé, restant une nouvelle fois paresseusement figé sur le magnifique soleil qui inondait le paysage depuis ce début de journée. Mais effectivement, un voile de nuages d’altitude ternissait depuis quelques minutes cette chaleureuse et trompeuse ambiance estivale.
Vincent secoua légèrement la tête pour faire comprendre qu’il avait bien compris l’invitation déguisée à ne pas entreprendre aujourd’hui sa randonnée. Il fixa une dernière fois Mathilde droit dans les yeux ; cela faisait bien longtemps qu’il ne s’était pas trouvé en situation de plonger son regard d’une façon si intense dans celui d’une femme…
Mais puisqu’il venait d’enfin réussir à se défaire des puissants aimants que représentaient ses clés, ce n’était pas pour se faire capturer par le magnétisme qui émanait de Mathilde. Dans un dernier et sincère « Merci », il pivota et reprit sa marche d’un bon pas ; quelques secondes plus tard, il était de nouveau happé par la forêt.
Livre premier
Me revoici, moi, celui que plus aucune lumière ne touche… Quand la chaleur des flammes se sera évanouie, seule restera la poussière de mes cendres.
Assise au soleil devant sa maison, sa ferme comme elle aimait à le dire, Mathilde profitait de la douceur de cette fin d’après-midi d’octobre, achevant sa lecture ; mais rapidement, le soleil fut effacé par un amoncellement de nuages bien décidés à faire comprendre à tous que l’automne venait réclamer son dû.
Elle posa son livre en accent circonflexe sur la petite table métallique et dressant la tête comme pour s’étirer, fixa le ciel qui s’assombrissait. Elle ne s’était pas trompée ; le vent de Sud qui soufflait depuis le matin allait apporter le premier épisode pluvieux de la saison. Elle repensa à cet étrange randonneur qui était passé devant chez elle puis avait rebroussé chemin pour lui confier, sans en dire plus, les clés de sa maison.
Combien de temps leur conversation avait-elle duré ? Dix minutes, quinze ? Plus elle y repensait maintenant, moins elle comprenait d’où pouvait provenir l’intensité du moment vécu avec cet homme, « avec Vincent » se surprit-elle à dire à voix basse… Elle déroula à nouveau le fil des évènements et se dit que finalement, leurs échanges n’avaient dû durer plus de trois à quatre minutes… Un si court laps de temps qui avait pourtant suffi pour qu’elle accepte de se faire gardienne des clés de la maison d’un parfait inconnu et qui de plus, l’avait vue tenter d’une façon à peine voilée de le dissuader d’entreprendre son périple… Revivant cet étrange épisode qui l’avait tout de même bousculée, elle éprouvait une sensation de mal être, se demandant ce que ce randonneur, ce que ce Vincent dont elle ignorait tout, pouvait maintenant penser d’elle.
Non, elle n’avait pas rêvé, ne s’était pas endormie en se laissant bercer par les douces vagues d’air tiède que le vent faisait onduler dans les feuillages, déclenchant ainsi de courtes averses dorées… Toga, son bon gros gardien débonnaire couché à ses pieds n’avait pas bougé, stoïque et toujours titillé par cette même mouche ; son chat Pluche avait rejoint son abri préféré et les poules n’avaient pas arrêté un seul instant la mécanique de leur danse saccadée… Ce moment avait-il seulement existé ? Sur la table en fer forgé à côté d’elle, il y avait bien là sa théière et sa tasse, son livre posé à l’envers… et un « V » argenté soutenant un trousseau de quatre clés.
Elle se leva et rentra dans la ferme, repoussant le lourd battant qu’elle avait laissé entrouvert afin que, narguant l’épaisseur des murs, un peu de chaleur pénètre la bâtisse. Dociles, Toga et Pluche l’accompagnèrent, laissant le pas de porte sous la surveillance des caqueteuses… Mathilde se dirigea vers l’unique bahut qui meublait la pièce principale ; sur une étagère, elle prit un pot de porcelaine, en souleva le couvercle pour en sortir une clé qui lui permit, après avoir marqué un temps d’hésitation, d’ouvrir un tiroir qu’elle dégagea complètement du meuble.
Elle s’assit à la grande et massive table de ferme et, toujours hésitante, renversa le contenu ; s’étalèrent alors sous ses yeux les versos jaunis de photographies ainsi que des enveloppes défraîchies… Puis dans un long soupir, marquant de la tête un imperceptible signe de dénégation, elle entreprit de ranger dans le tiroir tout ce qui étayait l’univers de ses souvenirs… Une à une, elle retourna les photos, prenant à chaque fois jusqu’à plusieurs minutes pour les contempler avant de les reposer. Elle rouvrit également les lettres, non sans avoir pris au préalable le temps d’en observer le cachet porté sur le timbre. Parfois les lieux et les dates qui fusaient sous ses yeux lui arrachaient un léger sourire baigné de mélancolie ; elle dépliait alors la feuille, relisait puis manifestement emportée par une puissante vague d’émotion, repliait la missive et la rangeait délicatement.
Elle resta par contre figée à deux reprises, gardant en main les enveloppes qu’elle ne put ouvrir. Elle les reposa directement dans le tiroir, sa main se portant ensuite immédiatement à ses yeux pour en effacer des larmes naissantes… Les photographies mélangées devant elle lui arrachèrent le même comportement, fait de sourires à peine dessinés ou de larmes péniblement contenues… Elle garda la dernière bien plus longtemps devant les yeux, ne cherchant pas cette fois-ci à réfréner une mélancolie qui se fit tristesse et sanglots étouffés, vibrants dans l’immensité de la pièce maintenant froide qui ne lui renvoya aucun écho… Depuis combien de temps était-elle là, telle une funambule en équilibre précaire au-dessus du gouffre de ce lointain passé ? Dehors, il faisait nuit et sur les fenêtres de lourdes gouttes venaient s’écraser, tambourinant violemment… La pluie, le déluge arrivait avec force comme pour laver son esprit de toutes ses pensées délétères.
Dans le tiroir, elle masqua l’image de cette dernière photographie en la reposant sur l’envers et acheva le rangement en glissant le « V » et ses clés dans une enveloppe sur laquelle elle inscrivit : « Domicile de Vincent Deniel à Manosque – 01/10/2022 ».
Voilà, c’était fait et Vincent se sentait maintenant vraiment plus léger ; ces clés dans la poche, ce lourd trousseau qui à chaque pas tapait contre sa cuisse, étaient un frein permanent. Au travers d’elles, il ressentait l’emprise d’un aimant déployant tous les tentacules de son flux puissant pour le ramener brutalement chez lui… Mais ainsi il n’y avait plus de « chez lui », ou plus exactement ce « chez lui » était maintenant partout, là dans ce champ, ici dans cette forêt, le long de ce sentier ou encore au bord de cette rivière.
Mathilde ne lui avait pas menti ; d’ailleurs, pourquoi l’aurait-elle fait ? Pourquoi aurait-elle tenté de le dissuader d’entreprendre son périple, du moins aujourd’hui et par ce chemin ? Il gardait tout de même une étrange sensation de malaise après ce bref échange avec cette femme… Il se rejouait la scène en marchant, se disant qu’il avait été directif, tranchant, très sûr de lui, presqu’arrogant, comme s’il avait inconsciemment senti l’impérieuse nécessité de se protéger, de s’éloigner de ce regard qui était sur le point de l’envoûter, quelques minutes à peine après l’avoir croisé… Pour lutter encore et toujours, malgré une douleur qui lui compressa alors la poitrine, il chercha à fixer dans sa mémoire le beau visage de Claire, mais se rendit compte que, les jours passant, cette image devenait de plus en plus floue…
Il y a quelques heures, alors qu’il s’approchait de la maison de Mathilde, il avait immédiatement vu ce qui dénotait étrangement dans cet idyllique tableau rural ; des poules, un chien, un chat bondissant à la poursuite d’un papillon virevoltant vers le jardin potager jouxtant la lourde bâtisse qui autrefois devait être une ferme… Et assise sur une chaise, protégeant avec une rare élégance son visage du soleil, la fermière lisait ! Oui, elle lisait ! Elle n’écossait pas ses petit-pois, n’épluchait pas plus ses légumes pour faire une soupe… Vêtue d’un pantalon jean plutôt moulant, d’un pull-over léger et d’un châle finement tricoté, elle ne correspondait pas vraiment à l’idée que l’on aurait pu se faire de la maîtresse des lieux. Passant devant elle, Vincent avait donc à peine détourné le regard pour lui adresser une furtive et minimale salutation ; juste le temps pour lui de se faire électriser par le regard de celle qui lisait sans lunettes, juste le temps également de reconnaître la couverture du livre qu’elle tenait en main.
« Le paradoxe du verrou »… Il connaissait parfaitement cet ouvrage, édité il y avait maintenant environ deux ans par une entreprise d’auto-édition ; le livre avait fait son petit bonhomme de chemin via le site internet de l’entreprise, via les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille. Quelle était donc l’âme de ce livre, de cet ouvrage sans prétention aucune qui avait pourtant interpelé tant de lecteurs ? Un thème qui était cher à Vincent : les choix de vie, nos choix de vie et les conséquences qu’ils ont sur nous, notre entourage proche et moins proche, c’est-à-dire tout simplement « les autres ». Dans quelle mesure suis-je réellement maître de mon destin ? Telle était la question qui sous-tendait son existence, question qui avait pris une trop douloureuse tonalité depuis le départ de Claire… Pourquoi l’avait-elle trahi d’une si abominable façon ? Quelle ombre cette trahison allait-elle encore jeter sur sa vie ? Et si finalement cette forfaiture le plongeait en pleine lumière ?
« Si tu penses trop, marche… », et Vincent marchait, avançait dans la forêt, repensant à Claire, repensant à ce livre et repensant à Mathilde qui lisait… ce livre qu’il avait écrit…