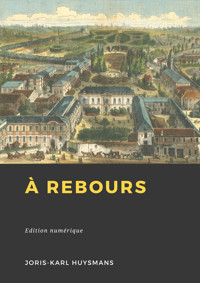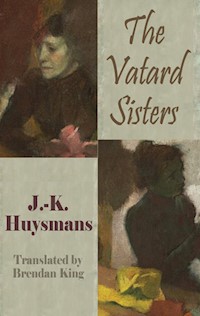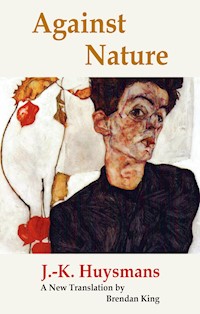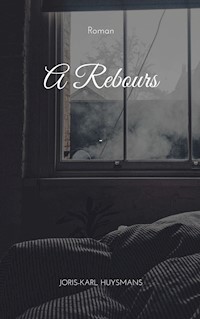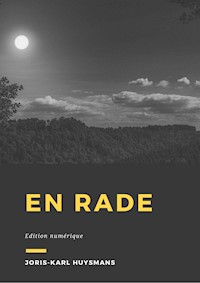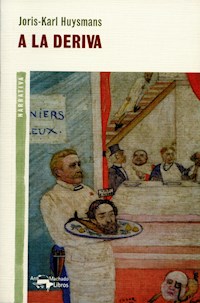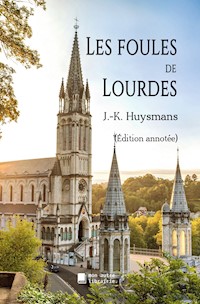
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Ce n'est pas la première fois que Huysmans, catholique convaincu, demeure à Lourdes, et il en connaît tous les recoins. L'époque des apparitions n'est pas si lointaine. Lourdes en est encore à s'organiser, et les visiteurs ont accès à tous les lieux aujourd'hui réservés aux malades et aux soignants. Il peut donc nous livrer une description fouillée, quasiment exhaustive, de cette énorme machinerie dévotionnelle, source inépuisable de stupeur et d'émerveillement. (Édition annotée)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les foules
de Lourdes
Joris-Karl Huysmans
Édition annotée
Fait par Mon Autre Librairie
À partir de l’édition Stock, Paris, 1906.
À l’exception de la note n° 39 qui est de l’auteur, toutes les notes ont été ajoutées pour la présente édition.
https://monautrelibrairie.com
__________
© 2021, Mon Autre Librairie
ISBN : 978-2-38371-004-2
Table des matières
Introduction
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Et secutæ sunt eum turbæ et curavit eos, ibi.
Mathieu XIX, 2.
Introduction
Mon intention n’est pas de narrer, par le menu, l’histoire de Bernadette et de Lourdes. Des centaines de volumes ont paru qui la racontent ; elle est, on peut le dire, rabâchée par les écrivains de tous les camps, efflanquée par les redites. Je veux simplement, pour aider à la compréhension des croquis et des notes dont se compose ce livre, rappeler brièvement les apparitions de la Vierge dans la grotte de Massabielle, située sur les bords de la rivière du Gave, au couchant de Lourdes.
En l’an 1858, la Vierge apparut dix-huit fois – du jeudi Il février au vendredi 16 juillet – dans cette grotte, à une petite fille de quatorze ans, l’aînée des six enfants du meunier François Soubirous, à Bernadette.
Bernadette la vit, en une sorte de buée lumineuse, debout, dans une crevasse, en forme d’ogive, ouverte dans le haut du roc ; elle avait l’apparence d’une jeune fille de seize ou dix-sept ans, de taille moyenne, plutôt petite, très jolie, avec une voix douce et des yeux bleus. Elle était vêtue d’une robe blanche serrée à la ceinture par une écharpe bleu de ciel qui tombait en deux pans jusqu’aux pieds nus, coupés à la naissance des doigts par le bas de la robe ; et ces doigts étaient fleuris d’une rose jaune, tout en feu. La tête était couverte d’un voile et les mains tenaient un chapelet dont les grains blancs étaient enfilés dans une chaînette d’or.
En ses diverses apparitions, Elle s’exprima dans le patois de Lourdes et dit à l’enfant :
– Voulez-vous me faire la grâce de venir, ici, pendant quinze jours ? Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l’autre ; je désire qu’il vienne du monde. – Vous prierez Dieu pour les pécheurs. – Pénitence, pénitence, pénitence ! – Vous irez dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle. – Je veux qu’on y vienne en procession. – Allez boire à la fontaine et vous y laver. Allez manger de l’herbe que vous trouverez là. – Je suis l’Immaculée Conception, je désire une chapelle, ici.
Elle révéla, en outre, à Bernadette, une formule spéciale de prière, et trois secrets personnels qui ne furent jamais divulgués.
Ajoutons que la Vierge n’a pas créé, au moment où Elle parlait, cette source qui fuse de la grotte ; elle existait depuis longtemps, mais était invisible et coulait, sans que personne le sût, sous les sables, avant que d’aller se perdre sans doute dans le cours du Gave. La Vierge s’est donc bornée à désigner l’endroit à la petite qui, sur ses indications, gratta le sol et l’en fit jaillir.
Cette source qui, lorsqu’elle s’élança de terre, n’était qu’un filet d’eau de la grosseur d’un doigt, débite actuellement, et sans jamais tarir, 122.000 litres par 24 heures.
Elle est devenue célèbre par les guérisons auxquelles elle sert de véhicule.
Quant à Bernadette, après avoir subi les épreuves de toutes sortes que lui infligèrent les autorités ecclésiastiques et civiles, elle entra, une fois sa mission terminée, à l’âge de vingt-deux ans, au couvent de Saint-Gildard, chez les sœurs de la Charité à Nevers. Elle y prit le voile sous le nom de sœur Marie Bernard et y mourut, très pieusement, le 16 avril 1879, âgée de 35 ans 3 mois et 9 jours.
I.
Les apparitions de la Sainte Vierge à notre époque n’ont rien qui puisse surprendre ; Lourdes n’est, dans l’histoire de la France, ni une exception, ni une nouveauté ; toujours la Mère du Christ a considéré ce pays comme son fief. En aucun temps, sauf au XVIIIe siècle, Elle ne l’a déshérité de l’aubaine continue de sa présence ; mais si l’on songe à l’effrayante bassesse des Bourbons et à l’inexorable infamie des Jacobins, cet abandon s’explique.
Il fallut même attendre la fin de la première moitié du XIXe siècle pour la voir réapparaître aux âmes privilégiées, dans certains coins réservés de ses domaines.
La dernière de ses apparitions qui ne puisse faire de doute, celle de Lourdes, n’est donc qu’un succédané de manifestations plus anciennes ; il me semble dès lors curieux d’en préciser les antécédents.
Ils dérivent de deux sources :
L’une, purement régionale, l’autre parisienne.
Les précédents de Lourdes dans la région des Pyrénées sont nombreux. Si l’on prenait une carte des diocèses de Bayonne et de Tarbes, on pourrait y tracer, autour de Lourdes, un cercle formé par les hameaux ou les chapelles qui furent autrefois des centres de pèlerinages à la Madone ; Lourdes surgirait alors, au milieu de ce rond, tel qu’un astre vivant, entouré de neuf satellites à peu près morts.
Ces satellites sont : Notre-Dame de Héas ; Notre-Dame de Piétat, à Barbazan ; Notre-Dame de Piétat, à Saint-Savin ; Notre-Dame de Poueylahün ; Notre-Dame de Bourisp ; Notre-Dame de Nestès ; Notre-Dame de Médoux ; Notre-Dame de Bétharram ; Notre-Dame de Garaison.
Tous ces sanctuaires, hormis l’avant-dernier qui relève de l’évêché de Bayonne, appartiennent au diocèse de Tarbes.
Voici, en quelques lignes, la biographie de chacun d’eux :
Notre-Dame de Héas, élevée dans un village situé entre Barèges et Saint-Sauveur, près du cirque de Gavarnie, existait avant le XVIe siècle, car elle est mentionnée dans un titre daté de 1415. La chapelle aurait été fondée par la famille d’Estrade d’Esquièze, afin de permettre aux bergers perdus dans ses pâturages d’entendre la messe, le dimanche ; elle est aujourd’hui quelquefois visitée par des touristes que tente l’escalade des monts sur la crête desquels elle est perchée.
Notre-Dame de Piétat. L’origine de cette chapelle, sise à Barbazan, disparaît dans le recul des âges et les documents sur sa vie, désormais terminée, manquent : l’autre Notre-Dame de Piétat, érigée à Saint-Savin, se dressait au-dessus de l’abbaye bénédictine de ce nom, construite par un solitaire du Poitou qui possède encore un autel dans l’église abbatiale de Ligugé.
Ses reliques, que contient une antique châsse, guignée par les brocanteurs, reposent dans l’église du village de Saint-Savin où, entre parenthèses, subsiste un vieil orgue démantibulé du Moyen-âge, bien étrange. Les pédales, quand on les remue, mettent en branle, les mâchoires de têtes fantastiques qui tirent la langue aux ouailles.
Ces mascarons dont les grimaces, dans un temple, surprennent, sont en bois, gaiement sculptés et violemment peints.
Notre-Dame de Poueylahün, à Arrens, est dominée, de tous côtés, par de hautes montagnes ; sa chapelle est bâtie dans le style de la Renaissance ; la Vierge y fut jadis très adulée, mais elle ne l’est plus guère maintenant que par les bonnes femmes du pays ; quant à sa monographie, elle est nulle.
Notre-Dame de Bourisp, à Vieille-Aure, est née de la légende tant de fois racontée par les historiens du Moyen-âge, d’un bœuf découvrant et adorant une statue de Madone qui, transférée dans plusieurs endroits, revient toujours, miraculeusement, au lieu où elle fut déterrée et force ainsi le peuple à lui construire, là où elle le veut, une église. Cette statue daterait du XIIe siècle ; elle n’est plus vénérée, en France, que par les fidèles de Vieille-Aure.
Notre-Dame de Nestès, à Montoussé ; l’emplacement de ce sanctuaire fut, comme celui de Sainte-Marie Majeure, à Rome, désigné par une nappe de neige qui tomba du ciel, en plein été ; il était à l’état de ruines et depuis longtemps abandonné lorsqu’en 1848, pendant les journées de juin, trois petites filles ayant vu, au milieu d’un buisson de ronces poussé dans les débris de ses pierres, une image lumineuse de la Vierge, l’on décida de réédifier la chapelle et l’on y replaça son ancienne statue qui avait été recueillie, en 1793, par l’église paroissiale du bourg ; si l’on excepte les terriens des alentours, les croyants n’y affluent guère et les pèlerinages l’ignorent.
Notre-Dame de Médoux, à 3 kilomètres au sud de Bagnères-de-Bigorre, en face du hameau d’Asté, dut sa vogue, désormais périmée, à deux légendes.
La première rappelle, en partie, la légende de Notre-Dame de Bourisp ; le bœuf n’y est pas, mais la statue, revenant d’elle-même dans le sanctuaire d’où elle fut enlevée, s’y retrouve. En effet, les habitants de Bagnères-de-Bigorre s’en emparèrent, en 1562 et l’attachèrent sur un chariot pour l’emmener dans leur ville ; mais, arrivée au petit pont du Martinet, elle rompit ses liens et fendit l’air pour retourner dans son église.
La seconde est plus intéressante et plus neuve. En 1648, la Vierge apparut à une pauvre bergère du nom de Liloye qui priait devant son effigie, et lui intima l’ordre d’avertir le clergé et le peuple de Bagnères qu’ils eussent à faire pénitence de leurs péchés. Liloye s’acquitta vainement de ce message et revint, bafouée, près de la Vierge qui renouvela ses injonctions, déclarant que, si on ne les écoutait pas, Elle décimerait, par une peste effroyable, la ville.
Liloye obéit de nouveau, mais ses remontrances échouèrent ; alors, la peste sévit et tua tous ceux des habitants qui ne purent s’enfuir ; Bagnères demeura désert pendant une année ; puis, peu à peu, les coupables qui s’étaient soustraits au châtiment, en s’éloignant du lieu contaminé, revinrent. Une de ces émigrées, Simone de Souville, rencontra Liloye dans la rue et, gouailleuse, lui dit : cette épidémie providentielle que vous aviez annoncée n’a pu atteindre que les malheureux qui n’avaient pas les moyens de déguerpir ; nous autres, nous avons pu facilement y échapper. La leçon est donc incomplète et nous attendrons des semonces moins maladroites pour nous convertir.
– Va, fit aussitôt la Vierge à Liloye, va prévenir cette mauvaise brebis que le fléau se déchaînera sur les riches, cette fois, et qu’elle en sera la première victime.
Et la prédiction s’accomplit à la lettre, et Simone mourut.
Le peuple, terrifié, se repentit et de nombreuses processions défilèrent, durant des années, devant l’autel voué à Notre-Dame. Quant à Liloye, elle entra comme religieuse dans un couvent de Balbonne, près de Montserrat, en Espagne, car tous les monastères du pays avaient été brûlés par les huguenots.
Ce sanctuaire de Médoux, que desservaient des Capucins, parmi lesquels vécut le P. Antoine de Lombez qui trépassa, l’an 1778, en odeur de sainteté, fut l’un des pèlerinages célèbres des Pyrénées. Des guérisons, des miracles de toute espèce, y attirèrent les foules, puis vint la Révolution qui les dispersa ; la chapelle fut fermée et la statue transférée dans l’église de la commune.
Notre-Dame de Bétharram est, elle, située dans le village de ce nom que le chemin de fer relie à Lourdes ; c’est un des lieux d’excursion les plus connus des pèlerins, qui y vont passer quelques heures afin de changer leur piété de place. Bâtie on ne sait quand, à la suite d’un miracle qui, sauf que ce furent des bergers au lieu de petites bergères qui découvrirent une image lumineuse de la Vierge dans un buisson, évoque, presque mots pour mots, la légende de Notre-Dame de Nestès, l’église fut incendiée par les protestants, en 1569, mais la statue, retirée intacte du brasier, fut sauvée par un prêtre qui l’emporta à Tauste, près de Saragosse, en Espagne, où elle se trouverait encore.
L’église n’était plus qu’un amas de décombres, et cependant des guérisons de maladies incurables s’y opéraient encore et des multitudes s’y pressaient pour implorer la Vierge.
Louis XIII restaura le sanctuaire et messire Léonard de Trappes, archevêque d’Auch, y plaça le 14 juillet 1616 une nouvelle statue destinée à remplacer celle que les habitants de Tauste se refusaient à rendre ; et, la veille de l’Assomption de l’an 1622, une fontaine, depuis des années tarie, se reprit à couler en abondance, dans une petite grotte creusée près de l’église, et de nombreux miracles furent effectués avec cette eau, comme si la Madone voulait préluder aux guérisons qu’Elle devait pratiquer, par ce moyen, deux siècles plus tard, à Lourdes.
L’église actuelle, qui rappelle à la fois le style Renaissance et le style jésuite, tel qu’il existe à Anvers, vaut qu’on la visite. L’intérieur est bizarre, avec ses cintres supportés par des piliers très bas, d’une taille d’homme, ses grandes figures d’anges en bois doré, coupés à mi-corps, tels que les bustes mythologiques des Termes et enguirlandés, à partir de la ceinture, de feuillages de rosiers et de chênes. L’autel est une énorme pièce montée, dorée sur toutes les coutures, soutenue par de superbes colonnes torses enroulées de pampres, décorée de colombes, d’anges, d’amours nus et gras, à la Rubens, entourant une effigie placide et atone de Vierge. La nef, surmontée d’un plafond arqué de bois peint en bleu de ciel, semé d’étoiles, est parée de tableaux naïfs relatant les miracles de naguères et, dans une chapelle, à droite, un bas-relief raconte l’épisode de l’Apparition aux bergers, de Marie souriant dans un buisson de feu.
La Châtelaine, qui distribuait autrefois si largement l’aumône de ses grâces dans cette demeure de Bétharram, a déménagé et fixé plus loin, au lieu-dit de Massabieille, son domicile...
Ces divers pèlerinages peuvent être considérés ainsi que les antécédents des triomphes hyperduliques de Lourdes, mais leurs légendes perdues dans la nuit des temps ne se rapprochent que par quelques points de l’histoire de la grotte. Tout au plus, Liloye pourrait-elle être envisagée telle qu’une image avant la lettre de Bernadette, car, après avoir servi de truchement à la Vierge et subi les contradictions de toute une ville, elle a fini, de même que la fille de Soubirous, dans un cloître ; et, d’autre part, la source et la grotte de Bétharram sont, en quelque sorte, les préfigures de celles de Lourdes.
Avec Notre-Dame de Garaison, les traits de ressemblance s’accentuent, se précisent davantage, car tout y est : la bergère, la grotte, l’eau, les foules innombrables, issues des confins les plus divers, les miracles et les cures. On peut affirmer que ce pèlerinage fut au XVIe et au XVIIe siècle ce qu’est le pèlerinage de Lourdes à notre époque.
La biographie de Notre-Dame de Garaison tient en quelques lignes.
Vers l’an 1500, à Monléon, au val de Garaison, dans un lieu jadis appelé « la Lande du Bouc » parce qu’il servait de rendez-vous aux sorciers de la Gascogne, une petite bergère, Anglèse de Sagazan, gardait les troupeaux de son père, près d’une fontaine, quand une Dame, vêtue de blanc, lui apparut et après s’être fait connaître sous le nom de la Vierge Marie, demanda, tout comme à Lourdes, qu’on lui bâtît une chapelle et qu’on y défilât en procession.
La petite courut annoncer la nouvelle à son père. Lui la crut sur parole, mais il n’en fut pas de même des habitants qui haussèrent les épaules et rirent. L’enfant retourna, le lendemain, à la fontaine et la Vierge lui apparut encore et réitéra sa requête, mais les recteurs et les consuls de Monléon, persuadés que le père et la fille qui leur débitaient de pareilles histoires étaient, l’un et l’autre, des déments, les congédièrent, en les engageant à se soigner.
Pour la troisième fois, Anglèse se rendit à la fontaine, mais elle y vint accompagnée de sa famille et de quelques personnes du voisinage ; celles-ci ne virent point, ainsi qu’elle, la Vierge, mais toutes l’entendirent déclarer qu’Elle allait, pour les convaincre, changer le morceau de pain noir que la petite portait dans son bissac, et aussi la provision restée dans la huche de la maison, en des miches de pain très blanc.
Et le double miracle eut lieu et, d’incrédule qu’elle était, la ville se fit fervente ; on organisa aussitôt des processions ; on construisit une chapelle, mais elle devint trop petite pour contenir les foules qui affluaient de toutes parts ; on la démolit, en 1536, et l’on édifia, à sa place, une vaste église gothique.
Une statue en bois de Notre-Dame des Sept-Douleurs fut posée sur le maître-autel ; d’où provenait cette statue aujourd’hui rongée par les vers et par les mites et qui simule une Vierge à la fois dolente et réfléchie, tenant sur ses genoux le corps inanimé de son Fils ? Nul ne le sait ; d’après une légende, cette Pieta aurait été découverte sur les indications de la Vierge, par Anglèse ; d’après une autre, on l’aurait déterrée dans un buisson de ronces. Quoi qu’il en soit de son origine, ce fut devant elle que des conversions, des cures de maux inguérissables se succédèrent. On amenait des malades de très loin et les aveugles voyaient et les perclus marchaient, après avoir bu de l’eau puisée dans la fontaine. Un temps d’arrêt surgit, au moment de la Ligue. Les hérétiques pillèrent l’église, jetèrent la statue de Notre-Dame dans le feu, mais, de même que celle de Bétharram précipitée dans une fournaise, elle ne s’y consuma point. Quand la tourmente eut cessé, les multitudes reprirent le chemin de Monléon, mais elles procurèrent tant de bien-être à ce bourg que les habitants se perdirent – comme se perdront ceux de Lourdes. L’argent développa la cupidité et attisa le dévergondage des mœurs et la Vierge se retira.
Garaison n’était plus qu’un endroit tel qu’un autre lorsque la Révolution transforma l’église en une fabrique de poudre ; la statue de la Vierge, qui avait échappé aux fureurs des Jacobins, fut transférée dans l’église de la paroisse et, en 1834, l’évêque de Tarbes restaura le sanctuaire et fonda, pour le desservir, une compagnie de missionnaires des rangs desquels sont sortis les Pères de Lourdes.
L’église est encore fréquentée par les gens du pays et par quelques touristes.
Quant à Anglèse, elle entra, en 1536, au monastère cistercien de Fabas, situé dans le diocèse de Comminges, à six lieues de Garaison. La tradition rapporte qu’elle se présenta, ainsi que devant la Vierge, trois fois, à la porte de cette abbaye dont les moniales appartenaient à la noblesse des alentours. Les deux premières fois, elle fut éconduite, à cause de sa roture, mais la troisième fois, les portes s’ouvrirent toutes seules, et les cloches sonnèrent d’elles-mêmes, à toute volée. Elle fut aussitôt admise et elle y mourut, âgée de plus de cent ans, en odeur de sainteté, simple religieuse ne sachant ni lire ni écrire selon les uns, prieuresse, suivant les autres, la veille de la Nativité de la Très Sainte Vierge, l’an du Seigneur 1589.
Lourdes, on le voit, n’est pas un fait isolé dans les annales des Pyrénées. Il n’est que la reviviscence d’anciennes dévotions populaires que la Madone a rajeunies ; sans changer de région, Elle s’est bornée à transporter sa demeure dans un site plus accessible à la piété des foules.
Tels sont donc ses antécédents régionaux. La filiation parisienne, moins directe, s’établit par ricochet.
Elle dérive de Notre-Dame des Victoires, qui se rattache à la chapelle des sœurs de Saint-Vincent de Paul, de la rue du Bac, laquelle se relie, à travers les âges, à Saint-Séverin.
Il faut ne pas oublier, en effet, que si Marie vint à Lourdes pour inviter les pécheurs à la pénitence et affirmer par des guérisons la puissance médiatrice de ses grâces, Elle vint aussi et surtout pour attester qu’Elle était cette « Immaculée Conception » dont le dogme avait été défini, quatre années auparavant, par le pape Pie IX, à Rome.
Or, il n’avait jamais été question, dans les apparitions précédentes des Pyrénées, de cette prérogative dont Elle n’avait jamais, elle-même, en personne, parlé avant l’année 1830 où elle la révéla à l’une des devancières de Bernadette, à Catherine Labouré, à Paris.
C’est donc dans cette ville que, pour la première fois, Elle entretint une créature humaine de l’intémérabilité de sa naissance.
À dire vrai, du temps même de Charlemagne, dans diverses provinces de la France, les chrétiens honoraient la Conception sans tache de la Vierge et l’Université de Paris, au XIIIe siècle, suivait, sur ce point, la doctrine enseignée par saint Anselme ; mais il faut attendre au XIVe siècle pour trouver une église à Paris qui érige un autel et instaure une confrérie, sous le vocable même de l’Immaculée Conception, et ce fut l’église Saint-Séverin qui, la première, en cette ville, reconnut et célébra, par ces actes mêmes, le privilège de Marie.
Cette dévotion fut récompensée par la Vierge qui guérit des multitudes de malades venus, de loin souvent, pour boire de l’eau d’un puits, creusé au pied de sa statue.
Mais avec les années, cette dévotion s’affaiblit ; Saint-Séverin finit par être plus une église paroissiale qu’un sanctuaire de pèlerins. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, elle devint un lieu de rendez-vous des jansénistes et il fallut bien des années et bien des efforts pour déraciner la secte du quartier. Aujourd’hui la Vierge si méprisée des « appelants »1 a réintégré son domicile, mais si elle y dispense encore des grâces spirituelles ; il semble qu’elle ait fermé son dispensaire des guérisons corporelles, avec l’eau abandonnée du puits que ses prêtres ont clos.
En somme, au XIVe siècle, la dévotion de l’Immaculée Conception était très vivante à Paris ; elle diminua, ou plutôt elle s’éparpilla de jour en jour, à partir du Moyen-âge ; elle n’avait plus, dans les derniers siècles, de demeure spéciale ; elle vivotait partout et nulle part quand, au mois de novembre 1830, la Vierge se décida subitement à lui donner une nouvelle impulsion et à l’étendre non seulement à Paris, mais à l’univers tout entier.
Ce fut alors qu’elle apparut à Catherine Labouré dans la chapelle des sœurs de la Charité, dite les sœurs grises, de la rue du Bac, et lui ordonna de faire frapper une médaille destinée à propager la croyance en son immunité d’origine.
Cette médaille, devenue rapidement célèbre par ses miracles, entraîna les foules vers la rue du Bac, mais la chapelle était trop petite pour les contenir et ce perpétuel va-et-vient eût dispersé du reste les heures concentrées du cloître. La Vierge arrangea pour le mieux les choses. Au moment où elle se montrait dans cette chapelle, M. Dufriche-Desgenettes était curé de Saint-François-Xavier, dans la paroisse duquel était située la maison des sœurs ; il connaissait les persuasives audaces de la médaille miraculeuse et il s’occupait activement à la répandre, lorsqu’il fut nommé curé de Notre-Dame des Victoires.
Cette circonscription était l’une des plus mauvaises de la ville ; l’église était vide du matin au soir ; après avoir vainement tenté d’y réunir quelques fidèles, ce prêtre se découragea et, le scrupule aidant, il résolut de se retirer, pensant qu’un autre réussirait peut-être mieux que lui à pêcher des repentirs dans le vivier de ces consciences mortes. Il était encore, plus que de coutume, obsédé par cette idée quand, le 3 décembre 1836, le matin de la fête de saint François Xavier, le patron de son ancienne paroisse, il monta à l’autel pour célébrer la messe. La hantise de tout quitter le torturait si cruellement qu’il lui était impossible de se recueillir. Il parvint cependant à se reprendre au moment du « Sanctus » et supplia le Seigneur de le délivrer de ce tourment. À peine eut-il achevé cette prière, qu’une voix intérieure prononça en lui distinctement ces paroles : « Consacre ta paroisse au très saint cœur immaculé de Marie », et soudain le calme lui fut rendu. Sa messe terminée, il se demande s’il n’a pas été la dupe d’une illusion, mais les mêmes mots se font entendre plus clairement encore ; il rentre chez lui, écrit d’un trait, comme sous une dictée, le règlement d’une confrérie qui doit vénérer plus spécialement l’Immaculée Conception et, avant même qu’il n’eût révélé publiquement ses desseins, sans qu’on sache pourquoi et comment, l’église déserte s’est remplie. Des guérisons, des conversions de toutes sortes s’y opèrent. Notre-Dame des Victoires devint peu à peu le grand pèlerinage de la Vierge, à Paris.
Marie a traversé l’eau et fixé son domicile dans l’endroit le plus contaminé de la ville, près de la Bourse, dans le camp même de la Juiverie des banques et des draps ; la dévotion, née dans la rue du Bac où Elle est apparue, s’est transférée dans l’ancienne église des Augustins, et la multitude des visiteurs qui s’y amoncellent, chaque année, est immense.
L’hyperdulie2 spéciale de Lourdes est une réplique, agrandie, mise à la portée de toute la terre, de la dévotion de Notre-Dame des Victoires restreinte au diocèse de Paris. Elle en dérive, elle en est issue, mais la Vierge ne l’a créée qu’après que l’antique croyance de ses églises-mères de Paris fut imposée au monde par un pape.
Enfin, en dehors de ces deux lignées régionale et parisienne que nous venons d’expliquer, on peut encore, bien que les conditions de parentèle soient différentes, rattacher les apparitions de Lourdes à celles de La Salette.
S’il n’a pas d’ascendance parisienne, le sanctuaire de La Salette possède une filiation locale, semblable à celle de Lourdes, car il est né, lui aussi, dans un lieu cerné d’anciennes chapelles de pèlerinages, plus ou moins mortes et, d’autre part, il présente ce cas particulier d’être situé dans un pays de montagnes, comme Lourdes.
Seize années après l’apparition de la rue du Bac et douze années avant celles de Lourdes, à La Salette, près de Corps, dans le Dauphiné, sur la cime des Alpes, Marie a parlé à la petite Mélanie et une source a jailli qui, de même que plus tard, dans les Pyrénées, a servi de véhicule à des guérisons.
Seulement la Madone n’a pas dit un mot, cette fois, de la dispense d’impureté de sa Conception, mais elle a pleuré et menacé, flagellé plus particulièrement les vices des prêtres et des cloîtres, exigé, en expiation de débordements de toute espèce, une prompte pénitence.
Ce pèlerinage eut, à ses débuts, une extraordinaire vogue, puis la difficulté des communications, l’impossibilité de hisser, par des lacets mal tracés sur le flanc des monts, les infirmes et les malades, découragèrent les pieuses caravanes qui se firent plus rares. Ajoutons que la plèbe des alentours, en majeure partie constituée de mécréants et de francs-maçons qui exploitait les pèlerins en s’en gaussant, contribua sans doute aussi à cette désertion de plus en plus prononcée des foules.
Bref, bien que les grâces spirituelles y fussent toujours sensibles, le pèlerinage déclinait de plus en plus et n’était guère composé que d’excursionnistes et de gens du voisinage, quand l’apparition de Lourdes lui asséna le dernier coup.
La Vierge s’en fut des Alpes dans les Pyrénées, et là, non au sommet d’un pic, mais tout au bas d’un mont, dans une grotte, comme si Elle avait voulu se rapprocher davantage et se mettre plus à la portée de la terre, Elle apparut, souriante, telle qu’une Vierge glorieuse, et Elle distribua à pleines mains ces grâces qu’elle répartissait moins généreusement dans ses dispensaires de la Seine et du Dauphiné.
Que s’est-il passé dans l’intervalle de ces douze années qui séparent les manifestations des Alpes de celles des Pyrénées ? La Vierge dit bien encore à Lourdes qu’il sied de faire pénitence et de prier, mais elle ne pleure plus, elle n’adresse plus de reproches et de menaces.
Il semble que la colère du Fils soit apaisée – et pourtant l’humanité n’a vécu, durant ce laps de temps, que de mal en pis, autant que l’on en peut juger ; alors, pourquoi ce changement d’altitude, pourquoi cette soudaine clémence ?
Rien ne pourrait l’expliquer, si l’on ne savait qu’en dehors même des quelques rares Ordres non dégénérés de la pénitence, il existe parmi les laïques, surtout parmi les femmes, de nombreuses réparatrices que stimulèrent les plaintes irritées de La Salette. Beaucoup d’âmes se sont sans doute sacrifiées et, rétablissant l’équilibre perdu, ont, à force de souffrances, détourné les cataclysmes.
Nous sommes dans l’obscurité, nous sentons vaguement en nous et au-dessus de nous des luttes qui toujours se recommencent et s’achèvent. La partie se joue à trois, entre Dieu, le démon et l’homme ; mais l’un des trois, l’homme, ignore la suite de cette partie dont il est lui-même l’enjeu.
Si nous résumons maintenant ces quelques remarques, il nous est possible de constater que l’itinéraire de la Vierge en France, au XIXe siècle, a eu Paris comme point de départ – et après une étape à La Salette, dans les Alpes – comme point d’arrivée, Lourdes, dans les Pyrénées.
Nous pouvons noter aussi que la Mère du Christ a choisi pour résidence des lieux situés dans des régions qu’Elle avait jadis occupées, et qu’Elle a, en quelque sorte, plus ranimé que créé, à notre époque, des dévotions qu’Elle a tirées de leurs provinces pour les propager dans l’univers entier.
Nous l’avons, en effet, relaté : La Salette et Lourdes figurent dans des territoires jadis habités par Elle ; quant à Paris, il convient d’observer que Saint-Séverin était, au Moyen-âge, un centre de pèlerinages très vivant et l’on peut admettre, d’autre part, qu’en dehors même des raisons qui décidèrent la Vierge à employer comme truchement une sœur de Saint-Vincent de Paul, Elle a choisi la maison de la rue du Bac parce que, dans ce quartier de la rive gauche, la dévotion à son privilège d’origine y avait été très active pendant les derniers siècles, alors que justement elle se mourait dans son domaine de Saint-Séverin, envahi par les disciples de Jansénius, devenu même une succursale du cimetière Saint-Médard, avec les convulsionnaires qui s’y rendaient pour prier sur la tombe de l’abbé Desangins, le confesseur du diacre Pâris, inhumé dans cette église.
Dans cette rue du Bac qui fut, au XVIIe siècle, une pépinière de communautés, il en existait, en effet, une située à quelques pas du couvent des sœurs grises, au coin de la rue de Varennes, le monastère des Recollettes, dites filles de l’Immaculée Conception, qui fut supprimé en 1792 et dont le but était précisément d’honorer la prérogative de sa naissance.
Ajoutons que lorsqu’Elle franchit les ponts et vint s’installer sur la rive droite de la Seine, Elle se rendit dans une ancienne église qu’Elle connaissait de longue date et qui lui appartenait plus spécialement que toute autre, car elle lui avait été vouée, au nom de la France, par le roi Louis XIII et baptisée par lui, à la suite de la prise aux huguenots de la ville de La Rochelle, du nom de Notre Dame des Victoires.
À Paris, ainsi qu’à la Salette et à Lourdes, Elle s’est servie, en tant qu’intermédiaires, de filles de la campagne, d’êtres humbles, tout à l’ait frustes et bornés. À la Salette et à Lourdes elle s’est adressée à des bergères, à Mélanie et à Bernadette, de même qu’Elle s’était autrefois adressée à Liloye et à Anglèse de Sagazan ; et à Paris, où les bergères manquent, Elle a jeté son dévolu sur une ancienne servante de ferme, devenue sœur de la Charité ; signalons encore, à ce propos, qu’Elle ne chercha pas son interprète parmi les moniales de la vie contemplative, mais bien parmi les religieuses d’un Ordre actif, fondé dans le temps même où se construisait Notre-Dame des Victoires. Et n’y a-t-il pas, à cause de cette ancienne simultanéité d’origine et du subit rapprochement, à notre époque, de ces deux sanctuaires que la Vierge échange l’un pour l’autre, une sorte de présomption qu’un lien mystérieux rattache cette église à cet Ordre ?
Enfin, à la Salette ainsi qu’à Lourdes, ainsi que jadis à Paris, à Saint-Séverin et dans les Pyrénées, à Bétharram et à Garaison, Elle a voulu que l’eau fût l’excipient des guérisons.
Cette question des rapports de l’eau avec la Vierge a été très ingénieusement traitée par un occultiste catholique, M. Grillot de Givry, dans son incitant volume Les villes initiatiques, Lourdes.
À dire vrai, la vieille symbolique du Moyen-âge, qui s’est beaucoup occupée de cet élément, n’a pas vu en lui une image spéciale, unique de la Vierge et encore moins l’a-t-elle désigné comme pouvant être « ce principe féminin vital de la nature », dont parle M. de Givry.
Il est bien évident que le rapprochement s’imposa du chapitre I de la Genèse et du chapitre I de l’Évangile selon saint Luc, et que l’on fut tenté d’assimiler les deux opérations du Saint-Esprit planant, d’une part, au moment de la Création, sur les eaux, les couvrant en quelque sorte et planant aussi, d’autre part, au-dessus de la Vierge que couvre l’ombre du Très Haut.
L’eau peut donc spécifier l’une des figures de la Vierge, mais il n’en est pas moins exact que plus souvent, que presque toujours même, la symbolique lui assigna une signification très différente, qu’il s’agisse d’eau proprement dite, de mer ou de fleuve, de fontaine ou de puits.
D’après elle, l’eau représente, tour à tour, le Christ, les anges, la doctrine évangélique, le baptême, la charité, la science des Justes, et, en consultant la double face de son système d’analogies, en la prenant alors dans un mauvais sens, l’eau est une image de la tentation, de la multitude des péchés, de la luxure.
Mais si nous nous en tenons au mode d’interprétation le plus connu, nous trouvons, d’après les textes de saint Grégoire le Grand,3 de Raban Maur,4 de Pierre de Capoue,5 que l’eau est surtout le symbole du Saint-Esprit.
Il serait prudent, d’ailleurs, de n’accepter cette formule de guérisons que comme l’une de celles qu’emploie, lorsqu’elle le veut, la Vierge, car fort souvent, elle s’en passe. Dans les lieux mêmes où elle fait jaillir des sources, à Lourdes, par exemple, elle guérit parfaitement les infirmes et les malades sans qu’ils aient besoin de boire de l’eau de la fontaine ou de se baigner dans les piscines.
L’eau n’est, au demeurant, qu’un signe matériel de régénération. Après avoir guéri l’âme des conséquences du premier péché, elle peut guérir les corps dont les souffrances sont les suites de ce premier péché. Tel est, peut-être, le motif pour lequel, en souvenir du sacrement de baptême, la Vierge use de ce procédé.
Elle fait, à certains jours, de cet élément un auxiliaire de ses grâces et, sans que l’on sache pourquoi, le délaisse à d’autres jours.
Les sources de la Salette et de Lourdes ont été, dans tous les cas, préfigurées, dans l’Ancien Testament par le Jourdain, qui délivra Naaman de la lèpre, dans le Nouveau, par la piscine probatique que remuait un ange.
II.
Si quelqu’un n’a jamais été stimulé par le désir de voir Lourdes, c’est bien moi. D’abord, je n’aime pas les foules qui processionnent en bramant des cantiques, et je suis de l’avis de saint Jean de la Croix, écrivant dans sa Montée du Carmel : « J’approuve fort celui qui, pour ne pas se joindre à la foule des pèlerins, entreprend des pèlerinages en dehors de l’époque fixée ; quand les multitudes s’y pressent, jamais je ne lui conseillerai de s’y mêler ; on risque d’en revenir plus distrait qu’on n’y est allé ! »
Ensuite, je ne tiens pas à voir des miracles ; je sais très bien que la Vierge peut en faire, à Lourdes ou autre part ; ma foi ne repose ni sur ma raison, ni sur les perceptions plus ou moins certaines de mes sens ; elle relève d’un sentiment intérieur, d’une assurance acquise par des preuves internes ; n’en déplaise à ces caciques de la psychiatrie et à ces barbacoles entendus qui, ne pouvant rien expliquer, classent sous l’étiquette de l’autosuggestion ou de la démence les phénomènes de la vie divine qu’ils ignorent, la Mystique est une science résolument exacte ; j’ai pu vérifier un certain nombre de ses effets et je n’en demande pas davantage pour croire ; cela me suffit.
Et voici cependant qu’en attendant l’arrivée des grands pèlerinages internationaux je suis, pour la deuxième fois, par suite de circonstances tirées de loin et presque indépendantes de ma volonté, installé, depuis des semaines déjà, dans cette ville.
Ce matin, il pleut comme il pleut dans ce pays, c’est-à-dire à seaux ; et, assis près de la fenêtre du cottage que j’habite sur la hauteur de la route de Pau, je regarde le panorama de Lourdes, au travers de mes vitres qui pleurent.
L’horizon, très court, est bousculé par des montagnes entre lesquelles poussent des touffes de vapeur blanche, alors qu’à des altitudes plus élevées, galopent des nuées charbonneuses et roulent des flocons fuligineux d’usines. La cime de l’un de ces monts a l’air de fumer, tandis que le pic d’un autre, dégagé de ses nuages, paraît mort ; çà et là, des écharpes de ouate grise s’enroulent autour du col des plus basses collines et s’écardent en descendant ; quant aux cônes dont les têtes sont éternellement blanchies par les neiges, ils ont complètement disparu dans la brume ; à mesure que les averses tombent, tout se brouille ; le grand et le petit Gers, les deux montagnes les plus proches, ressemblent, dans cette buée, à d’immenses pyramides de mâchefer, à des tas gigantesques de cendre.
La tristesse de ce ciel rayé en diagonale par le fil des pluies ! En bas de la chaîne de ces monts, juste devant moi, le Gave, en un torrent qui ruisselle, jours et nuits, bouillonne sur des quartiers de rocs et, avant de s’étendre plus loin en une tranquille rivière, ceinture d’écume un bâtiment surmonté d’un clocher pointu et entouré d’un maigre jardinet planté de sapins et de peupliers. On dirait d’un pénitencier de cette bâtisse percée, très haut, dans des murs très droits, de minuscules lucarnes : c’est le couvent des pauvres Clarisses ; à gauche, un pont enjambe la rivière et relie au nouveau Lourdes, dont j’aperçois les maisons, la vieille ville que domine un antique donjon qui paraît fabriqué pour un décor d’opéra, avec des châssis de toiles peintes ; on le croirait factice ; enfin, à droite, l’esplanade et ses arbres menant au Rosaire et à la double rampe que surplombe la basilique dont le profil se détache, tout blanc, sur le coteau des Espélugues où, pour figurer les stations du Calvaire, se dressent, dans des clairières cernées de verdure, d’énormes croix.
Et derrière l’esplanade et ses pelouses, en bas des rampes, deux cloches à gaz, l’une ripolinée au vert d’eau, l’autre teinte d’ocre jaune comme une porte de lieux, s’arrondissent, horribles ; ces tourtes de tôle contiennent, l’une, un panorama de Jérusalem, l’autre, un panorama de Lourdes.
Tout cela n’est pas très subjuguant, au point de vue de l’art, et la cathédrale, perchée ainsi que sur une languette de roc, en l’air, ne l’est pas davantage. Mince, étriquée, sans un ornement qui vaille, elle évoque le misérable souvenir de ces églises en liège dont certaines devantures d’industries se parent ; elle relève d’une esthétique de marchand de bouchons ; la moindre des chapelles de village bâtie au Moyen-âge semble, en comparaison de ce gothique de contrebande, un chef-d’œuvre de finesse et de force ; le mieux serait, malgré sa froide nudité, la double rampe de pierre qui conduit du bas de l’esplanade jusqu’à son portail, si elle n’était, elle-même, gâtée à son point d’arrivée par l’affreux toit du Rosaire qui bombe sous les pieds de la basilique, un toit composé d’un moule colossal de gâteau de Savoie, flanqué de trois couvercles de chaudière, en zinc.
Vue d’où je suis, de côté, on dirait de cette rotonde avec ses deux rampes qui dévalent, en ondulant, de son toit jusqu’au sol, d’un crabe géant dont les pattes tendent leurs pinces vers la vieille ville.
Et, en bas de cette rampe, au-dessous de la basilique et le long du Rosaire, court, devant le lit du Gave, une large allée qui passe devant les piscines et la grotte et meurt, brusquement barrée par une colline sur laquelle sont tracés des lacets en forme d’M. Ils grimpent, par des sentiers plantés d’arbres, derrière la basilique et s’acheminent vers la résidence des Pères de la Grotte et la demeure épiscopale, situées à quelques pas du chevet.
Tout cela se décèle étique et gringalet, chiche et nain, car l’ampleur trop voisine des monts l’écrase ; mais l’indigence de ce décor préparé s’efface si l’on regarde le trou de feu, creusé dans le roc, au-dessous de la basilique même ; c’est une cave de flammes qui brûle sous son flanc ; l’intérêt de Lourdes est là.