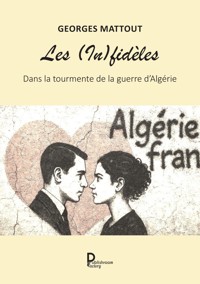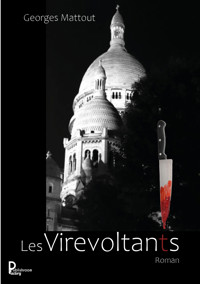
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Ils sortent de terre, poussent puis sèchent au soleil et un jour se détachent, espérant accéder ainsi à leur liberté. Mais c’est le vent qui les entraîne, lui qui dessine leur trajectoire, au hasard de ses seules humeurs. Ils roulent, s’élèvent, se croisent, se percutent parfois ou se précipitent vers d’autres cieux ; ils dansent et s’envolent sans parvenir à rien maîtriser, surtout pas leur destinée.
Un conseiller Pôle Emploi, un grand bourgeois, un réfugié somalien, un prêtre, un patron de bistrot, une commissaire de police, deux jeunes extrémistes, un médecin, un enfant perdu, une avocate : autant de personnages que la vie emporte et plaque dans un tableau dont ce roman compose la mosaïque. Une simple comédie humaine, en quelque sorte.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Georges Mattout est né en Algérie au siècle dernier mais l’a quittée au moment de l’indépendance, il avait 10 ans. Il a grandi et vécu pour l’essentiel à Paris, s’est formé à la philosophie et à la sociologie, devenues les sources essentielles de son futur métier. Marié et père de trois grandes filles, il couche aujourd’hui sur papier une imagination et des convictions qu’il aimerait partager. Lecteur assidu, il apprécie tous les genres de livres. Dans sa bibliothèque, se côtoient et font bon ménage ouvrages de philosophie, essais, poésie, différents types de romans et l’indispensable BD.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georges MATTOUT
LES VIREVOLTANTS
Roman
Aux illusions,
qui souvent s’égarent
mais qu’on ne perd jamais
Il va maintenant être question des hommes, sans prétendre dire des choses définitives. Ce ne serait guère possible (...). Lorsqu’on essaie d’augurer de la vie d’un homme, il faut toujours s’arrêter devant l’inconnu ».
–Rainer Maria Rilke. Worpswede. 1902
Avoir mauvaise conscience ouvre un précieux chemin vers l’humanité, à l’inverse de la bonne conscience qui justifie tous les renoncements.
–Anonyme. 2022
PREMIÈRE PARTIEDes vies comme il y en atant
1
Paris, le 17 juin2014
Il ouvre un œil, hésite pour le second et finalement se décide ; il faut bien se lever et aller bosser, c’est l’heure. Une journée de plus, sans doute banale comme les précédentes, mais sans risque. Paris est grise ce matin, aucune surprise. Le fenestron de sa chambre ne ment pas, qui emplit la pièce d’une lueur grimaçante et blafarde, un peu jaune, déjà crépusculaire. Michel s’arrache du lit, enfile ses savates et se traîne jusqu’à la cuisine toute proche, un réduit. Il se sert un café coulé d’hier, retourne s’asseoir sur le divan, et soudain pense à sa vie, comme ça, sans le vouloir, encore plongé dans le semi-gruau d’un sommeil perturbé. « Misérable », c’est le mot qui lui vient à l’esprit, ça le surprend. Pourquoi ? Pourquoi misérable ?... Bon c’est vrai, il est seul ici, loin de sa famille, et ne fait rien de folichon à Paris. Il n’a pas de petite amie, quelques copains tout au plus (et encore, le sont-ils vraiment ?), traîne souvent sa viduité dans les rues du quartier. Mais il travaille, gagne correctement sa vie, n’a pas d’ennuis, ça va quoi ! Et puis, il est libre ici, anonyme dans la cité, invisible et sans contrainte. Il n’a pas à faire semblant, ne doit rien à personne. Atteindre 24 ans sans encombre, ce n’est pas si mal après tout, surtout lorsqu’il se compare à ceux qui sont restés là-bas au pays, ses anciens copains d’école dont parfois sa mère lui parle : chômeurs pour la plupart, certains tâcherons dans il ne sait quelle usine ou ferme alentour, devenus qui alcoolique, qui drogué, avec séjours en prison pour prime. Alors « misérable » n’est pas le bon mot. Il cherche à le remplacer, mais n’y parvient pas et abandonne. Aucune importance : encore une queue de rêve sans véritable signification, on oublie. Vouloir qualifier sa propre vie, quelle bêtise ! une perte de temps. « Un cerveau, c’est tyran comme y a pas » disait Bardamu et il avait raison.
Lorsqu’il quitte la ferme de ses parents pour boucler ses études à Orléans, Michel se jure de ne jamais revenir. Trop de misère, trop de frustration, un travail ingrat et la quasi-certitude de l’échec, il n’a pas la force. Avant lui, son père s’est obstiné à vouloir maintenir cette vie d’un temps passé (ah ! les ravages causés par ce chanteur ringard et son putain de « Loir-et-Cher », ce Delpech à qui il doit son prénom). Pour quel résultat ? Usé jusqu’à la corde le paternel, cassé et toujours aussi pauvre. Et puis l’ennui, l’ennui à perte de vie, l’ennui qui vous poisse comme la glu sur les ailes de la grive qu’on chasse. Aussi, bac en poche direction Paris. Michel Raguain y débarque avec l’espoir d’un migrant, la capitale marque sa délivrance. Non ! décidément, elle n’est pas misérable sa vie, un peu terne oui (ça y est, il a trouvé le mot), mais pas misérable. D’ailleurs, la misère - la vraie - Michel la connaît, il la côtoie tous les jours, il est conseiller à Pôle Emploi.
C’est sûr, il en bave au début le Michel. S’installer à Paris n’est pas pour lui une sinécure. Logé un temps chez une cousine de sa mère, petite main chez un grand couturier parisien (et dont le fils militaire est en mission à l’étranger), il lui faut subsister. Brinqueballé entre petits boulots mal rémunérés, et stériles rendez-vous à l’ANPE, il a sa part de vache enragée. Manutentionnaire, livreur, arsouille dans le bâtiment, serveur ou plongeur en extra, souvent payé « au noir » ou régulièrement chômeur, il souffre, craint même de devoir repartir, l’angoisse au cœur et toute honte impossible à boire. Son baccalauréat tarde à lui être utile. Aucun emploi administratif ne lui est proposé, pas même un poste d’agent de bureau.
Puis, la solution vient enfin - une fois n’est pas coutume et sans qu’elle le sache - de l’ANPE. Lors d’un de ces rendez-vous de contrôle un peu humiliants qui lui sont imposés, il observe son conseiller, un jeune gars à peine plus âgé que lui, mais déjà bien arrogant. Le type parle, égrenant avec condescendance conseils et admonestations. Michel le fixe étrangement, un vague sourire aux lèvres. Son esprit est ailleurs, il prend une décision : bientôt, il sera à la place de cet abruti, et deviendra Conseiller à l’Emploi. Oh ! ce n’est pas l’intérêt pour le métier qui le pousse, non, simplement la certitude d’avoir trouvé « la planque », un boulot assez facile, sans doute monotone, mais au titre ronflant, qui confère à qui l’exerce un certain pouvoir ; et ça, ça lui plaît. Bac + 2, il devrait y arriver... et il y arrive. Deux ans plus tard, titulaire d’un BTS « d’assistant-manager » obtenu grâce aux cours du soir, il réussit le concours de conseiller ANPE, et trouve immédiatement un poste en agence. Depuis 2008, c’est à Pôle Emploi.
Michel emménage alors dans un petit appartement au loyer modique, une enfilade de minuscules chambres sous les toits d’un immeuble de la rue Feutrier, dans ce 18e arrondissement populaire et touristique, un peu trop mêlé à son goût, mais calme malgré tout (la Goutte d’Or n’est pas loin, mais son agitation déborde heureusement peu sur la zone). C’est là, dans son refuge du 6e étage sans ascenseur que, matin après matin, sa journée commence.
Aujourd’hui n’est pas jour de douche, une simple toilette « de chat » suffira. Il n’a d’ailleurs jamais compris cette habitude (parisienne, peut-être) de se doucher chaque matin, moins encore le plaisir qu’il y avait à prendre un bain ; chez lui, à la campagne, on économise l’eau. Par ailleurs exiguë, sa salle de bains partage l’espace avec la penderie, aussi y reste-t-il le moins possible. Ses ablutions effectuées, il enfile ses habits de la veille (un costume un peu fripé sur une chemise et une cravate achetées d’occasion dans l’une des boutiques « vintage » de Barbès, même slip, mêmes chaussettes), attrape sa sacoche, puis dévale l’escalier. Il rejoint la rue, au bout de laquelle l’attend le bistrot de Dédé, le Balto. C’est son étape matinale, le Balto, celle aussi d’habitués qui, petit noir ou blanc sec consommés sur le zinc, s’y saluent avant de se perdre dans leur assuétude quotidienne. Michel s’y sent bien.
Le Balto est un café à l’ancienne, un bistrot du Paris d’avant, d’un Paris populaire, de cette époque où le local l’emportait sur la modernité gentrifiée. N’y viennent d’ailleurs que les gens du quartier, hormis Moussa, l’éboueur jovial, qui à cette heure prend là sa pause, seule touche de couleur dans ce tableau de blancs visages. Au sol, des éclats de carrelage se combinent en une marqueterie multicolore. Des mosaïques incrustent les murs, à la gloire du Montmartre d’antan, celui du Moulin Radet et de l’impasse des Deux-frères. Derrière le bar pend une affiche cartonnée qui met en garde contre les méfaits de l’alcool (une vieillerie datant de plus d’un siècle). Une tireuse de bière trône en cloche au milieu d’un comptoir tout bosselé par l’âge et la servitude, observée de haut par une armée de verres pendus par les pieds. Dans la salle longue et étroite, quelques banquettes en bois (sièges d’anciennes rames de métro) se font face et forment de petites alcôves discrètes. À l’entrée, deux massifs guéridons accueillent les clients solitaires. Un vieux lustre en faux cristal assure l’éclairage, associé à des appliques mal coordonnées. Pas de cendrier ici, les mégots sont jetés à terre - eh oui ! on peut fumer au Balto. - Chaque soir, Dédé les balaie après avoir dispersé, tel un paysan sa semence, de la sciure sur le sol.
Sacré personnage le Dédé, une légende dans le quartier. Fort à bras et grande gueule, il anime son bistrot comme un bonimenteur de foire. Grand, brun, baraqué, il arbore une moustache de gaulois, et des yeux noirs qui vous transpercent. Par son seul regard, il trie sa clientèle ; ne restent que ceux qu’il adoube, ceux qu’il accepte dans sa « famille ». Intarissable avec ça l’animal, de la gouaille à revendre. Il interpelle, invective, commente et refait le monde, condamne ou encense à longueur de journée, joignant à sa parole des gestes de tribun, un vrai tragédien. Arrivé d’Auvergne tout jeune encore, il est d’abord « fort des Halles » dans le ventre de ce Paris perdu, à Baltard, au pavillon de la viande ; et comme il le dit, « j’en ai trimballé de la barbaque ! ». Il copine assez vite avec des « pays » qui, par solidarité tribale, l’aident un peu plus tard. Il devient alors bistrotier dans les Halles, rue Montmartre, puis... à Montmartre justement. Il reprend le Balto à un vieil auvergnat, un bougnat qui vendait du charbon, et le livrait par sacs entiers dans un vieux « Citron » aussi déglingué que lui. Autodidacte forcené, Dédé (André Chabrillard de son vrai nom) montre vite une intelligence poussée, mais biaisée par une répugnance marquée pour la France d’aujourd’hui, cette République « ramollie et bâtarde », en un mot privée de la virilité du peuple.
Comme il le fait chaque jour, Michel pousse la porte du Balto à 7h50 précise, et se sent aussitôt aspiré par l’ambiance du lieu, tout amicale pour lui. Il est accueilli par l’apostrophe moqueuse qu’immanquablement Dédé lui réserve : « Salut l’amer Michel ! J’te sers un p’tit noir, mon gars ? ». Dans la salle, son regard croise les mêmes têtes : Yvonne, une petite vieille rabougrie, bien sapée et délicatement maquillée, assise toujours à la même place. Comme chaque matin, elle lorgne sur les paris hippiques de son journal, et maugrée à l’envi. Plus loin, très discret, se tient le vieil Albert, un médecin à la retraite qui, verre de blanc en main, regarde fixement devant lui, et ne dit jamais mot. Sont aussi présents Victor le serrurier et Alphonse « la volaille », perdus dans une discussion sans fin sur les mérites respectifs de différents vins de pays. Ils parlent en même temps, s’écoutent à peine, vont ainsi de gorgeon en gorgeon, et en redemandent. Enfin, posée au bout du comptoir tel un bouquet de fleurs multicolore, trône « Madame » (c’est ainsi que la nomme Dédé), cette femme si singulière pour Michel. D’un âge difficile à déterminer, elle est un peu ronde, arbore une coiffure aux mille reflets, porte des robes moulantes, et tient sa gorge toujours cachée par un « truc en plume » chamarré ; elle sent bon. « Madame sait parler aux hommes, crois-moi, mon Michel ; elle balance de ces vannes, la coquine ! difficile de lui résister... J’l’ai connue rue Saint-Denis » lui confia un jour Dédé en clignant de l’œil. Mais Michel craint d’en savoir plus. Il ne souhaite pas connaître cette femme qui l’incommode, refuse de s’en approcher. Près d’elle se tient aujourd’hui Moussa, tout entier vêtu de « vert-Propreté de Paris ». L’éboueur lui parle à voix basse, et reçoit en retour une giclée du rire flûté de la dame, accompagnée d’une tape de protestation amicale sur la cuisse ; elle ne semble pas froissée.
Michel ne s’attarde pas ce matin, son travail l’attend. Sitôt son expresso avalé, il salue l’assemblée d’un évasif « bonne journée », jette quelques pièces sur le zincet quitte l’endroit. Il y reviendra ce soir, après l’heure du dîner. Ses copains seront là cette fois. Ensemble, ils ont l’habitude de jouer aux cartes, rigolent un peu, et il les écoute parler, ça le distrait. Des marrants ses potes, un peu hargneux parfois, mais sympas. Il les connaît peu, moins encore leur activité, ne les rencontre qu’au Balto. Plus jeunes que lui, ils semblent traîner une amertume un peu lasse face à la vie, mais l’expriment de manière plus agressive : ils en veulent à beaucoup de monde. Michel les a croisés au bar un soir, alors qu’il y musait un peu esseulé. Ils l’ont invité à « taper la belote » avec eux, il a accepté. Le petit fonctionnaire les retrouve depuis, plusieurs fois par semaine, toujours autour de cartes. Dans la vie, Ludo, Seb et Darios sont amis, semble-t-il. Ils se fréquentent, et vivent d’autres expériences qu’ils aimeraient partager avec lui. Michel le subodore, mais un peu méfiant, ne les encourage pas, il préfère les garder à distance. Du moins n’est-il plus seul au Balto. Avec ses nouveaux copains, ils forment désormais un petit groupe. Moqueur (et sinologue à ses heures), Dédé les surnomme « la bande des quatre ».
En quittant le Balto, Michel se dit qu’il a eu de la chance aujourd’hui. Dédé lui a foutu la paix, occupé qu’il était à réceptionner une commande de bière. Il n’a pas eu droit aux emportements acerbes du bistrotier sur son « boulot de merde » qui « ne sert à rien » sinon à encourager et à dorloter « ces assistés qui vident nos poches », les chômeurs, « ces branleurs qui préfèrent faire des gosses plutôt que bosser » pour « toucher de la tune grâce aux allocs ». Et d’ajouter « Pour beaucoup, y n’sont même pas français, hein, Michel ? Allez, dis-le, c’est pas des vrais Français ! ». Michel ne le dit pas, non, il ne dit jamais rien. Il n’approuve ni ne conteste, il s’en fout. Son travail lui convient assez, il s’y rend de ce pas. Sa journée ne sera pas plus ennuyeuse qu’une autre, il le sait d’expérience, et se fonddans la foule qui, à cette heure, excite la rue Andréa del Sarte.
Michel se dirige vers le métro, station Barbès-Rochechouart. Un mince sourire étire ses lèvres. « Chômeurs soyez prêts, j’arrive ! » siffle-t-i mezza-voce.Il est8h15.
2
Vanves, le 17 juin2014
–Maman, t’as pas vu mon sweat bleu ? Tu sais, celui avec « Proud » imprimé dessus ?
–Il est au sale, dans la panière, chérie. Tu l’as porté pendant une semaine au moins. Je ferai une machine demain.
–Oh non ! c’est pas vrai. Mais pourquoi t’as fait ça, c’est nul ! T’aurais pu me demander avant.
–Écoute Laure, ça t’apprendra à ne plus laisser tes affaires traîner n’importe où. Je l’ai trouvé dans le salon, jeté en boule, et son odeur m’a paru plus que suspecte. Je le laverai ce soir, si tuveux.
–Pfff ! Fait chier ! qu’est-ce que je vais me mettre alors ? J’ai plusrien.
–Quoi ? Tu plaisantes là ! Tu n’as plus rien ? Je rêve ! Tes placards sont pleins, et tes tiroirs débordent. Et puis, reste polie s’il te plaît.
–Tu comprends vraiment rien ! J’avais envie de le porter aujourd’hui, c’est tout... Laisse tomber, ça va.
Laure retourne dans sa chambre, et claque la porte derrière elle. Odile soupire. Elle a l’habitude de ces prises le bec, mais ce matin elle est en retard et perd patience.
–Presse-toi chérie, le lycée n’attend pas, mon travail non plus. Faut y aller !
–Pars sans moi maman, je me débrouillerai. Je prendrai lebus.
–Tu es sûre ? Je peux t’amener si tu te dépêches unpeu.
–Oui, je suis sûre. Vas-y, j’tedis.
–Bon, je pars alors. Gros bisous ma chérie, passe une bonne journée. À cesoir.
–Bye Mum. Oui, à cesoir.
Odile Maréchal rejoint sa voiture, démarre, et quitte Vanves au plus vite, en route pour « le 36 ». Une réunion l’y attend, animée par son divisionnaire. Il s’agit de faire un point sur les affaires en cours, et de définir certaines actions, qui parfois peuvent être délicates à mener. Commissaire à la Brigade Criminelle de Paris depuis six ans, elle a en charge quelques dossiers sensibles, et pour certains d’entre eux, doit s’assurer de l’appui de sa hiérarchie.
Son parcours de flique n’a pas été des plus simples à mener, mais à 42 ans, elle estime l’avoir jusque-là mieux réussi que sa vie personnelle. Odile n’était pas destinée à faire carrière dans la police. Elle n’y avait pas songé en entamant ses études supérieures, mais la vie réserve parfois des surprises ; celle-ci lui plaît assez. Fille d’intellectuels niortais (son père est professeur de littérature, sa mère bibliothécaire), Odile rejoint Bordeaux après le bac pour y « faire son Droit ». Bûcheuse, elle ne participe que rarement aux fêtes estudiantines organisées sur le campus, et se mêle peu aux liesses adolescentes. C’est à cette période néanmoins qu’elle rencontre Philippe, le brillant et austère étudiant de dernière année qu’on lui désigne comme tuteur. Ils s’entendent bien, et au fil du temps se rapprochent. Puis, en raison d’une timidité partagée plus que par passion, les deux jeunes gens deviennent intimes. Vite mariés, ils donnent naissance à une fille, sans qu’Odile interrompe pour autant ses études. Elle obtient un master 2 en Droit privé, quitte l’université. Devenu entretemps avocat, Philippe exerce au sein d’un cabinet spécialisé dans les affaires, dont le siège est à Paris. Par commodité, la famille déménage en Ile-de-France, Odile ayant accepté de suivre son mari et de se consacrer, pendant un temps du moins, à l’éducation de sa fille.
En réalité elle hésite, n’a en tête aucun projet professionnel précis, les métiers du droit ne l’attirent pas. À ses yeux, ils favorisent trop souvent les opérations douteuses de riches particuliers, ou d’entreprises à l’immoralité patente. Plusieurs affaires suivies par Philippe l’ont éclairée sur ces magouilles légales et l’écœurent. Être avocat oblige à faire preuve de ruse, de mauvaise foi ou, pire encore, à mentir, Saint-Augustin le constatait déjà. « Une profession où plus on ment, mieux on réussit », écrivait-il dans « les Confessions » ; très peu pour elle. Par ailleurs, Odile est une femme curieuse et sportive. Elle a besoin de bouger, de se dépenser, de faire souffrir son corps, de relever des défis ; une activité sédentaire l’ennuierait. Il lui faut un métier physique, dynamique et engageant. Elle ne souhaite pas s’enkyster des heures durant devant un ordinateur, ou perdre son temps dans des réunions stériles. Alors, tout en élevant sa fille, elle cherche ... Et c’est par hasard qu’elle tombe sur un article de Libération, qui relate la journée d’une brigade de police en zone sensible, dans ce fameux 9-3 qui défraie la chronique, et qu’un irresponsable prétendra, quelques années plus tard, « nettoyer au karcher ». Un commissaire est interrogé, il livre un témoignage éloquent d’humanité. Bien sûr, les difficultés sont nombreuses et les résultats incertains, mais il insiste sur l’importance de ces « petites victoires quotidiennes » qui permettent à la vie collective d’aller bon train, et qui en grande partie sont acquises par une approche plus psychologique que répressive des situations. Modération, patience et proximité semblent dans sa bouche de précieux outils de travail. Cela plaît à Odile. Peu après, elle se décide enfin : elle deviendra commissaire de police.
On ne peut pas dire que ce choix enchante ses proches. Ses parents comme son mari ne comprennent pas, ils se liguent contre elle.
–Tu n’y penses pas !
–Ça ne va pas, non ! tu plaisantes.
–Mais c’est n’importe quoi !
–Tu veux être flique ? Quelle idée saugrenue ! Pourquoi pas gardienne de prison, tant que tu yes ?
–T’as un peu réfléchi ? Tu pourrais faire tellement mieux. Il y a tant de métiers passionnants.
–C’est flippant ton truc, c’est un milieu pourri.
–Tu veux nous faire honte, c’est ça ? On est de gauche, tu l’as oublié ? Dans la famille, on n’aime pas trop la police.
–Tu n’as pas fait toutes ces études pour t’enfermer dans un poulailler. Et puis, c’est payé combien, un commissaire ? Une misère, j’imagine.
Etc.
En dépit des arguments qu’Odile présente, personne n’adhère. Ils sont unanimes à critiquer son choix, mais elle s’en fiche. Et lorsqu’un soir Philippe, en colère, lui lance « Il n’en est pas question, je m’y oppose. Tu vas mettre notre famille en danger », elle éclate d’un rire un peu crispé, puis moque ses préjugés. S’ensuit une discussion qui tourne vite à la scène de ménage ; il y en aura d’autres. Philippe a cependant raison sur un point : la famille explose. La séparation survient deux ans plus tard, alors qu’Odile suit une formation à l’École Nationale Supérieure de Police. Aucun homme n’a, depuis, durablement remplacé sonmari.
La suite est plus calme. Majore de sa promotion, elle suit un stage comme commissaire adjointe en banlieue, puis se voit confier la responsabilité d’un poste de police qu’elle parvient, en peu de temps, à débarrasser du sexisme et du racisme qui le gangrénaient, lui donnaient mauvaise réputation. Repérée par sa hiérarchie comme un « élément brillant et efficace », elle progresse rapidement, et après quelques années atteint le but qu’elle s’était fixé : intégrer le saint des saints, la Brigade Criminelle de Paris, logée dans les locaux du fameux 36, quai des Orfèvres. C’était il y a sixans.
On circule toujours mal dans Paris. Odile néglige le périphérique, souvent bouché à cette heure, tente la rue Castagnary. Avec un peu de chance, elle pourra atteindre facilement la rue de Vaugirard puis la rue de Rennes, le Pont-neuf, et arriver à temps. Son patron n’aime pas le retard. Il lui en a fait la remarque une fois, cela a suffi. Qu’elle soit seule à élever une adolescente n’est pas pour lui une excuse. Elle le comprend parfaitement, étant elle-même particulièrement exigeante envers ses collaborateurs. Beaucoup de travail et de nombreux enjeux, parfois sensibles, lui interdisent relâchement ou approximation.
Actuellement, son équipe mène de front trois enquêtes : un vol de bijoux et de tableaux chez un patron très médiatisé (collectionneur et mécène connu, proche du pouvoir), avec saucissonnage, insultes humiliantes, coups et blessures ; l’incendie volontaire d’un hôtel du 10e arrondissement, qui a causé la mort de deux réfugiés politiques ; à son domicile, l’assassinat particulièrement atroce d’une vieille dame, psychanalyste à la retraite, qui menait une vie en apparence sans problème. Dans chacune de ces enquêtes, les investigations qu’elle coordonne sont en cours. Dans le premier dossier, de notables progrès ont été accomplis, l’interpellation des braqueurs est imminente. Elle sera sans doute décidée lors de la réunion qui se tiendra ce matin. La commissaire conduira l’opération, elle y tient.
Ce métier, Odile l’a dans la peau, il lui correspond parfaitement. La charge est certes lourde, et les résultats parfois frustrants, mais il lui donne le sentiment d’être vivante, vivante et utile. Le cocktail est détonnant : un zeste d’adrénaline posé sur un mixte de science et d’intuition, beaucoup de mouvement, et toujours l’imprévu qui oblige à la plus rigoureuse des improvisations, bien au-delà de l’aide précieuse apportée par les techniques modernes d’investigation.Les registres de l’âme humaine sont infinis, Odile les découvre chaque jour, et en absorbe avec intérêt les combinaisons. La pire noirceur côtoie l’imagination la plus élégante, de candides intentions accompagnent les crimes les plus odieux, la raison sert toujours d’avocat à la folie. Mais par-dessus tout, sont souvent présents le lucre et l’intolérance, ces puissants moteurs du crime, deux inclinations qui pourrissent aussi la vie sans excès des bons citoyens, la rendant souvent pathétique.
8h50, Odile arrive enfin. Elle abandonne son véhicule dans la cour du « 36 » déjà bien remplie, entre prestement dans le bâtiment. La commissaire s’autorise un café, servi par une machine capricieuse, puis rejoint la salle de réunion. Un entrelacs de couloirs étroits et d’escaliers vénérables l’y conduisent.
3
Paris, le 17 juin2014
8h50, avenue Mozart. Guilhem Archambaud est à sa table, devant le petit déjeuner qu’Augusta lui a servi. Il feuillette distraitement Le Figaro du jour, et trempe une mouillette dans l’œuf encore chaud qui garnit son coquetier. Le café fume dans sa tasse, des croissants l’attendent, qui rivalisent aujourd’hui avec les petits pains moelleux de chez Lenôtre et la confiture d’orange, sa préférée. Une nouvelle journée s’annonce..., mais quelle journée au juste ? il verra bien. Guilhem « ne fait rien » dans la vie, rien de professionnel du moins : il est rentier. Dans l’hôtel particulier de ses parents dont il occupe une aile entière, règne le silence. À cette heure, son père a depuis longtemps rejoint ses bureaux ; sa mère s’apprête, ses œuvres de charité l’attendent. Lui traîne, c’est ainsi. Il a prévu un golf vers midi, mais rien d’autre avant ce soir. La journée étirera sa torpeur jusqu’à son rendez-vous nocturne.
Dans la vie, Guilhem s’ennuie. Il traîne sa nonchalance sur différents théâtres, mais aucun n’allume en lui la moindre étincelle, peu de choses l’intéressent. À 41 ans, il est le mouton noir de la famille, l’enfant que l’on préfère escamoter dans les ors du palais familial. Petit déjà, sa mère le dit « dans la lune », presque absent. Il est silencieux, toujours calme, à l’opposé de ses deux aînés, pris dans la turbulente spirale de leur âge. Il est « facile » Guilhem, mais tellement réservé. Consultés, les médecins ne décèlent rien, rien du moins qui doive alarmer ses parents. Il grandit sans encombre, a une scolarité brillante, mais affectionne la littérature plutôt que « les affaires », au grand dam de son père. Originaire de Vendée, cet industriel a fait fortune dans le bâtiment, et se développe aujourd’hui dans la robotique et les médias. Il dirige un groupe désormais puissant, et a tracé l’avenir de ses enfants : ils rejoindront l’entreprise, lui succéderont. Les plus âgés obéissent, ils se forment pour cela dans les meilleures écoles de commerce, à l’étranger. Guilhem tergiverse, puis acculé, refuse tout net. Il rejette tout autant les propositions alternatives que lui font ses parents : grandes écoles, droit, médecine, sciences politiques, ingénierie..., rien ne lui convient.
Il choisit finalement la philosophie, s’inscrit à la Sorbonne. Les diplômes ne l’intéressent pas, mais il souhaite approcher le mystère de l’Homme, trouver une explication au fatras qui campe dans sa tête, et espère-t-il dénicher une voie qui le libérera du malaise existentiel, qui depuis toujours le tient. Guilhem n’est pas déprimé, non. Il ne se sent pas vide, mais ne trouve pas Le Sens, et Dieu ne l’aide pas. Du grand ensemble que le Créateur a modelé, quelle part lui réserve-t-il ? y a-t-il seulement sa place ? il n’en est pas convaincu. Guilhem est entouré de gens à l’aise dans leurs certitudes, parties parfaitement prenantes de leur existence et sûrs d’eux, alors que lui ne sait pas, décode mal, s’empêtre dans ses réflexions. Avec obstination, il tente de vaincre le désordre qui règne dans sa tête, mais sans succès. La religion pas plus que l’existentialisme ne l’éclairent. Il se sent étrange plutôt qu’étranger, traversé de courants contraires qui le figent, et lui dévorent le cerveau.
Car Guilhem est profondément croyant, il frôle le mysticisme. Le religieux le transperce et le crucifie. Son cœur vit la passion du Christ jusque dans la chair, mais il ne comprend pas : l’Homme, lui a-t-on dit, a été créé à l’image de Dieu, il le croit. Alors pourquoi le Seigneur l’a-t-il fait ainsi, pourquoi ? Il est homosexuel, et se pense maudit. Strictement fidèle aux principes de l’église, il vit cela comme une abomination. Pas comme une maladie non, mais comme un crime à l’égard de Dieu. Il se sent coupable, infiniment coupable, mais sa culpabilité - la traîtresse - se retourne contre lui. Puissante et agressive, elle sert de terreau fertile à son désir malsain, l’empêche de résister, le plonge encore et encore dans le stupre. Aucune tentative ne l’en sort, surtout pas la confession, qu’il pratique pourtant avec assiduité, ni la flagellation que mentalement il s’inflige. Qu’elle prescrive absolution ou punition, aucune théurgie ne le guérit.
Hostile au PACS, au mariage gay, à la PMA et à tout le reste, il s’est un temps, associé aux cortèges de « la manif pour tous », mais y a côtoyé beaucoup de haine et d’insultes ; de la violence aussi, grossière, souvent aveugle. Ces gens-là ne comprennent pas. Ils s’attaquent à l’Autre, à la Bête qu’ils pensent étrangère, mais à aucun moment ne descendent en eux-mêmes, ne sondent le magma brûlant de leurs désirs, ni ne tentent d’atteindre en profondeur le vice qui probablement stagne en eux, et pourrit leur âme. Ils protestent, pleins d’assurance et d’intolérance, lancent des anathèmes, mais s’en contentent. Guilhem n’en reste pas là, il choisit d’agir radicalement. Coupable, il empoigne son destin à pleines mains, et se laisse glisser. Il se soumet à l’abomination, s’en rend esclave pour mieux s’en affranchir. Guilhem se souille « à fond », s’humilie jusqu’à l’écœurement. Il baise et baise encore, en espérant vaincre son penchant immonde, et se laver ainsi du péché... ; mais il échoue à chaque tentative.
Sa singularité a cependant un prix qu’il n’hésite pas à payer : Guilhem vit « a minima ». Il s’insère du bord des lèvres dans son milieu, se désintéresse du monde, déambule simplement dans l’existence ; sa condition de nanti le lui permet. Il traîne son indolence à la lisière du volcan, vaque parmi les siens, ces privilégiés qui l’intéressent pourtant si peu.
Sa mère a bien tenté de le marier. Elle a organisé pour lui des dîners auxquels il ne s’est pas soustrait. Les prétendantes avaient des qualités, mais il était ailleurs, et vite se défilait. Alors maman s’est lassée, elle s’abstient depuis. Malgré le silence qu’elle lui oppose, Guilhem pense qu’elle a compris. Maman connaît désormais son secret mais se tait ; et c’est bien ainsi. Il a aussi fréquenté les « rallyes », tiré par des amis qui, prévenants, ont voulu prendre ses amours en main. Avec tact et un certain talent, il a éconduit une théorie de « belles » qu’il trouvait, pour la plupart, futiles ou prétentieuses, aucune ne l’a troublé. À toutes, il parut d’ailleurs bizarre ; elles n’insistèrent pas. Dans son milieu, Guilhem a ainsi acquis une réputation de « dandy extravagant », à ne fréquenter qu’avec modération. Cela lui confère une certaine liberté, une belle latitude pour affronter sa vie secrète, et s’y perdre plus encore à chaque épisode.
Ses amours sont clandestines, faites de caresses, de sperme, de fange ; d’un peu de violence aussi : viriles. Elles se tissent au hasard de rencontres, sont le plus souvent anonymes, ne durent jamais : une succession bancale d’amours qui ne sont pas l’Amour. Dès que « l’affaire est faite », la nausée succède au plaisir, Guilhem s’en veut. Il se maudit, implore l’aide de Dieu, mais n’obtient jamais de réponse. Le pêcheur n’est pas heureux, mais il reste enchaîné à ce funeste contrat, qui de manière répétée associe jouissance coupable du corps et martyr rédempteur de l’âme. Pourtant, depuis quelques semaines, il y a Yusuf..., ça, c’est nouveau.
Il est temps de bouger. Guilhem referme son journal, quitte le salon et rejoint la salle de bains, Augusta y a tout préparé. L’eau est à bonne température, la mousse onctueuse. Il se coule avec plaisir dans l’immense baignoire à l’ancienne (récupérée par son père sur le paquebotFrance, avant qu’il ne devienne Norway), et s’y laisse fondre un moment. Puis, gant de crin en main, sans savon, il frotte frénétiquement chaque parcelle de son corps, sexe inclus, au point d’en irriter la peau. Des larmes lui viennent aux yeux, mais un sourire égaie son visage. « Yusuf » rêve-t-il, « ce soir ».
Deux heures plus tard, il atteint Feucherolles en voiture (un cabriolet récent, de marque étrangère, qui ne le distingue pas de ses fréquentations), et se gare dans le coquet parking du domaine, réservé aux hôtes les plus en vue. Il se rend d’abord au club-house, où il retrouve Benoit et Arnaud, ses partenaires de golf, aujourd’hui accompagnés d’avenantes créatures qu’ils exhibent comme des trophées, et qui confortablement installées sur la terrasse, les regarderont jouer au loin, fourmis perdues sur ce vaste océan de velours vert, vallonné à souhait. Ses amis sont riches, célibataires, désœuvrés. Ils arpentent la vie avec désinvolture, un peu comme lui. Mais eux sont en recherche permanente de paillettes, de victoires faciles, là est la différence. Guilhem se cache, eux se montrent ; ses deux compères sont légers, lui est douloureux. Mais extérieurement rien ne les distingue, ils flottent.
Petite collation prise, les trois hommes se dirigent en voiturette vers le départ du N°1, sacs de golf garnis, et défi en bandoulière. Parcours blanc aujourd’hui. C’est à qui terminera son 18 trous avec le meilleur score. Les drive se mettent à claquer, les balles quittent les tees et s’envolent. S’enchaînent alors des swings, on se rapproche des greens, les pitchs se relèvent, on putte, et on peaufine à l’occasion les chips, on s’extrait en riant des bunkers. Les trous s’atteignent parfois en coup roulé, quelques birdies sont réalisés,mais aucun hole in one cette fois. Le parcours se déroule ainsi, lentement, posément, ponctué d’exclamations ou de félicitations, de quelques propos fielleux aussi, que l’on crache sur les absents. Rien en revanche sur l’actualité ou les problèmes du monde (qui les indiffèrent), ni sur les affaires qu’ils ont en cours. Ces trois-là n’en font pas lorsqu’ils jouent, ils règlent simplement de petits comptes.
–Gaston, le pôôvre, il va se marier, vous le saviez ?
–Non.
–Eh oui ! il me l’a dit hier. Et vous ne devinerez jamais avec qui ?... Héloïse de Montalembert ! Il a du courage, l’animal. Je lui conseille de commander une belle paire de cornes, il en aura besoin. À part toi, Guilhem, qui n’a pas couché avec Héloïse ?
–Hum ! en effet, elle a de l’appétit m’a-t-ondit.
–Je confirme. Et il paraît que ses parents ont fait faillite en 2008, de vilains investissements. C’est sans doute pour cela qu’elle se fait discrète. On ne la croise plus au Sunshine depuis des mois, pas plus qu’ici d’ailleurs. C’était pourtant une habituée. Tu as de ses nouvelles,toi ?
–Non, pas de nouvelles.
Guilhem répond mécaniquement, il ne cherche pas à alimenter la conversation. Les sujets sortent toujours du même tonneau, un brin frelatés. Avec finesse, on fait mine de s’apitoyer, mais on dénigre, on assassine élégamment, c’est le jeu. Eux aussi en sont victimes : ailleurs, à d’autres moments, par leurs semblables. Tous le savent et l’acceptent, l’essentiel étant de se maintenir dans l’apparence, cette arme de clan qui unit les membres de ce monde-là. Guilhem a décidé de s’y cacher. Par facilité et prudence, il nourrit le leurre.
Leur parcours terminé, les trois compères rejoignent leurs amies sur la terrasse du club house, agréablement ouverte sur un petit plan d’eau. Des canards s’y ébrouent et pataugent. Au loin, les flammes rougeâtres de quelques viornes du Japon ou d’érables canadiens cassent la monotonie plutôt sombre d’une épaisse forêt. Des boissons fraîches sont servies aux valeureux, on débat des mérites de chacun. Arnaud a fait le meilleur parcours, Guilhem n’a pas brillé. Les embûches étaient nombreuses après la pluie, le choix des clubs pas toujours facile à faire. La conversation glisse ainsi, légère et frivole, jusqu’à rejoindre leur sujet favori : les autres. On reparle de Gaston, d’Héloïse, de leur mariage « Quelqu’un a-t-il reçu une invitation ? » On évoque aussi la déconvenue d’Ambre, son lifting raté. Ah ! la chirurgie esthétique, voilà une conversation intéressante.
–La pauvre, elle ne ressemble plus à rien. Bertrand y a aussi eu recours, il avait des bourrelets et un ventre à faire disparaître, mais cela ne semble pas avoir marché.
–Qu’est-ce qui lui a pris, à Bertrand ? Pourquoi s’est-il fait charcuter ? Je préfère laisser ça aux femmes. Un régime et un peu de sport donnent de meilleurs résultats. Il ferait bien de nous rejoindre.
Bref, on s’ennuie avec gourmandise.
Pour Guilhem il est temps de se retirer, il se rafraîchira chez lui. Encore en tenue de golf, il quitte la table, salue la compagnie d’un simple mouvement de casquette, et muet, s’éloigne en évitant les vestiaires. Il en a suffisamment fait, ses amis termineront l’après-midi sans lui. Personne ne proteste. Tous sont habitués à ses manières étranges, à cet écart qu’il tient tant à maintenir, qui abrupt se manifeste sans prévenir. Un peu gênant Guilhem, mais pas méchant ; il sait être agréable lorsqu’il le veut. Et puis, il est le sujet de beaucoup de conversations. Sur lui, tout se dit mais rien ne se sait, et le mystère finalement séduit.
Guilhem regagne sa voiture, déchausse ses crampons et se met en route vers Paris. Encore une journée de passée, un court répit dans son irrépressible mal-être, ce cancer intime qui ne parvient pas à le tuer, mais dont il ne peut guérir. Du moins pourra-t-il l’oublier dans les bras du garçon qu’il verra ce soir, Yusuf, cet ange « tombé du ciel », ce jeune homme frêle et si doux qu’il fréquente depuis peu. C’est une première pour lui, habitué qu’il est aux chocs charnels sans lendemain, qu’il partage avec des gigolos trouvés dans les cafés du Marais ou en bordure des Tuileries. Avec Yusuf, c’est différent, les sentiments s’en mêlent. Le désir qu’il éprouve pour lui est bien plus dense que le seul besoin d’assouvir son appétit bestial de sexe, Guilhem est attiré par ce jeune homme. Il lui est attaché par d’étranges émotions, mi-érotiques mi-spirituelles.
4
Paris, le 14 décembre2012
Il l’a rencontré par hasard Yusuf, hors préméditation, un jour qu’il se baladait sans but loin de ses terres, dans le 18e arrondissement de Paris, vers Montmartre. L’air d’une musique singulière avait attiré Guilhem dans une boutique pittoresque, sorte d’épicerie-salon de thé à la vitrine colorée de boîtes empilées, d’étranges paquets et de rangées de bouteilles : le Mandeeq, à deux pas de La Chapelle. Le sol de l’échoppe est carrelé de blanc. Au fond, près du comptoir, une pile de cartons part à l’assaut du ciel. De longues étagères couvrent l’un des murs, chargées de produits exotiques en sacs, dont l’alignement forme une étonnante dentelle multicolore. Une odeur douce et tenace d’épices mêlées embaume la pièce, que de puissants néons éclairent.
Un peu surpris par son entrée, le serveur se munit d’un franc sourire, l’accueille et l’installe à l’une des rares tables encore disponibles. L’ambiance est ici communautaire, la langue parlée lui est inconnue. Guilhem commande une boisson au nom mystérieux. On la lui sert dans une théière bellement ouvragée, orientale, semble-t-il. Une affiche attire son regard, rédigée en trois langues, dont le français. Il apprend ainsi que l’épicerie est un lieu de rencontre et d’entraide pour les réfugiés somaliens. Des posters de ce pays décorent l’autremur.
À une table voisine, deux hommes conversent dans une langue qu’il ne comprend pas, du somali probablement. L’un d’eux est plus bavard. Imposant, relativement âgé, cheveux gris et grosse moustache, il semble donner des informations au jeune homme qui lui fait face. L’autre écoute l’air abattu, puis soudain prend sa tête à deux mains et la secoue, il semble exaspéré autant que désespéré. La conversation se poursuit, tendue. Mais Guilhem ne la suit pas. Son regard est happé par le garçon, par la beauté triste de ce visage, qui déjà alerte ses sens. L’éphèbe a la peau sombre, ses yeux sont brûlants, comme sertis dans l’ovale d’immenses cils noirs. Long et légèrement courbé, son nez plonge sur des lèvres claires, finement ourlées ; un menton discret complète l’harmonie de ses traits. Le garçon est efflanqué, misérablement habillé, mal chaussé, mais se dégage de lui un halo de lumière. « Il est beau comme un dieu » se dit Guilhem, in petto, « ...et cette chevelure en bataille ! mes mains implorent d’y plonger ». Guilhem se fige soudain, son cœur bondit, il vient de comprendre : l’allure du jeune homme est christique. De l’adolescent émane l’aura d’une icône, la finesse de ses traits semble immarcescible. Guilhem est à cet instant pétrifié.
Les évènements se précipitent alors. Le gamin éloigne sa chaise et se dresse. Le visage figé, sans un mot, il se dirige hâtivement vers la porte.
–Yusuf ! Yusuf !
Le moustachu reste assis, mais tente de le retenir par la voix, et en faisant de grands gestes. Yusuf ne répond pas ni ne se retourne, il sort. Guilhem à l’inverse réagit. Instinctivement, il quitte la table, y jette quelques pièces, et se lance à la poursuite de celui qu’il peut maintenant nommer. Mais quoi faire ? Comment se présenter ? que dire au jeune homme ? Et puis, parle-t-il seulement français, Yusuf ?
La suite reste un récit brumeux dans la tête de Guilhem, mais c’est un rêve qu’il aime à convoquer, et remodèle en permanence. Dans son souvenir, tout se déroule très vite, s’agence comme dans une scène de film romantique. Il rattrape Yusuf sur le trottoir, le prend par le bras. Contre toute attente, le garçon ne proteste pas, le contact s’établit facilement. Les deux hommes se présentent, et un temps immobiles sur la chaussée, conversent sans trop de peine en français. Après quelques échanges, le jeune homme sourit enfin. Guilhem lui offre une cigarette que ce dernier décline. Ensemble ils s’éloignent, en échangeant des propos dont Guilhem ne se remémore pas le détail, seulement le doux frisson qu’ils ont provoqué sur sa peau. Il est cependant certain d’une chose : ce jour-là, sa vie a basculé, l’adolescent a ce pouvoir-là. Au moment de se quitter, devant l’hôtel où l’éphèbe réside, ils échangent leurs 06 et se serrent la main. Instinctivement, les corps se rapprochent, Guilhem se souvient avoir frôlé la taille de Yusuf avant qu’ils se séparent.
Ils se revoient très vite sans réel prétexte, et quelques semaines plus tard, deviennent intimes, puis assez rapidement amants. Leur premier baiser est gravé dans la mémoire de Guilhem et fait signature : il lui a été volé dans la modeste chambre d’un hôtel de la rue Marx Dormoy. Yusuf est depuis son « galant secret ». La beauté sauvage du jeune homme lui fait du bien. Tout extérieure, aussi légère que l’écume d’un océan, elle ne semble traversée d’aucun tourment. Yusuf se bat simplement pour survivre, ne s’encombre d’aucune complication existentielle. Rudimentaire et âpre, son caractère le protège du doute. Sur Guilhem, qui empêtré dans un magma d’affligeants questionnements, se noie chaque jour en eau profonde, l’amour limpide du jeune homme agit comme un oxygène salvateur, et lui promet la surface.
Guilhem sourit. Il ouvre la capote de sa Mercedes, et ivre de désir accélère, dans l’espoir fou de vaincre le temps. Sans en être conscient, il fonce vers son destin.
5
Paris, le 17 juin2014
9 heures sonnent au 36, quai des Orfèvres. Dans une immense salle côté Seine, à l’odeur d’encaustique et toute en boiseries, la réunion débute sur fond de brouhaha décroissant. Y assistent tous les chefs de « la Crim », un responsable des « Stups », un autre de la Brigade Financière, et deux membres de la Brigade de Répression du Banditisme. L’époque de la guerre des polices est révolue. Le grand patron encourage la coopération entre services, cela semble bien fonctionner. Odile a pris place à la droite de son divisionnaire, et salue certains de ses collègues. Elle remarque la présence inhabituelle de Lionel Lemeure, le patron de la Sous-Direction AntiTerroriste. Sans doute aura-t-il des informations importantes à partager.
On fait le point sur les différentes affaires en cours. La valse des méfaits tourne toujours à quatre temps : chaque enquête est présentée, son exposé suscite des questions, on discute ensuite - parfois âprement, - puis les décisions sont prises. Dernière à s’exprimer, Odile présente les trois affaires dont son groupe a la charge. Comme à son habitude, elle a préparé des synthèses, et gère son temps de parole à la perfection. L’investigation débute à peine sur l’incendie volontaire. Aucune piste n’est à ce stade privilégiée, quoique les victimes soient des opposants kurdes au régime d’Ankara. Les interrogatoires ont commencé (personnel de l’hôtel, autres locataires, voisins, connaissances...), des perquisitions sont menées dans les milieux concernés, on épluche la correspondance des défunts. On attend aussi les résultats de l’analyse toxicologique, les deux individus ayant été trouvés comme endormis au moment de leur mort ; cela intrigue. Enquête à suivre donc.
Dans l’affaire de la vieille dame assassinée, Odile expose les détails sordides de son martyre qui, selon le légiste, semble avoir duré plusieurs heures. Les recherches s’orientent vers d’anciens patients, dont on sait que la thérapeute s’occupait toujours, car rien n’a semble-t-il été volé dans l’appartement, par ailleurs trouvé intact et en ordre. Là encore famille, proches, anciens confrères, voisins sont interrogés. La correspondance et les dossiers de la victime sont en cours d’examen, quelques pistes prometteuses sont explorées.
L’enquête sur le « home-jacking » de l’avenue Henri Martin a, quant à elle, bien avancé. L’autorisation de la juge vient de tomber, l’interpellation des suspects est imminente. Les braqueurs ont été « logés » dans un immeuble des Quatre Tours, au Blanc-Mesnil, devant lequel une planque a été mise en place 24 / 24. Odile et son équipe prévoient d’agir aujourd’hui même, en coordination avec le BRI et le RAID mobilisés pour l’occasion. Tout est planifié.
La réunion devrait se terminer, mais le divisionnaire donne la parole à Lionel Lemeure. Son exposé est clair et succinct : en cette année 2014, la menace terroriste s’est fortement accrue en Ile-de-France. Le nombre de projets d’attentats que ses équipes ont à traiter explose, les moyens dont il dispose ne suffisent plus. Il demande un soutien en personnel. Autour de la table, on comprend, on compatit, mais personne ne pense pouvoir prêter main-forte aux collègues de la SDAT, tout le monde étant bien occupé par ses propres affaires. Un lourd silence emplit la pièce jusque-là animée. Cela dure un temps, puis Odile réagit et donne volontiers son accord : elle détachera deux de ses inspecteurs à la SDAT. Suivent d’autres promesses dont Lionel Lemeure prend bonne note.
La séance est enfin levée, il est 12h20. Odile regagne ses bureaux où l’attendent les membres de son groupe. Sandwich à la main, elle anime un rapide débriefing, puis passe en revue une dernière fois les différentes phases de l’intervention prévue au Blanc-Mesnil. Arrive14h, la pendule sonne, c’est le top départ.
L’après-midi qui suit est de ceux qu’affectionne Odile. Être sur le terrain la stimule, lui donne l’impression d’exister pleinement, et confirme le choix qu’elle a fait, seule contre tous, d’être à ce poste, en mission pour la justice. Son leadership s’exerce ici sans réserve. La pertinence de son approche, la finesse de ses analyses et la proximité qu’elle sait donner aux relations humaines impressionnent ses hommes, qui tous lui manifestent respect et attachement.
Ce n’est malheureusement pas le cas de Laure, qui chipote à l’excès, et la contrarie sans cesse. Entre elles deux, le lien s’est inexorablement distendu avec le temps. Il s’apparente aujourd’hui à une guérilla dont sa fille (la rebelle) maîtrise mieux qu’elle les codes et les astuces. Odile se trouve souvent piégée dans des conversations sans issue, ou des confrontations assassines dont elle sort toujours vaincue. S’embrasser, se toucher, ou simplement exprimer son amour s’avère difficile. L’une et l’autre préfèrent l’évitement plus commode, et s’y résignent le plus souvent. Odile suit le chemin peu gratifiant de la « maman en charge », Laure préfère batifoler sur les sentiers battus de son immaturité, un tantinet perverse, la tête pleine d’idées à la mode. La commissaire souffre, s’en veut, et se flagelle parfois (« Mais qu’ai-je bien pu rater dans son éducation ? »), oubliant que la révolte concourt pour beaucoup à l’accomplissement d’un processus adolescent ordinaire. « Ah les gosses, quelle galère ! » pense-t-elle en atteignant Le Blanc-Mesnil. « Que va-t-elle encore m’inventer ce soir ?»...
Un grésillement interrompt sa réflexion. On l’informe par radio que le dispositif d’intervention est en place. On attend son feu vert. « Go ! ».
6
Paris, le 17 juin2014
Yusuf est un peu perdu ce matin. Comme souvent au réveil, il a du mal à réaliser. Assis sur le bord du lit, encore ensommeillé, il jette un regard étonné à la chambre dans laquelle il dort depuis quelques semaines, dans cet appartement qu’il occupe tout simplement, grâce à Guilhem. Il en est l’unique locataire, et le doit à son amant, mais hésite encore à le penser sien. C’est la première fois, la toute première fois de sa vie qu’il dispose de quelque chose à lui, uniquement à lui. Depuis son départ de Mubdija, ce petit village perdu de Basse Juda - le berceau familial, - il ne s’est jamais trouvé seul, n’a plus mangé ou dormi qu’en groupe et mal, n’a rien possédé qui lui fût propre, hormis les quelques guenilles qu’il a longtemps portées sur le dos. Mais il est désormais à Paris. Se laver en un lieu convenable, sans témoin, n’est aujourd’hui plus un luxe, pas plus que cuisiner ou entreposer ses affaires quelque part sans crainte, les ranger, et soudain avoir le sentiment de vivre « pour de bon », d’exister. Yusuf Omar Muhudin est enfin « chez lui », et n’en revient pas : il a réussi.
Comme pour beaucoup de migrants, son chemin a été pénible depuis la Somalie, périlleux même en quelques occasions. Mais il a bénéficié d’avantages que sa jeunesse et sa candide beauté lui ont donnés, Yusuf s’en est sorti pratiquement indemne. Il a eu raison de partir. La vie qu’il menait en Somalie était terrible, son cœur se fige encore lorsqu’il ravive les braises de sa mémoire.
Il a poussé dans une famille de paysans pauvres, Yusuf, dans cette misérable contrée du Sud-Somalie ravagée par d’interminables sécheresses et d’incessants conflits armés, auxquels personne ne sait donner un sens. Dans son village, rien ne pousse ou presque. L’eau s’évapore dès qu’elle touche le sol, avant même d’irriguer les champs ; sa rareté condamne les récoltes, les troupeaux et les hommes. Les quelques maigres chèvres que son père possédait finirent par devenir stériles, et ne donnaient pratiquement plus de lait ; certaines périrent. Quant aux survivantes, elles furent volées par un groupe se revendiquant des « Al Shabaab », une bande d’islamistes plus animés par la cupidité que par la foi. Lors du dernier raid dont il se souvient, ses parents faillirent perdre la vie, ses sœurs ne durent leur salut qu’à leur absence. Elles étaient parties en quête d’eau vers un puits lové au creux d’une colline proche et peu connue ; elles s’y réfugièrent durant l’attaque. En Somalie, les guerres sont le plus souvent menées par des bandes armées, des pillards sans loi ni merci qui rançonnent les villageois, massacrent les hommes, raptent bétail, filles et femmes, parfois même les garçons. Tout le monde le sait mais rien n’est fait, le pays n’étant pas gouverné.
Yusuf n’a pas d’anniversaire. Ses parents n’ont jamais su donner de date à sa naissance. L’année, le mois, le jour, il ne les connaît pas. Il sait simplement qu’il est né « pendant la grande saison des pluies, plutôt à son début », en avril probablement. L’année, il l’a déduite du rythme régulier auquel ses trois jeunes sœurs sont nées. À tout le monde, il dit avoir aujourd’hui 21 ans. Yusuf n’a jamais fréquenté l’école, quasi inexistante en milieu rural.
Très tôt, il accompagne son père aux champs, l’aide à ensemencer, puis à tirer de cette terre ingrate les piètres végétaux qui nourrissent la famille (sorgho et niébé essentiellement), et la maintiennent à peine vivante. Physiquement, il souffre beaucoup. Il s’épuise à creuser, biner, bêcher ce sol aride, à pousser, porter... ; à traire aussi ou à aider les chèvres lorsqu’elles mettent bas, ces mêmes chèvres qu’à l’occasion de rares fêtes son couteau de boucher égorge et équarrit. Le plus dur est pourtant ailleurs, dans cet isolement qui pèse sur sa conscience et l’étouffe. Séquestré au cœur du désert, maintenu à la marge du monde par la seule fatalité de sa naissance, Yusuf se sent très tôt spolié. Le destin a dérobé son avenir, l’a privé de sa vie d’humain, l’a troquée contre celle d’une bête de somme, il ne comprend pas. Son père cite fréquemment le Coran, ce livre si précieux à ses yeux, qui fait la part belle aux hommes - aux croyants du moins, - élève leur pensée jusqu’à la foi, les rapproche de Dieu, en fait des êtres d’exception. Le monde qu’il décrit est bien plus doux, brillant et riche que l’enfer dans lequel sa famille stagne depuis toujours. Quelle raison à cela ? Pourquoi tant de souffrance ? Quelle faute impardonnable expie-t-elle ? Aurait-elle offensé Dieu pour mériter un tel châtiment ? Lorsqu’il interroge son père, le jeune homme n’obtient d’autre réponse que sa colère, et reçoit en retour insultes et coups de bâton.
–Blasphème ! Tu blasphèmes Yusuf. Repends-toi immédiatement, et arrête de poser des questions. On ne discute pas la volonté de Dieu, béni soit-il.
–Mais, je veux simplement....
–Tais-toi, je te dis, ça suffit ! Sors d’ici tout de suite, je ne veux plus rien entendre. Va prier, et demande pardon à Dieu, tu l’as offensé en doutant de ses choix.