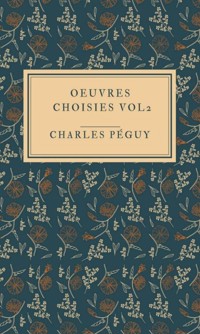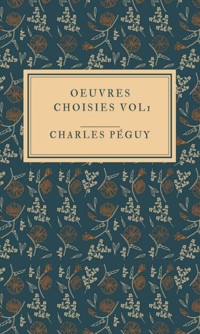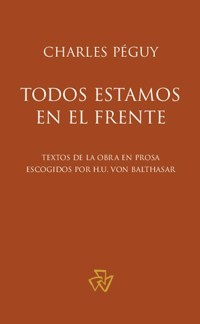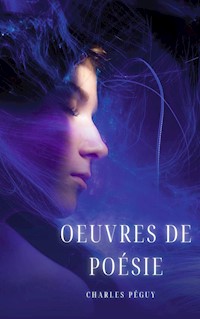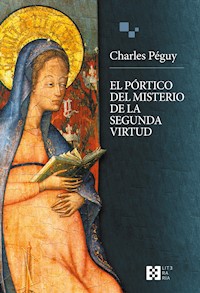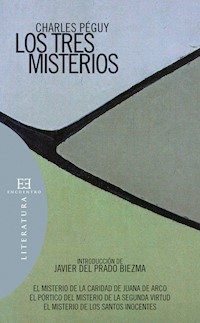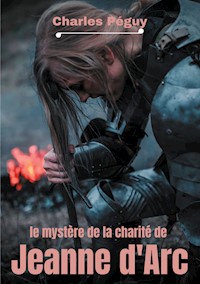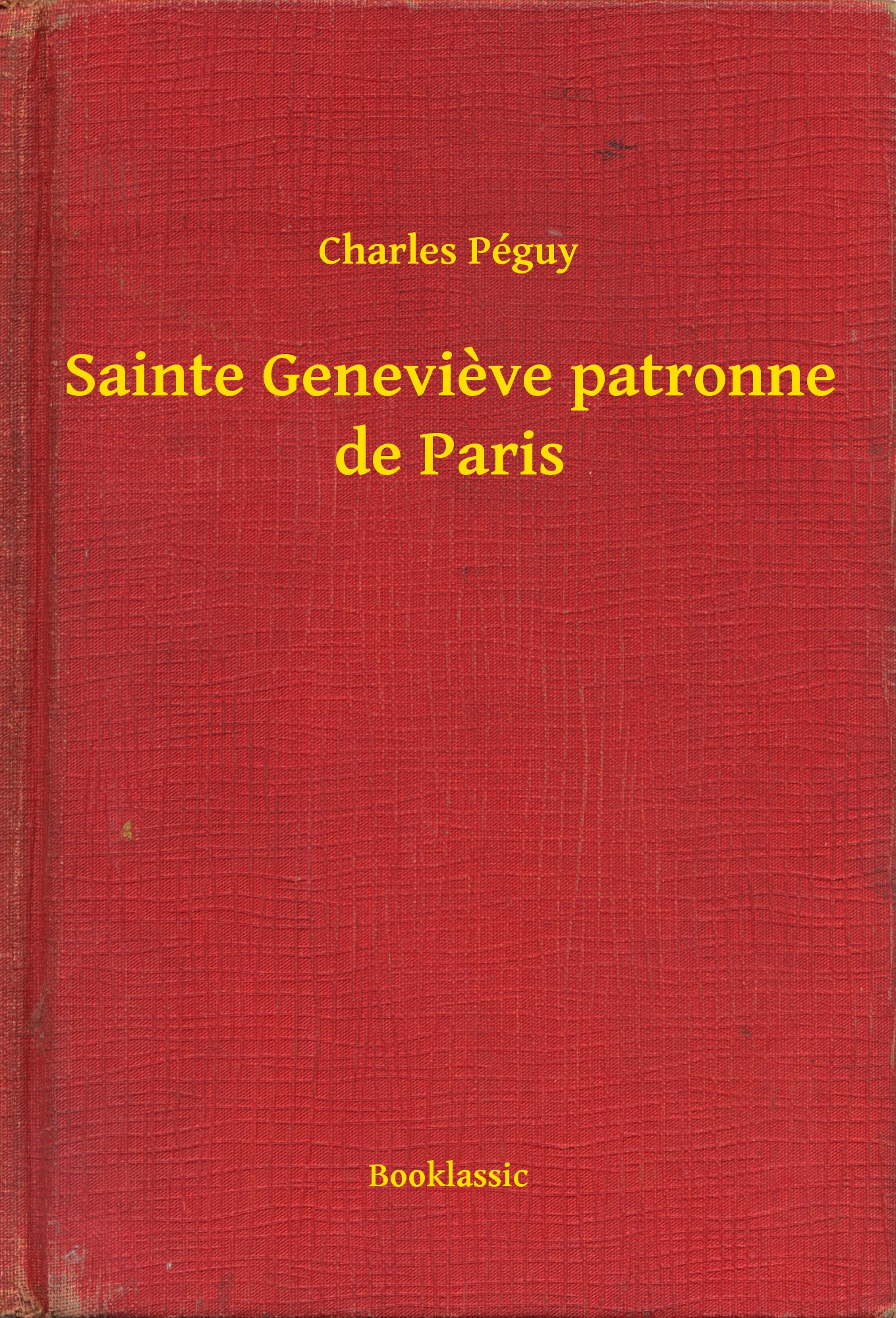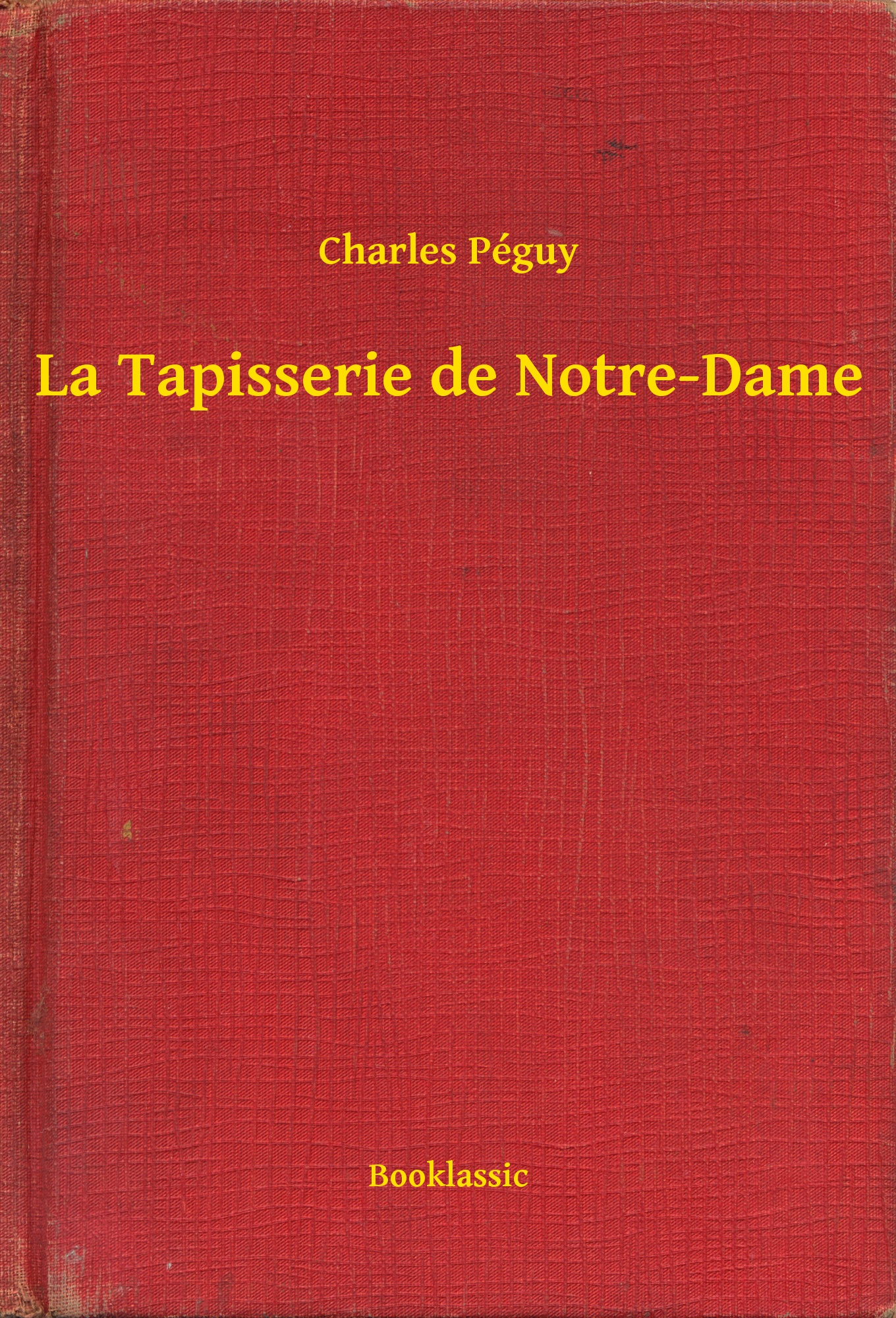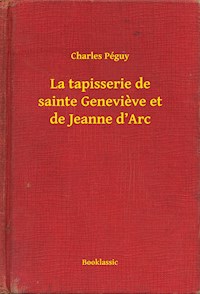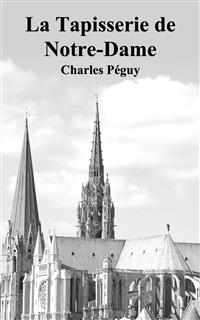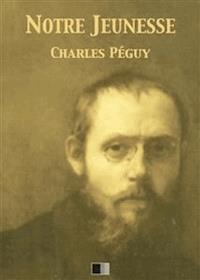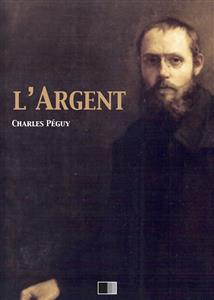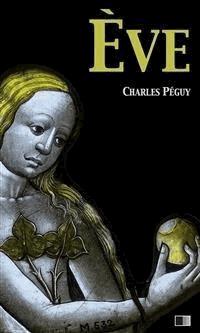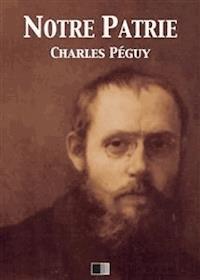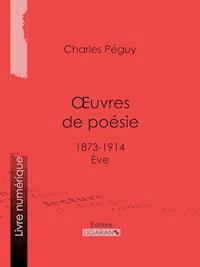2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Mes pensées de Charles Péguy sont un condensé de ses réflexions. Grâce à des extraits judicieusement choisis parmi ses nombreuses oeuvres et publications par son fils Pierre, nous disposons ici d'un ouvrage de référence.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sommaire
PREFACE
INTRODUCTION
LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ
NOTRE PATRIE
L’HISTOIRE
LE MONDE MODERNE
LA FOI
Renseignements pratiques :
Toutes les citations ont été faites d’après l’édition des Cahiers de la Quinzaine, seule édition originale. La pagination est celle des Cahiers, la typographie des titres est aussi celle des Cahiers. (…)
Toutes les pensées appartenant au même Cahier sont précédées de la date de publication et du titre de ce Cahier (ou partie de Cahier). Toutes les coupures sont indiquées par des points de suspension. Bien retenir enfin que dans l’énumération des Cahiers, le chiffre romain indique le numéro de la série, le chiffre arabe le numéro du Cahier, ainsi : XIV, 9 signifie neuvième Cahier de la quatorzième série.
PREFACE
Dans un premier recueil qui nous faisait relire les prières de Charles Péguy, le lecteur suit la laborieuse préparation de son âme.
Nous la suivons encore cette préparation dans ce nouveau recueil. Le lecteur n’y trouvera pas de longs poèmes, mais des sentences brèves, si pleines de vie, impérieuses comme des commandements militaires
On sent que Péguy cherche sa route ainsi que celle de la France vers plus de vérité, de justice et de charité.
Il sait, il sent qu'il ne peut se sauver tout seul. Aussi veut-il que tous ensemble, la main dans la main, s’acheminent vers le salut.
De là son appel si plein d’une rude franchise aux hommes de son temps pour les arracher aux mensonges et les entraîner vers la vérité qu'ils ignorent.
Qu’elle est émouvante cette parole écrite par Péguy à la fin de sa vie : « La justice et la vérité que nous avons tant aimées, à qui nous avons donné tout, n’étaient point des vérités et des justices de concept ; elles étaient organiques, elles étaient chrétiennes.
« ...Et de tous les sentiments qui ensemble nous poussèrent, une vertu était au cœur, et c’était la vertu de charité. »
Dans ces pages on voit une pensée en marche, une intelligence qui aspire à la vérité et la cherche sans l'atteindre encore. Mais n’est-ce pas déjà un hommage et une espérance ?
Pour lui aussi « le chemin du salut est raboteux ». Il est beau et réconfortant de contempler cet effort parfois rude, toujours sincère et si profondément humain qui « brise les vieilles servitudes, renverse les préjugés et les idoles, et monte peu à peu vers la lumière » ?
En lisant ces pages on a la ferme espérance que Dieu a exaucé cette âme ?
JEAN, cardinal VERDIER,
Archevêque de Paris.
INTRODUCTION
Pensées fait suite à Prières.
Prières se donnait l’aboutissement. Pensées voudrait refaire le chemin : donner du moins le désir de le refaire, amener à la lecture de l’œuvre entière en proposant quelques lignes isolées.
La difficulté d’une pareille tentative n’échappera à personne. Dans cette diversité vivante et agissante, dans cette création continue de pensée, il fallait d’abord couper : nous nous condamnions par là à ne retenir que des départs et des arrivées, des repliements ou des épanouissements, des points de cristallisation, jamais la ligne elle-même de la pensée dans toute son ampleur et toute sa hardiesse.
Ensuite, il fallait recoudre. La pensée de mon père n’est pas une ligne unique, c’est plutôt comme un arbre dont les branches s’étendraient à mesure que le tronc s’élève : si peu de problèmes relativement sont abordés dans les premiers cahiers, les dernières œuvres, comme Note Conjointe, sont d’une richesse et d’une variété incroyables, tout est repris à la fois, tout est poussé en avant d’un mouvement continu. Il en résulte qu’un ordre strictement chronologique risquait de dérouter le lecteur.
Celui que j’ai adopté :
la recherche de la vérité,
notre patrie,
l’histoire,
le monde moderne,
la foi,
présente les inconvénients de tous les classements : il est une demi-mesure entre l’ordre chronologique pur et la division infinie des sujets. Surtout nos préoccupations présentes y, transparaissent peut-être trop. Mais comment faire autrement ? Ne serait-ce pas trahir la pensée de mon père que de refuser d’y voir tout ce qui semble prophétiser, avec une angoissante précision, tous nos dangers actuels. Personne, je crois, n’osera nier que les difficultés dont je parlais il y a deux ans ne se soient encore beaucoup aggravées ; en présentant au plus large public possible ces pages écrites entre 1900 et 1914, je voudrais qu’elles puissent contribuer à ouvrir tous les yeux qui peuvent encore s’ouvrir.
Gap, le 24 avril 1926. .
Pierre PEGUY.
LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ
I, 1, 5 janvier 1900,
lettre du Provincial.
Dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste.
On aurait tort de s’imaginer qu’on peut distinguer entre les vérités, respecter aux moments de crise les grandes vérités... et dans la vie ordinaire négliger les petites vérités familières et fréquentes.
Nous avons donné à la vérité ce qui ne se remplace pas, des amitiés d’enfance, des amitiés de quinze et de dix-huit ans... Ayant subi cela pour la vérité, nous n’accepterons pas qu’on nous force à la lâcher pour ménager les susceptibilités, les amours-propres, les épidermes de quelques individus.
1, 2, 20 janvier 1900,
réponse provisoire.
Il ne suffit pas de prêcher : il faut d’abord savoir ce que l’on prêche... Il ne suffit pas de propager, propager. Nous devons faire attention à ce que nous propageons. Toute propagande qui n’est pas de vérité entière est mauvaise.
(préparation du congrès.)
Dans toutes les discussions publiques, aussitôt qu’on réplique à un orateur : « vous faites des personnalités »... l’orateur se tait et s’excuse... Je n’ai jamais entendu un seul citoyen répondre à l’interrupteur : « Parfaitement, monsieur, je fais des personnalités, parce que je dois faire ici des personnalités. »
Quand on manque à la vérité, mon ami, on manque forcément à la justice : à vérité incomplète, justice incomplète, c’est-à-dire injustice... Quand nous refusons d’attribuer aux personnalités marquantes la part qu’elles ont dans les événements, nous transférons cette part aux petites personnalités des soldats oubliés et de la misérable foule.
I, 6, 20 mars 1900. De
la grippe.
Nous disions hardiment que l’immortalité de l’âme, c’était de la métaphysique. Depuis je me suis aperçu que la mortalité de l’âme était aussi de la métaphysique. Aussi je ne dis plus rien.
I, 9, 5 mai 1900.
entre deux trains.
Je plains tout homme qui n'en est pas resté à sa première philosophie, j’entends pour la nouveauté, la fraîcheur, la sincérité, le bienheureux appétit.
II, 5, 28 janvier 1901,
pour moi.
Je désobéirai si la justice et la vérité le veut.
II, 7, 2 mars 1901,
Casse-cou.
Il va donc falloir à présent que l’on soit matérialiste et athée... Comme si le matérialisme n’était pas une métaphysique, et l’athéisme une théologie. Quand un bourgeois français inculte et grossier proclame qu’il est matérialiste cela veut dire en gros qu’il a envie d’outrager la morale usuelle. Et quand il dit : Je suis athée. Cela veut dire en gros qu’il a envie d’embêter les curés. Je ne vois pas quel avantage nous aurions, ni quel intérêt, à imiter les vieux bourgeois dans ce qu’ils ont de grossier et d’inculte, à imiter les vieux-radicaux dans leurs infirmités mentales, ou morales.
Nous avons de la matière une idée plus confuse encore et moins utilisable que celle que nous avons de l’esprit.
Je n’éprouve aucun besoin d’unifier le monde. Plus je vais, plus je découvre que les hommes libres et que les événements libres sont variés.
L’histoire n’est pas socialiste. Elle est historique. La philosophie n’est pas socialiste. Elle est philosophique.
Malheureux celui qui n’a pas au moins une fois, pour un amour ou pour une amitié, pour une charité, pour une solidarité, remis tout en cause, éprouvé les mêmes fondements, analysé lui-même les actes les plus simples.
II, 10, 4 avril 1901,
cahier d’annonces.
La révolution sociale sera morale, ou elle ne sera pas.
II, 12, 13 juin 1901,
préface de Jean Coste.
A moins d’avoir du génie, un homme riche ne peut pas imaginer ce qu’est la pauvreté.
II, 15, 23 juillet 1901,
mémoires et dossiers.
Flatter les vices du peuple est encore plus lâche et plus sale que de flatter les vices des grands.
III, 1, 1er octobre 1901,
compte rendu de congrès.
La pire des partialités est de se refuser, la pire ignorance est de n’agir pas, le mensonge le pire est de se dérober.
III, 2, 17 octobre 1901,
vraiment vrai.
Tout homme a droit qu’on le combatte loyalement.
III, 4, 5 décembre 1901,
de la raison.
La justice, la raison, la bonne administration du travail demandent que les intellectuels ne soient ni gouvernants ni gouvernés.
Loin que le socialisme soit définitif, il est préliminaire, préalable, nécessaire, indispensale, mais non suffisant.
C’est un insupportable abus de l’autorité paterternelle que de vouloir imposer aux générations neuves les radotages des générations fatiguées, vieilles, que nous sommes.
La presse constitue un quatrième pouvoir. Beaucoup de journalistes, qui blâment avec raison la faiblesse des mœurs parlementaires, feraient bien de se retourner sur soi-même et de considérer que les salles de rédaction se tiennent comme les Parlements... Les journalistes écrivent comme les députés parlent. Un rédacteur en chef est un président du conseil, aussi autoritaire, aussi faible.
La popularité aussi est une forme de gouvernement, et non des moins dangereuses.
III, 5, 19 décembre 1901,
lettre à M. Ch. Guteysse
Reconnaissons que la convertion soudaine en masse est dans le temps présent toujours grossière et causée par des malentendus. Sachons que la propagande est soumise aux lois ordinaires du travail, que l’on n’a rien sans peine, — et sans peine lente. Sachons que la formation d’un esprit n’est pas l’application d’une étiquette. Habituons-nous à cette idée que d’avoir contribué à former un seul esprit dans le monde est déjà un résultat considérable. Nous ne sommes pas des grands capitalistes d’esprits et de consciences. Nous ne sommes pas de grands propriétaires d’hommes. Sachons procéder par élaboration laborieusement lente. Sachons nous adresser aux esprits individuels, aux consciences personnelles. Soyons modestes
C’est une illusion dangereuse que de croire que l’on peut publier sans recevoir, écrire sans lire, parler sans écouter, produire sans se nourrir, donner de soi sans se refaire.
III, 6, 28 décembre 1901,
préface de la Grève de
Jean Hugues.
Le classique se connaît à sa sincérité, le romantique à son insincérité laborieuse.
III. 7, 16 janvier 1902,
réponses particulières.
J’accorde à la plupart des hommes un crédit beaucoup plus considérable que celui où ils ont droit. Outre mon imbécillité naturelle, je le fais exprès : mieux vaut mal placer du crédit à beaucoup de gens que de s’exposer à refuser du crédit à un seul qui le mériterait.
Je hais la pose comme un vice et la lèche comme une ordure.
Il faut savoir parler d’argent quand il faut. Il y a une espèce de tartuferie à s’en taire.
III, 8, 13 février 1902.
Jean Coste.
A la plupart des grands théoriciens socialistes, il a manqué d’être pauvre.
III, 9. 22 février 1902,
avertissement à une lettre
inédite de Tolstoï.
Les débats ne se poursuivent efficaces que dans les hauteurs.
III, 12, 5 avril 1902,
personnalités.
La guerre contre la démagogie est la plus dure de toutes les guerres.
Presque toute la culture universitaire est de la fausse culture.
Quand on rend les enfants malheureux, on est un criminel et on risque de les tuer. Quand on les rend heureux, on a raison, mais on risque de les rendre niais, présomptueux, insolents.
Ce qu’il y a de pressé, d’urgent, c’est de barrer la route à la démagogie politique et sociale, intitulée socialiste, à la démagogie littéraire.
Refaire un public ami de la vérité sincère, de la beauté sincère, un public peuple, ni bourgeois ni populace, ni faisandé ni brute, c’est la tâche redoutable où nous sommes attelés.
Le peuple, avant la culture, a les proverbes qui sont déjà dangereux, parce que l’on ne croit pas tout à fait que c’est de la pensée. Certains intellectuels, après la fausse culture, ont les formules, qui sont grossières comme les proverbes, et qui sont tout à fait dangereuses, parce que l’on croit tout à fait que c’est de la pensée.
Je croyais quand j’étais petit que les groupes travaillent. Aujourd’hui nous savons que les groupes ne font aucune œuvre. Ils font de l’agitation.
III, 14, 22 avril 1902,
Cahiers de la Quinzaine.