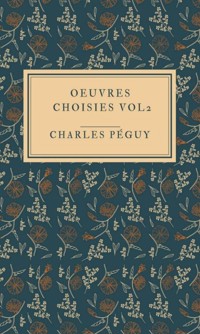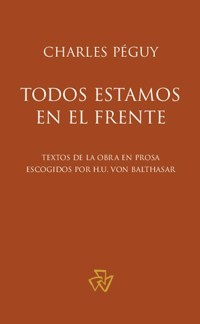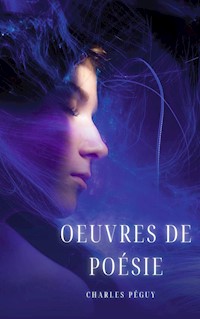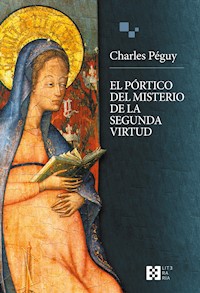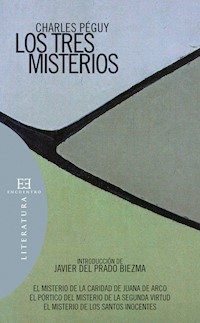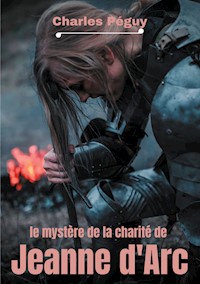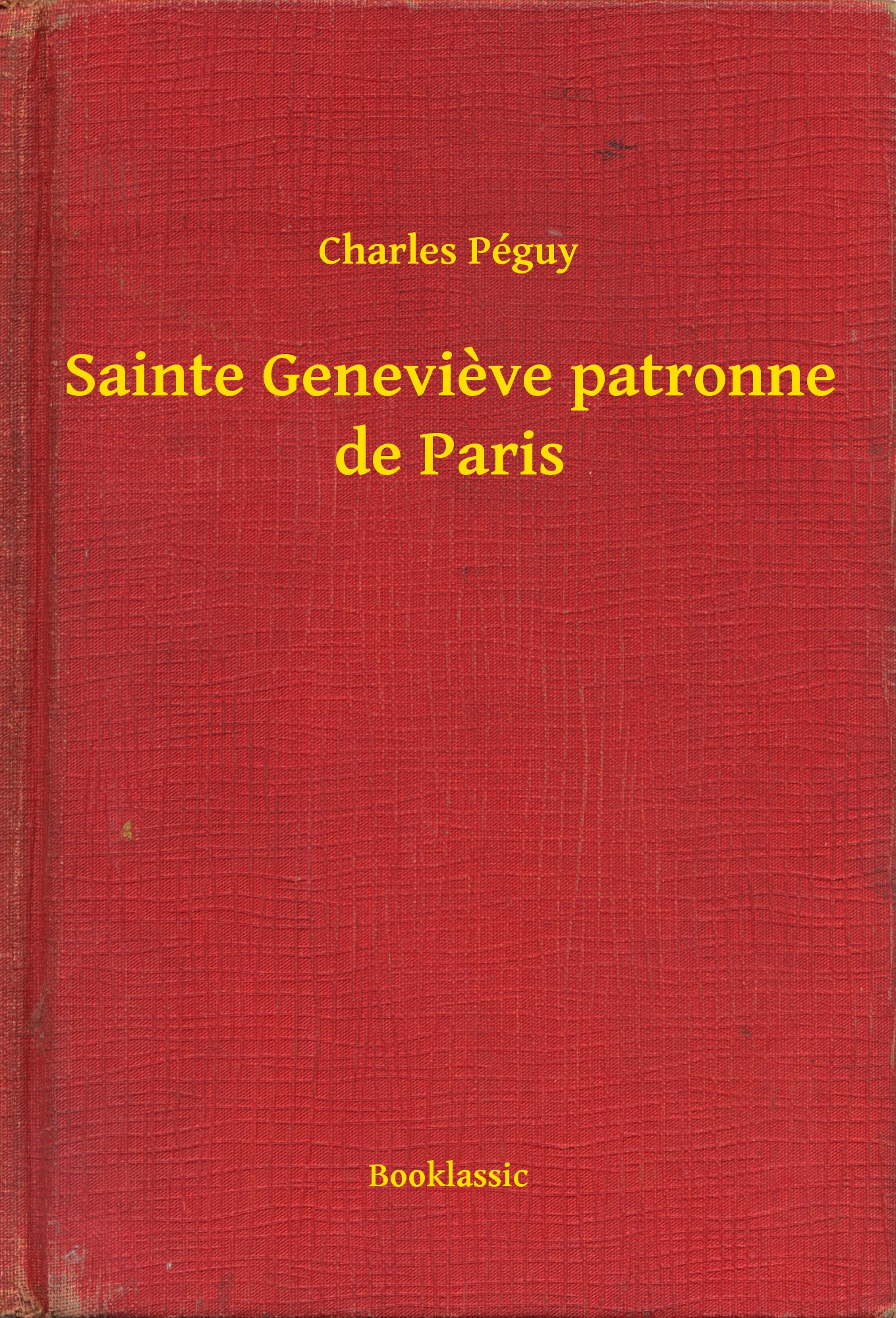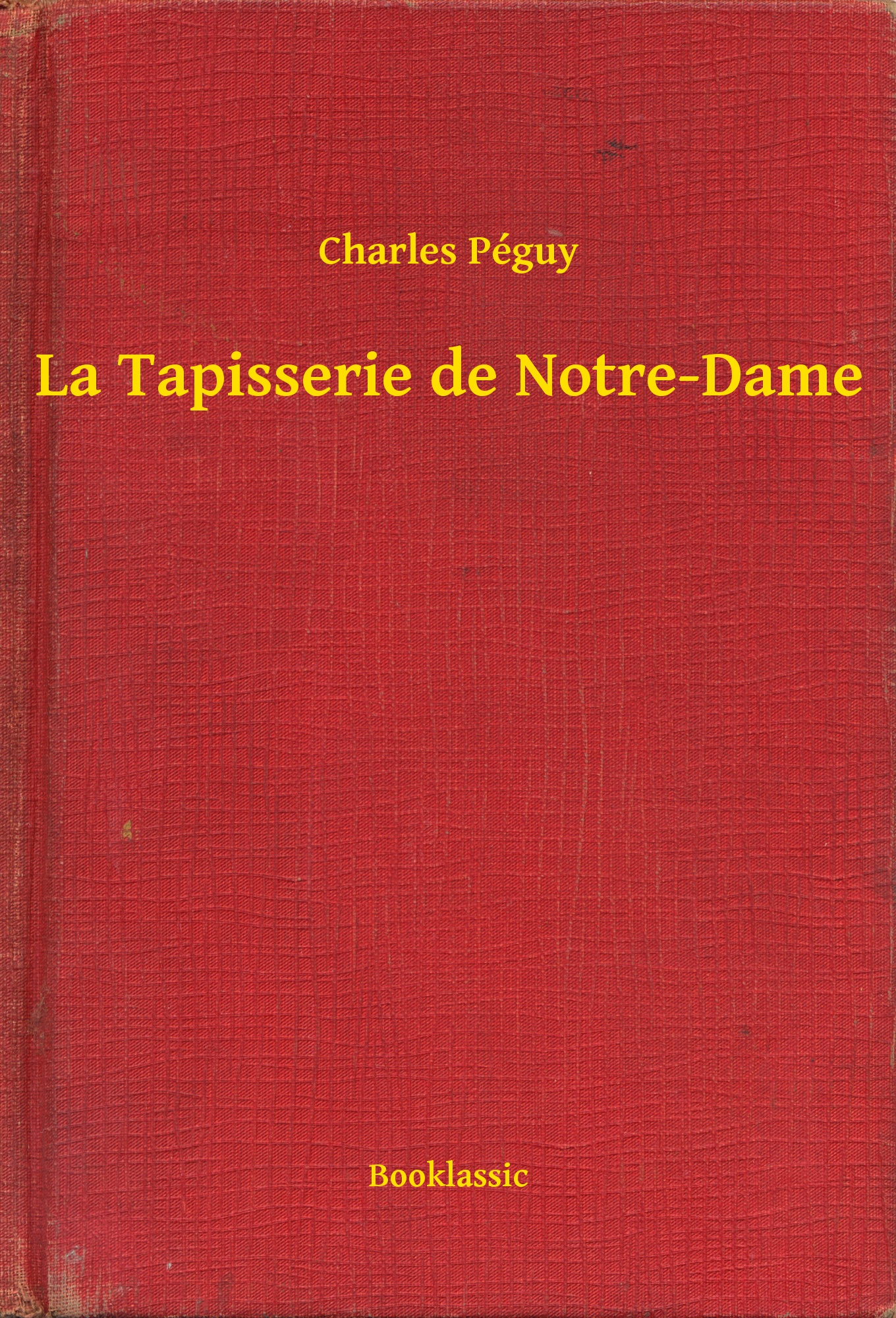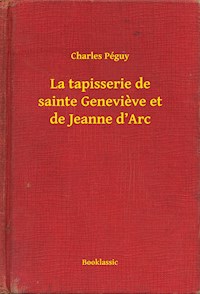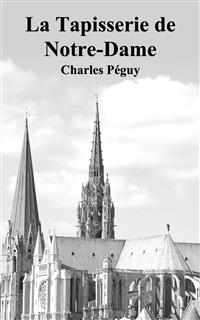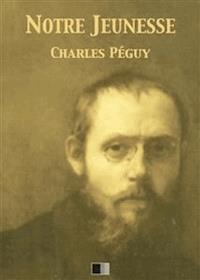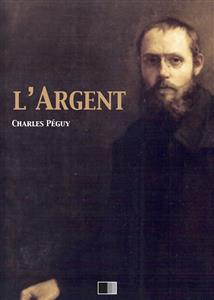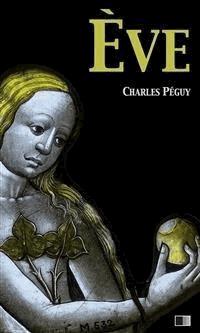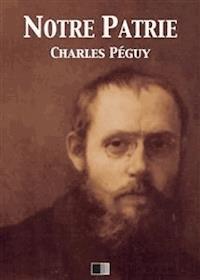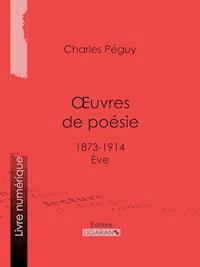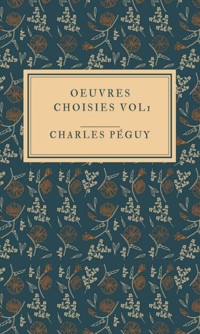
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
DE JEAN COSTE, Mon mari fait depuis quelque temps partie de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, et nous lisons les Cahiers de la Quinzaine, qu'un autre membre de la ligue veut bien nous passer obligeamment. J'ai pensé que, étant donnée l'importance de la publication dont vous êtes gérant, vous devez être en relation avec beaucoup d'hommes de lettres, de journalistes, d'éditeurs, de libraires. L'esprit démocratique qui anime les articles des cahiers me donne bonne idée de la fraternité qui doit unir les auteurs et les lecteurs; c'est pourquoi je me permets de vous demander un service. ORLÉANS VU DE MONTARGIS, ZANGWILL,NOTRE PATRIE, COURRIER DE RUSSIE, LES SUPPLIANTS PARALLÈLES
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ŒUVRES CHOISIES
Vol. 1
de
Charles Péguy
DE JEAN COSTE
ORLÉANS VU DE MONTARGIS
ZANGWILL
NOTRE PATRIE
COURRIER DE RUSSIE
LES SUPPLIANTS PARALLÈLES
DE JEAN COSTE
Ce qui fait que je n'avais pas de la joie de ce que les gendarmes embarquaient les sœurs en troisième, c'est que j'avais reçu un peu avant le commencement des vacances la lettre suivante:
Montée de Charente
22 juillet 1902
Monsieur Charles Péguy,
gérant des Cahiers de la Quinzaine
8, rue de la Sorbonne, Paris
Monsieur
Mon mari fait depuis quelque temps partie de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, et nous lisons les Cahiers de la Quinzaine, qu'un autre membre de la ligue veut bien nous passer obligeamment.
J'ai pensé que, étant donnée l'importance de la publication dont vous êtes gérant, vous devez être en relation avec beaucoup d'hommes de lettres, de journalistes, d'éditeurs, de libraires. L'esprit démocratique qui anime les articles des cahiers me donne bonne idée de la fraternité qui doit unir les auteurs et les lecteurs; c'est pourquoi je me permets de vous demander un service.
Nous sommes de très pauvres gens. Mon mari est employé de perception aux appointements de 60 francs par mois; je gagne 80 francs comme institutrice publique. Nous sommes mariés depuis trente-trois mois et j'aurai dans un mois et demi mon troisième bébé.
Tant de besoins et de si maigres ressources vous laissent deviner que nous vivons étroitement. L'arrivée d'un nouvel enfant, la perspective des dépenses prochaines, qui vont être si lourdes à notre petite bourse, nous fait désirer de travailler un peu plus afin d'augmenter nos ressources. Or il nous est bien difficile de trouver, dans la campagne où nous sommes, des occupations supplémentaires.
J'ai pensé que peut-être vous pourriez nous procurer quelque travail de plume: adresses à faire, manuscrits à copier, etc. J'espère n'avoir pas trop présumé de votre obligeance; je pense que vous voudrez être assez bon pour me répondre. Puisse votre réponse m'apporter une bonne nouvelle, je vous serai infiniment reconnaissante! Je prends mes vacances le 2 août; j'aurai un mois et demi de loisirs et je serai si heureuse de pouvoir les employer utilement!
Daignez agréer, monsieur, avec mes excuses pour la peine que je vais vous causer, l'expression de mes remerciements et de mes sentiments les plus distingués.
Marguerite Meunier,
Institutrice primaire publique
à la Montée de Charente
Charente
Bien entendu, j'ai modifié les noms propres, le nom de la commune, la signature. Une institutrice qui cherche du travail pour nourrir ses enfants serait mal notée des grands chefs; de telles démarches feraient croire que les familles des instituteurs ne sont pas complètement heureuses.
Mais si quelqu'un de nos abonnés veut entrer en relation avec cette famille et peut lui procurer du travail, nous serons heureux d'établir la communication. Écrire à M. André Bourgeois.
⁂
Cette lettre nous parvint quelques jours avant le commencement des vacances. Nous recevons un assez grand nombre de lettres écrites par des instituteurs; j'aime cette écriture soigneuse, régulière, grammaticale, presque toujours modeste, calme, et déjà conforme à la typographie; ce papier écolier; cette encre violette, qui sert à corriger les devoirs.
Tout y était, dans cette lettre: d'abord la répartition des genres entre la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et les cahiers; la Ligue, dont on fait partie; les cahiers, qu'on lit; la Ligue, chargée de préparer les cérémonies des nouveaux cultes; les cahiers, à qui on s'adresse pour demander du travail.
Puis cette idée, cette illusion des pauvres gens que les cahiers sont déjà une importante publication, dont je suis le gérant important, que je suis en relation avec beaucoup d'hommes de lettres, de journalistes, d'éditeurs, de libraires, et qu'en outre les cahiers ont un esprit démocratique; cette confusion presque universelle, et dont vivent les politiciens, entre l'esprit démocratique et l'âme populaire; cette confusion non moins universelle entre la fraternité, la solidarité socialiste et la charité bourgeoise, le travail demandé comme un service.
Enfin et surtout cette illusion suprême des pauvres gens: que l'on peut trouver facilement du travail honnête; qu'il suffit d'être courageux, vaillant au travail, soigneux, pour avoir le droit de vivre en travaillant; que nous pouvons sauver de la misère les gens que nous aimons; que nous pouvons sauver nos amis de la faim; que nous sommes assurés nous-mêmes contre le déficit, contre la misère, contre le dépérissement et contre la mort.
Singulière illusion des pauvres gens, mais dont une cause au moins est évidente. Quand il s'agit d'organiser des cérémonies cultuelles, ou des cérémonies culinaires, enterrements, banquets, ou de bâtir des monuments, nous lisons dans nos journaux que des milliers de francs par jour tombent; les pauvres gens en concluent qu'à plus forte raison ils pourront trouver de quoi vivre en travaillant; ils ne peuvent imaginer que l'argent aille aux représentations, et qu'il manque à l'organisation du travail.
C'est pourtant ce qu'il faut se représenter; le vice bourgeois, d'entretenir le luxe avec ce qui est dû au travail, n'a peut-être jamais sévi avec autant de férocité dans le monde bourgeois que dans un certain monde prétendu socialiste. S'agit-il de commémorations, de fêtes et banquets, de meetings, d'élections, de manifestations politiques, de voyages, de monuments morts, d'exhibitions, de listes publiées, de romantisme et de théâtre, l'argent tombe aux mains des innombrables Puech et des innombrables Barrias. Et non seulement l'argent des nombreux bourgeois égarés dans le mouvement prétendu socialiste et demeurés snobs, mais, hélas, l'argent des véritables petites gens. Car les petites gens n'ont rien de plus pressé que d'imiter les grands de leur monde. Qu'il s'agisse au contraire d'œuvres vivantes et d'hommes vivants, et que l'on demande un dévouement anonyme, je manquerais aux nombreux et solides amis qui travaillent pour nous et qui travaillent pour plusieurs institutions vraiment socialistes si je disais que l'on ne trouve personne et que l'on ne trouve rien; mais tous ceux qui ont essayé de préparer ou d'organiser du véritable travail savent, à considérer l'ensemble du marché, de combien le rendement qui intéresse le travail est inférieur aux flots qui alimentent la représentation. Loin qu'ayant alimenté la représentation les souscripteurs habituels se croient tenus d'autant plus, à plus forte raison, à nourrir le travail, ils arguënt, au contraire, de ce qu'ils ont dépensé en représentations pour ne pas dépenser en travail: Nous sommes épuisés; il faut, vous le savez, contribuer tous les jours; les occasions ne manquent pas.—Nous ne sommes pas les seuls à qui on ait accoutumé de tenir ce langage; tous ceux qui ont voulu organiser du travail sans luxe, ni boniment, sans affectation, sans gloire, sans pose ni publicité, se sont heurtés aux mêmes refus, qu'ils voulussent faire des coopératives ou des écoles, des livres ou du pain, c'est-à-dire, en dernière analyse, quelles que fussent les coopératives de production qu'ils voulussent faire, car nous ne faisons rien jamais qui ne soit, en dernière analyse, de la coopérative de production; et fabriquer des livres n'est pas moins indispensable que de fabriquer du pain; aussi quand les initiateurs, quand les fondateurs, quand les gérants des institutions laborieuses, leurs démarches finies, et mal consommées, rentrent dans leur atelier, dans leur boutique maigre, et dans leur misérable bureau, vienne le même jour une occasion de grande liste, ils ont le même jour l'amère consolation de retrouver, affectés de coefficients variables, mais plutôt considérables, notés de sommes importantes, les noms de ceux qui se trouvaient trop pauvres pour fournir des moyens de travail. Et ce qu'il faut noter parce que c'est un événement considérable moralement, c'est que l'argent des pauvres se refuse aux pauvres presque autant que l'argent des riches; les pauvres qui sortent de l'égoïsme et de la misère, au lieu d'acquérir directement une solidarité de classe, commencent par se donner un orgueil de parti, une affectation de grandeur, un goût bourgeois de la cérémonie et de la représentation.
A ces aberrations des pauvres et des riches nous savons qu'il y a des exceptions nombreuses; nous savons qu'elles sont beaucoup plus nombreuses pour les pauvres que pour les riches; nous sommes ici mieux situés que partout ailleurs pour estimer à leur valeur juste les dévouements anonymes de quelques riches et de pauvres nombreux; nous reviendrons sur cette répartition; mais ce que je veux indiquer dès aujourd'hui, c'est que dans les partis et dans les compagnies républicaines, socialistes, révolutionnaires, anarchistes, laïques, et parmi les individus correspondants, sous les mêmes étiquettes, sous les mêmes aspects, deux genres d'hommes coexistent, et cohabitent: les uns soucieux de travail, et que nous devons nommer les classiques, les autres, préoccupés de représentation, et que je suis bien forcé de nommer les romantiques; ces deux genres d'hommes s'interpénètrent partout; et partout depuis le commencement du mouvement révolutionnaire les classiques sont gouvernés par les romantiques; ceux qui travaillent sont gouvernés par ceux qui représentent; l'introduction du gouvernement parlementaire parmi nous, je ne dis pas avec tous ses abus, mais je dis: de préférence par ses abus, sous ses formes d'abus, n'est qu'une introduction particulière de ce gouvernement général, et sauf de rares et d'honorables exceptions, les travailleurs émancipés pensent à gouverner plutôt qu'ils ne pensent à travailler; les romantiques et les classiques vivent partout ensemble, de bonne amitié, parce que les classiques sont bonne pâte, parce que les romantiques sont imposants, parce que les classiques ne demandent qu'à s'en laisser imposer; tous les romantiques sont gouvernementaux, ministériels, étatistes, quand même ils font profession, par démagogie électorale, d'être antigouvernementaux, antiministériels, antiétatistes; c'est que l'État militaire, totalement incapable d'organiser le travail, est assez capable d'organiser les représentations, les manifestations romantiques. Ces deux genres d'hommes vivent ensemble parce que les classiques, bonnes têtes, ont accepté l'asservissement romantique. En réalité, il y a peut-être plus de différence entre ces deux genres qu'il n'y en a entre les ennemis politiques et sociaux les plus acharnés. Il y a peut-être entre ces deux genres la plus profonde, et la plus grave des séparations contemporaines. Ceux qui aiment le travail sincère et ceux qui aiment les mensonges rituels des cultes romantiques sont peut-être séparés par le plus profond des dissentiments contemporains. Il est permis d'espérer qu'on s'en apercevra quelque jour. Déjà des présages laissent voir que les travailleurs sont las du gouvernement des théâtreux. Et il se peut que cet affranchissement le plus vaste fasse toute l'histoire de la période où nous entrons.
⁂
Cette lettre d'une institutrice était écrite parfaitement. Ceux de nos abonnés qui n'ont jamais manqué de pain ne peuvent imaginer comme il est difficile d'en demander. Demander une circonscription à la tourbe électorale n'est rien: il suffit, sauf de rares et d'honorables exceptions, d'être plat; demander un gouvernement à la tourbe parlementaire n'est rien: il suffit, sauf de rares et d'honorables exceptions, d'être plat; mais demander du pain, même par le moyen du travail, quand on est bien né, sans platitude, sans déclamation, est une opération délicate.
Par hasard, et par intermédiaire, je pus mettre cette famille en relation avec un auteur qui avait à faire faire un travail de copie; mais le plus souvent je n'ai rien; je ne puis procurer du travail aux pauvres gens qui en demandent; je ne puis trouver des leçons pour les camarades qui en ont besoin; je ne puis répondre à leurs lettres, parce que je suis moi-même surmené; j'en ai du remords; et ce remords m'empêche de partager la joie laïque d'État.
⁂
Personnalités. Jean Coste est un personnage. Il n'est pas imaginaire. Il n'est pas littéraire. Il est vrai. On en parle comme de quelqu'un. Nous savons qui c'est. On a commencé par le vouloir ignorer. Mais il s'est fait connaître par sa force propre. Aujourd'hui les députés, les journalistes, les chroniqueurs de l'enseignement, Téry, parlent de lui souvent, comme de quelqu'un de bien connu.
Je n'ai pas reproché à Téry d'avoir étouffé totalement le Jean Coste. Il ne le pouvait pas. Il ne le voulait pas. Je lui ai reproché de n'avoir pas accueilli, soutenu le Jean Coste à l'origine avec toute la justice, avec toute la force que cette œuvre méritait. Je persiste à croire que Jean Coste, sous son nom, valait un article de tête, en première page de la Petite République. La Petite République se sert beaucoup des instituteurs. Elle pouvait lancer le Jean Coste.
⁂
On a dit: Je ne puis m'intéresser à Jean Coste; il est prétentieux, poseur, mièvre.
Nous savons de reste comme il est. Il n'est pas parfait. Il n'est pas un saint. Il est un homme. Il est un instituteur de village. Il est comme il est. Aux vertus que l'on exige des pauvres, combien de critiques et combien d'éditeurs seraient dignes d'être des maîtres d'école?
On veut qu'il soit parfait. On ne voit pas que c'est la marque même de la misère, et son effet le plus redoutable, que cette altération ingrate, mentale et morale; cette altération du caractère, de la volonté, de la lucidité, de l'esprit et de l'âme. Ceux qui font de la philanthropie en chambre, et qui sont, à parler proprement, les cuistres de la philanthropie, peuvent s'imaginer que la misère fait reluire les vertus. On peut se demander alors pourquoi ils combattent la misère. Si elle était pierre ponce, ou tripoli à faire briller les vertus précieuses, il faudrait la développer soigneusement. En réalité la misère altère, oblitère les vertus, qui sont filles de force et filles de santé.
On dit qu'il est faible, et que fort il pourrait s'évader de son bagne. Ceux qui font du moralisme en chambre, c'est-à-dire, à parler proprement, les cuistres de moralité, peuvent s'imaginer que la misère fait un exercice de vertus. C'est la pesanteur et c'est la force inévitable de la misère qu'elle rend les misérables irrémédiablement faibles et qu'ainsi elle empêche invinciblement les misérables de s'évader de leurs misères mêmes. Dans la réalité la misère avarie les vertus, qui sont filles de force et filles de beauté.
La misère ne rend pas seulement les misérables malheureux, ce qui est grave; elle rend les misérables mauvais, laids, faibles, ce qui n'est pas moins grave; un bourgeois peut s'imaginer loyalement et logiquement que la misère est un moyen de culture, un exercice de vertus; nous socialistes nous savons que la misère économique est un empêchement sans faute à l'amélioration morale et mentale, parce qu'elle est un instrument de servitude sans défaut. C'est même pour cela que nous sommes socialistes. Nous le sommes exactement parce que nous savons que tout affranchissement moral et mental est précaire s'il n'est pas accompagné d'un affranchissement économique.
C'est pour cela qu'avant tout nous devons libérer Jean Coste, ainsi que tous les miséreux, des servitudes économiques.
⁂
On confond presque toujours la misère avec la pauvreté; cette confusion vient de ce que la misère et la pauvreté sont voisines; elles sont voisines sans doute, mais situées de part et d'autre d'une limite; et cette limite est justement celle qui départage l'économie au regard de la morale; cette limite économique est celle en deçà de qui la vie économique n'est pas assurée, au delà de qui la vie économique est assurée; cette limite est celle où commence l'assurance de la vie économique; en deçà de cette limite le misérable ou bien a la certitude que sa vie économique n'est pas assurée ou bien n'a aucune certitude qu'elle soit ou ne soit pas assurée, court le risque; le risque cesse à cette limite; au-delà de cette limite le pauvre ou le riche a la certitude que sa vie économique est assurée; la certitude règne au-delà de cette limite; le doute et la contre-certitude se partagent les vies qui demeurent en deçà; tout est misère en deçà, misère du doute ou misère de la certitude misérable; la première zone au-delà est celle de la pauvreté; puis s'étagent les zones successives des richesses.
Beaucoup de problèmes économiques, moraux ou sociaux, politiques même seraient préalablement éclairés si l'on y introduisait, ou plutôt si l'on y reconnaissait comme due la considération de cette limite. Nous y reviendrons si nous le pouvons. Nous examinerons si cette limite existe en fait, si cette limitation vaut en droit, dans quelle mesure, sous quelles conditions.
En fait on s'apercevrait sans doute que cette limite n'existe pas universelle, qu'elle n'est pas fixe, qu'on ne la constate pas dans tous les cas, et que dans les cas où on la constate elle est variable; mais on reconnaîtrait qu'elle se présente dans un très grand nombre de cas, même aujourd'hui; qu'elle a une importance capitale dans les sociétés fortement constituées; qu'elle a une grande importance encore dans une société troublée, comme est la société contemporaine; aujourd'hui même, on reconnaîtrait qu'un très grand nombre de situations sociales sont définies parce qu'elles sont condamnées à demeurer en deçà de cette limite; et un assez grand nombre d'autres sont définies parce qu'elles ont franchi cette limite sans risque de retour; toute une zone sociale est déterminée parce qu'elle est située au delà de cette limite, juste au delà, sans la déborder beaucoup vers l'aisance, mais sans aucun risque de bavure en deçà; ainsi on étudierait cette crise morale et sociale de première importance, qui survient à vingt-sept ans, et par qui l'immense majorité des révolutionnaires deviennent et restent conservateurs, soit qu'ils aillent faire de la conservation dans les partis de la conservation, soit, communément, qu'ils restent faire de la conservation dans les partis prétendus révolutionnaires, par opportunisme ou par surenchère, soit qu'ils pratiquent cette conservation publique et privée, de ne plus faire de l'action après avoir commencé par s'y intéresser; on reconnaîtrait que le souci de certitude, le besoin de sécurité, d'assurance, de tranquillité, est un facteur moral considérable; on distinguerait que ce besoin entre comme un élément respectable dans beaucoup de vocations religieuses; on éprouverait enfin que tant qu'un homme, jeune ou adulte, n'a pas dépassé l'âge de cette crise, on ne peut ni le juger, ni le présumer.
La misère est tout le domaine en deçà de cette limite; la pauvreté commence au delà et finit tôt; ainsi la misère et la pauvreté sont voisines; elles sont plus voisines en quantité, que certaines richesses ne le sont de la pauvreté; si on évalue selon la quantité seule, un riche est beaucoup plus éloigné d'un pauvre qu'un pauvre n'est éloigné d'un miséreux; mais entre la misère et la pauvreté intervient une limite; et le pauvre est séparé du miséreux par un écart de qualité, de nature.
Beaucoup de problèmes restent confus parce qu'on n'a pas reconnu cette intervention; ainsi on attribue à la misère les vertus de la pauvreté, ou au contraire on impute à la pauvreté les déchéances de la misère; comme ailleurs on attribue à l'humilité les vertus de la modestie, ou au contraire on impute à la modestie les abaissements de l'humilité.
Ainsi à l'égard de la consommation la différence du pauvre et du miséreux est une différence de qualité, de mode, comme à l'égard de la production la différence du travailleur et du théâtreux était une différence de nature.
En droit, en devoir, en morale usuelle on reconnaîtrait que le premier devoir social, ou pour parler exactement, le devoir social préalable, préliminaire, celui qui est avant le premier, le devoir indispensable, avant l'accomplissement duquel nous n'avons pas même à discuter, à examiner quelle serait la cité la meilleure, ou la moins mauvaise, car avant l'accomplissement de ce devoir il n'y a pas même de cité, on reconnaîtrait que l'antépremier devoir social est d'arracher les miséreux à la misère, d'arracher les miséreux au domaine de misère, de faire passer à tous les miséreux la limite économique fatale.
Comme il y a entre les situations où gisent les miséreux et la situation où les pauvres vivent une différence de qualité, il y a ainsi entre les devoirs qui intéressent les miséreux et les devoirs qui intéressent les pauvres une différence de qualité; arracher les miséreux à la misère est un devoir antérieur, antécédent; aussi longtemps que les miséreux ne sont pas retirés de la misère, les problèmes de la cité ne se posent pas; retirer de la misère les miséreux, sans aucune exception, constitue le devoir social avant l'accomplissement duquel on ne peut pas même examiner quel est le premier devoir social.
Au contraire, étant donné que tous les miséreux, sans aucune exception, seraient sauvés de la misère, étant donné que toutes les vies économiques, sans aucune exception, seraient assurées dans la cité, la répartition des biens entre les riches différents et les pauvres, la suppression des inégalités économiques, l'équitable répartition de la richesse entre tous les citoyens n'est plus qu'un des nombreux problèmes qui se posent dans la cité instituée enfin. Le problème économique de répartir également, ou équitablement, les biens entre tous les citoyens n'est pas du même ordre que le problème économique de sauver tous les citoyens, sans aucune exception, de la misère; sauver tous les miséreux de la misère est un problème impérieux, antérieur à l'institution véritable de la cité; attribuer à tous les citoyens des parts égales, ou équitables, de richesses est un des nombreux problèmes de la cité instituée; le problème de la misère est un problème incomparable, indiscutable, posé, posé d'avance, dans la réalité, un problème de la cité à bâtir; nous devons le résoudre et nous n'avons pas à discuter si nous devons le résoudre; nous n'avons qu'à discuter comment nous pouvons le résoudre; c'est un problème sans relâche; au contraire le problème de la pauvreté est pour ainsi dire un problème de loisir, un problème de la cité habitée, un problème comparable, discutable, que les citoyens se poseront après, s'ils veulent; avant d'examiner comment ils pourront le résoudre, ils pourront examiner même s'ils doivent se le poser.
Qu'on me permette une comparaison théologique: l'enfer est essentiellement qualifié comme l'effet d'une excommunication divine; le damné est un excommunié de par Dieu; il est mis par Dieu hors de la communion chrétienne; il est privé de la présence de Dieu; il subit l'absence de Dieu; les différentes et innombrables et lamentables peines où se sont excitées les imaginations sont dominées par cette peine d'Absence, qui est la peine capitale, incomparable; d'ailleurs l'enfer est essentiellement modifié comme éternel, c'est-à-dire comme infini dans le temps, ou comme infini dans ce qui serait le temps et qui exclut le temps; à cet égard l'enfer se connaît à ce qu'il n'admet aucune espérance; l'horizon du damné est barré d'une barre infinie; l'enfer est cerclé; aucun espoir absolument ne filtre, aucune lueur.
Au contraire le paradis est essentiellement qualifié comme le maintien de la communication divine; l'élu est élu par Dieu pour demeurer dans la communion chrétienne; il reçoit la présence de Dieu; les nombreuses béatitudes où les imaginations ont assez vainement tâché de s'exercer sont dominées par cette récompense de Présence, qui est la béatitude capitale, incomparable; d'ailleurs le paradis est essentiellement modifié comme éternel; donc il ne supporte aucun risque; l'horizon de l'élu est ouvert d'une ouverture infinie; aucun désespoir absolument, aucune hésitation ne filtre.
Cela étant, le purgatoire a beau ressembler à l'enfer en ce qu'il est un lieu de peine et d'expiation, en ce qu'il comporte la même Absence; il a beau avoir la même qualité; il suffit que le mode n'en soit pas éternel, et que l'espérance non seulement passe mais soit assurée pour que tout soit autre; au jugement dernier quand Jésus viendra dans sa gloire il viendra aussi pour délivrer, pour chercher les dernières âmes du Purgatoire; la Présence commencera dès lors, pour l'éternité; cette ouverture suffit pour que le purgatoire devienne, à cet égard, totalement étranger à l'enfer; il suffit qu'une lueur de certitude éclaire; deux séjours de peines, l'enfer et le purgatoire, peuvent sembler analogues ou de même ordre à une observation superficielle, parce qu'ils sont deux séjours de peines, et de peines analogues; mais il suffit que dans ces peines analogues une certitude de vie ait pénétré en purgatoire et qu'une certitude de mort domine en enfer pour que le purgatoire et l'enfer ne soient pas du même ordre; l'enfer est hors de la communion; le purgatoire est dans la communion; l'Église souffrante, après l'Église militante, avant l'Église triomphante, est de la communion; le purgatoire est de la vie; l'enfer est de la mort.
L'enfer est de la mort éternelle. Or quand nous parlons de l'enfer social ou de l'enfer économique les hommes de littérature, les hommes de gouvernement, les députés, les journalistes, les perpétuels candidats peuvent croire sincèrement, autant qu'ils peuvent être sincères, que nous employons avec eux une métaphore théâtrale, romantique, outrée, commode, inexacte, électorale pour tout dire; c'est ainsi en effet qu'insoucieux ou ignorants de la réalité ils emploient la même expression; ils disent un enfer social comme ils disent du concurrent qu'il est un immonde apostat: ces mots n'ont pas de conséquence; mais ce ne serait pas la première fois qu'une expression profondément populaire serait détournée par les politiciens de son sens profond et plein, utilisée d'une utilisation fade et vide; ici encore le langage exact, le sens profond appartient au peuple et aux écrivains, par dessus la tête creuse de la plupart des parlementaires de langue et des parlementaires de plume; quand un candidat parle de l'enfer social, économique, il veut dire une situation où l'on ne se trouve pas bien; quand le peuple dit que la vie est un enfer, il garde au mot son sens exact, premier.
Quand avec le peuple ou, vraiment, dans le peuple, nous parlons d'enfer, nous entendons exactement que la misère est en économie comme est l'enfer en théologie; le purgatoire ne correspond qu'à certains éléments de la pauvreté; mais la misère correspond pleinement à l'enfer; l'enfer est l'éternelle certitude de la mort éternelle; mais la misère est pour la plus grande part la totale certitude de la mort humaine, la totale pénétration de ce qui reste de vie par la mort; et quand il y a incertitude, cette incertitude est presque aussi douloureuse que la certitude fatale.
On objecterait en vain que notre comparaison n'est pas fondée, sur ce que les peines infernales sont inépuisablement atroces; d'abord elles ne sont pas toutes extrêmes; l'attention, comme on pouvait le prévoir, s'est portée presque toute sur celles qui étaient extrêmes, autant l'attention des poètes que l'attention populaire, mais il n'est dit nulle part qu'elles soient extrêmes toutes, ni qu'il y en ait beaucoup d'extrêmes; puis on ne ferait que de constater que notre comparaison est une comparaison; mais on n'établirait pas qu'elle est mal fondée; on oublie cette première loi de la psychologie, que les malheurs sont pour nous ce que nous les sentons; les souffrances nous sont comme nous les éprouvons; la capacité de souffrance étant demeurée au moins la même sans doute, la souffrance humaine exerce un dommage non moins grand que ne pouvait exercer l'idée de la souffrance éternelle; d'autant que cette idée même était une idée, une image, une représentation humaine. On s'est flatté trop vite qu'en supprimant les dieux et les sanctions des dieux on supprimait les souffrances les plus grandes; premièrement on supprimait aussi, au moins dans le même sens, les consolations les plus grandes; et peut-être la nature humaine est-elle ainsi faite qu'au lieu que ce soient les causes réelles extérieures qui mesurent la souffrance éprouvée, c'est au contraire la capacité réelle intérieure qui mesure le retentissement des causes; il se peut que la menace ou même l'assurance d'un disloquement éternel introduisît moins de souffrance réelle dans l'âme d'un reître que n'en apporterait aujourd'hui dans une âme sentimentale ou douce le plus commun des malheurs sentimentaux. Notre première conclusion sera donc que la simple misère humaine a une suprême importance. La damnation a une suprême importance pour les catholiques. La misère sociale a une suprême importance pour nous.
On objecterait en vain que notre comparaison n'est pas fondée, sur ce que les peines infernales sont éternelles, infinies dans le temps ou dans ce qui serait le temps; on oublierait cette première loi de la psychologie, que les souffrances nous sont grandes autant que nous les éprouvons; la capacité de souffrance étant donnée, la vie humaine subit un dommage non moins grand que ne subirait une éternité, puisque cette éternité, pour nous au moins, ne serait jamais que représentée. On nous dit: Les misérables qui croyaient à l'enfer croyaient à une éternité de souffrance; ils en avaient donc une souffrance infinie, totale, barrant toute la vie, où aucune lueur ne passait; au contraire le plus misérable des non-croyants a parmi nous au moins cette consolation qu'il sait que la mort ferme tout, y compris la misère.—C'est interpréter mal un phénomène assez simple. C'est apporter du dehors à ce phénomène sentimental une interprétation comme en fournissent les intellectuels qui ont commencé par ne pas se placer dans la situation requise. L'observateur extrinsèque tient le raisonnement suivant, qu'il n'avoue pas: étant donné un homme qui souffre d'une souffrance humaine et, en outre, d'une souffrance infinie, si nous commençons par le débarrasser de la deuxième, ce sera autant de gagné, autant d'acquis, et même on l'aura débarrassé de la souffrance la plus grave à beaucoup près, d'autant que la peur de l'enfer, souffrance infinie, est plus grave que la simple souffrance humaine, souffrance finie.—Ce raisonnement d'aspect mathématique est incomplet, grossier; il néglige la réaction presque automatique des sentiments. Il traite la conscience et l'inconscient des sentiments comme un vase inerte, qui ne se réveillerait pas, qui ne réagirait pas; il introduit à faux le mathématique, l'arithmétique, dans le vivant; il ne se vérifie, et mal, que dans les premiers temps de la libération; quand un homme, quand un peuple, quand une génération se libère d'un effroi religieux, d'une crainte religieuse, au moment de l'affranchissement il se produit un vide sentimental, une aération; il en résulte une respiration, une impression d'aise et de bonheur. «Celui que ni le renom des dieux, ni les foudres, ni les menaces du fracas céleste n'ont bloqué.» Mais cette impression ne dure pas; la place laissée vide est occupée bientôt; les sentiments humains que les sentiments religieux comprimaient se donnent ou se redonnent du volume; la souffrance humaine se détend, se dilate, occupe l'emplacement précédemment occupé par la crainte et la peur et la souffrance religieuse. Et la souffrance humaine emplit souvent cet emplacement. Car la souffrance religieuse pouvait avoir un objet infini, éternel, surhumain: elle n'en était pas moins une souffrance humaine, limitée dans le sujet, finie, limitée au sujet.
Quand une libération religieuse est accomplie, l'humanité respire, comme après un travail fait; c'est un déménagement de fait; cette impression ne dure pas longtemps; c'est pour cela qu'il y a tant de jeunesse, tant d'ivresse, mais aussi tant de naïveté, quelquefois de la cruauté dans les générations qui s'affranchissent, tant de tristesse, mais aussi plus de sérieux et souvent de profondeur, et de la bonté dans les générations qui leur sont immédiatement consécutives; on reconnaît alors qu'il n'y a rien de fait, aussi longtemps que tout n'est pas fait; à cet égard au moins; que nous devons renoncer aux religions parce qu'elles ne sont pas fondées rationnellement, parce qu'elles ne sont pas vraies, non pour nous donner de la place dans nos sentiments.
C'est pour cela que les radicaux ne sont pas des hommes de notre génération; loin d'être en avance, comme on le dit, sur la situation intellectuelle de l'humanité présente, ils sont en retard d'une génération; ils sont, littéralement, des rétroactionnaires, c'est-à-dire, en un sens, déjà des réactionnaires; ils ont, quand ils tapent sur le curé, une joie naïve, sincère ou feinte, qu'un nomme averti de notre génération, soucieux des immenses problèmes renaissants, ne peut plus avoir.
[Aujourd'hui même je lis dans la revue blanche du premier novembre ce paragraphe de M. Michel Arnauld, critiquant le livre de M. Barrès; Scènes et Doctrines du Nationalisme. C'est le paragraphe de conclusion du critique:
«Ce n'est pas sur cette impression que je veux finir, mais en citant un beau passage d'une lettre que le très libéral Ernest Havet écrivit, le 23 août 1880, au très catholique Barbey d'Aurevilly...: «Je ne veux pas que vous me soupçonniez de la sottise de vous réduire a ce qu'on appelle le style. Le style et la pensée, c'est tout un; c'est donc bien dans la pensée qu'est votre force. Mais la pensée n'est pas la même chose que la thèse; sans quoi, étant donnés par exemple Bossuet et Voltaire, l'un des deux ne serait nécessairement qu'un imbécile. Une thèse erronée peut être une occasion de penser très fortement et de répandre des vérités à pleines mains; et c'est précisément ce que vous faites et ce qu'ont fait aussi vos grands hommes. Comme eux, à mon avis, vous êtes à la fois puissant et impressionnant. Vous ne viendrez pas à bout de nous faire monarchiques et catholiques, mais vous réussissez supérieurement à nous faire sentir que, quand on a dit qu'on ne l'est plus, tout n'est pas dit et qu'on n'a pas trouvé pour cela la solution de tous les problèmes ni le remède à tous les maux.» Non, tout n'est pas dit, quand on a dit qu'on n'est pas nationaliste; et même sans Barrès, nous nous en doutions un peu.»
Je lis du même dans le même ce dernier paragraphe à la critique de: Marius-Ary Leblond, les Vies parallèles:
« Dans leur lettre liminaire à M. Léon Bourgeois, MM. Leblond prennent non sans fougue la défense du néologisme. Ils n'avaient pas besoin de se justifier et je n'ai, dans leur livre, relevé nul excès de mots nouveaux. Mais leur thèse appelle des objections, qui ne sont pas spéciales aux seuls «puristes». Sans même rappeler que notre langue se révèle plus riche à mesure qu'on en use davantage, il faut avouer que le néologisme détourne de l'analyse, et ne favorise que des synthèses un peu grosses. Donner un nom spécial à chaque sentiment, dispense de le distinguer par des nuances fines et sans cesse changeantes. Il ne vit plus, le voilà classé, épingle, empaillé pour toujours. La science a besoin de néologismes; c'est qu'à chacun de ses progrès elle pose une loi, un rapport fixe, que dès lors elle a le droit de désigner, sans le définir. En art,—surtout quand il s'agit de décrire des sentiments,—la sobriété du vocabulaire et la souplesse de la syntaxe laissent mieux voir le retour des mêmes éléments simples sous des formes variées. C'est d'ailleurs question de mesure, qu'on ne peut trancher d'un mot.»
Tout le monde regrettera que l'auteur de ces deux paragraphes ne forme pas le ferme propos d'œuvrer lui-même; ces deux paragraphes ont une importance capitale, chacun pour ce qu'il veut être; la lecture du premier serait de la plus grande importance pour M. François Daveillans, de la revue blanche; la lecture du deuxième serait d'une grande utilité pour M. François Simiand, et pour un assez grand nombre de sociologues; il y a dans ce bref paragraphe, indiquées seulement, les distinctions les plus utiles, et aussi les plus fondées, entre la science et l'art social. Quand un homme jeune en vient à mettre sur pied, presque en passant, deux paragraphes aussi fermes, quand il est aussi maître de sa forme et de sa pensée, il ne suffit plus qu'il parle à propos des livres qui paraissent, et qui souvent ne valent pas la critique. Il est temps que lui-même il fasse œuvre, et nous donne un cahier.]
⁂
Tant qu'il y a de la misère, la misère prend et tient la place de la misère.
C'est un fait d'expérience que pour les individus et pour les peuples libérés la simple souffrance humaine atteint souvent à la même gravité qu'atteignait la souffrance religieuse, comme le courage humain atteint où atteignait le courage religieux, comme la dignité humaine atteint où atteignait la dignité religieuse. L'analyse permettait de prévoir les résultats de l'expérience: l'homme étant demeuré sans doute le même, sa capacité de souffrance étant sans doute à peu près la même, le misérable reçoit dans sa misère la même impression totale de désespoir; le misérable ne reçoit pas de sa misère la même impression partielle que le non misérable qui voit la misère du misérable; le misérable ne voit pas le monde comme le voit le sociologue; le misérable est dans sa misère; le regard perpétuel qu'il jette sur sa misère, lui-même est un regard misérable; la misère n'est pas une partie de sa vie, une partie de ses préoccupations, qu'il examine à tour de rôle, et sans préjudice du reste; la misère est toute sa vie; c'est une servitude sans exception; ce n'est pas seulement le cortège connu des privations, des maladies, des laideurs, des désespoirs, des ingratitudes et des morts; c'est une mort vivante; c'est le perpétuel supplice d'Antigone; c'est l'universelle pénétration de la mort dans la vie, c'est un arrière-goût de mort mêlé à toute vie; la mort était pour le sage antique la dernière libération, un affranchissement indéfaisable. Mais pour le misérable elle n'est que la consommation de l'amertume et de la défaite, la consommation du désespoir. Si Jean Coste acculé se tue un jour avec sa femme et ses enfants, son dernier jour sera son plus terrible jour. Dies irae, jour de colère.
Pour que la mort soit une libération que l'on goûte, il faut toute une civilisation, toute une culture, toute une philosophie, tout ce que la misère, justement, interdit.
Le misérable est dans sa misère, au centre de sa misère; il ne voit que misérablement; justement parce qu'il ne croit pas à la vie éternelle, à une survie infinie, le misérable que nous connaissons, le misérable comme l'a fait l'élimination de la croyance religieuse n'a plus qu'un seul compartiment de vie et tout ce compartiment lui est occupé désormais par la misère; il n'a plus qu'un seul domaine; et tout ce domaine est irrévocablement pour lui le domaine de la misère; son domaine est un préau de prisonnier; où qu'il regarde, il ne voit que la misère; et puisque la misère ne peut évidemment recevoir une limitation que d'un espoir au moins, puisque tout espoir lui est interdit, sa misère ne reçoit aucune limitation; littéralement elle est infinie; point n'est besoin que la cause ou l'objet en soit infini pour qu'elle soit infinie; une cause, un objet qui n'est pas infini pour la science extérieure, pour la physique, peut déterminer dans une âme un sentiment infini si ce sentiment emplit toute l'âme; non pas en ce sens qu'il exterminerait de l'âme tout autre sentiment, conscient, subconscient, inconscient, mais en ce sens qu'il affecte sans exception, qu'il nuance et qualifie toute la vie sentimentale, intellectuelle, toute la vie de l'âme et de l'esprit; peu importe quels événements se produisent à l'intérieur de la misère; il suffit qu'ils soient à l'intérieur de la misère pour être misérables; quand un homme est comme Jean Coste en pleine misère, dans l'enfer de la misère, le dernier événement qui l'achève peut être un événement extrinsèquement peu considérable, un événement à qui résisterait aisément quelqu'un qui ne serait pas misérable; mais pour celui qui le subit dans la misère, c'est-à-dire pour celui qui importe, en définitive, cet événement soi-disant peu considérable est un événement capital, un événement de conséquence infinie. Notre deuxième conclusion sera que la simple misère humaine a une importance infinie. La damnation a une importance infinie pour les catholiques. La misère sociale a une importance infinie pour nous.